L’Arcom vient de mettre en ligne sa recommandation aux services audiovisuels et numériques afin qu’ils puissent « mieux informer les consommateurs sur l’impact environnemental de la consommation de contenus audiovisuels ». Le régulateur souhaite aussi « leur donner accès à des solutions ». Les idées ne sont pas nouvelles, mais un rappel est toujours bon à prendre.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre l’article 26 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 (REEN). Comme le rappelle l’Arcom (qui travaille conjointement avec l’Arcep et l’Ademe sur ce sujet), cet article 26 lui demande de publier une recommandation sur « l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos […] en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l'utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d'accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage ».
Le numérique, c’est 2,5 % de l’empreinte carbone des Français…
Une consultation publique a ainsi été lancée fin 2022 afin de recueillir des retours des acteurs du secteur. La recommandation est désormais disponible et publiée au Journal officiel. Elle incite les plateformes et les services à « informer les consommateurs de l’impact environnemental », en particulier sur la consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre. Des leviers d’action sont également précisés afin que les consommateurs de contenus puissent devenir acteurs de leur consommation énergétique… dans une certaine mesure évidemment.
Commençons par planter le décor de la consommation du numérique en France. Selon une étude Arcep/Ademe, « le numérique représentait en 2020 près de 2,5 % de l’empreinte carbone des Français, soit 17,2 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2éq) ». Sauf grosse surprise, la consommation devrait largement grossir au fil des années puisque le numérique occupe une place toujours plus importante dans nos vies. Elle pourrait ainsi passer à 25 MtCO2éq en 2025 (+45 %) et 49 Mt CO2éq en 2050 (x3 par rapport à 2020), selon les estimations de l’Arcep et de l’Ademe.
… avec une forte disparité (fabrication/utilisation)
Autre point important à prendre en compte : la forte disparité entre fabrication et utilisation des équipements. Nous avons déjà abordé le sujet à plusieurs reprises, mais pour résumer : « la fabrication des équipements (terminaux, centres de données, infrastructures réseaux), concentre 78 % de l’empreinte carbone du numérique. La phase d’utilisation de ces équipements représente quant à elle 21 % des émissions carbone et tendrait à s’accroître ».
- Empreinte environnementale du numérique : entre certitudes, inconnues et recommandations
- Le deuxième rapport de l'Arcep sur le numérique soutenable pointe plusieurs progressions
Si au lieu de prendre le cycle de vie pour mesurer l’empreinte carbone, on prend les composantes du numérique, on arrive toujours à une répartition déséquilibrée : 79 % de l’empreinte carbone vient des équipements pour le grand public (télévision, smartphones…), 16 % des datacenters et seulement 5 % des réseaux fixes et mobiles.
L’œuf et la poule
Pourquoi, dans ces conditions, se focaliser sur une seule partie du problème ? Pour l’Arcom, la problématique doit être traitée de manière globale (il ne faut laisser aucun aspect de côté), car l’ensemble de l’écosystème est interdépendant et s’auto-alimente. En effet, il ne faut pas oublier que l’utilisation des services numériques a « un effet direct sur le renouvellement et la commercialisation de nouveaux équipements, la quantité de données consommées ou le dimensionnement des réseaux », qui a leur tour ouvrent de nouveaux usages. La boucle est bouclée.
Quoi qu’il en soit, la vidéo – sans surprise – occupe une place très importante dans le volume des échanges : « Les flux vidéo représentaient en effet 66 % du trafic internet mondial en 2022 selon Sandvine (janvier 2023) », indique l’Arcom dans son rapport. En France, environ 54 % du trafic envoyé vers les clients des principaux FAI en France provient de cinq acteurs : Netflix (à près de 20 %), Google, Akamai, Meta et Amazon.
Donner au public des informations « accessibles et pédagogiques »
La première recommandation est de mettre à disposition du public des « informations générales, accessibles et pédagogiques, relatives à l’impact environnemental de la consommation de contenus audiovisuels ». L’Arcom ressert l’étau et apporte des précisions sur ce qui est attendu.
Tout d’abord, et comme nous venons de le rappeler, différents acteurs participent à cet impact environnemental : fabricants de terminaux, réseaux, datacenters, services audiovisuels, « mais aussi les utilisateurs de ces services et plateformes, au travers de leurs usages ».
Dans le cas du multimédia, « l’intensité de cet impact est fonction de divers facteurs, en particulier les choix en matière de qualité d’image, les modalités techniques d’accès et la combinaison des deux ». En effet, « l’impact dépend aussi du type de terminal (notamment de la taille de l’écran), de la fréquence de renouvellement du terminal de réception et du choix du réseau de diffusion ».
S’acheter un nouveau smartphone pour regarder une vidéo en 4k via le réseau mobile n’a pas du tout la même empreinte qu’une vidéo 720p ou 1080p en Wi-Fi à la maison, sur son téléphone actuel. On tire évidemment le trait, mais même sur un smartphone récent, a-t-on vraiment besoin de la qualité maximum ? On se doute bien que la quantité de données est plus importante en 4k. Pour rappel, les réseaux mobiles consomment davantage que les lignes xDSL, qui consomment plus que la fibre.
- L'Arcep revient sur l'empreinte carbone du numérique et sa consommation électrique
- L’extinction des réseaux 2G-3G diminuera l’empreinte carbone des réseaux mobiles dès la première année
Toujours dans les informations données aux clients, la recommandation de l’Arcom souhaite préciser les actions mises en œuvre par les plateformes pour réduire leur impact environnemental. Les possibilités sont nombreuses : codecs plus efficaces, serveurs de cache, engagements sur la publicité, développement d’infrastructures durables, etc. Il est aussi question des « leviers à disposition des utilisateurs de préférence sous la forme d’une fonctionnalité "sobriété énergétique", la proposition par défaut sur le service ou la plateforme d’une qualité d’image sobre énergétiquement, etc. ».
L’Arcom joue aussi la carte de la pédagogie et explique aux utilisateurs comment réduire leur impact. Plusieurs pistes là encore : éteindre terminaux et équipements quand ils ne sont pas utilisés et privilégier le réseau fixe quand c’est possible, y compris le Wi-Fi (sauf à être derrière une 4G/5G box) pour les raisons évoquées précédemment.
Bientôt une campagne de communication commune ?
Le rapport veut mettre en place « la diffusion d’une campagne de communication commune »… dont on a du mal à imaginer comment elle pourrait rentrer dans tous les détails tant les différences sont importantes entre les services, les réseaux, les terminaux. L’idée peut être intéressante, mais on attend de voir ce qui pourrait en ressortir tant les orientations sont parfois différentes entre les FAI, les services de streaming, les publicitaires, etc.
Il faut davantage voir cette campagne publicitaire comme une piqûre de rappel, qui aura lieu de manière régulière. Les informations relatives à des consommations plus sobres devront aussi être rendues accessibles au client, par exemple dans une rubrique dédiée ou via un message d’information.
L’Arcom rappelle à juste titre que ces informations doivent être actualisées et provenir « de sources fiables et reconnues au niveau national ou international ».
Un mode « sobriété énergétique »
Informer c’est bien, agir c’est mieux. L’Arcom souhaite donner des clés aux utilisateurs pour adopter facilement des usages plus respectueux de l’environnement. Un chapitre est ainsi consacré à « l’accès aux réglages des paramètres de qualité de l’image et la recommandation au public de paramètres d’utilisation sobres en énergie, en privilégiant si possible la mise à disposition simple d’une fonction de type « sobriété énergétique ».
Dans le cas des services multimédia, cela pourrait concerner la qualité de l’image et la désactivation de la lecture automatique de vidéos… On rêve que ce soit le cas dans toutes les publicités ! Évidemment, cet ajustement devra tenir compte des conditions d’utilisation (taille de l’écran, réseau utilisé, etc). Il faut trouver le juste milieu entre sobriété d’un côté, simplicité et qualité pour l’utilisateur de l’autre afin de ne pas le perdre en cours de route. Si la manipulation est trop compliquée ou la différence de qualité trop visible, l’utilisateur n’adhérera surement pas.
L’Arcom semble d’ailleurs consciente de cette problématique et veut simplifier au maximum la démarche : « Les services privilégient, si cela s’avère techniquement possible, la mise à disposition d’une fonctionnalité de type « sobriété énergétique », aisément accessible (le chemin depuis l’écran d’accueil nécessite un nombre d’actions limité, par exemple en un ou deux « clics ») et permettant d’appliquer automatiquement l’ensemble des réglages les plus respectueux de l’environnement ». On retrouve déjà des fonctionnalités du genre dans la mobilité.
Actuellement, sur les plateformes de streaming, ce genre d’information est quasiment inexistant. Des applications comme Disney+, Netflix et Prime Video permettent certes de limiter les téléchargements de vidéos aux réseaux Wi-Fi et d’ajuster la qualité, mais ne précisent que l’influence que cela aura sur la quantité de stockage utilisée et/ou le nombre d’heures de vidéo que vous pouvez enregistrer. L’empreinte écologique n’est bien trop souvent même pas évoquée.
Une exception tout de même : MyCanal. Que ce soit pour la qualité des images ou des vidéos, l’application précise que « le choix d’une qualité adaptée contribue à réduire l’empreinte carbone », avec un petit pictogramme vert pour attirer l’œil. L’information mériterait d’être mieux mise en avant et surtout plus détaillé pour celui qui voudrait en savoir plus. On est encore loin d’un bouton unique accessible en deux clics, mais cette information a le mérite d’exister.
Le rêve d’une méthodologie commune et comparable
Ce sera une autre paire de manche, mais la recommandation de l’Arcom souhaite « la mise en place d’une méthodologie commune de calcul de l’impact environnemental des usages audiovisuels ». Prévoyant déjà les difficultés à venir, Arcom, Arcep et Ademe pourront être associés aux réunions, précise le rapport.
Cet indicateur devra se baser sur « un référentiel catégoriel réalisé selon les principes généraux pour l’affichage environnemental des produits et services développés par l’ADEME et la Commission européenne. La mise en œuvre d’un tel référentiel nécessite en particulier la fourniture par les acteurs concernés de données d’Inventaire de Cycle de Vie (ICV) ».
Trois formats d’affichage sont prévus en fonction du type de service : services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), chaîne de télévision ou plateforme de partage de vidéos.
Pour l’Arcom, ce travail pourrait s’inspirer de l’information aux clients des FAI sur leur empreinte carbone. Problème, la méthodologie était largement discutable et critiquée par de nombreux spécialistes du secteur. Pas sûr que ce soit le meilleur exemple à mettre en avant…
Un retour des actions mises en place, un bilan dans deux ans
Enfin, l’Arcom va regarder si cette recommandation est suivie de faits de la part des acteurs. Elle demande ainsi que, chaque année, les plateformes et les services concernés lui précise les actions qui ont été mises en place :
« Cette information, qui est communiquée au plus tard le 31 mars pour l’exercice précédent, est étayée par des indicateurs chiffrés visant à rendre compte de l’efficacité des mesures mises en place (par exemple, visibilité de l’information pour l’utilisateur, actualisations régulières de ces informations, comportements plus sobres observés chez les utilisateurs en particulier) et fait état le cas échéant des améliorations envisagées pour les années suivantes afin de renforcer l’efficacité de ces mesures ».
Un bilan est prévu dans deux ans… espérons qu’il sera rendu public, idéalement avec le détail des actions par service… Nommer les bons élèves pourrait aider à faire bouger les choses, car les entreprises pourraient alors y voir un intérêt économique et un moyen de communiquer auprès de leurs clients… d’autant que l’Arcom n’émet ici que des recommandations, pas d’obligations.







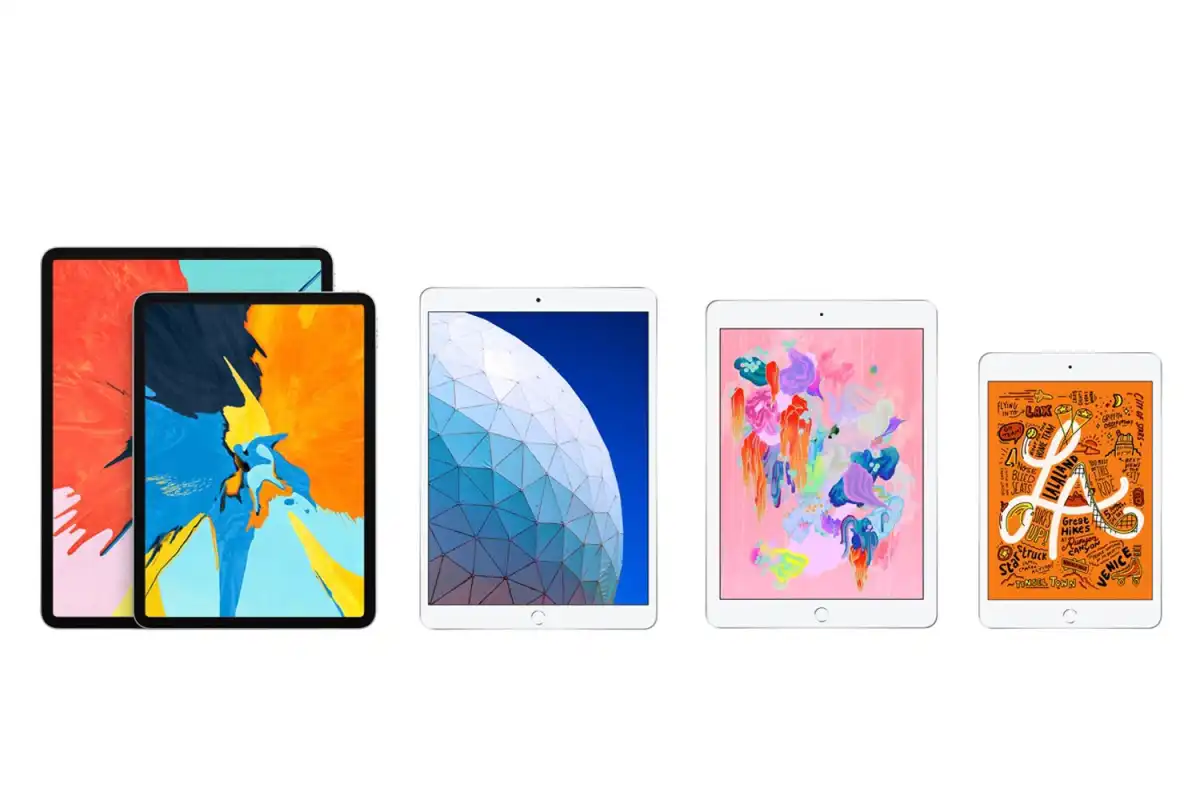
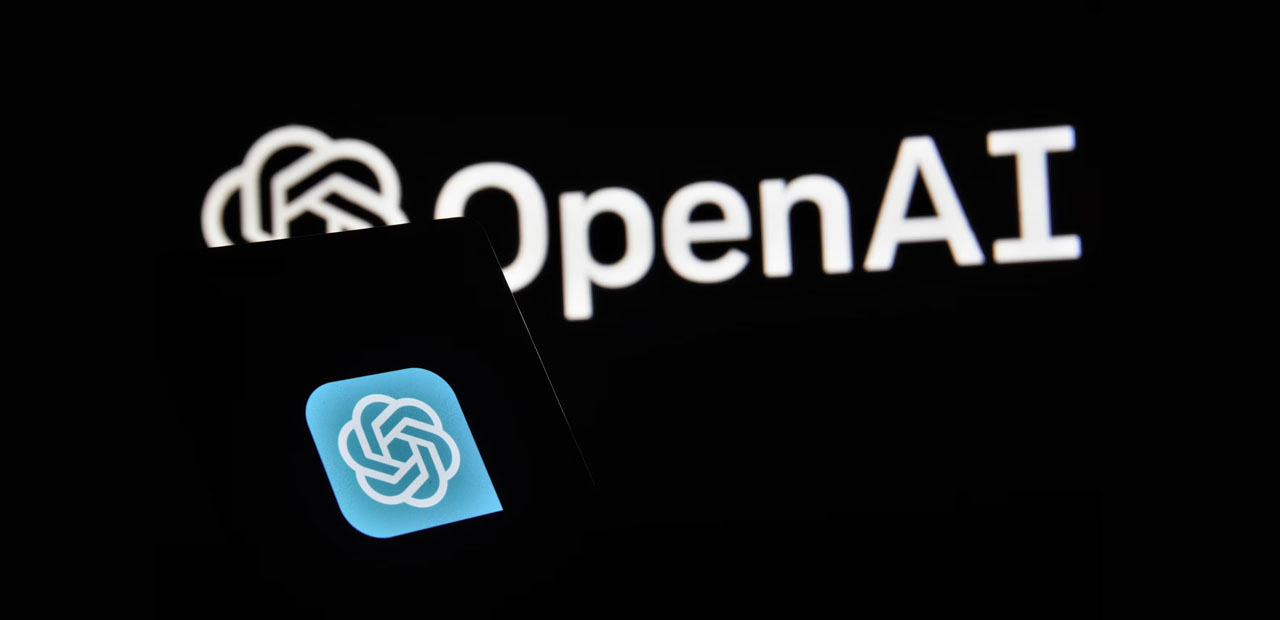
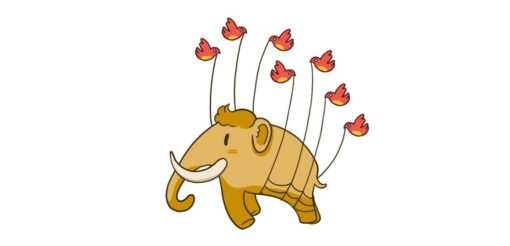



Commentaires (13)
#1
Concernant la sobriété des plateforme de streaming, une option existe sur la plateforme de replay/streaming de France.tv. Dans les options une petite feuille pour un equilibre entre conso et qualité
#1.1
J’avais testé cette option, je trouve que ça pique un peu sur les plans larges d’une retransmission sportive mais sur du film ça passe, disons qu’il faut tolérer les artefacts de compression accentués sur les zones très sombres.
Le téléchargement au lieu du streaming peut éventuellement faire la différence sur du contenu lourd.
#2
Si les plateformes de streaming voulaient réduire leur empreinte carbone, il faudrait qu’elles laissent les médias être mis en cache au plus prêt des utilisateurs finaux. Le contenu serait tout de même chiffré, elles délivreraient “juste” la clé.
Mais cela empêcherait diverses protections du contenu, DRM et Watermarking. Et les FAI pourraient observer le traffic…
Donc, je trouve que le problème de consommation non optimale vient des plateformes ou des propriétaires des oeuvres. Et venir nous demander de réduire la qualité revient à prendre le problème à l’envers.
#2.1
C’est le cas pour Netflix qui propose aux FAI d’installer gratuitement des serveurs de cache dans leur réseau pour distribuer le contenu au plus proche des abonnés. Bizarrement, il n’y en a pas beaucoup en France, on se demande pourquoi.
Netflix a annoncé en 2022 passer à 800 gbps pour un serveur de cache.
Sachant qu’en moyenne, un abonné va utiliser 15 mbps pour faire du streaming (je ne retrouve plus la source mais j’avais lu 12 mbps il y a quelques années donc je prends 15 pour avoir un peu de marge). Cela veut dire qu’un serveur de cache peut fournir du contenu à plus de 50 000 abonnés. En considérant qu’un tel serveur consomme en 1h 1000 Wh (ce qui serait beaucoup pour un serveur de cache), un utilisateur consommerait donc un peu moins de 0,02Wh pour une heure de streaming).
Concrètement, la consommation est donc du côté de l’utilisateur (un pc portable va consommer environ 50W, une télé peut monter à plus de 100W) que du côté du réseau (la fibre, c’est quelques W en moyenne) et du datacenter.
Mais ce n’est pas réduire la qualité qui diminuera la consommation effectivement, puisque cela réduirait la charge côté réseau qui est déjà plutôt faible et un écran consomme toujours à peu près la même chose quelque soit la qualité du média affiché.
Le vrai sujet, et on le voit sur les documents de l’ARCEP et l’ARCOM, c’est le remplacement des terminaux. Il faut donc pousser pour qu’on puisse les conserver plus longtemps (je pense par exemple aux smartphones ou aux ultraportables où c’est complexe de les réparer aujourd’hui par exemple).
#2.2
Un écran OLED de 83 pouces ne précise pas sa conso dans son manuel.
J’ai donc trouvé cela bizarre.
Tu m’étonnes, ça monte à 1000 W sur une image dynamique
Mais que c’est beau (et grand)
Donc en fait, il faut :
C’est beau le progrès.
Genre on va payer Netflix pour de la 4K et consommé en 720p
#2.4
OK le réseau consomme peu.
Merci
#2.3
Ce qu’indique l’étude, c’est que la partie réseau a un impact faible et que ce qui compte finalement, c’est ce qui est côté utilisateur : consommation électrique du terminal et fréquence de renouvellement du matériel et type de connectivité réseau.
Sinon, je n’ai pas compris pourquoi la 4K consomme plus que le 720p.
#2.5
Netflix mets déjà en cache du contenu chez les opérateurs
#3
En quoi la capacité de stockage/enregistrement est un facteur d’empreinte écologique ?
Les secteurs non-utilisés sur mon SDD sont plus “vert” que ceux alloués ?
Je peux comprendre un facteur lié à la quantité de données transférés. Mais données stockées ?
#4
A noter que par défaut, androidTV et toutes les applications associées (sauf mycanal mais il faut le faire pour chaque session de streaming), utilise la résolution maximum de la TV.
A titre personnel je préfère avoir un film en très bon 720p qu’en médiocre 4K, mais le seul moyen de forcer le 720p est de changer les paramètres d’affichage dans android manuellement.
#5
Pour en avoir fait l’expérience cet été, je peux confirmer. 4k + canicule -> surchauffe du PC qui s’est mis en sécurité. Première fois que ça arrive, jamais arrivé avec du full hd dans les mêmes conditions. Et si ça chauffe plus, c’est que ça consomme plus.
Pour faire simple : plus de données brutes, donc plus de travail pour le cpu, donc il consomme plus.
#6
Continuons de nous donner bonne conscience en regardant les vidéos en basse résolution pour économiser deux grammes de co2 pendant que la majorité des entreprises du tertiaire avec leur mentalité boomer impose toujours aux collaborateurs de se taper 30+ minutes de bagnole tous les jours pour aller au bureau devant un ordinateur et faire de la réunionite où on va entre autres “sensibiliser” au fait d’envoyer moins d’emails pour sauver la planète.
Pas étonnant que les ados soient dépressifs et anxieux face au futur, quand ils voient comment leurs aînés prennent la situation au sérieux.
#7
Ah, mince… J’ai cru qu’ils parlaient du Paris-Dakar