Il y a désormais environ 2,2 millions d'abonnés fibre en France, en majorité chez l'opérateur historique. Une performance qui cache de fortes disparités sur le territoire, les plus grandes villes étant bien favorisées face aux campagnes. L'Arcep détaille désormais ses chiffres par zone, relevant le peu de choix de FAI sur les réseaux publics.
Le très haut débit poursuit son avancée, alors que l'ADSL perd des clients de trimestre en trimestre. L'Arcep a publié son observatoire des marchés fixes, pour le quatrième trimestre 2016. Si les tendances restent, des paliers ont été franchis en matière de très haut débit, notamment de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH). Le régulateur complète aussi son document, avec (enfin) un détail des déploiements en fibre par zone. Une granularité qui confirme, s'il en était besoin, la domination d'Orange en termes d'abonnements et de réseau.
Fin 2016, la France compte ainsi 27,7 millions d'abonnements Internet fixe, dont 5,4 millions en très haut débit (20 %). Sans surprise, le haut débit (dont l'ADSL) continue sa chute, avec 130 000 lignes de moins sur trois mois et 380 000 de moins sur un an. « La baisse provient entièrement de celle du nombre d'abonnements DSL dont le débit est inférieur à 30 Mbit/s, qui s'élève à 21,7 millions » détaille l'autorité. Elle rappelle que les autres réseaux haut débit (sous les 30 Mb/s), soit le câble, le satellite et les technologies radio, ont gagné 5 % d'abonnés en un an (535 000).
Si le très haut débit grignote de plus en plus de terrain sur le haut débit, la situation est loin d'être parfaite. Un opérateur domine largement la concurrence (voir notre analyse), quand les plus grandes villes disposent d'un choix dont les campagnes semblent cruellement manquer.
La fibre a toujours un goût d'agrume
En face, le très haut débit a progressé de 385 000 lignes sur le dernier trimestre, et de 1,2 million sur 2016. La fibre passe enfin le cap des deux millions d'abonnés, avec 2,19 millions de lignes. Au quatrième trimestre, 260 000 abonnements ont été souscrits, 740 000 sur l'année. Le marché est mené sans surprise par Orange (1,452 million d'abonnés), suivi de Free (310 000) et du couple Bouygues Telecom (121 000) et SFR (potentiellement 300 000).
De son côté, le câble à 100 Mb/s et plus sert 1,25 million de lignes, soit 5 000 de mieux sur trois mois et 58 000 supplémentaires sur un an. Enfin, le VDSL2 et les lignes câble sous 100 Mb/s représentent (eux aussi) deux millions de clients, soit 123 000 de plus sur le dernier trimestre et 418 000 de mieux sur l'année. La rénovation du réseau cuivre d'Orange (dont la montée en débit) semble contribuer à cette performance. Désormais le très haut débit affiche 34 % de pénétration dans les logements éligibles.
7,7 millions de lignes fibre, 70 % des nouvelles construites par Orange
Sur les réseaux eux-mêmes, l'Arcep affirme que 29,6 millions de lignes cuivre sont compatibles haut débit. Face à cela, le territoire compte 15,8 millions de lignes éligibles au très haut débit (fibre jusqu'à l'abonné, câble et VDSL2). Là-dessus, 11,6 millions disposent de débits de 100 Mb/s ou plus.
Dans le détail, le câble compte 8,9 millions de lignes, dont 8,2 millions à au moins 100 Mb/s. Reste donc 749 000 raccords entre 30 Mb/s et 100 Mb/s, un nombre qui a fondu de 59 % sur un an. SFR a donc presque fini de moderniser son réseau. En janvier, il promettait de passer son réseau « Fibre » (câble et fibre) en Gigabit dès cette année, pour une complétion l'an prochain. D'ici 2018, les premières lignes éligibles avec un upload de 200 Mb/s devraient être commercialisées (voir notre compte-rendu).
En fibre jusqu'à l'abonné, le total se porte à 7,7 millions de logements (+11 % sur trois mois et +37 % sur un an). 6,6 millions proviennent de l'investissement privé, quand 1,08 million sont situées sur des réseaux d'initiative publique (RIP). « 70 % de ces lignes [construites au dernier trimestre] ont été construites par Orange qui est l’opérateur d’infrastructure le plus actif » rappelle encore l'autorité.
Un nouveau détail des déploiements par zones
C'est là que cet observatoire répond à une demande de longue date : un meilleur détail en fonction des zones de déploiement. L'autorité a retenu les trois zones du plan France THD.
Il y a d'abord, les zones très denses, qui correspondent à la centaine de communes les plus peuplées du pays, où chaque opérateur est censé déployer sa propre fibre... À l'exception de Bouygues Telecom, qui se contente de cofinancer les déploiements avec SFR.
Viennent ensuite les zones moins denses (dites « zones conventionnées » ou « zones AMII »), des agglomérations de taille moyenne, où les opérateurs coinvestissent, avec Orange et SFR aux manettes des déploiements. Cela a d'ailleurs donné lieu à une bataille pour la répartition, alimentée par l'abandon du fibrage dans les zones câble par SFR. Un débat tranché en 2015 par l'Autorité de la concurrence, qui a ouvert les zones câble SFR à Orange. Une décision sur laquelle SFR voudrait encore revenir, pour obtenir une plus grande part du travail. Il faut dire qu'Orange aura la responsabilité de la très grande majorité des déploiements dans cette zone.
Enfin, arrivent les zones peu denses, voire rurales, où sont déployés des réseaux d'initiative publique (RIP), pilotés par les départements et régions, avec une subvention partielle de l'État. Ce sont les zones qui ne sont pas immédiatement rentables, que les opérateurs privés ont choisi de ne pas fibrer à leurs frais.
Les zones très denses, toujours les plus avantagées
Sur 7,7 millions de lignes éligibles à la fibre, 4,2 millions sont donc en zone très dense et 3,5 millions en zone moins dense (dont 1,08 million sur les réseaux publics). Plus largement, les zones très denses concentrent 10,2 millions des lignes « très haut débit », soit les deux tiers. En zones de coinvestissement (agglomérations moyennes), l'essentiel des déploiements du dernier trimestre sont le fait de l'opérateur historique affirme le régulateur, pour son compte et celui de ses partenaires.
Sur les réseaux publics, les déploiements sont le fait d'un petit nombre d'opérateurs, avec en tête Orange et SFR, ainsi qu'Axione, une filiale du groupe Bouygues. L'opérateur Covage a dû avaler son concurrent Tutor pour atteindre une masse de 1,2 million de lignes à exploiter.
Les FAI grand public sont, eux, moins nombreux sur les RIP, avec une incidence directe sur le taux de mutualisation. En français, il s'agit de la part de lignes éligibles à la fibre disposant d'au moins deux fournisseurs d'accès au point de mutualisation (hors offres activées). En zone très dense, 67 % des logements ont le choix de leur opérateur, contre 57 % en zone moins dense. Au total, sur les 7,7 millions de lignes, 62 % sont mutualisées ; 38 % n'ont donc pas encore le choix de leur FAI.
Dans le détail, en zone très dense, deux tiers ont donc accès à deux FAI, et près de la moitié à trois. En zone de coinvestissement, la mutualisation progresse plus vite que les déploiements, les grands FAI l'ouvrant massivement depuis le premier semestre 2016. Elle compte 70 % de mutualisation à deux opérateurs, et 31 % à trois (contre à peine 9 % un an plus tôt). La bataille des zones très denses se déporte donc bien à ces villes.
Si ces chiffres peuvent encore sembler insuffisants, ils sont au beau fixe face aux réseaux publics. Les 1,08 million de « lignes fibre » affichent un taux de 30 % de mutualisation. En zones peu denses, sur 835 000 lignes, il tombe à 21 % à peine. Cela veut donc dire que les réseaux fibre censés combler la fracture numérique ne proposent pas plus d'un FAI à 80 % des lignes éligibles. À peine 177 000 logements ont ainsi accès à deux fournisseurs d'accès, et 12 000 à trois ou plus. Les déploiements allant plus vite que la mutualisation, ce taux baisse depuis le troisième trimestre (21 % contre 24 %).
D'un point de vue commercial, l'arrivée des FAI nationaux reste un défi. Axione a réussi à attirer Free sur ses réseaux avec la promesse de deux millions de lignes à terme... Suffisant pour que le « trublion » s'interconnecte (voir notre analyse). Cela en attendant une plateforme nationale pour harmoniser les réseaux, dont les travaux ont été pris en main par les opérateurs (la Fédération française des télécoms et celle des industriels des RIP, notamment). Des travaux longs et chronophages, comme nous l'affirmait il y a quelques jours Étienne Dugas, le président de la FIRIP (voir notre entretien).



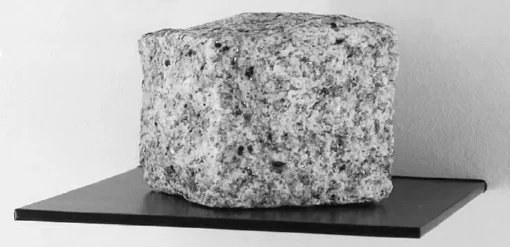





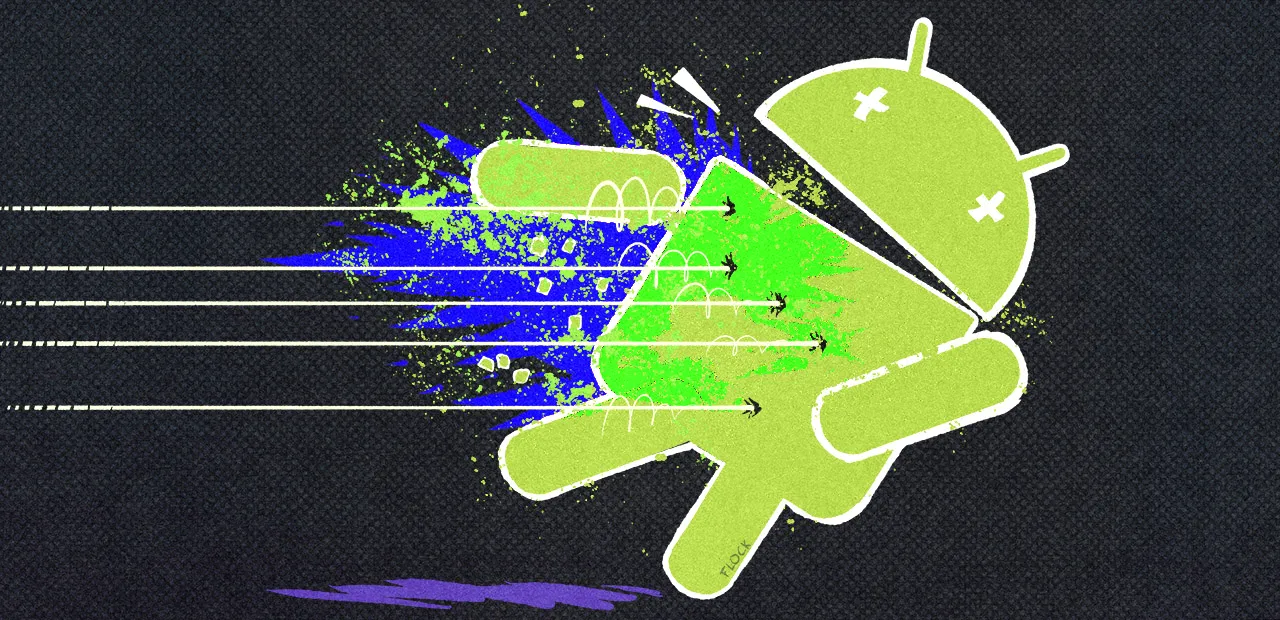

Commentaires (34)
#1
Année : 2017.
Technologie: fibre optique.
Site : youtube.
Heure : 21h
Qualité maximale de lecture : 144p (avec temps de chargement)
Fournisseur : free.
peut lire la news
#2
???
Et tu ne veux pas changer d’opérateur ? (j’ai free en cuivre à 1.5 Mo/s, c’est correct sur Yt)
#3
Plein d’articles de fond pour les abonnés en ce moment!
Top! Bravo!
#4
C’est par période. Mais ces dernières semaines ça s’est vraiment aggravé autour de 21h.
Mais oui changer de fournisseur est envisagé sur le moyen terme si ça continue dans ce sens.
(je parle de youtube mais faut voir le temps necessaire pour que netflix affiche une qualité stable)
#5
#6
Oui au début quelques secondes c’est “normal” par contre quelques minutes et des retours de passages de pixels minecraftiens en plein milieu d’épisode par contre ça l’est moins " />
" />
#7
Oui mais c’est pas cher ! C’est ça aujourd’hui l’important ! De la merde, mais pas cher !
#8
Après c’est l’ADSL, quel est ton débit ? S’il est un peu à la limite, en fonction du débit de données (qui diffère d’un contenu à l’autre, en fonction de l’intensité des scènes), il n’est pas rare que la qualité d’image soit en-deça, et ça peut durer 30 secondes, le temps que ce qui a été bufferisé en basse qualité ait fini d’être affiché.
#9
#10
Le taux de mutualisation (nombre de FAI) ne compte que les 4 FAI nationaux, non?
Sur les RIP, il n’y a pas accès à plusieurs petits opérateurs? genre K-Net, WiBox, Kiwi..
#11
J’ai eu des emmerdes avec Orange pendant quelques semaines il y a quelques années, bon depuis rien à signaler :)
#12
Là-dessus, 11,6 millions disposent de débits de 100 Mb/s ou plus…….là…d’accord –> THD ! " />
" />
#13
Chez Bouygues, je suis (soit-disant) à 950 Mbps, mais la box ne peut pas enregistrer et mettre en pause la tv, “débit insuffisant” qu’elle me dit.
 " />
" />
En sachant que je le faisais facilement avec la Freebox en ADSL à 15 Mbps, calculez l’enfumage de Bouygues
#14
D’après fast.com speedtest.net et degrouptest.com le débit de ma ligne est situé entre 17 Mb/s et 18,93 Mb/s
Sachant que, d’après Netflix, une image basse définition (SD) a besoin d’un débit de 3Mb/s
ça ne m’a pas contrarié, mais ça m’a fait pensé qu’à cette heure-là il y avait sûrement beaucoup de monde comme moi sur Netflix.
#15
J’ai la possibilité de passer de Free ~13Mo/s à SFR en FTTH en zone faiblement peuplée. Et bien, je préfère m’abstenir. J’ai quelque chose qui fonctionne plutôt bien la plupart du temps. Chez SFR, c’est la roulette et vu les retours clients…
Une chance pour que Orange passe un jour par chez moi ? Je sais qu’avec Free, ça n’arrivera jamais…
@NXI, merci pour l’article.
#16
C’est déjà ‘dredi ?  " />
" />
#17
Moi chez Orange en ce moment, malgré ma connexion VDSL à 74Mb, j’ai des énormes ralentissements … Du genre Next Inpact qui charge lentement ou encore Netflix sur mon beelink GT1 qui est d’une lenteur malgres un test avec fast.net à 60Mb … Alors qu’a contrario sur ma Xbox One Netflix tourne nikel …
 " />
" />
Ca sens encore des histoire de peering cette affaire
#18
Effectivement, je pense savoir que ces problématiques concernent plus les accords de peering que la bande passante disponible à l’abonné.
Le psychodrame Qobuz en est un bon exemple.
Est-ce au FAI de tout mettre en oeuvre en terme de QoS pour les plateformes de contenus, l’inverse, ou une solution à mi-chemin est-elle à trouver ?
#19
#20
13 Mo/s c’est beaucoup, déjà du très haut débit. Si c’est 13 Mb/s, franchement passe à la fibre direct. Tu sentira immédiatement la différence et SFR a un meilleur peering que Free (Youtube, netflix etc.).
#21
Ah oui pardon, 13Mb/s.
#22
C’est une maison dans mon cas et numerique28 (qui déploie par le biais de SFR) m’assure que c’est du FTTH.
@wagaf, c’est surtout que j’adore la Freebox ;)
#23
quand on parle de débit on parle en MegaBit/second Monsieur, du coup si j’en crois les 1,5 Mo/s vous devez être sur une connexion 12Mb/s (1,5*8 car 1 octet = 8 bits).
Après c’est pas tant le débit qui permet de dire si tu peux aller sur youtube a 21h sans problème, il y a 3 facteur selon moi :
la qualité de ta ligne (réseau de ton opérateur)
la charge supporté par ton DSLAM (commutateur de zone, je sais pas si le terme est toujours correct)
et la charge d’utilisation du service demandé
du coup dire oui YT ça marche pas à 21h car free c’est caca, c’est pas forcément légitime. Après free est connu pour avoir appliqué une politique de bridage non officiel pour YT, je ne sais pas si c’est toujours le cas, du coup ce n’est peut-être pas pertinent d’utiliser ce service comme référence.
#24
Je pense pour le coup que c’est plus lié à un défaut matériel plutôt que réseau, néanmoins, ça ne change pas l’enfumage " />
" />
#25
La ligne Orange de mes parents chez qui je suis en ce moment, bien moins favorisée en débit, affiche les mêmes problèmes. Des 3 à 4 secondes pour ouvrir NXi ou d’autres sites français (mais pas tous…) et des délais délirants sur des sites aux US/Canada/Singapour ou UK.
Je ne comprends pas vraiment l’origine du problème. Ce serait lié au peering, les sites français ne devraient pas être touchés si?
Par contre, pas de soucis sur primevideo en 720…
Et des sauts de ping jusqu’à 2000 par moments…
#26
#27
Pour info Orange a de gros soucis en IPv6 sur VDSL2 et FTTH, chez pas mal de clients je dois couper l’IPv6…
#28
#29
J’ai répondu plus haut. C’est du 13 Mb/s bien loin de la fibre.
#30
Je souhaiterais passer de Orange FTTH à Free, rien que pour le mode bridge … j’avais ça chez Numericable et c’était nickel (100M et pas d’emmerdes). Là je suis en 300⁄100 et ça fonctionne super bien depuis un an, sauf quand j’éteint la livebox, la synchro foire et je dois faire reboot sur reboot de 4 à 10 fois pour retrouver la connexion. En plus pour accéder à l’interface admin c’est la roulette … et j’ai passé une demi-journée pour lui faire enregistrer un seul paramètre le jour de l’installation. bref …
#31
#32
Je suis en ZMD au sud-est de Grenoble et nous avons le choix entre Orange et Free pour la fibre dans l’immeuble. J’ai pris free en ce qui me concerne. Historiquement, c’était une zone câble.
Commentaire supprimé a-t-il ce choix dans Grenoble intra muros?
#33
tutafait monsieur.
#34
Effectivement avec un débit comme ça il n’y a pas de raison que la résolution soit si basse.