La semaine dernière, Fleur Pellerin a confirmé une nouvelle fois sa volonté de voir modifier le statut juridique de l’hébergeur. Seul souci : cette réforme n’est pas vraiment à l’ordre du jour à la Commission européenne, laquelle souhaite plutôt dépoussiérer le droit d’auteur.
Dans une interview aux Échos, la ministre de la Culture a démultiplié les arguments pour justifier la réforme du statut des hébergeurs. « Ces statuts datent de la loi de confiance dans l’économie numérique, de 2004, qui transpose elle-même une directive européenne de 2000. Internet a évolué depuis ! ». L’argument calendaire est fragile puisque le droit d’auteur est plus vieux encore, mais dans le même temps la ministre assure que dans le cadre d’action en contrefaçon, les décisions de justice auraient du mal à être exécutées « rapidement ».
La locataire de la Rue de Valois a donc dans son chapeau une solution pour résoudre tous ces maux. Comment ? « Il ne s’agit pas de rendre les réseaux sociaux, les plates-formes vidéo responsables, de les muer en police de leurs contenus. Ce serait difficile, philosophiquement et matériellement » assure la ministre. Et pour cause : le statut de l’hébergeur est intimement lié à celui de la liberté d’expression. Seulement, pour la ministre, « il faut que chacun ait conscience de sa responsabilité, revoir nos modes de coopération, notamment en matière de protection du droit d’auteur, en allant peut-être vers un statut hybride, par exemple pour les grandes plates-formes, qui ne sont ni simplement des hébergeurs ni totalement des éditeurs. »
Des plateformes, du filtrage
Ce statut hybride n’est pas sorti de l’imagination fertile de Fleur Pellerin. Il est directement inspiré des travaux du Conseil d’État notamment (voir notre actualité). Dans son dernier rapport annuel sur le numérique, celui-ci propose en effet de créer entre éditeur et hébergeur, une nouvelle catégorie juridique, celle des plateformes.
Elle viserait les intermédiaires qui « proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers ». Ces plateformes seraient alors soumises à une obligation de loyauté envers les utilisateurs non professionnels (droit de la consommation) ou professionnels (droit de la concurrence). Elles mettraient par ailleurs à disposition des ayants droit des outils de détection des contrefaçons, outils qu’elles devraient elles-mêmes activer sur ordre d’une autorité administrative (proposition 28 du rapport) afin d’empêcher un temps durant, la réapparition d’un contenu ayant déjà fait l’objet d’un retrait. Pour résumer, il s’agit d’un système de filtrage, limité dans le temps et l’espace, un mécanisme qui menace bien la liberté d'expression lorsqu'il est trop musclé.
Les barrières du droit d'auteur intéressent davantage la Commission européenne
Seulement, ces propositions ne sont pas seulement critiquées par la doctrine (voir notre interview de Me Ronan Hardouin), elles sont aussi en déphasage avec la Commission européenne.
Si Bruxelles se montre prudente sur l'instauration d'une taxe Google, l'institution européenne envisage surtout de retoiletter le vieux droit d’auteur en Europe afin de faire tomber les barrières territoriales et de créer un grand marché européen de la Culture.
Le 27 janvier, le vice-président de la Commission Andrus Ansip l’a clairement exposé à Paris, tout en se montrant rassurant pour l’industrie culturelle : « les gens pensent que, quand on parle de réforme du copyright, c’est forcément qu’on va arrêter de protéger les droits d’auteurs et bafouer les droits des créateurs. Pas du tout. Mais la situation actuelle est perdante pour tout le monde, consommateurs et créateurs ». Il faut dire qu’un tel chantier est attendu fusil à l’épaule par les ayants droit français : une culture harmonisée, c’est autant de pouvoirs en moins à l’échelon local, avec des conséquences financières immédiates. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher un instant sur le statut de la redevance pour copie privée, un domaine où la ministre de la Culture refuse là aussi, tout « surcroit » d’harmonisation, alors que la France est le pays qui sollicite le plus les consommateurs.

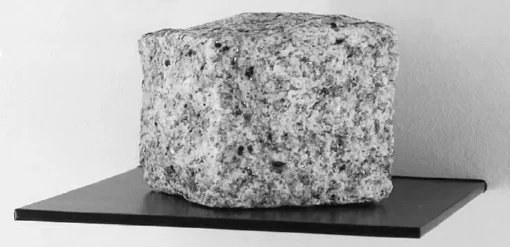





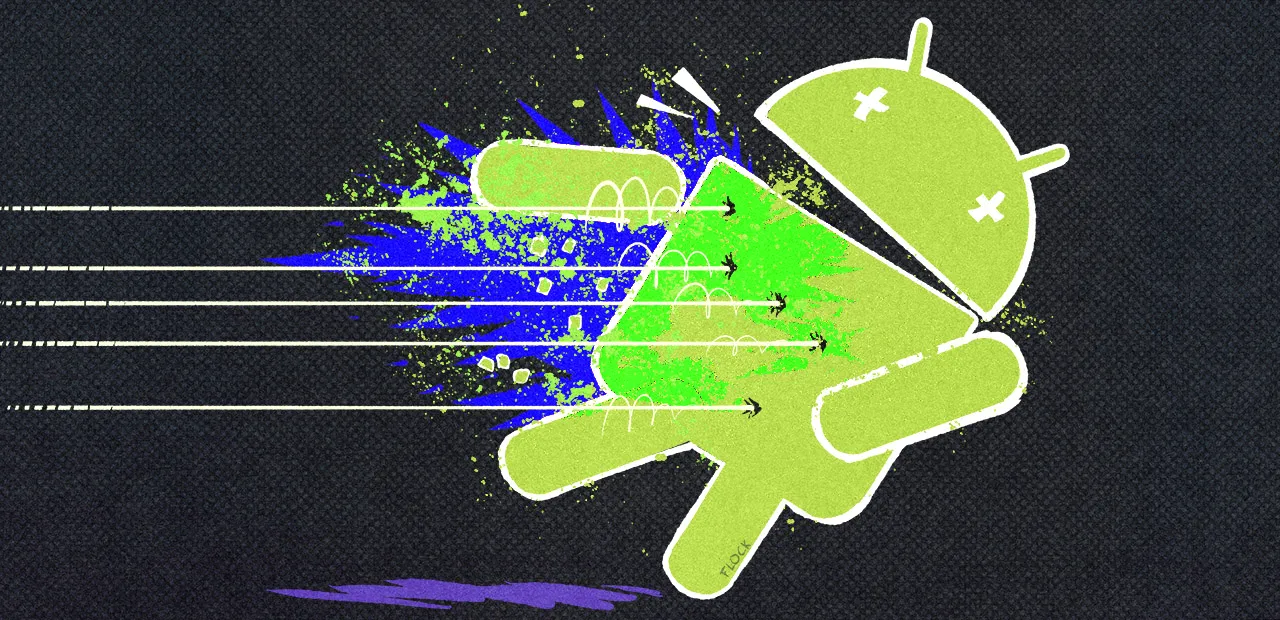

Commentaires (64)
#1
Allez ,et cela recommence …
Et , après ,ils osent parler de neutralité du net …
Quel bande de vendu !
Nous savons qui sont derrière tout cela …
#2
L’action gouvernementale habituelle : cataloguer, légiférer, surveiller et taxer.
#3
Bravo Fleur, le texte est bien appris, bonne articulation, encore un 20⁄20 en lecture !
 " />
" />
Continues, et tu vas réussir à égaler Aurélie, meilleure élève du groupe socialiste
#4
#5
En dehors des droits d’auteurs, le statut d’hébergeur touche aussi beaucoup d’autres domaines nettement moins rentable pour les dit protecteurs des auteurs. La majorité des sites marchands ayant une marketplace, les sites d’annonces, …
Allo?! y’a pas que youtube et piratebay dans la vie
#6
#7
#8
Le point Godwin atteint au 7ème commentaire.  " />
" />
#9
Il est allez directe au 7eme ciel.
#10
Sources ?
Wikipedia me confirme qu’il a été créé par de Gaulle pour Malraux :
Le ministère de la Culture (dont la dénomination officielle est, depuis 1997, « ministère de la Culture et de la Communication ») a été créé en France en 1959 par le général de Gaulle, et attribué à André Malraux sous le nom de « ministère d’État chargé des Affaires culturelles ».
Fleur étant très loin d’André, la suppression de ce ministère et le rattachement à l’industrie (Ministère de l’Économie) me semble une bonne chose.
#11
elle me fait marrer cet loi google  " /> genre au lieu de bricoler une fois de plus des ajouts de surtaxes bancales on paut pas tout simplement s’attaquer à l’évasion l’optimisation fiscale au sein de l’EU deja et des paradis fiscaux. de reformer les stratus des multinationales pour éviter les reventes au sein de succursales etc etc…
" /> genre au lieu de bricoler une fois de plus des ajouts de surtaxes bancales on paut pas tout simplement s’attaquer à l’évasion l’optimisation fiscale au sein de l’EU deja et des paradis fiscaux. de reformer les stratus des multinationales pour éviter les reventes au sein de succursales etc etc…
 " />
" />
mais ouai continuez a prendre les gens pour des cons, messieurs et mesdames les incompétents
#12
C’est un bon résumé des choses.
#13
Pour résumer, il s’agit d’un système de filtrage, limité dans le temps
et l’espace, un mécanisme qui menace bien la liberté d’expression
lorsqu’il est trop musclé.
Limité dans le temps…. comme vigipirate. On sait ce que ça veut dire. Définitif en somme.
#14
#15
“autorité administrative”
On les collectionne décidément… c’est le remède à tous les maux^^
#16
#17
Fleur Pellerin décrédibilise sa fonction. Elle est totalement acquise aux lobbies. Elle se fout du peuple et du partage de la culture.
#18
#19
#20
Le bras des ayants droit est tellement profond dans son cul à celle là qu’on ne devrait pas tarder à voir des doigts sortir par sa bouche…
Sans déconner, la justification du “la loi date de 2004 faudrait l’actualiser”, ça marche pas pour la directive sur le droit d’auteur de 2001 ?
#21
#22
#23
Samedi dernier, l’émission “allo bouvard” (pardon si j’écorche le nom) a démontré à quel point le mot culture ne signifie plus grand chose parce qu’il a beaucoup trop de significations.
#24
#25
Je suis entièrement d’accord avec les propos de Fleur. " />
" />
il faut que chacun ait conscience de sa responsabilité
VPN, Proxy, firewall, TOR, …
revoir nos modes de coopération
P2P, Stream, Fansub, Seeder, Hosting, …
notamment en matière de protection du droit d’auteur,
CAM, TS, BDRiP, SCR, WEBRIP, …
en allant peut-être vers un statut hybride, par exemple pour les grandes plates-formes, qui ne sont ni simplement des hébergeurs ni totalement des éditeurs.
Torrent index, File index, Meta Search engine ,CouchPotato, Sonarr, …
#26
« Et pour cause : le statut de l’hébergeur est intimement lié à celui de la liberté d’expression. Seulement, pour la ministre, « il faut que chacun ait conscience de sa responsabilité, revoir nos modes de coopération, notamment en matière de protection du droit d’auteur, en allant peut-être vers un statut hybride, par exemple pour les grandes plates-formes, qui ne sont ni simplement des hébergeurs ni totalement des éditeurs. » »
- le Droit d’Auteur est une prérogative d’un créateur d’une oeuvre pour se défendre contre les tiers et surtout contre les éditeurs/producteurs. Or la complexité du Droit de la Propriété intellectuelle actuelle mériterait une simplification salutaire pour les Droits et les Libertés d’Expression et d’accès à la Culture.
#27
#28
#29
#30
#31
« Ces statuts datent de la loi de confiance dans l’économie numérique, de 2004, qui transpose elle-même une directive européenne de 2000. Internet a évolué depuis ! »
Ce genre de phrase qui te laisse pantois. Les mecs surexploitent des mécanismes inventés il y a tellement longtemps qu’ils sont rédigés sur papyrus mais sinon, une loi de 2004 sur internet c’est obsolète.
Elle mérite un high-five, sur la tête, avec une chaise.
Dans son dernier rapport annuel sur le numérique, celui-ci propose en effet de créer entre éditeur et hébergeur, une nouvelle catégorie juridique, celle des plateformes.
En gros, on change le nom et hop ! On peut y appliquer toutes nos idées folles ?
La Fleur, si elle portait un autre nom, sentirait-elle moins bon ?
#32
#33
toujours aussi bon  " />
" />
#34
#35
En 2017 ont vous éjecte crapules de politocards
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
j’en suis qu’à 58mn pour le moment.
Mais est-ce une source fiable ?
#44
« Ces statuts datent de la loi de confiance dans l’économie numérique, de 2004, qui transpose elle-même une directive européenne de 2000. Internet a évolué depuis ! »
#45
#46
#47
#48
Décidément on aura tout entendu, voici une ministre de la Culture qui se plaint du trop grand succès de la diffusion de la culture par des moyens actuels, c’est un comble !. Au lieu d’en reconnaitre le succès inouï qui ne lui a réclamé aucun effort ni subventionnement, elle devrait tout au contraire l’encourager c’est dans son mandat originel, mais aussi l’étendre dans d’autres modes (théâtre, expositions, musées..). Voici un ministère qui aurait son véritable rôle, et sa véritable utilité sociétale, ce n’est pas celle d’une ministre chargée uniquement de gérer des rentes de situations, qui est le seul visage qui nous reste aujourd’hui.
Il est incroyable de constater l’absence totale de vision des derniers ministres en charge, et de cet aveuglement choisi sur la réalité des usages qui dictent pourtant très simplement les politiques à suivre. Comme le droit d’auteur ne peut être protégé dans certaines circonstances, il faut donc le modifier pour tenir compte de ces évolutions. Ni l’abroger, ni le nier. Même si cela signifie par ailleurs un subventionnement plus important du secteur, et une aide bien nécessaire à la création. Le savoir comme la culture n’a de valeur que s’il est partagé. Il est curieux de constater que ce terrain de friction, ce symptôme de l’incompréhension, à été transféré, de ministre en ministre, sur les hébergeurs, sur les usagers, sur les futures “plate-formes”, mais n’a jamais conclu que le mal venait de l’absence de définition claire du rôle du ministère de la culture, et de son dévoiement -total- aux intérêts privés.
#49
#50
#51
#52
la dictature c’est pas seulement la dictature communiste ou alors j’ai loupé un truc. Hitler était communiste ?
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
Je ne dis pas que ca s’impose forcément juste par la violence, bien au contraire, plus c’est subtil et plus ca passe facilement, petit a petit.
Pour la délation, je n’irai pas jusqu’a dire que ca me rappelle quelque chose, malgré certains choix surement constestables dans l’EN par exemple, on peut encore critiquer l’Etat et le gouvernement sans se faire enfermer.
par contre, le grignotage qui se fait petit a petit sur les libertés individuelles ca pourrait finir par poser problème
#61
#62
#63
Allons-y!!
Ensuite comme les hébergeurs et fournisseurs de contenus chinois ou russes prendront le relai il faudra interdire ces sites! Puis comme les gens utiliseront des proxy il faudra interdire les proxys puis le cryptage;
Internet finira par n’être qu’un grand centre commercial…
http://www.dailymotion.com/video/x2fwbl7_j-zimmermann-1-audition-internet-et-ter…