La Commission européenne s'est dite « inquiète » des restrictions que la Chine va imposer sur les exportations de deux matériaux critiques indispensables aux semi-conducteurs et dont elle est le principal producteur, rapporte l'AFP. Elles s’installent dans un climat tendu où États-Unis et Europe mettent aussi en place des « licences » sur les exportations.
La liste des matériaux critiques de la Commission européenne comporte 30 éléments dans sa version de 2020. Ils représentent « un risque particulièrement élevé de pénurie d’approvisionnement dans les dix prochaines années et [...] jouent un rôle particulièrement important dans la chaîne de valeur ». Cette liste est mise à jour tous les trois ans, la prochaine version devant arriver cette année.
Coup de semonce : la Chine impose des licences sur l’exportation
La Chine a annoncé que les exportations de gallium et de germanium nécessiteront, à compter du 1ᵉʳ août, une licence pour être autorisées. Devront également être précisés le destinataire final des exportations et l'objet de leur utilisation.
Le pays justifie ces mesures par la nécessité de « préserver la sécurité et les intérêts nationaux », à l'image de ce qu'exigent les pays occidentaux en matière d'exportation de biens « à double usage ». On peut aussi y voir un début de réponse aux restrictions américaines et européennes.
Pourquoi le gallium et le germanium ?
La Chine représente, selon des chiffres de la Commission, 80 % de la production mondiale de gallium, que l'on trouve (avec l’indium) dans les circuits intégrés, les LED et les cellules des panneaux photovoltaïques. Même pourcentage pour la production planétaire de germanium, indispensable pour les fibres optiques et l'infrarouge, les cellules solaires pour satellites et les catalyseurs de polymérisation.
Le choix du gallium et du germanium n’est pas anodin. Non seulement la Chine est en position dominante, mais les États-Unis ne font pas partie des principaux producteurs mondiaux. Pour le gallium, l’Allemagne représente 8 % et l’Ukraine 5 % ; pour le germanium, la Finlande est à 10 % et la Russie à 5 %.
La Chine n’est pas seulement en position dominante sur ces deux matériaux, elle représente aussi 86 % des sources d’approvisionnement des terres rares lourdes et légères, 89 % du magnésium (4 % pour les États-Unis) et 80 % du bismuth (7 % pour le Laos, 4 % pour le Mexique). Ils ne sont pour le moment pas concernés par ce type de licence.
Si chacun tire la couverture à soi, la situation mondiale va rapidement se compliquer puisque l’Afrique du Sud représente 93 % du ruthénium, 80 % du rhodium et 71 % du platine, le Congo 59 % du tantale et 64 % du cobalt, les États-Unis 88 % du béryllium, le Brésil 92 % du niobium, le Chili 44 % du lithium, etc.
La Commission européenne s’inquiète
Une porte-parole de l'institution a indiqué, ce mardi 4 juillet, préparer « une analyse détaillée de leur impact potentiel sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'industrie européenne », précise l'AFP.
« Nous appelons la Chine à adopter une approche avec laquelle les restrictions et les contrôles sont basés sur des considérations de sécurité claires dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) », a ajouté la porte-parole. Selon ce dernier, l'UE pourrait envisager « des actions dans le cadre de l'OMC ».
Ces restrictions interviennent dans un contexte de tensions internationales grandissantes autour des semi-conducteurs, sur fond de rivalité technologique avec les États-Unis.
Guerre froide entre les États-Unis et la Chine… avec l’Europe au milieu ?
Après avoir mis sur liste noire des entreprises chinoises pour les priver d'accès aux technologies américaines, les États-Unis ont en effet renforcé récemment les restrictions à l'exportation des semi-conducteurs vers la Chine. Ils font également pression sur leurs alliés pour qu’ils fassent de même.
Cela semble porter ses fruits. Quelques semaines après la visite de Joe Biden aux Pays-Bas, une annonce importante est tombée : « Le gouvernement a abouti à la conclusion qu’il était nécessaire pour la sécurité internationale et nationale d’étendre le contrôle actuel des exportations de matériels pour la production de semi-conducteurs spécifiques ».
L’Europe n’a guère de matériaux rares à mettre dans la balance, mais elle a des idées : « les limitations d’exportations devraient affecter le groupe néerlandais ASML, plus grand fabricant européen de machines qui permettent de produire des semi-conducteurs ». La Chine avait de son côté vertement critiqué la décision néerlandaise d'imposer de nouvelles restrictions sur ses exportations de semi-conducteurs, résultat, selon elle, du « harcèlement et de l'hégémonie » de l'Occident.
La nouvelle réglementation des Pays-Bas a été publiée et entrera en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2023. ASML confirme qu’elle concerne les « technologies de fabrication avancées des puces, y compris les systèmes de lithographie par dépôt et par immersion les plus avancés ». ASML doit désormais demander des licences d’exportation pour les systèmes concernés.
Par contre, la société estime que ces mesures n’auront pas « une incidence importante sur ses perspectives financières publiées pour 2023 ou sur ses scénarios à long terme tels que communiqués lors de notre Journée des investisseurs en novembre 2022 ».
- Semi-conducteurs : pour des raisons de « sécurité » les Pays-Bas vont limiter leurs exportations
- Les États-Unis bloquent les exportations de semi-conducteurs et de puces vers la Chine
- Les contrôles à l'export des puces américaines ne font que ralentir les industriels chinois
- IA : les sanctions américaines et le marché noir chinois des puces haut de gamme NVIDIA
Critical Raw Materials Act en Europe
En mars, la Commission européenne a elle aussi proposé une nouvelle législation pour s’attaquer au problème des matières premières critiques. Son but est de « garantir un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable ». L’enjeu est d’autant plus important que, selon des estimations de l’Europe, la demande pour le lithium va être multipliée par 89 d’ici 2050, celle des terres rares par 6 ou 7, celle du gallium par 17, etc.
La Commission européenne veut aussi doubler sa part de production mondiale de puces. Elle souhaite passer de 10 à 20 % d'ici à 2030, dans un marché qui va lui aussi doubler ; ce qui implique de multiplier par quatre le volume de production. Dans le cadre de son Chip Act, l’Europe mobilise 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés, rehaussés à 45 milliards d’euros depuis.
- L'Europe dégaine ses règlements sur les matières premières critiques et l'industrie « net zéro »
- Semi-conducteurs : l’Europe veut « quadrupler la production »

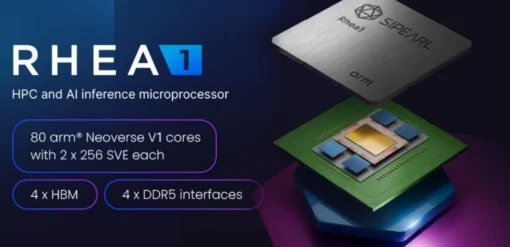









Commentaires (34)
#1
Avantage de tout cela : il risque d’y avoir une poussée de l’innovation pour se passer de ces éléments… pour peu que les dirigeants européens et nationaux prennent les mesures nécessaires et incitent à ce type d’investissements.
Il faut bien se rendre compte que la période de la “mondialisation heureuse” est terminée. La mondialisation sera toujours là mais va prendre un autre visage dans la décennie à venir, de par la géopolitique mais aussi de par les enjeux climatiques.
#2
Et on passera par des pays tiers qui, moyennant une commission, ferait office d’intermédiaire.
Après tout, c’est bien le rôle que tiens la Chine envers la Russie …
#3
Ou, on relocalisera, comme les médicaments, les services numériques d’informations…
Profitons en pour reprendre la main.
#3.1
Je suis curieux de savoir comment on relocalise des filons à miner… 😅
#3.2
On peut commencer par les chercher, l’europe et ses térittoires, c’est vaste.
#4
Tout à fait, dommage que ce n’ai pas été anticipé 5 ans auparavant.
#5
Cela va surtout repousser la contrainte sur d’autres matériaux
#6
Il y a des terres rares partout sur la planète. Si c’est la Chine qui en extrait le plus, c’est juste parce que c’est elle qui regarde le moins le côté écolo du truc.
#7
Le minage n’est qu’une partie de la filière qui alimente la production de matières premières. Le recyclage (surtout pour les métaux) peut dépasser les capacités de minage.
#8
Est-ce un début de solution pour diminuer la croissance et ainsi améliorer l’état de la planète (ou a minima moins l’abimer) ???
#8.1
oui, c’est bien un début d’excuse pour augmenter artificiellement le prix de tout les appareils électroniques
#8.2
Cette notion “d’artificiel” n’a de sens qu’à tes yeux:
Avant la dernière carte graphique coutait un bras, elle en coutera 2.
Mais la réflexion de long terme va bien au delà de ton besoin en cartes graphiques.
Et pour tacler ton besoin d’expansion, une carte qui valait 10 pesetas hier n’en vaudra pas plus demain, le marché de l’occasion existe et ne bougera pas.
Seul les espoirs d’une nouvelle carte sera INpacté.
Du coup le marché s’adaptera. Si tu veux 2Gflops tu raques, sinon tu utilises le marché d’hier.
PS: ce n’est pas bon pour la planète si tous les besoins du jour restent assouvis, le fait d’augmenter les ressources à leur juste valeur, ou à une valeur anormalement élevée permet de limiter les besoins en “appareils électroniques”.
Donc ça va dans le bon sens il me semble.
#9
Hansi manque sur ce sujet car les U-S sont en déclin et nous les suivons docilement au lieu de viser à être une entité distincte et autonome.
Preuve que les seuls gagnant à cette «Europe» sont les grands comptes américains…
#10
#11
Comme d’autres l’on fait remarqué, c’est peut-être le début de la fin du “n’importe quoi”, ce qui serait une bonne chose pour notre planète et générations futurs…
Avec une grosse augmentation des prix, on valorisera peut-être l’ingénierie de produire autant de valeur, voire plus… avec moins de ressource. Exemple, pour ce que j’en vois dans mon taff, arrêter de vouloir faire du code qui tourne dans une JVM, dans un container, sur un cluster k8s, hébergé sur des VMs dans un cluster ESX…
#11.1
putain d’hérésie ! ça me fou les boules, on commence à regarder du côté de kubernetes pour juste un truc : “AWX” par ce que les devs sont pas foutus de savoir ce qu’ils font et donc construire des packages propres… c’est tellement le bordel ce projet :(
même redhat avec tower galère à proposer des packages (si c’est pas déjà fini).
les conteneurs ça n’a rien apporter de bon à l’informatique ! pour moi c’est clair et net.
#11.2
Tain’ les gars, je me sens moins seul.
Après, j’ai un avis moins tranché que toi (al_bebert) sur les conteneurs, c’est très utile, pratique et performant dans certain cas, le problème, c’est quand c’est utilisé pour de mauvaises raisons, comme celle que j’ai énoncé au dessus.
#11.3
Je ne me sert que de serveurs physiques dans mon boulot et parfois je me dis que je suis hasbeen et trop vieux pour ce métier (ce qui est sûrement vrai).
#11.4
perso j’utilises des CTs LXC et un peu de docker, ça à du sens (enfin docker pas en prod).
Ce que je reproche c’est que sous pretexte de conteneur ils ne savent plus proposer d’autre mode de mise en place (package deb/rpm, voir un simple tgz avec une liste de dépendances).
#12
L’augmentation des prix des terres dite “rare” va surtout normalement rendre plus rentable le recyclage des smartphones (actuellement on recycle surtout le cobalt).
#13
Le gallium et le germanium s’utilisent également dans la production des cellules photovoltaïques. Cette technologie en plein essor par tout dans le monde. C’est un autre des leviers commerciaux qui est impacté.
De plus, selon un rapport de l’UNEP de 2020, le gallium est en situation critique de fourniture du fait du très haute demande d’ici 2025.
Le gallium provient principalement du raffinage de bauxite (ce qui semble être la source la plus simple à raffiner). Mais il se trouvent en plus grande quantité mais à un taux bien plus bas dans les minerai de phosphate ou dans le charbon (qui est le plus grand producteur de charbon ? :)) Taux de présence très bas. Est-ce que cela vaut la peine économiquement parlant ?
Le raffinage de la bauxite se fait principalement en Chine, Russie et Canada.
Or, les mines de bauxite sont principalement situées en Australie, Brésil et Guinée. C’est ici que la pression internationale devrait sortir son épingle du jeu.
De plus le rapport insiste sur la nécessité d’avoir des entreprises de recyclage du Gallium, actuellement inexistantes ou seulement en train de se mettre en place.
http://web.archive.org/web/20200606205711/http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1202xPA-Critical%20Metals%20and%20their%20Recycling%20Potential.pdf
#14
C’est plutôt de la recherche fondamentale sur ces sujets … oouuuups pour la France du coup
La “mondialisation” existe depuis l’antiquité, a été accélérée par les technologies modernes. Je n’ai jamais entendu parler du terme “heureux” accolé à ça. Ce serait heureux par rapport à quoi? Une mondialisation malheureuse avant?
On est juste dans un enième ajustement des rapports de force mondiaux, ça ne va pas changer fondamentalement les choses ou marquer une rupture. La Chine a toujours été protectionniste. Comme dit par d’autres, c’est peut être pour le mieux en termes de gaspillages.
#14.1
L’utilisation du terme “mondialisation heureuse” était ironique pour reprendre le terme tant utilisé par certains idéologues
#15
Et pourtant, c’est une expression utilisée couramment par les partisans de la mondialisation, et par le premier d’entre eux :
https://www.fnac.com/a921649/Alain-Minc-La-mondialisation-heureuse
#15.1
Ah oui, 1999, quand on nous expliquait que la Chine allait devenir une démocratie grace aux technologies qu’on lui transférait qui allaient hâter sa transition politique et culturelle
Je voulais dire sérieusement, par des analystes économiques ou historiques, des universitaires, des gens sérieux tout au moins, pas par des guignols d’idéologues, parasites (SANEF) comme Minc.
Sinon des slogans politiques novlangue on peut trouver tout et n’importe quoi oui en effet…
#16
+12 !
#17
J’ai un gros doute que les 40ans de mondialisation à outrance pour les occidentaux basculent vers autre chose. C’est la base de l’économie actuelle que chacun sait, au-dessus de tout le reste.
D’où les guerres économiques en cours.
#17.1
J’ai aussi des doutes, et pourtant, avec le dérèglement climatique il faut remettre en cause (fortement) nos modes de vie.
#17.2
Oh mais vous prêchez à un convaincu.
Mais ce sera l’économie, toujours l’économie.
#17.3
[La réponse n’est pas contre vous:-) ]
Et si on arrêtait de faire des mômes … A 7 milliard d’individus, je pense que l’espèce n’est pas menacé….
#18
Tout est dit dans le sous-titre.
#19
Dépendre de la Chine pour quoi que ce soit était déjà une bêtise pourtant déjà identifiée à l’origine, mais c’était “plus simple” et on les sous-estimait, donc “tout alalit bien”.
Il aurait fallu interdire à nos entreprises les délocalisations, avec contrôles (donc moyens) et sanctions appropriées.
Il aurait fallu réaliser que l’industrie, secteur secondaire, ne faisait que disparaître du pays, et que les objets ne se crée pas tous seuls… donc qu’ils venaient de plus en plus massivement de Chine. Si un lambda moyen pouvait s’en apercevoir en regardant les inscriptions de production sur les objets qu’ils possédait, j’imagine que nos dirigeants ne sauraient avoir été plus aveugles à la chose.
Il aurait fallu réaliser que les mines, secteur primaire, avait déjà quasiment intégralement disparu du pays, quand que la production d’objets n’est encore là pas magique.
Les composants électroniques, puis informatiques, sont prévus depuis des décennies comme ayant une croissance de consommation au moins quadratique (voire exponentielle ?). Ils ont leur lot de minerai très spécifiques et d’agents de réaction bien sales, qu’il aurait convenu de sécuriser. Pareil : c’était déjà évident il y a au moins deux décennies.
Mélangez le tout, et on obtient une Chine dont on dépend pour notre production de manière générale qui sécurise & produit les composants électroniques & informatiques depuis des décennies… Et tout était évitable, point par point.
Et on en entend, des chercheurs, plaider pour cela depuis fort fort longtemps. Et on en a pas eu fort fort grand chose à carrer, collectivement.
Pour les matières premières, il serait peut-être enfin temps de changer notre regard/relation avec les États d’Afrique ?
Entre la (auto-)flagellation concernant le passé colonial et l’arrogance de tentatives de colonisation économoque sans réels échanges pair-à-pair mis en place, un nouvel équilibre n’est toujours pas toruvé.
BIen malins, la Chine & (plus récemment) la Russie surfent sur les ressentiments qui en découlent pour coloniser économiquement à leur tour ces États (les fameux invesitssements dans les transports chinois en retour d’une concession infinie dessus ainsi que… sur des mines).
Les Russes ont réussi à faire dégager l’armée de stabilisation europépenne, en premier lieu française, sur la base de ces ressentiments !
TL; DR
Donc, alors qu’il nous faudrait nouer des partenariats avec l’Afrique afin d’assurer notre approvisionnement en matières premières pour de la production eurpéenne de composants électroniques & informatiques… eh bien on a les fesses dans l’eau.
La seule bonne nouvelle est enfin l’annonce d’une volonté européenne de production de ces composants, mais il va falloir encaisser l’inertie avant de voir les premiers produits découler de cette initiative… et cette question des matières premières me taraude, car créer des objets les nécessite, et on ne produit rien sur notre territoire, ni ne pouvons d’ailleurs produire grand chose.
#19.1
Complètement raccord sur la relation avec les états africains. Il y a en effet une forme d’auto-flagellation constante sur le passé colonial mais qui est, de façon assez contradictoire, complété par une tentative de néo-colonialisme utilisant l’outil économique.
Et comme tu le mentionnes, cela ne fait qu’augmenter le ressentiment anti-européen. Ce qui profite indirectement à la Chine et à la Russie, qui ont bien compris les enjeux sur le continent pour les décennies à venir.
#20
Je vois pas pourquoi tu me parle de carte graphique quand je parle de TOUTE l’électronique (de ta brosse à dents électrique au contrôleurs d’éclairage public en passant par les switchs des fournisseurs d’accès à internet), pas juste de l’informatique pour geek, gamers et graphistes…
On en reparlera quand l’accès à internet coûtera 100€/mois et que absolument tout aura augmenté afin de payer n’importe quel équipement avec de l’électronique dedans…
je grossis le trait? pas tellement… toute notre civilisation est basée sur les semi-conducteurs et de moins en moins de personne peuvent s’en passer, que ça plaise ou non.