Coup sur coup, l’Europe a proposé tout un ensemble de mesures et une législation pour deux problématiques liées et d’actualité : les matières premières critiques et l’industrie à zéro émission nette. Un ambitieux programme qui repose en grande partie sur les entreprises.
L'accès aux matières premières est un sujet régulier depuis quelques années. La crise sanitaire et les énormes problèmes d’approvisionnement qui en ont découlé, ainsi que la guerre en Ukraine, ont braqué de puissants projecteurs sur la dépendance du Vieux continent à l’Asie et l’Afrique. 63 % du cobalt mondial est par exemple extrait au Congo, et 60 % de cette matière première sont raffinés en Chine. Plus parlant encore, 97 % du magnésium utilisé en Union européenne provient de Chine.
La Commission européenne aimerait donc se doter d’une industrie plus souveraine, donc sur son sol, si possible avec des matières premières extraites sur son territoire.
Dans le même temps, la Commission, qui a affiché des objectifs ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre, veut donner un sérieux coup de fouet à la transition vers une industrie bas-carbone et zéro émission nette, « afin d’intensifier la production de technologies propres dans l’UE et d’assurer que l’industrie soit prête pour la transition vers une énergie propre ». Elle a proposé il y a quelques jours une nouvelle législation pour accélérer le pas, qui doit également répondre à la pression américaine.
La Commission propose son Critical Raw Materials Act
Le CRMA est un nouveau cadre législatif pour s’attaquer au problème des matières premières critiques. Elles sont dites « critiques » à cause de leur importance dans nombre de domaines, dont le numérique au sens large et les batteries, mais également l’aérospatiale et la défense.
Le Critical Raw Materials Act veut « garantir un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable ». Il inclut un règlement et une communication pour « atténuer les risques pour les chaînes d'approvisionnement liées à ces dépendances stratégiques afin de renforcer sa résilience économique ». En outre, les pénuries constatées « peuvent mettre en péril les efforts que l'UE déploie pour atteindre ses objectifs climatiques et numériques ».
Les mesures doivent entrer rapidement en action pour aboutir à des résultats à horizon 2030. Elles sont en majorité intérieures et commencent par établir des listes mises à jour de matières premières critiques, et surtout de matières stratégiques : bismuth, bore, cobalt, cuivre, gallium, germanium, lithium, magnésium, manganèse, graphite, nickel, platine, terres rares, silicium, titane ou encore tungstène. L’Europe estime par exemple que la demande pour le lithium va être multipliée par 89 d’ici 2050, celle des terres rares par 6 ou 7, celle du gallium par 17, etc.
- L’Europe avance (doucement) « pour surmonter la pénurie de semi-conducteurs »
- Dans nos appareils, des matériaux « critiques » et « stratégiques »
Ces listes sont assorties de valeurs de référence claires. Ainsi, l’extraction dans l’Union doit permettre de couvrir au moins 10 % de sa consommation annuelle. La transformation doit atteindre 40 % de cette consommation et le recyclage 15 %. En outre, chaque matière ne devra jamais dépasser les 65 % d’approvisionnement depuis un seul pays tiers. En d’autres termes, l’Europe n’a que quelques années pour cadrer toute son industrie et multiplier ses sources d’approvisionnement.
Pour y parvenir, elle va notamment réduire la charge administrative et simplifier les procédures d’autorisation pour les projets relatifs à ces matières premières. Les projets sélectionnés auront droit à un soutien pour l’accès au financement. Les délais d’autorisation seront raccourcis : 24 mois pour les permis d’extraction, 12 mois pour ceux de traitement et recyclage.
La garantie des chaines d’approvisionnement se manifestera d’abord par leur suivi, qui impliquera notamment une coordination des stocks entre États membres. En outre, certaines « grandes entreprises devront réaliser un audit de leurs chaînes d'approvisionnement en matières premières stratégiques, comportant un test de résistance à l'échelle de l'entreprise ».
Renforcer les compétences et le recyclage
On trouve également deux autres mesures fortes, dont l’investissement dans « la recherche, l’innovation et les compétences ». La Commission compte renforcer l’adoption et le déploiement de technologies de pointe liées aux matières premières critiques. Elle mettra en place un « partenariat à grande échelle » pour le développement des compétences liées. Elle va aussi créer une « académie des matières premières » pour promouvoir, là encore, les compétences « pertinentes pour la main-d'œuvre travaillant dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques ». Enfin, l’Europe veut servir de « Global gateway », afin de devenir un « vecteur » d’aide pour les pays partenaires, toujours dans l’optique de « développer leurs compétences et leurs propres capacités d'extraction et de traitement ».
L’autre grande mesure concerne l’environnement, et plus spécifiquement l’amélioration de « la circularité et la durabilité des matières premières critiques ». Mais si l’Europe parle d’environnement, rappelons que les filières de recyclage sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important, au fur et à mesure que les matières se feront rares, puisqu’elles permettront leur réutilisation.
Pour preuve, les États membres vont devoir « mettre en œuvre des mesures nationales visant à améliorer la collecte des déchets riches en matières premières critiques et à garantir leur recyclage en matières premières critiques secondaires ». Et ce n’est pas tout, car ces mêmes États, tout comme leurs opérateurs privés, devront se pencher sur la récupération des matières premières dans les déchets d’extraction des activités minières, aussi bien les actuelles que les anciennes.
À l’international, la diversification des chaines d’approvisionnement
La Commission le dit clairement : « l'Union ne couvrira jamais ses propres besoins en matières premières et continuera de dépendre des importations pour la majeure partie de sa consommation ». Le commerce international, puisqu’il gardera son rôle « essentiel », va voir ses bases évoluer.
L’Union devra ainsi chercher des « partenariats mutuellement bénéfiques avec les marchés émergents et les économies en développement », le tout devant s’articuler autour de sa stratégie « Global Gateway ». Elle va créer un « club des matières premières critiques », qui vise à renforcer l’Organisation mondiale du commerce, élargir le réseau d’accord de facilitation des investissements durables et d’accords de libre-échange et à lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales déloyales.
En parallèle, une industrie « net zéro »
En même temps que le précédent règlement, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en a présenté un second, cette fois dédié à une industrie à « zéro émission nette » (Net Zero Industry Act). Rappelons que cette expression caractérise une production aussi réduite que possible (tendant vers zéro) de gaz à effet de serre, le reste étant réabsorbé par des moyens naturels (océans, forêts) ou compensations.
Dans l’Union, cette évolution se fera par étapes. Le règlement veut atteindre « une capacité européenne de production des technologies « zéro émission nette » correspondant à 40 % des besoins de l’UE, d’ici à 2030 ». En d’autres termes, 40 % de la production des technologies « propres » (batteries, éoliennes, biométhane, etc.) devront être réalisés directement au sein de l’Union d’ici quelques années.
« Nous devons développer notre base industrielle de technologies propres, pour créer de l'emploi, en Europe, et pour nous assurer un accès aux solutions propres dont nous avons besoin de toute urgence », a déclaré Ursula von der Leyen.
Le propos contient en fait deux composantes. La première concerne l’impact environnemental en tant que tel, car cette proposition de règlement est intimement liée aux objectifs de l’Europe en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, l’Union avait annoncé en septembre 2020 relever son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 40 à 55 % d’ici 2030.
Une réponse à peine cachée aux subventions américaines
L’autre composante est une réponse du berger à la bergère, en quelque sorte. Les États-Unis, avec l’IRA (Inflation Reduction Act) ont mis sur la table une gigantesque enveloppe de 500 milliards de dollars sur dix ans, contenant des subventions massives pour leurs producteurs de technologies propres. Séisme planétaire et particulièrement en Europe, où la crainte de voir les entreprises délocaliser outre-Atlantique est réelle.
Le règlement entend ainsi faire de l’Europe « l'épicentre de la production des technologies propres et des emplois verts ». Pour cela, le règlement mettra en place des conditions plus propices, en améliorant notamment les conditions d’investissement dans les technologies vertes (là encore, réduction de la charge administrative et simplification des procédures d’octroi de permis). Une priorité sera donnée aux projets stratégiques « zéro net », comme les sites permettent « de stocker en toute sécurité les émissions de CO2 captées ».
Une accélération du captage est aussi prévue, avec un objectif annuel de « 50 millions de tonnes dans les sites de stockage stratégiques du CO2 dans l'UE d'ici à 2030 », avec contributions proportionnelles des producteurs de gaz et de pétrole.
D’autres mesures sont prévues, comme la prise en compte obligatoire, par les pouvoirs publics, de critères de durabilité et de résilience dans le cadre des marchés publics et enchères. Signalons aussi le renforcement des compétences liées aux technologies « zéro net » et celui de l’innovation, en permettant notamment aux États membres la création de « bacs à sable règlementaires » pour tester des technologies. Une plateforme « Europe zéro net » sera en outre créée pour coordonner les actions et échanger des informations, « notamment autour des partenariats industriels ».
Dans le même ordre d’idée, l’Union souhaite mettre en place une Banque européenne de l’hydrogène, toujours dans l’optique d’apparaître comme le lieu idéal de production. Cet automne, et comme indiqué dans le plan industriel du pacte vert, se tiendront les premières enchères pilotes sur la production d’hydrogène renouvelable. « Les projets sélectionnés bénéficieront d'une subvention sous la forme d'une prime fixe par kg d'hydrogène produit pour une durée maximale de 10 ans d'exploitation ».
Ces deux règlements doivent maintenant être examinés et approuvés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union dans les mois qui viennent.


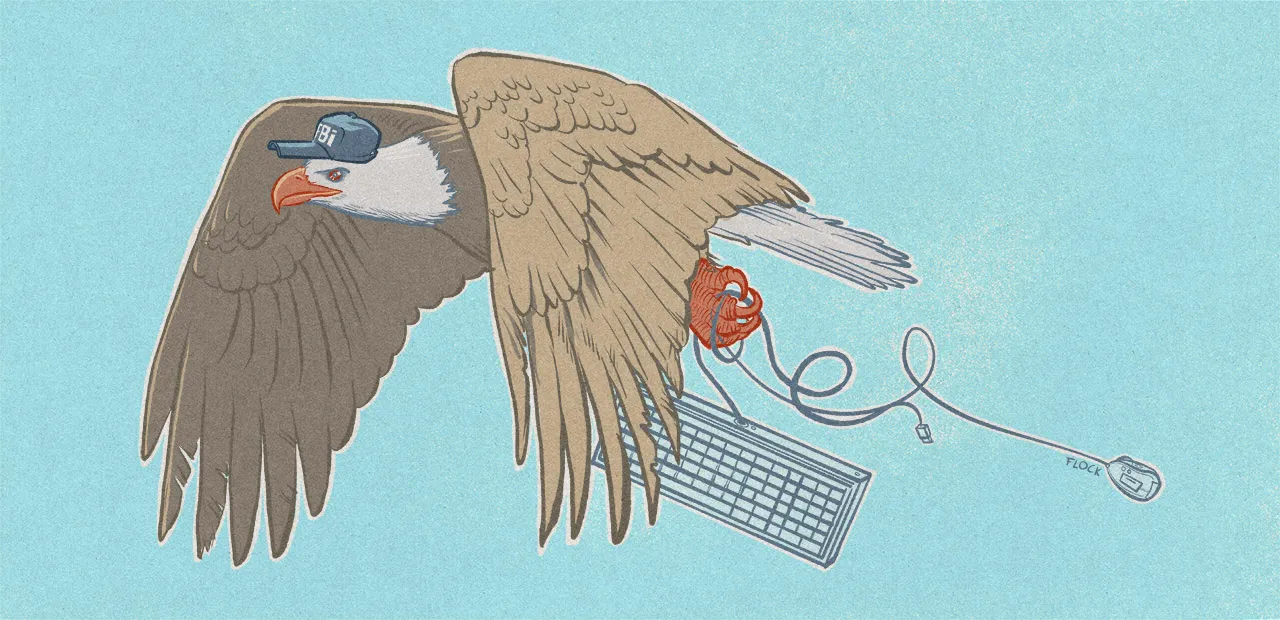
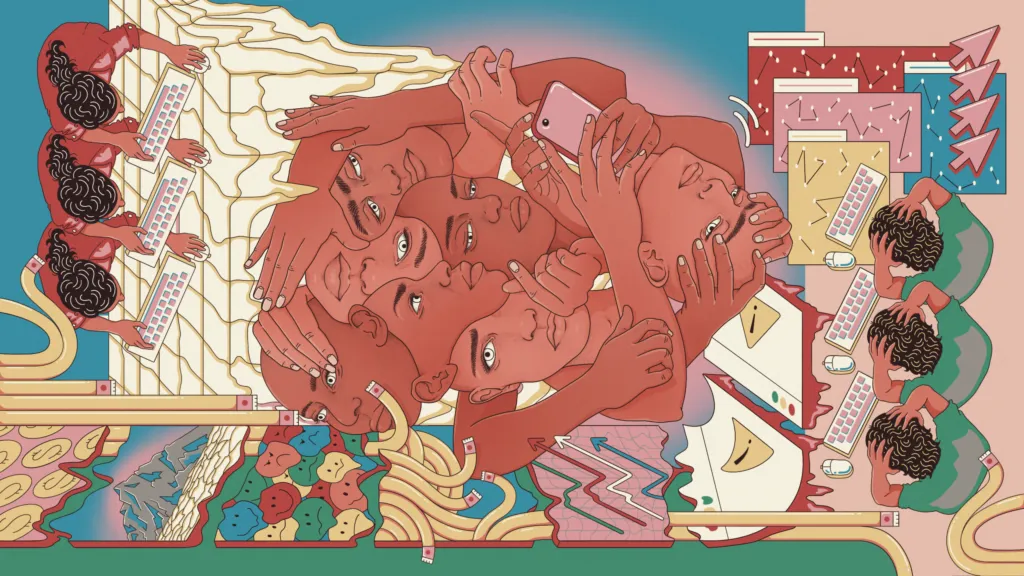
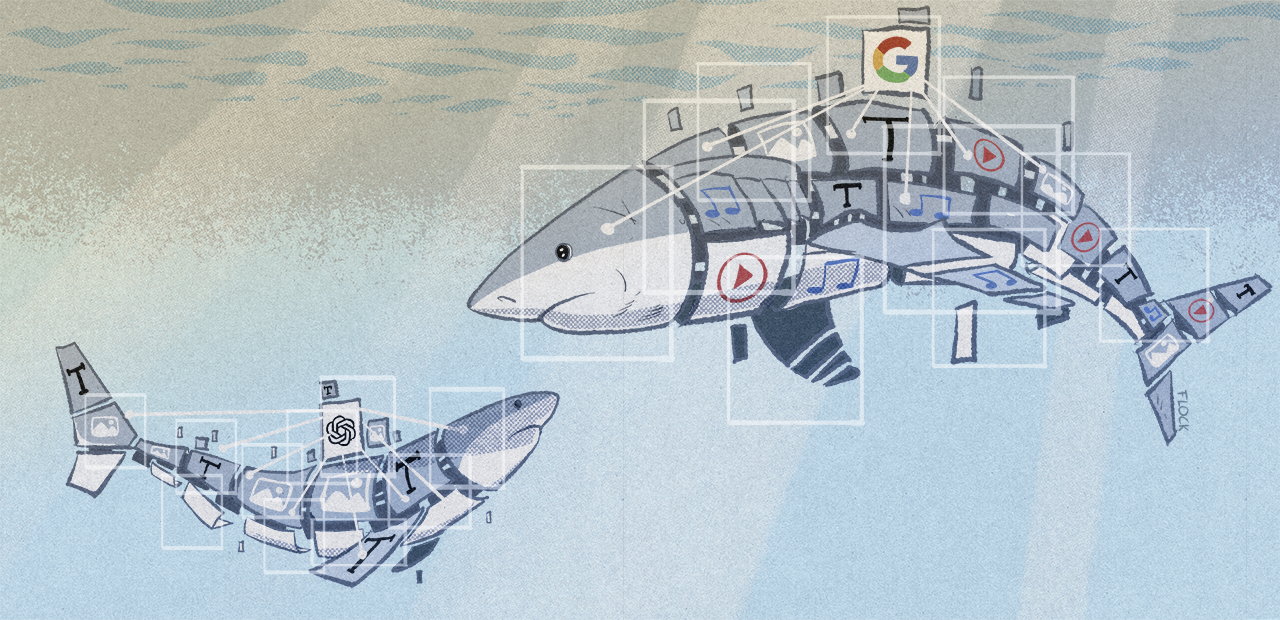

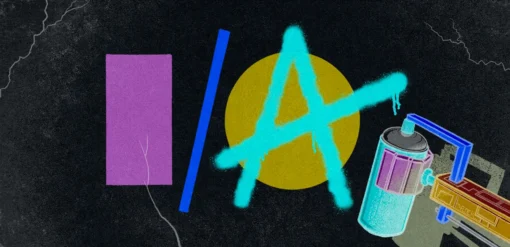

Commentaires (14)
#1
Mon rêve: récupérer le dioxyde de carbone pour fabriquer du graphite. Le top pour stocker le carbone sous une forme très stable en prime.
#2
Ouais, quand je vois qu’il y a des recherches pour stocker le dioxyde de carbone sous différentes formes industrielles, il semble (à moins qu j’aie loupé quelque chose) que la méthode naturelle, à savoir planter des arbres par exemple, ne soit pas une priorité. Peut-être pas assez intéressant financièrement pour certains ?… Des surfaces constructibles qu’i faudrait sacrifier ?…
#2.1
La plantation d’arbre c’est plus compliqué que ce que l’on fait actuellement (vidéo de 20 minutes).
En sois l’Europe s’est reverdie ces dernières décennies, mais ce n’est pas vraiment une solution et je crois que ce ne sera pas suffisant.
(je ne veux pas dire qu’il ne faut absolument pas le faire, juste que si on le fait il faudra bien le faire et que ce ne sera pas suffisant)
#3
Quand j’écoute cette experte (Aurore STÉPHANT),
https://www.thinkerview.com/aurore-stephant-effondrement-notre-civilisation-au-bord-du-gouffre/
je me dis le secteur minier ne pourra jamais suivre la demande, autant prévoir des systèmes réparable, conçus pour être recyclé et recycler.
#3.1
Grave même réaction, ils doivent avoir2-3 planètes de planquer à la commission européenne, s’pour ça…
#4
Aurore Stephant a été débunkée un nombre incalculable de fois. Thinkerview n’est pas une émission fiable (ils utilisent la stratégie complo/russe : commencer par des intervenants crédibles et des sujets consensuels pour asseoir leur sérieux avant de passer à de la désinformation).
https://twitter.com/ObjectifDefonce/status/1567593634328969218
Pour les débunks, entre autres :
https://twitter.com/Le_Reveilleur/status/1633444154553389063
J’ai pris pour une vidéo récente (ça doit d’ailleurs être celle que tu cites)
#4.1
Merci de ton retour, je vais essayer de croiser tes sources.
Par contre le defonceur n’étaye pas ses propos et semble faire du déni de sale gueule.
#5
J’avais vu l’interview d’Aurore Stéphant. Je viens de parcourir le débunk. Ce qui me pose problème, c’est que l’auteur du débunk dit qu’A.S. serait contre la transition énergétique et pour la continuation du système actuel adossé aux énergies fossiles.
Ce n’est absolument pas ce que j’ai retenu de l’interview. Ce que j’en ai retenu c’est que le système actuel ne peut pas continuer et que les plans de transitions (qui nous promettent de garder le même mode de vie) sont irréalistes.
#6
Je ne vois pas où il dit ça (en tout cas pas dans le thread de base). Le problème, c’est que rien ou presque, n’est dit concernant le fossile, et toute l’extraction minière est mise sur le dos de la transition (alors que le gros de l’extraction, même en faisant des projections avec les métaux de la transition, ça reste les combustibles fossiles), ça ressemble furieusement à des arguments contre la transition énergétique, même quand on se présente comme n’y étant pas opposé.
Les plans de transition ne permettent pas de garder exactement le même niveau de vie (ceux qui disent ça sont des menteurs, soit qu’ils aient qqch à vendre, soit qu’ils s’en servent comme homme de paille).
#6.1
Ici
#6.2
Dans les réponses du thread donc, ce qui explique que je n’avais pas vu à partir de mon lien. Ceci dit, je suis d’accord avec lui, A Stephant est soit idiote utile de l’industrie fossile et des climato-dénialistes, soit elle-même dans cette posture.
On ne peut pas dire ce qu’elle dit, et prétendre œuvrer pour le bien de tous.
#6.3
Je disconviens respectueusement.
Je ne crois pas qu’elle soit idiote et encore moins climatodenialiste et je ne crois pas qu’elle souhaite que le modèle de société actuelle persiste, voir mon commentaire #6.
Mais pour en être sûr, il faudrait lui poser la question directement.
#7
Ce que dit A. Stephant est partiellement faux et ignore l’impact des fossiles que ces systèmes visent à remplacer.
https://twitter.com/Gregdt1/status/1491843977519284224
#8
Non, Sky est vraiment un sale type à la solde du Kremlin, et ce n’est pas nouveau.
https://twitter.com/MusicOfMyFuture/status/1450917976249602054
https://www.paperblog.fr/9017864/les-reseaux-du-kremlin-n-existent-pas-mais-nous-les-avons-rencontres-thinkerview-berruyer-giletsjaunes-afd/