La mise en œuvre des droits voisins avance péniblement. Après le bras de fer des éditeurs et agences avec Google, c’est au tour des journalistes de réclamer leur part du gâteau aux éditeurs et agences, non sans difficulté.
Les droits voisins sont les contreparties financières auxquelles les éditeurs et agences peuvent désormais prétendre du fait de l’usage par les services en ligne de leurs titres, même sous forme d’extraits. L'idée ? Rétribuer leurs investissements, quand les géants du Net peuvent tirer parti de ces mêmes contenus en maximisant leurs retombées publicitaires et aiguiser leur attractivité.
Un fromage réparti autrement, en somme. Qui dit « rémunération » des droits voisins, dit nécessairement évaluation de ces droits. La loi du 24 juillet 2019, venue transposer l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur, impose de tenir compte des recettes d'exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou à défaut, d’engager une évaluation forfaitaire.
Le montant doit, dans tous les cas, prendre en compte des « investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse », de « la contribution des publications de presse à l'information politique et générale » et de « l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».
Cette liste n’est pas exhaustive, en ce sens que dans les négociations, d’autres intérêts peuvent être identifiés pour évaluer ces flux financiers.
Les services en ligne sollicités sont tenus à cette fin de révéler à ces futurs bénéficiaires « tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (…) et de sa répartition ».
Les éditeurs et agences face à Google
Google, premier parmi les premiers, avait été très tôt appelé à indemniser les éditeurs et agences. Le G de GAFAM avait cependant trouvé une astuce pour réduire à néant leurs espoirs : il a tenté de conditionner l’affichage de leurs extraits d’articles sur Google News à l’abandon de la moindre indemnisation.
Cet acte de résistance a été balayé par l’Autorité de la Concurrence qui lui a infligé une sanction de 500 millions d’euros en juillet 2021. De retour dans les rangs des bons élèves, Google a finalement pris une série d’engagements, acceptés par l’AdlC pas plus tard que la semaine dernière.
Entretemps, éditeurs et agences se sont organisé pour créer la société des Droits Voisins de la Presse (DVP), avec Jean-Marie Cavada à sa tête, celui-là même qui, eurodéputé, avait milité bec et ongles pour la reconnaissance de ce mécanisme indemnitaire.
Les premières cibles de cette société gérée par la SACEM et le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) ? Google, Facebook et Microsoft.
Les syndicats de journalistes face aux éditeurs et agences
Sur le ring des droits voisins, quid des journalistes ? La directive sur le droit d’auteur organise un partage des montants perçus par les éditeurs et agences : « Les États membres prévoient que les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse ».
Le texte se garde bien de définir ce qu’est la « part appropriée ». En France, la loi de transposition a précisé que cette portion perçue par les journalistes doit être « équitable », négociée par accord au niveau de l’entreprise ou par accord collectif. À défaut, elle est déterminée par une commission paritaire, encadrée par décret.
Un communiqué des syndicats de journalistes (SNJ - SNJ-CGT - CFDT-JOURNALISTES - SGJ-FO) révèle cependant que la répartition des droits voisins connaît de nouvelles difficultés.
Si le bras de fer entre Google et les éditeurs et agences touche aujourd’hui à sa fin, les journalistes ont visiblement du mal à obtenir leur part du gâteau.
Les syndicats du secteur plaident avant tout pour un accord de branche afin « de fixer un cadre devant permettre à l’ensemble des journalistes de percevoir la part "appropriée" et "équitable" qui leur revient, et de ne pas léser les auteurs les plus précaires ».
Les éditeurs n'ont d'yeux que pour les accords d'entreprise
Le 17 mai à cette fin, ils réclamaient aux représentants des éditeurs et agences de presse « l’ouverture de discussions de branches afin de trouver un accord au plan national ».
Dans leur réponse, le Syndicat de la presse quotidienne départementale, le Syndicat de la presse quotidienne régionale et enfin le Syndicat de la presse quotidienne nationale ont tous vanté les mérites d’une négociation d’entreprises, plutôt qu’un tel accord de branche qu’ils rejettent en choeur.
Pierre Louette (SPQN) considère par exemple qu'une négociation limitée au périmètre de chaque groupe de presse serait la plus à même d’assurer aux journalistes une rémunération significative et rapide. Et Jean-Michel Baylet (SPQR) d'insister dans le même sens, sans imaginer l'alternative de l'accord de branche pourtant prévue par la loi.
La réalité dépeinte par les syndicats de journalistes le 23 mai dernier est moins clinquante : « des remontées des premières négociations commencées en entreprise, il ressort (…) que les éditeurs n’entendent céder aux auteurs des contenus que des miettes des fonds versés par les GAFAM, sous forme d’un "forfait" annuel fixe ».
Voilà qui tranche avec les propos de Jean-Noël Tronc, alors numéro 1 de la SACEM, qui avait tenu à mobiliser les journalistes à la cause des droits voisins, à l’approche des échéances européennes en 2018 : « Je voudrais juste dire aux journalistes qui sont avec nous et la presse que c’est d’abord leur combat. Cela fait des années que des pays d’Europe, l’Espagne, l’Allemagne ont essayé d’adopter une rémunération normale pour que Google ou Facebook, qui s’enrichit grâce à la presse, rémunère aussi votre travail. Ce n’est toujours pas le cas. Il n’y aura pas de solution nationale. Il doit y avoir une solution européenne. C’est aussi et d’abord ça qui se joue mercredi prochain. Voilà, tous ensemble, merci ! »
Vers une mise à jour législative ?
Quatre ans plus tard, les quatre syndicats de journalistes sont donc désormais obligés de réclamer une mise à jour législative pour que les notions de part « appropriée » et « équitable » soient précisées, tout en validant « le fait qu’elle doit faire l’objet d’un pourcentage intégrant l’ensemble des opérateurs redevables du droit voisin ».
Ils souhaitent par ailleurs être autorisés à défendre leurs intérêts sous la forme d’un organisme de gestion collective pour les représenter. Ils plaident également en faveur d’« une gestion collective obligatoire pour l'ensemble des éditeurs, qui permette une mutualisation de la répartition des sommes entre petits et gros. »
En mai 2019, durant les débats parlementaires, les députés LFI avaient déjà demandé que la rémunération des journalistes ne puisse être inférieure à 50 % des sommes perçues par les éditeurs et agences, et ce au titre du « ruissellement » de la richesse.
Leur amendement n’avait pas survécu aux critiques de Patrick Mignola, rapporteur du texte. « Il pourrait arriver que ce montant soit supérieur à 50 %. Pourquoi la loi le fixerait-elle à 50 % ? » avait opposé le député MoDem. « Le droit voisin est défini par rapport à l’investissement consenti par un éditeur de presse ou une agence de presse. Cet investissement peut être matériel, technologique et surtout humain. Sous réserve que la théorie du ruissellement existe, les journalistes devront nécessairement en bénéficier ».
Et celui-ci d’insister : « Pour certains éditeurs, l’investissement humain dans le travail journalistique peut parfois être supérieur à 50 %, et parfois moindre. Je ne crois pas qu’il revienne au législateur de se substituer à une négociation relevant du droit du travail ».


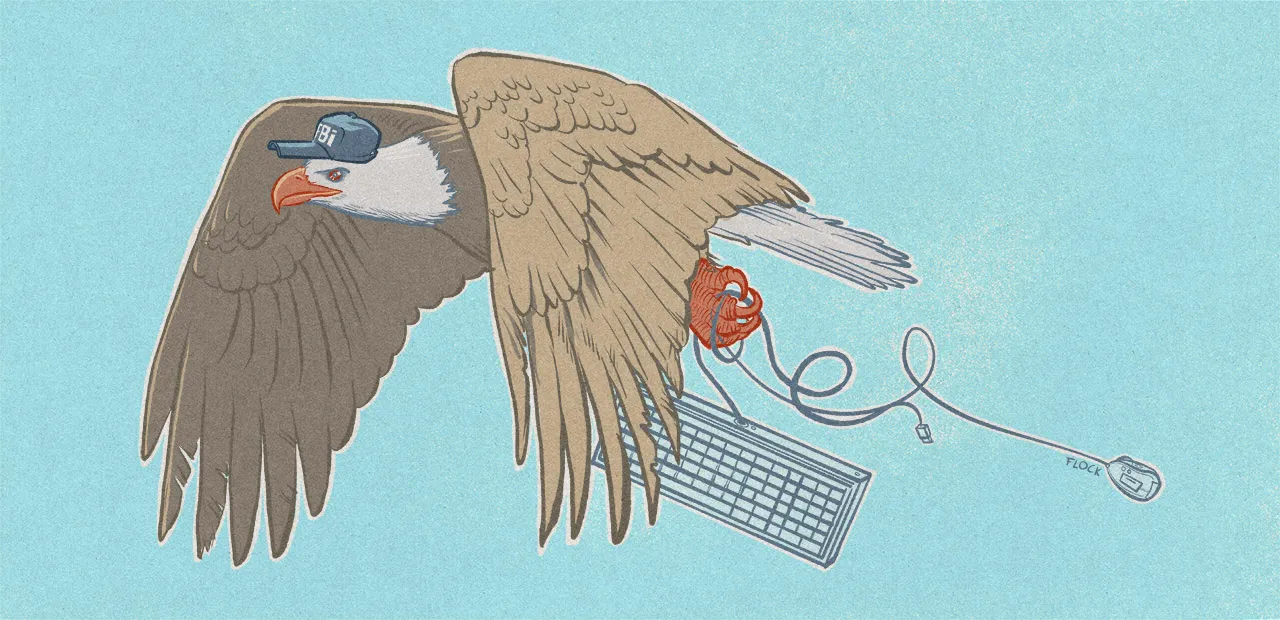
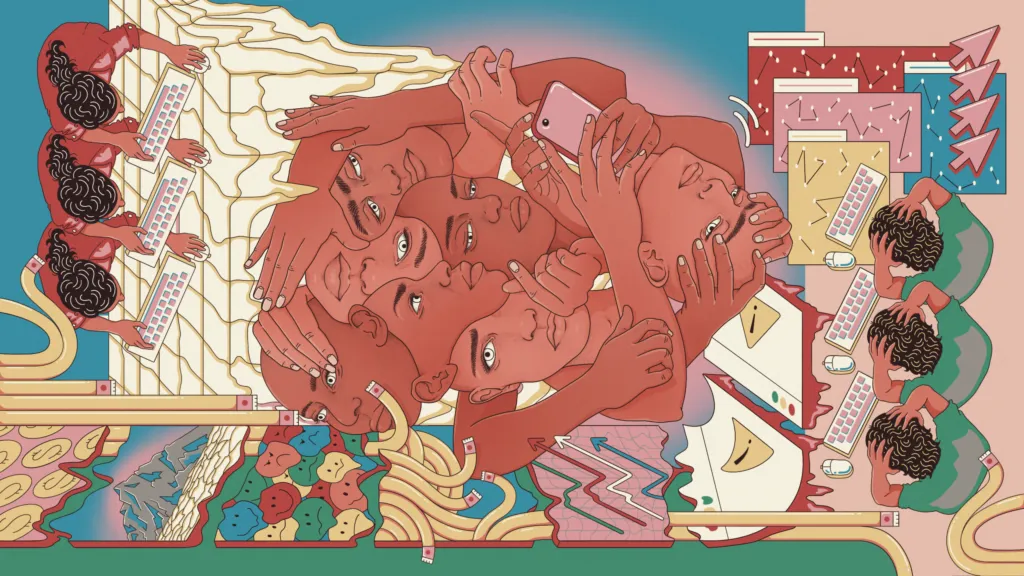
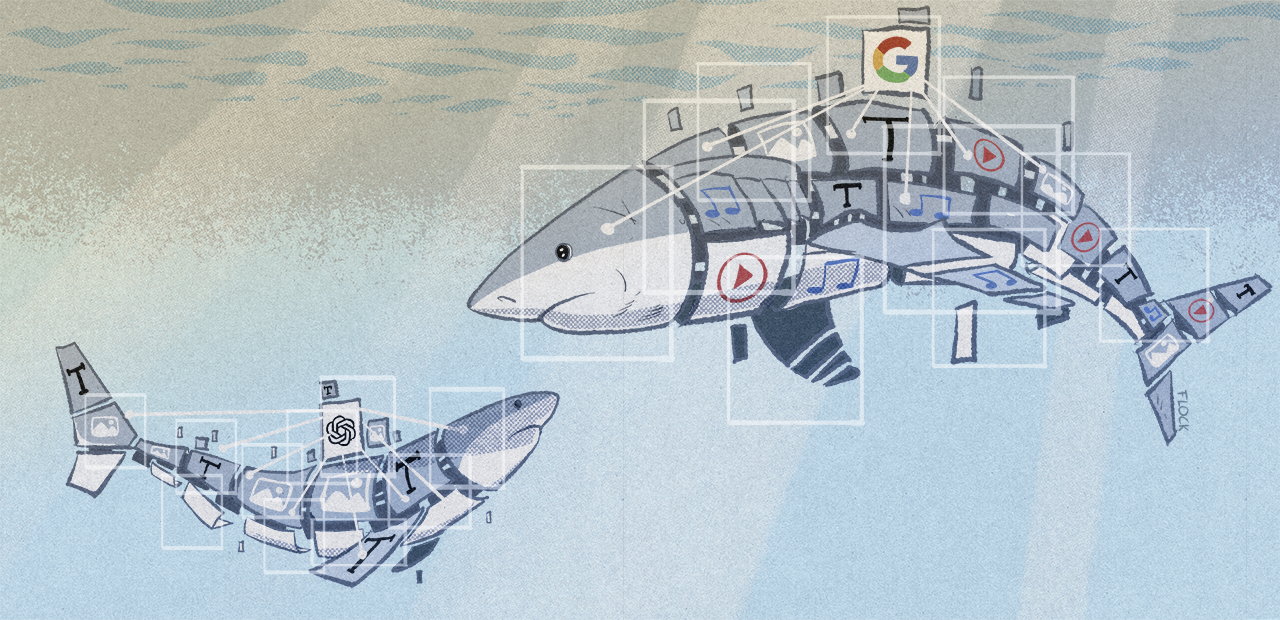

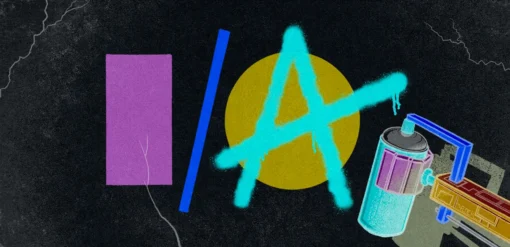

Commentaires (12)
#1
Quelle surprise !!!
#2
Pourquoi le commentaire de Citan666 a été supprimé ?
J’ai pu le lire, je ne vois pas en quoi c’était un troll.
#2.1
Ce n’était pas un troll. Mais apparemment même chez NXI parfois la vérité crue ne passe pas : les journalistes n’ont pas fait leur taff à l’époque en défendant un texte moisi au prétexte que ça servirait leur intérêt, et se plaignent ensuite de faire partie des dindons de la farce à leur corps défendant. Vu qu’ils ont ainsi contribué à faire accepter un texte profondément destructeur en termes de libertés, c’est un retour de karma pleinement justifié (en plus d’avoir été parfaitement prévisible).
#2.2
C’était un troll dans sa formulation très agressive, nous n’avons pour habitude de supprimer un commentaire quand il nous gêne, notre historique à ce sujet est suffisamment éloquent.
Pour le reste, c’est une discussion pour Marc :)
#3
C’est pas faute de les avoir prévenus.
Ils ont été les idiots utiles, ils ont joué leur rôle, maintenant il rapporte du blé à leurs propriétaires.
Merci pour tout.
#4
Ce n’est pas en le réécrivant que ça passera mieux. Si on laisse pire, c’est qu’on ne l’a pas vu, parce que ne nous pouvons pas être partout. Et on ne justifie pas une chose par une autre jugée “pire”.
Le message peut être sans problème écrit en se passant d’expressions violentes.
#5
Ce n’est pas violent, ni insultant. Irrespectueux vu que je vise personne particulièrement c’est assez bizarre comme concept. Mais au moins c’est plus compréhensible.
Je ne trolle quasiment jamais, et me modérer sur cette raison, ÇA C’EST VIOLENT ET IRRESPECTUEUX. Tenez le vous pour dit.
Quant à l’expression en elle-même “Allez vous faire xxx” ou similaire ça ok je comprendrais. “Bien fait pour vous” faudra m’expliquer en quoi c’est agressif, vis-à-vis d’une population de toute façon non présente sur le site à priori. Vu que je ne vous incluais pas.
#5.1
Le fait de ne “presque jamais troller” ne donne pas de droits supplémentaires pour le faire une fois de temps en temps.
Tu n’as pas dit “Bien fait pour vous” (qui serait resté) mais “Bien fait pour votre G”. Pour le reste, les formulations de type “Tenez-vous le pour dit” sont déjà bien assez péremptoires
#6
It’s just business, as usual
#7
« Jamais je n’ai trollé, vous entendez, JAMAIS. Sauf une fois… au chalet. »