Un an après le lancement de la 5G, qu’en est-il de l’exposition aux ondes des populations ? Les résultats de l’ANFR « montrent que l’exposition est comparable ». Sur la bande des 3,5 GHz, il faut néanmoins s’attendre à une hausse de 20 % environ à terme.
En guise de préambule, l’Agence nationale des fréquences rappelle que Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a présenté en octobre 2020 un « programme de mesures pour l’évaluation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques ».
Il s’inscrit dans le cadre du lancement de la 5G, qui a ouvert commercialement en novembre. Ce travail de l’ANFR sur la mesure et le contrôle des niveaux d’exposition aux ondes est pour rappel complété par celui de l’l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) sur la question des risques sanitaires liés à la 5G, notamment sur la « nouvelle » bande des 3 500 MHz.
- 5G : coup d’envoi dès le 18 novembre, l’Arcep prépare un observatoire des déploiements
- 5G et risques sanitaires : notre analyse du long rapport mi-figue mi-raisin de l’ANSES
Dans le cadre de l’étude préliminaire dont il est aujourd’hui question, environ 3 000 mesures ont été effectuées sur près de 1 650 sites 5G répartis sur le territoire : 85 % en milieu urbain, 15 % en zones rurales, une répartition proche de celle de la population française qui se trouve à 80 % en zone urbaine. L’ANFR avait pris le soin de mesurer les niveaux d’exposition de certains sites avant l’activation de la 5G afin d’avoir une base de comparaison.
« Les sites ont été sélectionnés à partir des demandes d’autorisation COMSIS (comité de concertation des sites et servitudes) déposées par les opérateurs de téléphonie mobile. La déclaration de mise en service par l’opérateur a ensuite permis à l’Agence de planifier les mesures en 5G sur ces mêmes sites », explique-t-elle. Elle a évidemment dû s’adapter car certains sites prévus n’ont finalement pas été déployés lors des mesures.
Trois bandes de fréquences et deux « cas »
Trois bandes sont actuellement utilisées par les opérateurs pour la 5G : 700 MHz (Free Mobile uniquement), 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR) et 3 500 MHz (les quatre opérateurs). Les deux premières sont également utilisées pour d’autres technologies mobiles (2G, 3G ou 4G), la dernière est exclusivement 5G.
Afin d’entrer dans le vif du sujet, une précision importante : le protocole utilisé par l’ANFR est la V4.0 d’août 2017. Il détaille deux types de mesures :
- Cas A : il « tient compte de toutes les sources et fréquences radioélectriques significatives. Il repose sur l’utilisation d’une sonde large bande couvrant la bande 100 kHz – 6 GHz. Cette sonde a une sensibilité de 0,38 V/m ». C’est une mesure globale de l’exposition aux ondes, toutes fréquences confondues.
- Cas B : « il suppose l’utilisation d’un analyseur de spectre et fournit une mesure détaillée de chaque contribution à l’exposition dans cette même gamme de fréquences ». Les mesures avec le cas B se concentrent donc sur une bande de fréquences bien précise et sont généralement faites après un cas A.
700 et 2 100 MHz : circulez, il n’y a rien à voir
Dans la bande des 700 MHz, 87 sites ont fait l’objet de mesures détaillées avant/après l’activation de la 5G, c’est-à-dire dans le cas B. La conclusion de l’ANFR est sans appel : cela « n’a pas modifié la distribution des niveaux dans cette bande et 99 % des mesures (avant comme après) se sont révélées inférieures à 2 V/m ».
La moyenne passe de 0,30 à 0,31 V/m, la médiane de 0,16 à 0,16 V/m et le maximum de 2,09 à 3,14 V/m. Dans le détail, il y a des hausses et des baisses : « 91 % des écarts sont compris entre -0,3 et 0,3 V/m ce qui représente une variation très faible (rappelons que les émissions sont considérées comme significatives à partir de 0,3 V/m) ». Au-delà de l’activation de la 5G, la variation du trafic au moment des mesures peut expliquer ces résultats.
L’ANFR a aussi procédé à un comparatif de 143 sites avec le protocole de mesure cas A, soit le niveau d’exposition aux ondes global, toutes les fréquences confondues. Le résultat est du même acabit : « il ressort que plus de 92 % des écarts sont compris entre -0,4 et 0,4 V/m (rappelons que la sensibilité de la sonde est proche de 0,4 V/m et que les écarts ne sont considérés comme significatifs qu’à partir de 0,3 V/m) ».
De plus, « la moyenne des écarts sur l’exposition globale avant et après l’activation de la 5G ressort à 0,07 V/m, valeur très faible proche de 0 V/m. Cette valeur, compte tenu de la précision des instruments, conduit également à considérer que l’exposition globale générée après l’activation de la 5G sur la bande 700 MHz reste comparable à celle constatée avant son activation ».
Dans tous les cas, on est très (très) loin de la limite réglementaire qui est de 36 V/m sur les 700 MHz.
L’ANFR passe ensuite aux 2 100 MHz, en commençant encore par le cas B, qui permet pour rappel de ne mesurer l’exposition que dans cette bande. Même conclusion qu’avec les 700 MHz : « Il en ressort que l’activation de la 5G dans la bande 2 100 MHz n’a pas modifié la distribution des niveaux dans cette bande et que 100 % des mesures "avant" sont inférieures à 2 V/m et près de 99 % des mesures "après" sont inférieures à 2 V/m ».
La moyenne est de 0,45 V/m (-0,01), la médiane de 0,33 V/m (+0,03) et le maximum passe de 1,83 à 2,58 V/m, là encore largement en dessous du seuil réglementaire qui est à 61 V/m sur les 2 100 MHz. « 82 % des écarts sont compris entre -0,3 et 0,3 V/m ».
Avec le cas A du protocole, l’activation de sites sur les 2 100 MHz n’apporte pas plus de changements sur les niveaux globaux d’exposition aux ondes. La moyenne générale baisse de 0,02 V/m, la médiane augmente de 0,03 V/m et le maximum passe de 4,98 à 4,33 V/m. « Dans plus de 77 % des cas, les écarts sont compris entre -0,4 et 0,4 V/m, proche de la sensibilité de la sonde (0,38 V/m) ».
Là encore, « ces variations peuvent être expliquées par la variation du trafic entre deux mesures ». Pour résumer, l’activation de sites 5G sur les 700 MHz et les 2 100 MHz n’a pas eu d’impact notable sur les niveaux d’exposition aux ondes, que ce soit sur ces fréquences ou au niveau global.
5G sur les 3 500 MHz : des niveaux globaux inférieurs à 1 V/m
Passons maintenant à la bande au cœur de la 5G : les 3 500 MHz. Elle a fait « l’objet d’une vaste opération de réaménagement ». En 2020, elle était encore utilisée en France par « des réseaux de BLR (Boucle Locale Radio) fonctionnant avec la technologie WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ».
Par contre, à la « fin de l’année 2020, avant la mise en service de la 5G, plus aucune émission n’était autorisée dans la bande attribuée à la téléphonie mobile, les niveaux d’exposition attendus correspondaient donc au niveau de bruit résiduel ».
1 359 sites 5G en 3 500 MHz sélectionnés pour des mesures. 1 063 sites ont fait l’objet d’une mesure détaillée après le déploiement (cas B) et 112 ont eu droit au même traitement de faveur avant le déploiement. 1 062 et 111 sites ont finalement été pris en compte, car l’un d’entre eux « a été démonté et déplacé d’une quinzaine de mètres, ce qui ne permet pas de comparaisons fiables ».
La première analyse concerne la contribution de la seule bande des 3 500 MHz sur l’exposition : « les résultats font ressortir que près de 100 % des niveaux mesurés restent inférieurs à 1 V/m ». La moyenne des mesures avec la 5G activée est de 0,11 V/m, la médiane de 0,07 V/m et le maximum mesuré de 2,1 V/m. « Ce niveau apparaît très faible comparé au niveau de référence (valeur limite) dans la bande considérée (61 V/m) », explique l’Agence.
3 500 MHz : activer la 5G entraine une augmentation réelle, mais faible…
Sur l’échantillon de 111 sites, la moyenne était de 0,02 V/m avant l’activation de la 5G et correspond donc au « niveau de bruit » de cette bande. La médiane était pour sa part à 0 et le maximum né dépassait pas les 0,30 V/m.
Une fois la 5G activée, les niveaux sont en hausse : 0,15 V/m de moyenne, médiane à 0,09 V et maximum à 1,25 V/m. La moyenne progresse donc de 0,13 V/m : c’est « faible mais sensiblement supérieure à celles observées pour les bandes basses qui sont de 0,01 V/m pour la bande 700 MHz et de -0,01 V/m pour la bande 2 100 MHz ».
De plus, la distribution des hausses et baisses n’est plus centrée autour de 0 V/m comme c’était le cas sur les fréquences basses : « la grande majorité des écarts sont positifs et traduisent une augmentation de l’exposition, qui apparaît faible puisqu’elle reste non significative pour la majorité des cas ».
… qui ne change pas grand-chose sur les mesures globales
L’ANFR passe à l’exposition globale (cas A) en se basant sur les 1 359 mesures. La moyenne passe de 1,16 à 1,17 V/m, la médiane de 0,75 à 0,74 V/m et le maximum de 6,19 à 5,41 V/m. Des changements non significatifs dans les deux premiers cas, tandis que la baisse du maximum ne veut pas dire grand-chose puisque cette valeur est susceptible de changer en fonction de nombreux paramètres.
« Dans plus de 93 % des cas, la variation est comprise entre -0,4 et 0,4 V/m, donc proche de la sensibilité de la sonde. Dans près de 4 % des cas, une augmentation moyenne de 0,6 V/m est observée tandis que dans près de 3 %, on constate une diminution moyenne de 0,7 V/m ».
Bref, l’ANFR arrive à la conclusion que « à ce stade de l’étude que l’exposition globale aux ondes électromagnétiques générée par des sites hébergeant la 5G sur la bande 3 500 MHz est restée comparable à l’exposition sur ces mêmes sites générés par des générations antérieures de téléphonie mobile (2G/3G/4G) sur les bandes basses ».
Et si on « charge » le réseau ?
L’arrivée de la 5G dans les 3 500 MHz « n’a entraîné qu’une augmentation très faible du niveau de l’exposition globale ». Mais il y a un dernier point à prendre en compte : « le trafic 5G reste faible » pour le moment.
L’Agence a donc décidé de « créer artificiellement du trafic pour étudier l’effet de la 5G sur l’exposition globale en simulant une plus forte utilisation dans cette bande ». Près 370 sites ont fait l’objet de mesures détaillées sur les 3 500 MHz lors du téléchargement d’un fichier de 1 Go. L’ANFR propose deux catégories de résultats : une moyenne des mesures prises pendant le téléchargement, puis une moyenne des mesures sur une période de six minutes.
Dans les deux cas, le bilan est le même : sur les 3 500 MHz, il y a bien « une augmentation de l’exposition due au téléchargement du fichier ». Elle reste néanmoins limitée avec 0,3 V/m dans le cas de la moyenne sur 6 minutes.
Afin d’estimer l’impact que cela pourrait avoir sur le niveau global, « la mesure spécifique avec sollicitation de la 5G est intégrée par calcul dans l’exposition globale » aux ondes. Il en ressort une hausse de la moyenne de 0,13 et 0,14 V/m, « soit une augmentation en moyenne de 14 % et 16 % respectivement ».
Fort de cette expérience, l’ANFR en déduit « qu’une augmentation du trafic de la 5G conforme à l’indicateur d’exposition introduit par l’ANFR devrait à terme engendrer une augmentation de l’ordre de 20 % sur le niveau global de l’exposition ».

L’Agence rappelle au passage que « cette bande offre par ailleurs 50 % de capacité supplémentaire pour les réseaux mobiles ouverts au public ». Elle permet de proposer des débits plus importants, mais aussi de soulager les autres fréquences qui sont de plus en plus sollicitées avec l’augmentation incessante de la consommation sur mobile.
Quoi qu’il en soit, l’Agence ne s’arrête pas là et continue sa campagne de mesures sur le terrain. Ce rapport, qui est pour le moment préliminaire, sera donc complété ultérieurement.













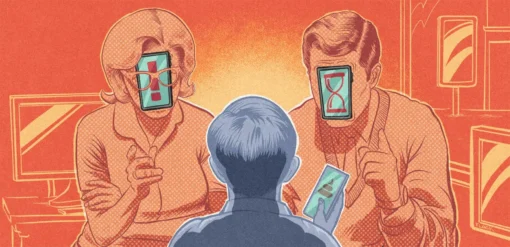

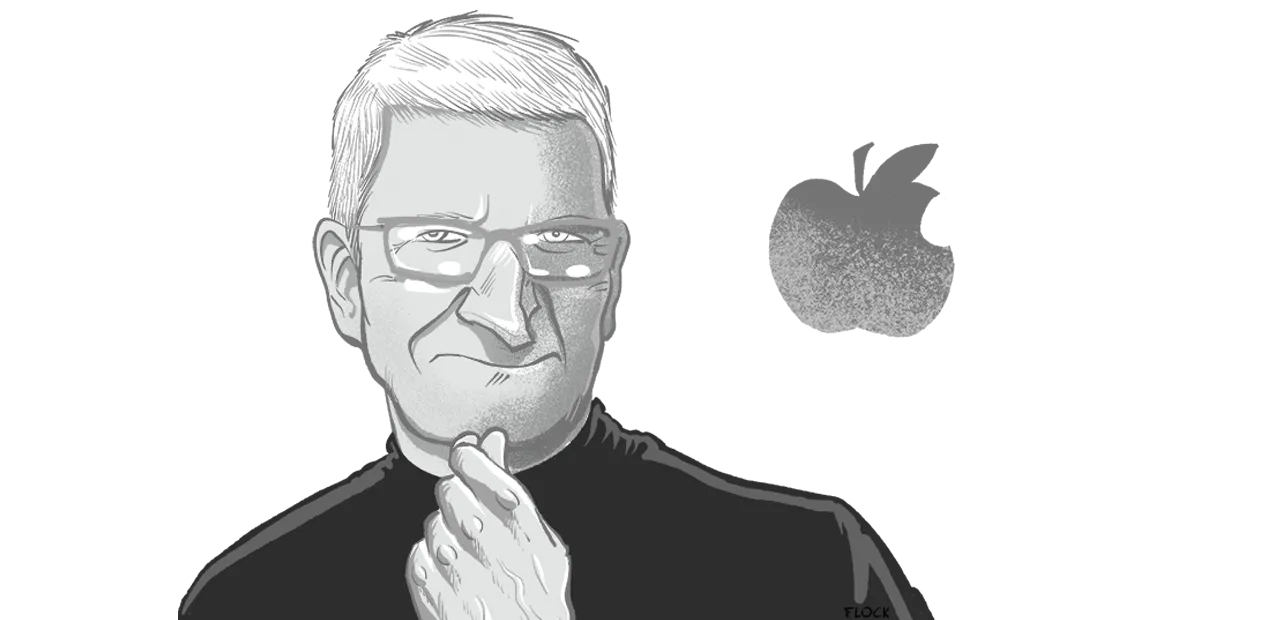
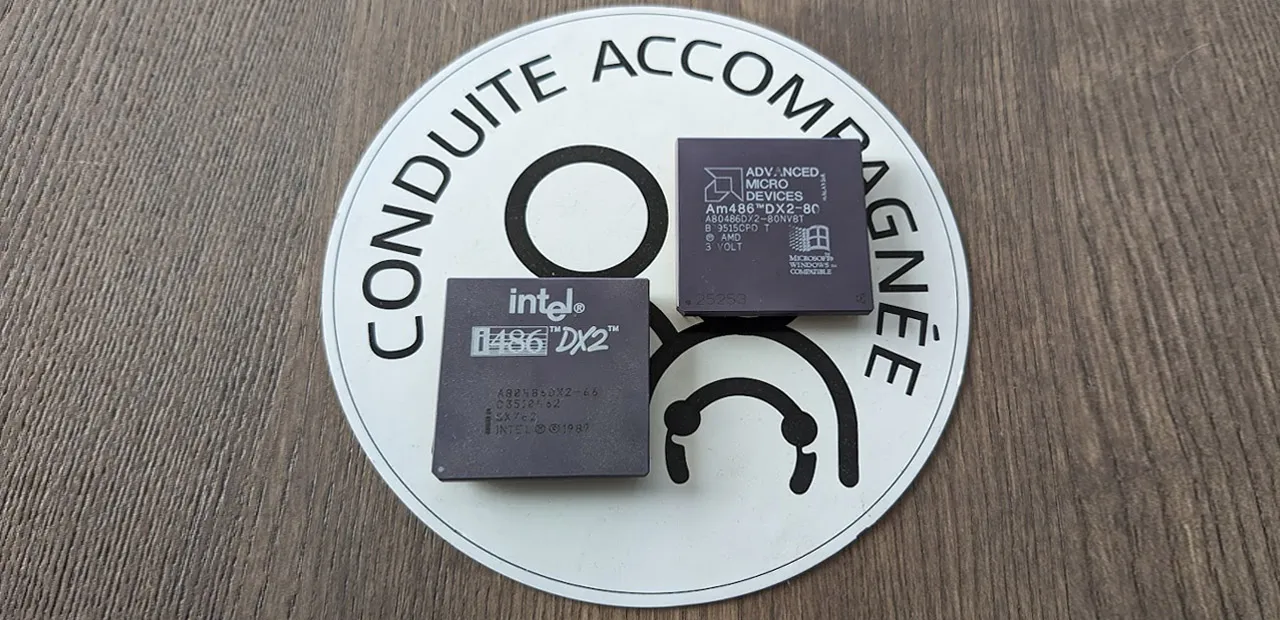
Commentaires (14)
#1
Je ne comprends pas les deux courbes de la dernière partie (Et si on « charge » le réseau ?).
L’axe des abscisse (“Mesure”), c’est le temps ? (J’imagine vu que 6 min ça fait 360 secondes, mais c’est pas clair du tout…)
Et du coup pourquoi il y aurait une augmentation du niveau de champ avec le temps et une augmentation brutale à la fin de la mesure, notamment quand il n’y a pas de téléchargement…
#2
Euh mais à terme, les usagers vont transiter de la 3/4G vers la 5G générant donc du trafic sur les bandes de la 5G mais moins de trafic sur les bandes des 3 et 4G. Est-ce que cela a bien été pris en compte dans leur estimation ?
#3
Oui tu peux mesurer le taux de pénétration de la 5G ENTRE les ~360 mesures. Mais c’était pas l’idée… il faudrait qu’ils ajoutent toutes les courbes de chaque fréquence en concession. Puis, en faire la courbe de v/m moyenne.
#4
Je n’ai pas encore lu l’étude mais je pense que oui. Il y a un effet rebond, les nouvelles capacités de la 5G vont engendrer de nouveaux usages, plus consommateurs, donc une exposition en hausse.
#5
Non. Mais je suis d’accord, c’est latent : il est dit qu’ils font une soustraction sur les fréquences pour discrétiser la courbe 3500mhz etc de l’ensemble 5G.
Sans logique additive l’exposition en v/m globale reste spéculée, et surtout par l’ANFR…
Les tangentes des Jevons sont donc à peu près dissimulées… je trouve aussi dommage de ne pas communiquer sur ce point crucial.
#6
J’ai l’impression que l’abscisse c’est le numéro de la mesure et qu’il correspond au temps en secondes.
Par contre, je ne m’explique pas la quantité de points ni, comme toi, le pic à la fin.
Vu que les 2 courbes sont censées êtres prises à des moments différents, je ne vois que la personne qui prend les mesures qui a fait foirer les données en se rapprochant des antennes avec son téléphone dans sa poche pour arrêter la prise de mesure.
#7
On râle sur la HADOPI et son budget, mais perso je râle autant sur ce genre de chose, qui ne sert à rien concrètement, et qui sert juste à rassurer (et encore) une partie minoritaire de la population, qui ne comprend rien à la physique : « programme de mesures pour l’évaluation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques ».
#7.1
J’avoue que je ne comprends pas l’intérêt non plus, ca fait 50 ans qu’on étudie scientifiquement les effets des ondes sur le vivant, on a toujours rien trouver d’autre qu’un effet thermique inoffensif.. (ce qui m’empêche pas de chier sur la 5G qui est absolument inutile m’enfin c’est un autre débat..)
#7.2
Oui, et une fois qu’on comprend l’aspect “rayonnement non ionisant” (versus l’inverse), on ne peut guère avoir de crainte.
#7.3
Le but n’est que de rassurer la population en espérant que ce genre de choses soit repris pour compte dans les médias de masses. Les gens aiment quand ils y a des mots savants même s’ils n’en comprennent pas la définition. Bref, une façon de dire, non la 5G n’est pas dangereuse.
Par contre, je trouve que ce genre d’études n’est pas inutile. Déjà pour s’assurer que les normes de puissances sont respectées mais aussi d’autres choses comme le “bavage” des antennes (même si non reportés ici) sur des bandes non-autorisées.
#8
J’ignorais qu’on pouvait marcher sans sentir la force de gravité mais j’avoue que le commun des mortels ne peut saisir la gravité de ton propos… ce qui explique pourquoi nos chevaliers de l’invisible ne sont pas des conquérants de l’inutile.
Après tout, ce qui s’affirme sans preuve etc.
#9
J’allais dire “arrête de fumer la moquette et de faire des commentaires incompréhensibles” et je vois que tu as choisi un émoji en rapport avec ton activité
#9.1
C’est bien, me voilà catalogué anti-moquettes… retourne donc à Leroy Merlin t’acheter un interrupteur, ça relativise le temps.
#10
Et c’est pourquoi un petit nombre de mauvais chercheurs (dont Monsieur Bronner) classent circonstantiellement dans la catégorie “complotistes” les personnes exerçant un simple droit constitutionel : le droit de proprieté.
On s’étonne que ces personnes du poste à subside confondent complot et état de droits tout autant que la déontologie sur laquelle ils bavent…
Elle est dangereuse pour le droit de proprieté. Mais pas plus que le sont déjà les autres ondes.
Oui on peut aussi voir ce phénomène.