Lors de la conférence Spectre & Innovation de l’ANFR, une des tables rondes était centrée sur les nouvelles communications spatiales, avec une question : « eldorado ou Far-West ? ». Un peu des deux. Pour le moment, c'est un peu le Far-West, mais cela pourrait devenir l’eldorado pour ceux qui sont les plus rapides.
C’est la « guerre économique »
Didier Le Boulc’h, vice-président strategy et telecoms solution chez Thales Alenia Space, a développé un rapide exposé de la situation. Cela permet de mieux en comprendre les enjeux. Déjà pour répondre à la question, il explique que « du point de vue industriel, c’est plutôt la guerre économique, car il y a une véritable course ». La raison est assez simple : comme pour toutes les technologies sans fil, le spectre n’est pas infini et les fréquences sont donc un bien rare et extrêmement précieux.
Les acteurs se livrent ainsi une course afin d’être le premier à proposer un modèle économique capable de tenir la route, permettant de récolter des fonds et de se lancer, dans tous les sens du terme. Dans cette course, « les premiers prennent les fréquences et s’assoient un tout petit peu sur les règles de priorité de l’UIT [Union internationale des télécommunications, ndlr] ». Sans oublier qu’ils prennent au passage des parts de marchés importantes.
Constellations LEO et GEO : avantages et inconvénients
Didier Le Boulc’h propose ensuite de comparer les constellations LEO et GEO. Il s’agit respectivement de l'orbite terrestre basse (low earth orbit ou LEO) qui s’étend jusqu’à 2 000 km environ, et de l’orbite géostationnaire (GEO) à 36 000 km d’altitude. Entre les deux, on retrouve aussi l’orbite MEO. Nous avons détaillé les différentes orbites dans notre dossier sur Ariane 6.
À première vue, les satellites des constellations sur des orbites basses « paraissent beaucoup moins chers – car plus petits, plus légers et fabriqués en série – mais il en faut aussi beaucoup » comparé à ceux des constellations géostationnaires.
Si les satellites GEO sont immobiles par rapport à un point fixe sur Terre, ce n’est pas le cas des LEO qui traversent le ciel. De plus, « ils passent une grande partie de leur temps sur les pôles, sur les océans où il n’y a pas beaucoup de trafic, ou sur des pays dans lesquels ils n’auront pas de licence ». Par exemple, des satellites américains n’ont pas vraiment de chance d’avoir des clients chinois ou russes, et vice-versa.
Pour Didier Le Boulc’h, « le temps d’utilisation moyen d’un satellite LEO c’est peut-être 10 à 15 %, alors que le satellite géostationnaire, s’il est bien conçu et agile, va être utilisé à 100 % ». Au final, l’équation s’équilibre à peu près, selon l’intervenant, bien que cela dépende de plusieurs paramètres.
Il ajoute même que « les gros géostationnaires récents sont plus compétitifs sur le coût du bit transmis que la plupart des constellations LEO… sauf les plus massives qui vont faire 10 000 satellites et vont écraser les prix, les lancer eux-mêmes à prix coutant », etc. Toute ressemblance avec Starlink de SpaceX – qui réutilise en plus ses premiers étages à tour de bras – n’est pas fortuite. Les satellites LEO ont par contre un avantage indéniable sur les GEO : une latence beaucoup plus faible. Pas besoin de faire plus de 70 000 km pour un aller-retour avec le satellite. Et sur ce point, la technologie ne peut rien faire puisque le facteur limitant est la vitesse de la lumière.
La problématique des stations au sol
Par contre, avec des satellites sur des orbites basses, il faut que les terminaux puissent traquer les satellites, qui se déplacent dans le ciel, pour rappel.
Le vice-président de Thales cite en exemple l’opérateur O3B (qui appartient depuis 2016 au luxembourgeois SES). Il dispose de satellites sur des orbites MEO et d’un réseau d’antennes paraboliques (équipées de moteurs) un peu partout dans le monde.
« Ça marche bien, c’est performant et ce n’est pas très cher, mais ça peut tomber en panne ». Et ce n’est pas toujours évident et rapide pour un opérateur du Luxembourg de se déplacer sur un site en Afrique pour procéder aux réparations par exemple.
Mais la solution existe déjà : « ces solutions mécaniques sont un peu dépassées et laissent la place à des antennes électroniques […] Ça marche très bien et c’est joli… mais petit défaut : ça coutait jusqu’à présent très cher […] Les constellations américaines sont en train de montrer un exemple impressionnant de réussite industrielle : elles arrivent à faire des antennes actives qui coutent 1 000 euros, peut-être 500 euros demain et voire encore moins ».
Pour Didier Le Boulc’h, pas de doute : « c’est un défi que l’Europe doit relever pour la constellation Iris². Si on fait des terminaux qui coutent 100 000 euros, on aura un peu de mal à vendre des services ». Il faut donc trouver une solution, mais « c’est faisable, car les technologies à la base de ces antennes actives américaines sont européennes ».
De nouveaux services… qui intéressent les militaires
Les nouvelles constellations sont par défaut pensées pour proposer de nouveaux services, notamment les communications avec des smartphones et des véhicules connectés, mais les opérateurs vont devoir se livrer une guerre du spectre, car il n’y aura pas de la place pour tout le monde.
Deux pistes sont à l’étude : « on partage le spectre des réseaux terrestre et c'est la galère à coordonner » ou « on travaille dans les bandes des opérateurs mobiles, mais ils sont très peu nombreux et tous en train de devenir américains avec Inmarsat qui est en train de se faire racheter par Viasat ». Les stocks de fréquences vont donc être rares, et certainement vendus à prix d’or au plus offrant.
Didier Le Boulc’h pointe du doigt un autre « petit risque » : les départements de la défense et les militaires s’intéressent beaucoup à ce genre de service : « On a lancé ça comme des projets commerciaux, mais maintenant les militaires – en particulier les Américains – se rendent compte que ça peut être extrêmement intéressant aussi pour eux d’avoir un téléphone mobile dans les champs de bataille qui peut causer sur un réseau sécurisé qui ne passe pas par les réseaux de télécommunications des gens qu’ils sont en train d'agresser ».
Sans oublier que la question de souveraineté doit être prise au sérieux sur ces enjeux : « il y a une course pour ce spectre et l’Europe doit défendre ses intérêts, sinon on serait un peu naïfs ».
Avis d’encombrement ! Il n’y aura pas de place pour tout le monde
Éric Fournier, directeur de la DPSAI (Direction de la planification du spectre et des affaires internationales) à l’ANFR détaille les risques liés à l’encombrement de l’espace par des constellations de satellites, et pourquoi il faut être dans les premiers à se lancer.
Entre deux satellites GEO, le partage de l’espace est finalement assez simple : on « tire » dans la bonne direction et on laisse 2 à 3° de marge par rapport à l’autre satellite GEO, en fonction des bandes de fréquences. Chacun vise un point fixe au sol, ce n’est pas plus compliqué.
Avec l’arrivée des constellations, il faut éviter les alignements entre le satellite d’une constellation et l’arc géostationnaire ; cela provoquerait des brouillages. Avec deux constellations, les choses se compliquent : « s’il y a deux satellites de deux constellations différentes qui sont alignés avec un même point de la terre, il y a un risque de brouillage ». En théorie, cela peut se gérer grâce à la multitude de satellites d’une constellation qui peuvent servir de relai les uns avec les autres.
Renaud Vogeleisen (responsable des fréquences chez Airbus Defence & Space) explique que, « plus votre constellation est grosse, plus vous aurez la capacité d’éviter l’arc géostationnaire ou les autres constellations […] Mais plus elles sont grosses, plus ça sera difficile de les coordonner entre elles […] C’est assez paradoxal ».
« C’est pour ça que je parlais de véritable course, car les premiers qui vont arriver, se déployer et avoir le droit d’émettre laisseront peut-être de la place à un deuxième acteur qui devra se coordonner par rapport au premier suivant les règles de priorité », ajoute Didier Le Boulc’h.
Mais ce sera déjà plus compliqué pour le deuxième puisque son « business plan va se fragiliser un petit peu ». Il faudra en effet qu’il s’éteigne de temps en temps en cas d’alignement avec l’autre constellation, ou qu’il bascule sur un autre satellite. Cela demande donc d’en construire et d’en lancer plus que s’il était seul sur place. Quant à un troisième acteur qui devra composer avec deux autres constellations et les satellites GEO, « je pense que son business plan sera tellement fragilisé qu’il n’ira pas ».
Six places à prendre, l’Europe doit être présente
Pour résumer, il y a six places à prendre : « deux constellations en Ku, deux en Ka et peut-être deux dans les bandes basses… et voila ». Et il faut que l’Europe arrive à s’y imposer. « On souhaite tout le bonheur à Eutelsat avec OneWeb Gen 2 qui a pris une des places en Ku et qui doit transformer l’essai avec une constellation qui doit être compétitive par rapport à ce que fait Elon Musk ».
Il y a quelques années, l’ANFR rappelait que « même si la plupart des projets prévoient aujourd’hui d’utiliser les bandes 20/30 GHz (bande « Ka »), ou, dans le cas de OneWeb, la bande 11/14 GHz (bande « Ku »), les bandes 40/50 GHz (bandes « Q/V ») sont envisagées par de nombreux projets ». Quand bien même de nouvelles fréquences sont utilisées, il y aura toujours la problématique des brouillages au-delà de deux constellations… et encore, on ne parle même pas des risques d’encombrement de l’espace avec des dizaines de milliers de satellites.
L’intervenant en profite pour expliquer un peu les « règles du jeu », qui ne sont pas les mêmes pour les sociétés européennes et les entreprises américaines. Les premières sont privées, côtées en bourse et se doivent donc d’avoir une certaine rentabilité – ou au moins ne pas perdre d’argent –, alors que « Amazon ou Elon Musk, c’est exactement ce qu’ils font. Ils ont une capacité à perdre de l’argent sur des durées qui semblent presque indéterminées. Ils ne jouent pas exactement avec les mêmes règles que nous ».
Même si Starlink (la constellation de SpaceX) perd de l’argent depuis ses débuts (et pendant encore des années probablement), « si on modélise ce qu’ils vaudront dans 20 ans, on arrive à une estimation entre 20 et 80 milliards selon les hypothèses ». Bref, en France et en Europe, « il y a vraiment besoin de réagir ».
Dans sa conclusion, Gilles Brégnant (directeur général de l’ANFR) revient sur « l’urgence » de la situation face aux géants du Net et autres entreprises qui s’installent dans l’espace : « il n’y a que six places si j’ai bien compris. Il faut en prendre au moins une, peut-être plus, pour l’Europe. La Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) 23 sera cruciale pour établir des règles, on va s’y atteler »

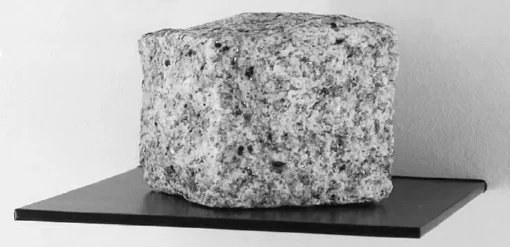





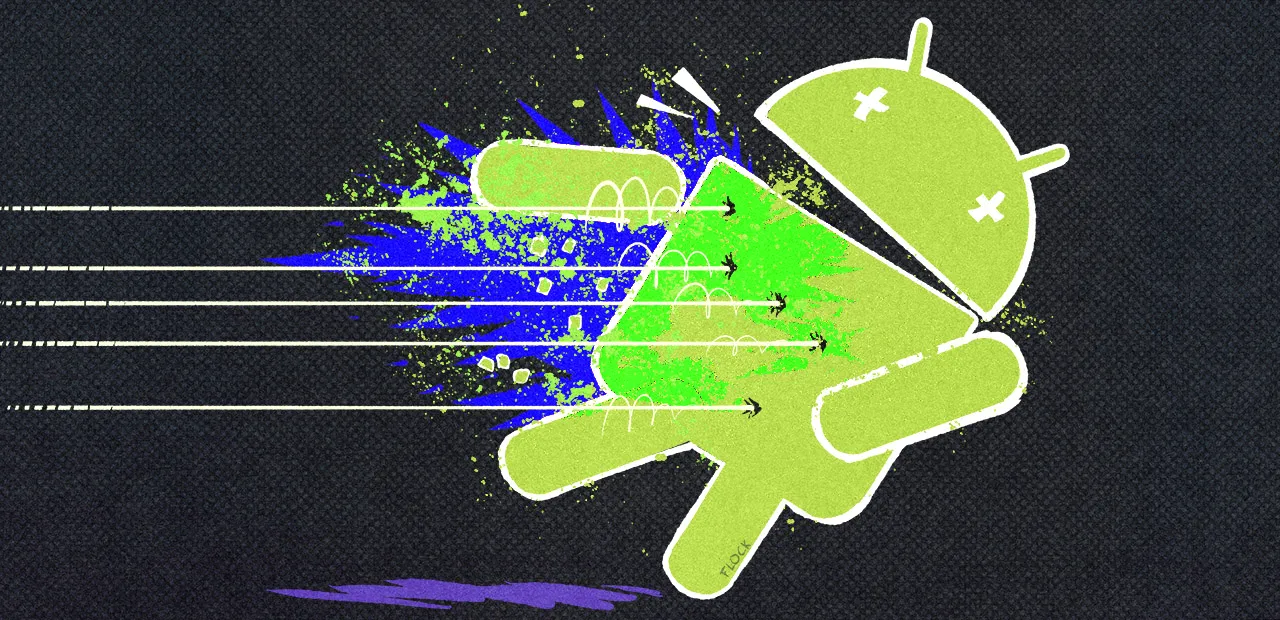

Commentaires (9)
#1
En Europe (France), on a EutelSat (qui a racheté OneWeb).
Les Luxembourgeois ont SES.
Ces deux là sont coté en Bourse en Europe.
Et ils sont extrêmement rentable (même les Russes passaient par EutelSat, c’est dire !).
#2
Et l’encombrement du ciel, cela n’a pas été évoqué ?
#2.1
+1
6 places à 10-15000 satellites? Déjà que cela commence à être une plaie pour les astronomes avec la constellation starlink.
#3
L’astronomie a, hélas, bien peu de chance face à l’appât du gain :(
Valorisation entre 20 et 80 mrd$ pour Starlink dans 20 ans ! Tu m’étonnes qu’ils veulent tous faire leur constellation…
#3.1
heu, ça c’est pas gagné du tout, je ne vois pas comment on peut prévoir ça,
les technologies fixes se développent aussi, il n’est pas sûr que le créneau de l’aubaine dure très longtemps.
Surtout si l’espace n’est qu’une immense déchetterie de bouts de ferraille à force de collisions, ça deviendra difficile d’y faire passer des ondes, mais en même temps, ça peut aider à atténuer l’effet de serre
#3.2
C’est dans l’article :
« si on modélise ce qu’ils vaudront dans 20 ans, on arrive à une estimation entre 20 et 80 milliards selon les hypothèses »
C’est une modélisation, donc oui, c’est pas gagné du tout.
#4
Eutelsat n’a que 20% de Oneweb, le reste appartenant aux indiens, anglais et japonais. Pour la souveraineté c’est raté. Quant a leur rentabilité, leur capitalisation a été divisée par 6 en 10 ans
#4.1
Ne pas confondre rentabilité, qui est liée au chiffre d’affaire et aux bénéfices de l’entreprise, et sa cotation en bourse qui représente la “valeur” de l’entreprise aux yeux des marchés.
Je bosse chez Eutelsat, et malgré la baisse continue du chiffre d’affaire depuis plusieurs années, c’est une machine à cash (à son échelle bien sûr). Son EBITDA tourne autour de 75% chaque année, donc pour 100€ de chiffre d’affaire il reste 75€ en banque une fois payer tous les frais pour faire tourner l’entreprise (hors impôts, investissements …). Même Apple dépasse rarement les 35% !
Ce qui ne plaît pas aux marchés c’est la contraction lente mais régulière du cœur de métier d’Eutelsat (télévision par satellite) et surtout l’annonce de la future fusion avec OneWeb. OneWeb a besoin d’énormément de financements pour lancer la 2ème génération de sa constellation, la première devant être terminée d’ici la fin 2023. Eutelsat a annoncé qu’en cas de fusion il n’y aura plus de dividendes pour au moins les deux prochains exercices fiscaux … et avec un rendement dividende par action de 9% en moyenne les actionnaires qui restent focalisés sur le très court-terme n’ont pas appréciés !
#5
L’EBITDA ne veut rien dire sur la vraie performance financiere d’une boite, il est trop facile de le manipuler en sortant du calcul des dépenses soit disant non-operationelles et un fort endettement. La cotation boursière prend en compte tous ces elements, toute l’information disponible sur les flux financiers actuels et futurs.