Gonfler le prix barré d’un produit permet à un site de e-commerce d’afficher une grosse réduction de façon artificielle. Le stratagème pourrait disparaître. À partir du 28 mai 2022, une directive européenne encadre la définition de ce prix de référence. Elle rétablit une règle supprimée il y a sept ans.
« 260 € d’économie » : c’est la réduction alléchante qu’affichait le site Cdiscount pour un smartphone Samsung Galaxy S20 FE 4G, début mai pendant l’opération promotionnelle des French days. Au lieu de 659 euros (son "ancien" prix, selon Cdiscount, qui affiche ce montant comme prix barré), l’appareil est proposé à 399 euros.
Une super affaire ? Pas si sûr… Car au même moment, de nombreux autres sites proposent ce modèle à des tarifs voisins, entre 380 et 400 euros, y compris Samsung sur sa propre boutique en ligne. Surtout, Cdiscount lui-même vendait cette version du Galaxy S20 à 449 euros début avril, selon une ancienne version de la page, conservée en copie sur le site archive.org. Bref, le prix barré de 659 euros sert surtout à pouvoir afficher une grosse réduction – Next INpact vous avait pourtant prévenu de vous méfier des prix barrés !

La nouvelle règle : le prix le plus bas des 30 jours précédents
Ce genre d’annonces illusoires qui pullulent sur le web pourrait bien disparaître. Une disposition issue de la directive européenne sur les règles de protection des consommateurs vient mettre de l’ordre dans les annonces de réduction de prix (directive 2019/2161 dite directive « omnibus », transposée en droit français fin 2021). Applicable au 28 mai 2022, elle encadre précisément le prix de référence (ou prix barré) qui sert à calculer les remises. Jusqu’à présent, les professionnels disposaient d’une grande liberté dans le choix de ce prix, autorisant de nombreux excès.
Le prix antérieur à la réduction, obligatoirement affiché, devra désormais correspondre « au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix », selon le nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation. Cela revient, peu ou prou, à rétablir une règle ayant existé en France avant 2015.
Il s’agit de garantir que les remises affichées sont authentiques. Cette période de référence de trente jours « a pour objectif d’empêcher les professionnels de jongler avec les prix et d’afficher de fausses réductions de prix, comme augmenter le prix pendant une courte période avant de le baisser par la suite en faisant passer cela pour une réduction (importante) du prix qui induit en erreur le consommateur », indique le document d’orientations publié par la Commission européenne sur cet aspect.
Cette règle « garantit donc que le prix de référence est réel et qu’il ne s’agit pas d’un simple outil de marketing visant à rendre la réduction attrayante. »
L’Europe rétablit ce qu’elle avait supprimé
Aujourd’hui, l’utilisation de prix de référence anciens ou peu appliqués afin de gonfler artificiellement les réductions fait l’objet de critiques récurrentes : les défenseurs des consommateurs montent au créneau sur le sujet par exemple lors du Black Friday ou lors des soldes.
Ironie de l’histoire : si c’est l’Union européenne qui vient mettre de l’ordre dans ces pratiques, c’est par elle que le désordre était arrivé. En France, la règle du prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents la réduction figurait déjà dans la réglementation depuis… 1977 ! Il s’agit de l’arrêté 77-105/P, étudié par des générations de juristes. Plus récemment, elle était reprise dans un arrêté de 2008.
Mais ce vieux principe n’a pas résisté à la montée en puissance du commerce en ligne, où tous les coups sont permis pour éviter que l’internaute parte cliquer chez le concurrent. Ainsi, le site Cdiscount, épinglé pour de nombreuses promotions litigieuses, a entrepris de contester la réglementation française il y a une dizaine d’années. La justice européenne lui a donné raison en septembre 2015. Elle a estimé que le droit de l’Union européenne ne permettait pas un cadre aussi restrictif.
Les autorités françaises ont donc abrogé la règle des 30 jours. Depuis cette époque et jusqu’à aujourd’hui, la réglementation (arrêté du 11 mars 2015) laisse une grande marge de manœuvre aux magasins physiques et sites de vente en ligne. Ils déterminent librement le prix de référence, à condition de pouvoir le justifier et de ne pas tomber dans la pratique commerciale trompeuse.
Le prix conseillé par le fabricant ne pourra pas être utilisé
C’est donc cette période d’encadrement très lâche, propice aux promotions fantaisistes, qui prend fin le 28 mai 2022. Mais le retour à la situation antérieure n’est pas complet. Les nouvelles règles sont plus contraignantes que celles en vigueur avant 2015. À l’époque, était également admis comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant. La directive européenne ne prévoit pas cette possibilité.
Ce garde-fou peut se révéler précieux concernant les produits high-tech, dont les prix dégringolent rapidement après leur arrivée sur le marché. Aujourd’hui, de nombreuses offres utilisent comme prix de référence un « prix conseillé par la marque » obsolète. C’est le cas de Cdiscount pour l’exemple du Galaxy S20 : le prix barré de 659 euros, qui laissait croire à une réduction colossale, est indiqué comme étant « le prix conseillé par la marque en juin 2021 ». En réalité, il n’était plus vraiment pratiqué depuis longtemps… Avec la nouvelle réglementation, Cdiscount ne pourra plus utiliser ce montant comme prix barré.
La règle du prix le plus bas dans les trente jours précédents connaîtra toutefois quelques exceptions. Elle ne s’applique pas pour les réductions de prix sur les produits périssables, ni en cas de réductions successives (par exemple, la 2e démarque lors des soldes), ni lorsqu’un revendeur compare ses prix à ceux d’autres revendeurs.
Les sanctions dépendront de l’ardeur des contrôles
Pour un professionnel, le non-respect de ce nouvel encadrement du prix de référence sera considéré comme une pratique commerciale trompeuse, passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Les e-commerçants les plus agressifs sur les promotions trouveront-ils de nouveaux stratagèmes pour échapper aux annonces de réduction loyales ? Ou peut-on enfin espérer un grand ménage ?
Les promotions douteuses étant particulièrement enracinées, tout dépendra de la fréquence et de la sévérité des contrôles. C’est l’administration de la répression des fraudes (DGCCRF) qui en a la charge. Mais son action est limitée par ses faibles moyens : le manque d’effectif est régulièrement dénoncé par les syndicats de l’administration.
Pour faciliter leur travail, les internautes peuvent signaler les réductions suspectes via la plateforme officielle signal.conso.gouv.fr. Dans la rubrique « Achat (magasin ou Internet) » figure des sous-rubriques « Prix » puis « Fausse réduction de prix ».





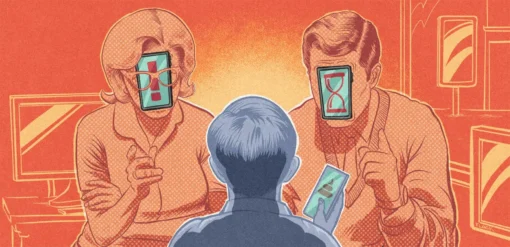

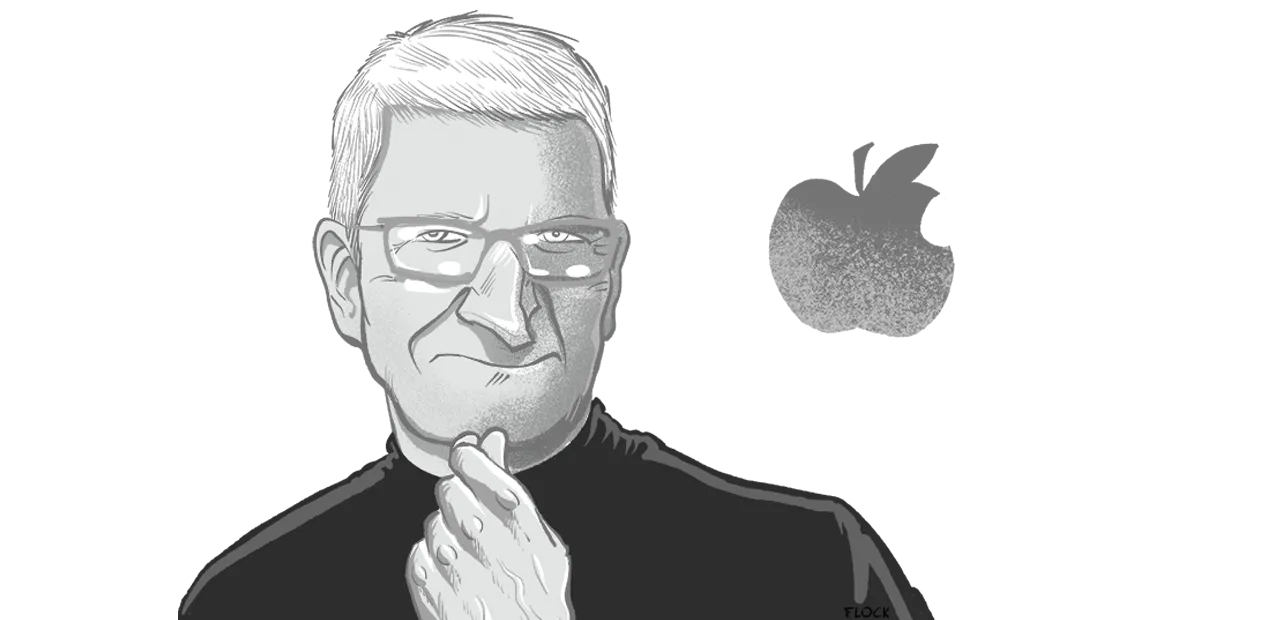
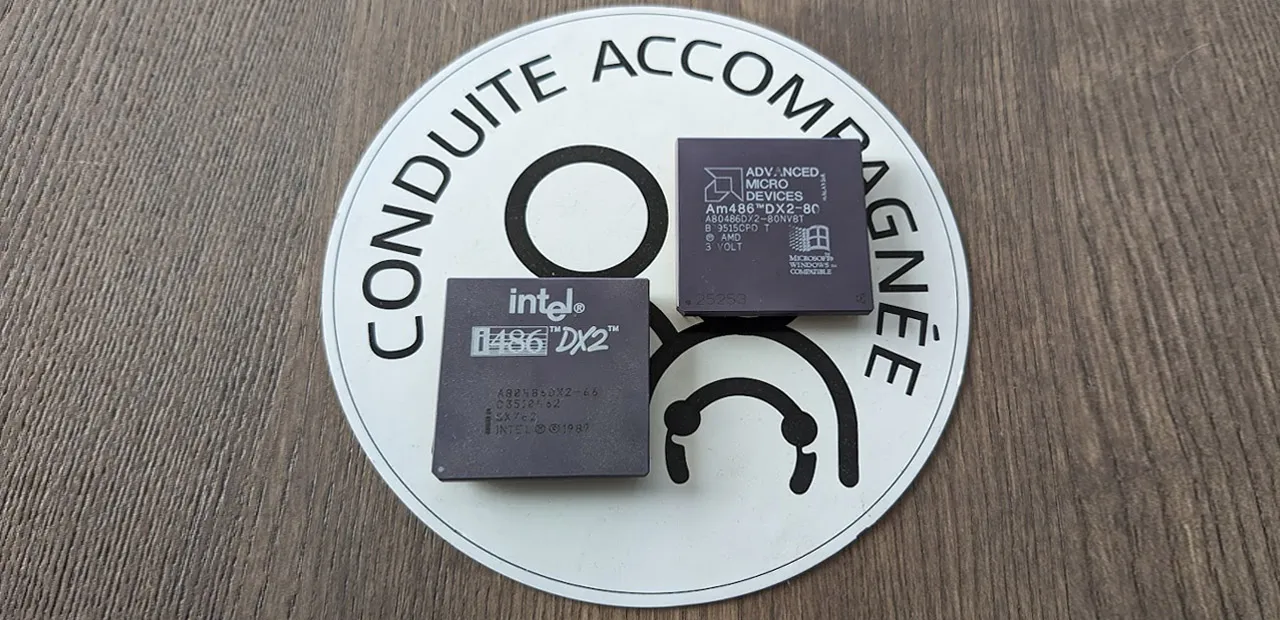
Commentaires (24)
#1
Il suffirait que les clients ne se laissent pas berner, et ce système disparaîtrait de lui même.
#1.1
Ou juste de n’autoriser à afficher que le prix effectif, le prix de référence ne servant qu’à embobiner le consommateur un peu con
#1.3
C’est un peu condescendant de traiter les autres de con? Mais je comprends l’idée dans le fond, juste que la façon de la présenter dans la forme n’est pas la meilleure selon moi.
#1.2
Pour ça encore faudrait-il justement que les clients aient les outils et la capacité de savoir qu’ils se font berner. C’est le même souci que la pub mensongère.
C’est trop facile de rejeter la faute sur les utilisateurs, arnaqués, plutôt que sur les vendeur, arnaqueurs. (et c’est valide pour énormément de domaines d’ailleurs).
Le mieux reste donc bien évidemment de faire quelque chose contre les arnaques.
#2
Faire, défaire et refaire c’est un moyen comme un autre de se créer du travail.
C’est sûr cette foi ci on ne changera plus, ou pas.
#3
Le bug créé aujourd’hui sera ton travaille de demain

#4
Donc il suffit de baisser le prix pendant une heure, pour ensuite dire qu’il a été pratiqué pendant les 30 jours, et valider le principe du prix cher barré ?
#4.1
Je n’ai pas compris la même chose que toi.
Dans ton exemple, si un commerçant baisse un prix pendant une heure, et fait une “promo” dans les trente jours qui suivent, ce sera ce prix “baissé une heure” qui devra servir de prix barré.
Ce serait se tirer une balle dans le pied.
Edit : grilled by Arthuria
#4.2
Rien ne l’oblige à afficher un prix barré
#4.3
Non, mais j’vois vraiment pas ce que tu expliques dans ton message précédent alors.
Ce que dit le billet c’est “le prix barré ne peut être supérieur au prix le plus bas pratiqué par le marchand dans les trente jours précédents la promotion”.
Quel intérêt pour le commerçant de faire une promo d’une heure, du coup ? Ou quel rapport avec la choucroute ?
#4.4
Heu… Je n’ai pas de message précédent (tout au moins sur ce sujet)
#4.6
Mea maxima culpa ! ;)
#4.5
C’est bien ça, vous avez bien compris ;)
Je confirme que ce que recherchent les commerçants, pour attirer le client, est de pouvoir afficher un prix barré le plus élevé possible (pas le plus bas!), ce qui permet de donner l’impression (parfois illusoire, donc) d’une réduction plus importante.
#5
C’est donc ce prix qui pourra être barré pour montrer que tu fait profiter d’une énorme réduction.
Maintenant, pour faire beaucoup mieux, il faut augmenter le prix artificiellement le mois précédent sans discontinuer et ainsi valider le principe du prix cher barré.
#6
@Jarodd et @choukky
Le but pour les commerçant est que le prix barré soit le plus élevé possible pour faire miroiter une grosse économie. Quel intérêt pour un commerçant de baisser un prix pour en faire un prix de référence juste avant une promo ? Plus ce prix de référence est bas et plus la différence avec le prix promo sera faible.
J’ai du mal à voir où vous voulez en venir.
#6.1
C’est bien ce que j’avais compris.


J’aurai du mettre “énorme” entre guillemet pour être plus clair.
La dernière phrase démontrait qu’il était possible de faire mieux pour maximiser le profit.
#7
Dès qu’on parle de promos bidons, ce site est systématiquement cité..
Étonnant 🙃
#7.1
à ces débuts c’était une véritable guirlande de noël avec des comptes à rebours “vente flash” qui tournent en rond, des prix barrés clignotants, du jaune, du rouge, des prix en italique…
http://web.archive.org/web/20060428132624/http://www.cdiscount.com/home/default.asp
Magnifique ! :)
#7.2
Merci pour le lien.
#8
C’est tellement simple la vie pour certains
#9
Avec cette loi, Amazon va couler
#10
Il serait bon de bien expliquer aux consommateurs que l’objectif n’est pas l’achat d’une remise.
Un PC à -40% qui revient à 2k€ revient donc à dépenser 2K€ pas d’économiser 40%.
#11
Bonf.
Si tout simplement tu trouves que 399€ est un bon prix pour un S20, le prix barré n’a absolument aucune importance.
#12
Maître Capello, pourtant si pointilleux :
travaille==> travail