L'association nationale de la vidéoprotection appelle, tout comme la CNIL, à une refonte du cadre légal régissant l'utilisation des caméras. Elle plaide également pour la légalisation de l'« audiovidéoprotection », la création d'un réseau national de capteurs de plaques d'immatriculation, et l’expérimentation de l'IA « à grande échelle ».
Créée en 2004 à l’initiative de « professionnels du secteur public et privé afin de rencontrer les élus locaux », l'association nationale des villes vidéosurveillées (AN2V) voulait « répondre à un besoin de mutualisation des expériences dans le domaine des technologies de sûreté ».
Depuis, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) de Michèle Alliot-Marie et Brice Hortefeux a imposé, en 2011, le terme de « vidéoprotection » pour désigner les systèmes installés sur la voie publique, la vidéosurveillance étant quant à elle cantonnée aux seuls lieux non ouverts au public.
Cette même année 2011, l'AN2V s'était donc rebaptisée association nationale de la vidéoprotection. En 2012, son fondateur, Dominique Legrand, se défendait d'être perçu comme un lobbyiste :
« Nous ne sommes pas là pour vendre des caméras mais pour que, s’il y a vidéoprotection, elle soit faite dans les règles de l’art et avec efficacité. C’est une technologie complexe, voire coûteuse, il faut expliquer au citoyen en permanence ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas. Les dérives effectivement peuvent être rapides, il faut être vigilant et nous sommes là pour ça. »
L'industrie de la vidéoprotection s'est depuis banalisée, au point qu'environ un tiers des articles de presse qui lui sont consacrés concernent désormais l'installation de caméras (ou leur montée en puissance) dans des communes ou des villages.
Les désidératas de l'AN2V sont donc a priori d'autant plus révélateurs des besoins exprimés par les clients potentiels de tels systèmes, mais donc aussi des problèmes auxquels sont confrontés les PME et industriels du secteur. Et ce, d'autant plus que ces technologies vont aujourd'hui bien au-delà des seules caméras vidéo.
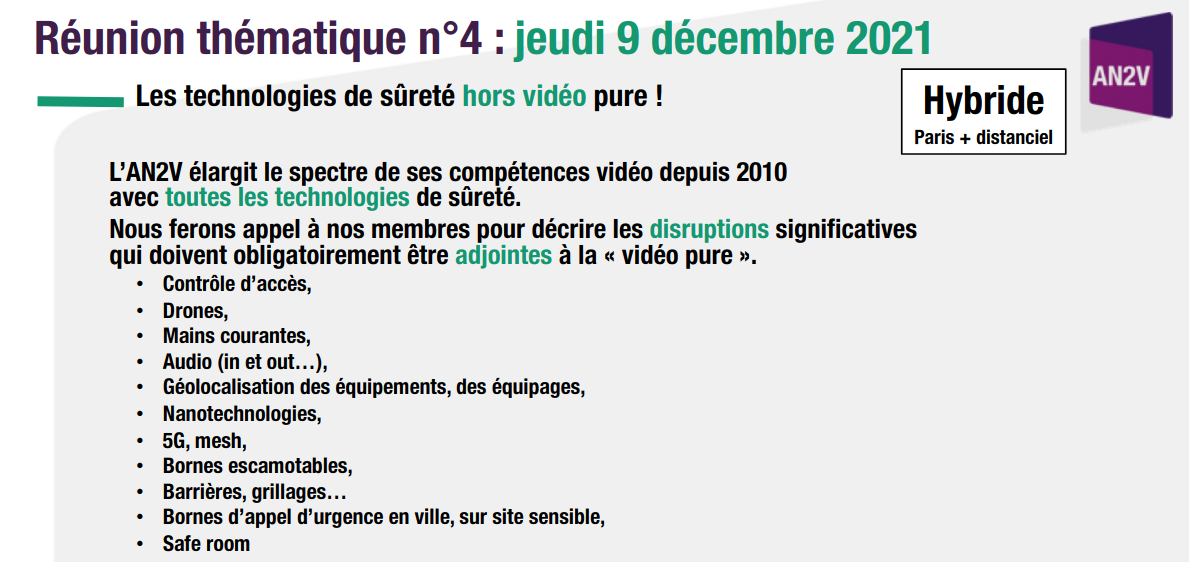
D'où l'intérêt de se pencher sur la contribution de l'association, qui figure dans l'annexe de 348 pages du rapport de la « mission relative aux nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité » confiée par le Premier ministre au député de Loire (LREM) et spécialiste du numérique Jean-Michel Mis, qu'il vient de rendre public.
Les professionnels concernés méconnaissent le régime juridique
L'AN2V y rappelle avoir déjà été entendue l'an passé par les rapporteurs de la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui a « permis de répondre à certaines attentes de nos membres » mais que, « toutefois, ce texte est très en retrait par rapport aux besoins de la profession ».
Reposant sur les contributions de ses 140 membres industriels « travaillant sur les technologies les plus avancées (analyse de son, intelligence artificielle) qui se sont le plus fortement mobilisés », l'AN2V y voit la « preuve que ces sujets nécessitent un encadrement juridique qui permettra à des PME françaises, dynamiques et innovantes, de se développer et de donner vie au plan de relance et de relocalisation ».
Étrangement, l'AN2V commence par déplorer que « les professionnels concernés (utilisateurs, fournisseurs et même les institutionnels) méconnaissent le régime juridique de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection et de la protection des données personnelles ».
Elle l'explique du fait d'une « réglementation complexe et inadaptée », conséquences des deux régimes juridiques concernant l’installation de caméras de sûreté, le Code de la sécurité intérieure pour la « vidéoprotection », et la loi informatique et libertés de 1978 pour la « vidéosurveillance » :
« La réglementation de la vidéoprotection, issue la LOPSI de 1995 puis intégrée au Code de la sécurité intérieure [CSI, ndlr], repose sur le principe que l’image n’est pas à elle seule une donnée personnelle. Il faut un traitement spécifique pour le système relève de la loi de 1978. Mais cette analyse n’est pas celle proposée par la CNIL, qui se base sur les textes européens. »
La CNIL, « s’appuyant notamment sur le paquet européen », considère en effet que « l’image d’une personne est une donnée personnelle » puisqu’elle peut permettre « d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ». De ce fait, « si l’on suit cette analyse, l’ensemble des systèmes de vidéoprotection / vidéosurveillance sont des traitements de données à caractère personnel », écrit l'AN2V.
Or, si « la CNIL a fait un énorme effort d’information par le biais notamment de fiches pratiques », reconnaît l'association, « cette analyse n’est visiblement pas partagée par le ministère de l’Intérieur. Il suffit de consulter les sites de la CNIL et du ministère pour comprendre la différence d’analyse » :
« De fait, la CNIL revendique aujourd’hui des compétences sur les systèmes de vidéoprotection qui vont au-delà de ce qui est prévu par le CSI, en exigeant une mise en conformité des systèmes au droit européen. La plupart des exploitants prennent d’ailleurs en compte ces textes dans leur organisation. »
Même les juristes professionnels ont des analyses contradictoires
« À ce problème de fond s'ajoutent d'autres difficultés », déplore l'AN2V :
- « Les commissions départementales de vidéoprotection ont chacune leur propre interprétation des textes. Nos professionnels constatent des règles différentes d’un département à l’autre. Il semble ne pas y avoir de doctrine nationale, de coordination.
- La commission nationale de la vidéoprotection, créée par le Code de la sécurité intérieure (CSI), a disparu sans explication...
- La plupart des exploitants ont à la fois des caméras de vidéoprotection et de vidéosurveillance en fonction des espaces traités. Un commerce utilise de la vidéoprotection dans l’espace ouvert au client, et de la vidéosurveillance dans les zones réservées au personnel.
- Des textes autres que ceux déjà cités encadrent directement ou indirectement la vidéosurveillance-vidéoprotection : code du travail, textes spécifiques à certaines activités (stades, casinos...).
- Les textes du CSI relatifs à la vidéoprotection ne sont plus adaptés et doivent être mis en conformité avec le droit européen. »
« Dans ce contexte, utilisateurs et fournisseurs sont désorientés. Même les juristes professionnels ont des analyses contradictoires sur les textes ! », déplore l'association.
Elle estime que la loi de 1978, « difficilement compréhensible pour les professionnels et beaucoup trop générique (...) n’est pas le bon support juridique pour les technologies de sûreté ». Elle n'en constate pas moins que « les textes du CSI relatifs à la vidéoprotection ne sont plus adaptés et doivent être mis en conformité avec le droit européen ».
L'AN2V demande donc « un texte uni et clair, dédié à tous les systèmes vidéo (et audio) de sûreté », qu'il s'agisse de caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, mais également des caméras embarquées sur des robots, des aéronefs, des agents des forces de sécurité ou leurs véhicules, notamment :
« Et plus largement, nous souhaitons un cadre juridique pour tous les dispositifs de sûreté : systèmes de détection de signatures sonores, contrôles d’accès (biométrie), intelligence artificielle, reconnaissance faciale... »
L'AN2V rappelle en outre que « la CNIL, souvent critiquée par la profession pour ses prises de position, est la première à demander au législateur de poser un cadre juridique clair ».
« Défavorablement connus des services de police »
Le second chapitre du plaidoyer de l'AN2V, qualifié d'« important », concerne la « nécessaire prise en compte des réticences de nos concitoyens », au sujet desquelles l'association a longuement discuté avec ses entreprises membres :
« On constate actuellement une crispation de l’opinion publique sur les technologies de sûreté. Cela a été constaté dans les débats autour de la loi sécurité globale. Les médias mélangent tout, il n’y a pas de nuance. Le risque est qu’une loi mal présentée soit rejetée en bloc. »
Pour répondre à ces problèmes, l'AN2V propose de « donner un cadre conforme aux grands principes du RGPD » :
- « Définir des finalités d’utilisation précises et limitées,
- Prévoir des conditions d’exploitation strictes,
- Informer de manière claire et transparente,
- Proposer des alternatives lorsque cela est possible. »
Les membres de l'association pointent « par ailleurs », mais sans que l'on comprenne bien le lien, « la responsabilité de l’institution judiciaire dans les problèmes de délinquance », qui aurait été « souvent évoquée » :
« Ce sont souvent les mêmes individus "défavorablement connus des services de police" [parce que fichés, quand bien même ils n'auraient pas été condamnés, ndlr] qui sont arrêtés plusieurs fois "grâce" aux technologies de sûreté. Une remise en question des politiques pénales et carcérales nous paraît indispensable et complémentaire à un élargissement de l’utilisation de la technologie. »
Une nouvelle loi globale sur l'« audiovidéoprotection » ?
L'AN2V voudrait également « donner un cadre juridique à l'audio », technologie qui « ne dispose d’aucun fondement juridique et dont l'utilisation « est bloquée par la CNIL » :
« L’analyse de situations nécessite de recueillir différentes données permettant à l’opérateur d’un système de comprendre ce qui est en train de se produire. Aujourd’hui, il peut voir grâce aux caméras mais il ne peut pas entendre. Or, il existe des solutions technologiques qui permettent de détecter des signatures sonores significatives. »
L'association explique en effet que « le capteur ne renvoie qu’une alerte et pas de son », et qu'« il ne s’agit pas de capter tous les sons sans discernement, d’enregistrer des conversations », comme cela se ferait d'ores et déjà, mais « officieusement, par exemple dans les transports publics ».
SENSIVIC, qui propose des systèmes intelligents de « détection automatique de bruits anormaux, événements et incivilités sonores », déplore en effet que la CNIL lui ait répondu qu'« une base législative spécifique apparait nécessaire pour la mise en œuvre de tels dispositifs sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ».
« Idéalement, ces dispositions seraient intégrées à une nouvelle loi globale "audiovidéoprotection" », propose l'association, pour qui « il ne s’agit absolument pas de capter des conversations », et qui rappelle qu'« aucune conservation de son n’est faite par le système », qui se contente d'envoyer une alerte en cas de détection de certains types de « signatures sonores significatives ».
SENSIVIC évoque ainsi l'exigence d'anonymisation des données : « le traitement du son doit être effectué dès la capture, sur site, dans le détecteur lui-même. Le système doit garantir qu'aucune donnée fournie par le détecteur/capteur ne peut permettre de remonter à sa source ».
L'AN2V n'en estime pas moins qu'« une deuxième marche plus ambitieuse pourrait être étudiée avec l’idée d’enregistrer l’audio avec l’image, comme une métadonnée de l’image (comme sur une bande VHS), moyennant un cryptage solide à la source, où les données ne pourraient être décryptées/lues que par les forces judiciaires par exemple » :
« L’audio peut dans certains cas critiques apporter une information précieuse pour l’élucidation. Nous attirons l’attention du législateur sur le fait que toutes les caméras récentes peuvent disposer d’une capture audio, et que l’image telle que pratiquée à ce jour ne préserve pas l’anonymat des discussions puisque certains savent lire sur les lèvres ! »
Sur son site, SENSIVIC évoque ainsi des articles de presse déplorant l'inefficacité de la vidéosurveillance : « la caméra n'était pas orientée vers la bijouterie et n'a pas filmé la scène », déplorait ainsi un article consacré au bijoutier de Nice accusé d'avoir tiré (dans le dos) sur celui qui venait de le braquer.
Un réseau national des capteurs de plaques d'immatriculation
L'AN2V voudrait également « donner un cadre juridique aux métadonnées » dont sont aujourd'hui truffées les vidéos, qui « permettent de la décrire et de réaliser des recherches par critères », alors que le Code de sécurité intérieure « ne parle que d’images ».
Si « le silence actuel sur ce sujet arrange plutôt les professionnels (personne n’en parle) », l'association estime « important de ne pas laisser perdurer ce flou ». Il s'agirait de « distinguer les métadonnées à caractère personnel ou non », mais également « définir des finalités » permettant leur exploitation, ainsi que des durées de conservation.
L'association propose également d'« encadrer l’utilisation de la lecture automatisée de plaques d’immatriculation » (LAPI), dont l'usage est certes réglementé par la loi de 1978, mais dont la CNIL aurait « une vision très restrictive ».
À l'en croire, les maires pourraient en effet « installer du LAPI à ses frais », mais pas s'en servir, son utilisation étant « réservée aux policiers et gendarmes ». En outre, il ne pourrait être utilisé « que pour du stationnement réglementé (ex : stationnement payant) », la CNIL ayant ainsi récemment « dénoncé l’utilisation du LAPI sur 4 communes à des fins de verbalisation de stationnements gênants... »
« Des initiatives sont menées par la DGGN [Direction générale de la gendarmerie nationale, ndlr] pour créer un réseau national des capteurs LAPI mais ce projet avance lentement », déplore l'association :
« Des évènements tragiques ont démontré la difficulté à retrouver un véhicule recherché, alors même que sa plaque est connue et que ce véhicule circule dans des zones couvertes par la vidéoprotection. On préfère encore aujourd’hui faire décoller des hélicoptères et déployer des barrages routiers plutôt que d’exploiter des solutions de type LAPI... »
L'AN2V propose dès lors la « création d’un réseau LAPI national, intégrant l’ensemble des capteurs publics et privés, couplé au fichier des véhicules recherchés », adossé à un cadre juridique spécifique prenant en compte « tous les usages possibles, et notamment tous les textes liés à l’environnement (co-voiturage, sites propres, zones à faible émission) ».
La CNIL dans le viseur des vendeurs de technologies de sécurité
En termes de « souveraineté », l'AN2V voudrait en outre « favoriser l’expérimentation dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la sûreté en conditions réelles » et « à grande échelle », comme peuvent le faire certains « concurrents étrangers » des membres de l'association :
« Dans la perspective de l’organisation de prochains grands événements (JO, CDM Rugby) il faut pouvoir réaliser des déploiements de reconnaissance faciale, et plus largement de solutions utilisant l’IA, distinguer les recherches sur liste blanche et sur liste noire. »
L'AN2V transmet par ailleurs, et « pour information », un certain nombre de « remarques intéressantes » émanant de certains de ses membres (non identifiés) :
- « Lorsqu’une caméra est installée en s’appuyant sur une finalité, on ne peut l’utiliser pour répondre à une autre finalité. On ne peut par exemple pas faire du comptage pour une caméra autorisée à des fins de prévention des atteintes aux biens et aux personnes. De ce fait, on se prive de nombreux usages basiques très utiles (Smart city). »
- « Dans beaucoup de cas d’usage, le recueil du consentement des personnes est impossible à mettre en œuvre. Et proposer une alternative n’est souvent pas possible. »
- La CNIL, qui « a le champ libre pour interpréter, bloquer (...) semble beaucoup moins ouverte au dialogue et à l’expérimentation qu’il y a quelques années » et serait « souvent à l’origine de nombreux blocages de nouvelles technologies ».




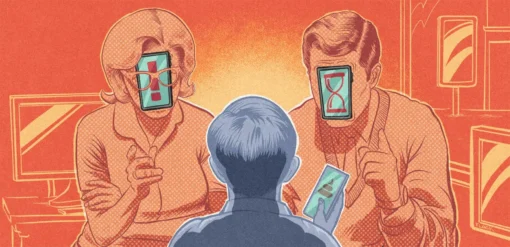

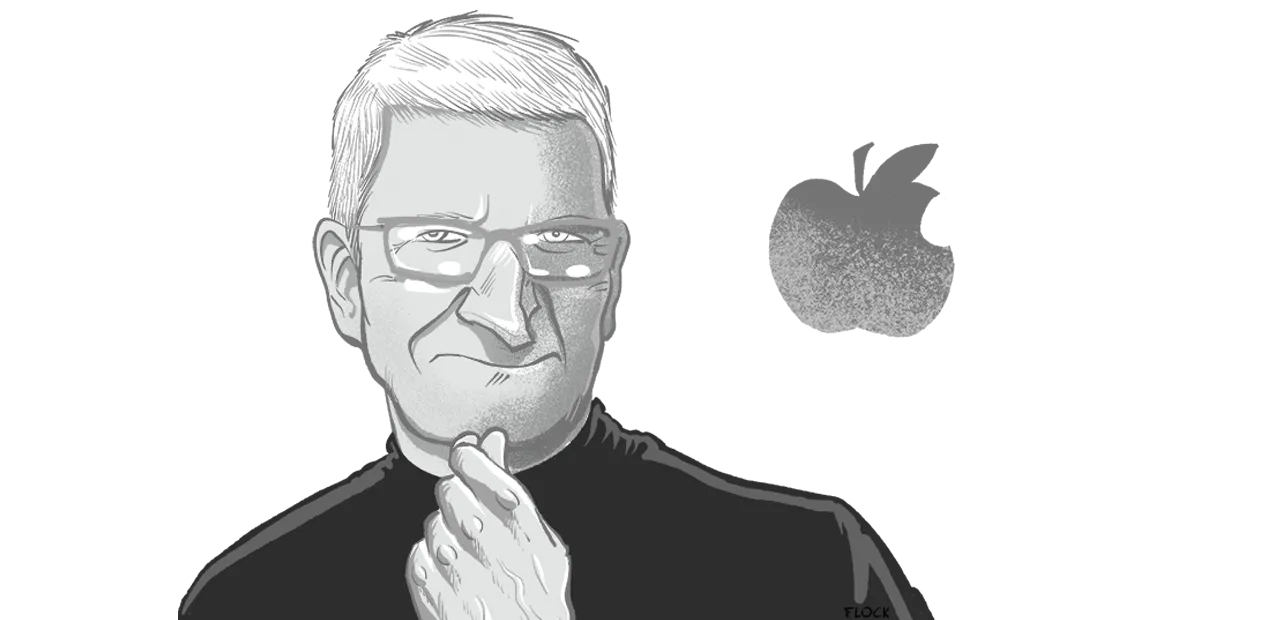
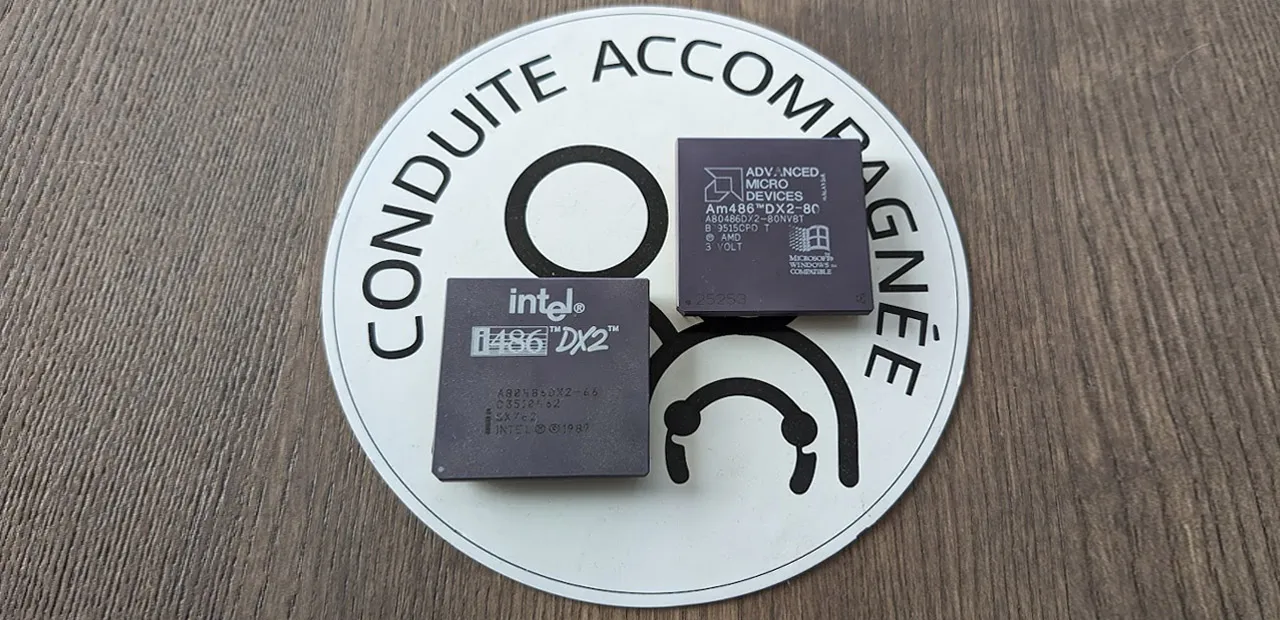
Commentaires (18)
#1
Les marchands de peur qui se plaignent de ne pouvoir bien vendre leur produit
#2
Certains = ceux devant vérifier leurs transcriptions et habilités et ne pouvant se décharger par effet d’échelle sur la technique importée (chine et/ou IA hollywoodienne…).
Donc attirer l’attention sonore sur quoi ? Le bout du tunnel… ??
Après l’apathie (ou l’absence évidemment) devant les réactionnaires “pas de photo”, bientôt, l’apatride bruyant et non covid-free devra payer en nature.
Si l’alternative n’est pas possible il faut donc légaliser les formes de brouillage afin de ne pas provoquer comme c’est bien souvent le cas à la haine et l’agressivité. Merci pour ce moment de lucidité…
#3
Un réseaux national de LAPI alimenté par les caméras publiques et privées…
Trop gros, ça passera pas… Pas tout de suite, il va falloir attendre l’émoi provoqué par une affaire (terrorisme, pédophilie…) qui aurai pu être résolu comme ça. La traçage des tel portable ne suffit pas on dirait.
Bientôt il faudra également un fichier d’empreinte génétique systématiquement prélevé à la naissance.
La sécurité répressive en pleine action.
#4
Je déteste ce terme de “vidéoprotection”. Une caméra n’a jamais protégé personne. “Vidéosurveillance” est quand même beaucoup plus adapté.
#4.1
Le glissement sémantique s’inscrit dans un cadre d’acceptabilité sociale. Et forcé de constater que cela fonctionne.
#4.2
Platon : «la perversion de la Cité commence par la fraude des mots».
#5
Tu n’en as jamais vu descendre d’elles-mêmes de leur poteau, et protéger tout le monde grâce à leurs petits bras?
C’est courant pourtant…
#5.1
Et pendant ce temps là ils sont toujours infoutu de nous dire combien d’arrestation grâce à ça. Dans mon cas c’est 0. La fois où j’en ai eu besoin ils ont pas été foutu de mater les images.
En gros ils piquent du pognon sur nos impôts pour installer ces mères et ne sont pas foutu d’analyser les images. Ce qui fait dire à cioti qui nous a démontrer son incompétence avec ce genre de dispositif qu’il appreci tant lors des attentats dans sa ville (il aurait pas des actions dans ce type de boite… ou un membre de sa famille) qu’il faudrait coupler tout ça à de l’IA car nos brave gars de le securitat sont infoutu de traiter les images… quand ils savent pas précisément où sont disposés les dites caméras ou si elles sont toujours en état de fonctionner.
Allez y les gars argent facile et gratuit. C’est pas vous qui raquez mais nous.
#6
« Nous ne sommes pas là pour vendre des caméras mais pour que
s’il y a vidéoprotection, elle soit faite dans les règles de l’art et avec efficacité.
C’est une technologie complexe, voire coûteuse, il faut expliquer au citoyen
en permanence ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas. Les dérives effectivement
peuvent être rapides, il faut être vigilant et nous sommes là pour ça. »
“hé, on est entre-nous” : un peu quand.même…..non ?
#7
J’ai lu “les vendeurs de vidéoprojection”
Toute autre ambiance du coup ^^’
#8
la différence vidéoprotection/vidéosurveillance est pourtant super importante je l’ai déjà écrite ici. d’abord les termes sont prévus dans la loi pour différencier deux dispositifs : soit dans les lieux publics ou accessibles au public pour la protection, soit dans les lieux privés pour la surveillance. Genre une gare est sous protection, quand ses tunnels d’approvisionnement ou les couloirs d’accès réservés aux agents de l’exploitant sont sous surveillance. C’est assez important de faire la différence, parce que le droit du travail est assez peu permissif par défaut sur le sujet et protège plutôt bien (enfin si les employés sont syndiqués surtout…).
De plus, on parle de protection parce que les images sont (normalement) visualisées en continu, contrairement à la surveillance où ça peut être de l’exploitation à posteriori. Alors oui, la caméra ne protège pas en elle-même.
Et pour rester dans un domaine que je connais, si demain les gares des exploitants de transports publics sont privés de caméras, ce ne seront pas les mêmes délais d’intervention et d’immobilisation pour les bagages abandonnés par exemple. Situation ou de la vidéo intelligente aurait un intérêt certain, et je ne parle de pas de chasser du terroriste mais bien de retrouver le glandu qui est capable d’oublier une valise de 30 kilos.
#9
Ca sent bien le ptit discours fait sur mesure pour vendre des cameras
#10
Pourquoi automatiquement préjuger de la volonté / de l’état d’esprit d’une personne ?
Dans ce cas aucune raison d’appeler ça vidéo protection. “Vidéo enregistrement” pour l’un ou “vidéo surveillance en temps réel” pour l’autre est tout aussi adapté et plus explicite. Au passage, je suppose que le visionnage temps réel n’empêche pas les bandes d’être enregistrées et conservées pour revisionnage / exploitation ultérieure, donc la distinction en changeant de mots est encore moins justifiée à fortiori.
Entre nous même si je comprends bien que ça arrive toujours, je serais curieux de voir si la fréquence n’a pas baissé depuis plusieurs années avec les mesures incitatives (étiquettes, rappels audio). Je ne suis pas sûr par ailleurs que ce bénéfice justifie l’ensemble des contraintes en termes d’investissements, coûts de maintenance et respect des libertés qui vont avec.
#10.1
sur la sémantique mais pas que : les vidéos de vidéo protection sont regardées en temps réel et permettent de déployer une assistance (faut que les planètes soient alignées certes, et il y a plus de caméras que de personnels sur le terrain certes aussi), la surveillance ce n’est pas le cas on est plutôt sur des alertes/alarmes qui déclenchent une visualisation temps réel.
alors entre nous pas du tout, c’est plutôt en augmentation. il y a un biais du fait de l’existence de la procédure de bagage abandonné bien entendu (ils sont de plus en plus signalés et traités correctement), mais il y a de plus en plus d’oubli aussi. sur les coûts j’aimerais en parler concrètement mais les entreprises de transport sont un peu frileuses à ce sujet. en gros, le maintien du système de vidéo protection et le coût de formation/emploi des agents de cyno détection sont largement couverts par le temps gagné (enfin pas perdu).
#11
En tous cas un truc est évident, je serai un criminel j’investirai lourdement dans ces sociétés qui permettent une logistique criminelle de haute volée. Et plus ce sera interconnecté et automatisé et plus ce sera rentable et facile de pouvoir suivre des personnes et les voler en leur absence, racketter les conjoints infidèles et les dealers, savoir où passer pour être discret, quelles plaques changer vers quel numéro accidenté, stationné chez des gens qui ne sortent pas, pouvoir simuler des pannes/pertes d’enregistrements quand ça arrange…
Au final ce seront les plus malhonnêtes qui tireront le plus grand profit de ces technologies et c’est très flippant que ça se développe.
Un réseau de surveillance vidéo/audio de tout l’espace commun c’était le rêve de la Stasi … on a oublié ce qu’était le communisme et les régimes policiers depuis 30ans
 est ce que c’était bien pour autant…
est ce que c’était bien pour autant…
Effectivement il y avait assez peu de vols de sac à main et de bagnoles à berlin est
#12
Est-il possible de cessez de parler de Vidéoprotection pour l’appellation correcte de vidéosurveillance.
Un parapluie PROTÈGE de la pluie, une caméra ne protège de rien, elle aide à la surveillance.
A moins que je sois dans le pâté et que les nouvelles caméras soient dotées d’une cape en kevlar quelles déploient autour des personnes en danger, qui se font agresser ou en cas d’attentat.
Si c’est le cas, je résilie mon abonnement a NextImpact qui ne m’a jamais parlé de ces technologies.
#12.1
Les deux termes correspondent à deux régimes juridiques différents, ce pourquoi je me devais de faire le distingo; mais nous sommes bien d’accord, le terme vidéoprotection c’est de la novlangue, datant du temps où Nicolas Sarkozy voulait multiplier le nombre de caméras par trois, et comme j’ai déjà eu l’occasion de le documenter à de nombreuses reprises :
https://www.lemonde.fr/blog/bugbrother/2010/02/11/pour-hortefeux-la-video-dun-mariage-releve-de-la-videosurveillance/
https://www.lemonde.fr/blog/bugbrother/category/videosurveillance/
http://owni.fr/2011/04/28/les-petits-bras-muscles-de-la-cnil-souvrent-a-la-videosurveillance/index.html
#13
La Machine a besoin de plus en plus de données.