Saisie par la commission des lois du Sénat, la CNIL rend public son avis sur la proposition de loi relative à la sécurité globale. Autant dire que les critiques de l’autorité indépendante sont multiples à l’égard du texte porté par la majorité LREM.
La CNIL avait été délaissée jusqu’à présent, les députés ayant adopté la proposition de loi sur la sécurité globale, sans s’enquérir de son avis. Et pourtant, la loi de 1978 modifiée permet déjà au président de l'Assemblée nationale ou des commissions compétentes de la saisir « sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données ».
Au Sénat, autre lieu, autre ambiance : François-Noël Buffet (LR), président de la commission des lois, a corrigé le tir. Un choix bienvenu selon Marie Laure Denis, qui « témoigne de la volonté de prendre en compte les enjeux significatifs sur certaines dispositions de la proposition de loi, en particulier en matière de vidéo ». Message transmis aux députés.
Aujourd’hui, l’autorité indépendante vient de rendre cet avis sur le texte LREM, défendu mordicus par Gérarld Darmanin au gouvernement. Et pour cause, plusieurs de ses dispositions centrales orchestrent des traitements de données à caractère personnel à des fins sécuritaires.
Des outils de surveillance de plus en plus performants
Dès l’introduction, le ton est donné : la PPL s’inscrit dans un mouvement appuyé sur « des technologies de surveillance de plus en plus performantes ». Et la présidente de la commission de regretter l’absence d’évaluation globale sur « l’efficacité de ces systèmes » au regard des risques d’atteintes aux libertés individuelles. Un peu plus loin dans son avis, elle évoque même un « changement d’échelle ».
La proposition de loi sur la sécurité globale ? « Une nouvelle étape, majeure de ce mouvement » écrit Marie-Laure Denis. Les outils qu’elle draine induisent « des choix de société auxquels il convient que le Parlement soit particulièrement attentif », et dont les conséquences à moyen terme « ne sont pas (…) parfaitement identifiées ».
D’autant plus que le texte ne permet pas d’aboutir à un encadrement juridique « cohérent, complet et suffisamment protecteur des droits des personnes en matière de vidéoprotection », estime-t-elle. La faute à de nombreuses dispositions du Code de la sécurité intérieure jugées « obsolètes ».
Plusieurs articles sont passés au crible.
Les drones équipés de caméras, un « changement de paradigme »
Si tous les yeux se sont tournés sur l’article 24 relatif aux photos du visage des policiers, la CNIL débute son examen par l’article 22 relatif aux caméras dites aéroportées.
Cette disposition avait été appelée par le Conseil d’État, alors que la Préfecture de Police de Paris a multiplié ces vols, sans l’ombre d’un texte encadrant les traitements de données personnelles qu’ils induisent. Une cavalerie aérienne dégommée par un missile sol-air lancé par la CNIL à l’égard du ministère de l’intérieur.
Avec la PPL, drones, avions et hélicoptères pourront donc être utilisés dans des « missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique » mais aussi « de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ».
Contrairement aux caméras au sol, voilà des dispositifs « mobiles, discrets par nature et dont la position en hauteur leur permet de filmer des lieux jusqu’ici difficiles d’accès voire interdits aux caméras classiques », relève la CNIL. Ces caméras permettent même le suivi individualisé des déplacements d’une personne, à son insu « et sur une durée qui peut être longue ».
Un changement de « paradigme » pour la Commission, qui évoque la question de la société dite « de surveillance ». Pour éviter le pire, la CNIL recommande aux parlementaires de conditionner ces outils à une expérimentation préalable, suivie d’un bilan transmis à l’autorité, aux députés et aux sénateurs. Des phases non prévues par le texte actuel, qui autorise le déploiement de ces flottes aériennes dès publication au Journal officiel.
La commission rappelle sans mal que ces yeux électroniques devront respecter les textes européens et français en la matière, puisqu’ils opèrent un traitement de données à caractère personnel. Or, « les personnes filmées peuvent être aisément identifiées », des techniques d’analyse d’images permettent de restaurer une image proche de celle d’origine » outre que des données sensibles (convictions religieuses, etc.) seront possiblement aspirées.
La loi en gestation a fixé plusieurs finalités pour justifier ces drones aéroportés :
- La prévention d’actes de terrorisme
- Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
- La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords
- La protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale
- La régulation des flux de transport
- La surveillance des rodéos routiers
- La surveillance des littoraux et des zones frontalières
- Le secours aux personnes
Ces images pourront en outre être diffusées en temps réel au poste de commandement, même en l’absence de menace sur les biens ou les personnes.
Des finalités jugées « très larges, diverses et d’importance inégale » qui peuvent conduire à une banalisation de l’usage des drones, en contrariété avec le principe de limitation ou de proportionnalité. Or, cet usage doit normalement « être limité à certaines finalités et missions précisément définies par la loi, pour lesquelles des dispositifs moins intrusifs se sont révélés insuffisants ».
Une certitude : « le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves » ne peut être autorisé selon la CNIL. Elle demande que le législateur définisse précisément les infractions graves, qui seules seront susceptibles de nécessiter l’envol de ces drones.
Même remarque pour la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ou le secours aux personnes. Là encore, il faudrait réserver ces usages aux situations les plus épineuses. Dans tous les cas, il faudra s’assurer que « les circonstances précises des missions menées justifient l’emploi de ces dispositifs, et ce pour une durée adaptée à ces circonstances ». Elle suggère des précisions législatives, outre la mise en place de lignes directrices pour permettre de jauger la proportionnalité.
Le texte interdit certes de filmer l’intérieur des domiciles ou de leurs entrées, mais la CNIL doute de l’effectivité de cette garantie. Faute de mieux, elle recommande des solutions destinées à « bloquer la retransmission des images selon certaines caractéristiques de vol », comme l’altitude, le niveau de zoom ou la zone survolée. Autre piste : rendre anonymes les données collectées pour la finalité liée à la régulation des flux de transport (on pense ici aux plaques d’immatriculation).
Derniers missiles sol-air, dans le silence des textes, considère la Commission, l’usage de micros couplés à ces drones sera interdit, tout comme le recours à la reconnaissance faciale ou à l’interconnexion de fichiers. Des amendements avaient été déposés pour matérialiser cette interdiction, ils furent tous rejetés par le groupe LREM. La précision apportée par la CNIL est donc riche de conséquences.
Les caméras un peu trop individuelles
La proposition de loi, portée par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, ouvre la possibilité pour les forces de l’ordre de déporter les images captées par les caméras mobiles à un centre de commandement, en temps réel. Ce, dès lors que « la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée ».
Les autorités pourront se servir de ces enregistrements pour combattre les faits jugés « alternatifs » et diffusés en boucle sur les réseaux sociaux, afin d’informer le public sur les circonstances de l’intervention. La CNIL réclame de solides garanties pour « préserver les libertés individuelles et publiques attachées à l’anonymat dans l’espace public en recourant par exemple à des solutions techniques de floutage ».
L’agent pourra aussi consulter ces images « dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention ». La mesure est considérée comme légitime par la CNIL, mais celle-ci réclame que les textes d’application décrivent « précisément les missions et circonstances justifiant cet accès ». Et elle annonce déjà qu’elle lancera des contrôles pour s’assurer que l’intégrité des enregistrements est bien assurée en pratique.
L’usage malveillant des images des policiers, déjà sanctionné
Au détour de son avis de 12 pages, elle revient sur l’article 20 bis de la proposition de loi. Aujourd’hui, sur décision de la majorité des copropriétaires, les images des caméras installées dans les parties communes des immeubles d'habitation peuvent être transmises aux policiers et gendarmes. Cet accès est possible seulement « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes ».
Suite à un amendement porté par Alice Thourot (LREM), la diffusion pourra se faire « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux ». Ces critères d’accès sont jugés très, pour ne pas dire trop, larges. La CNIL demande que la formulation soit « resserrée ».
La Commission n’a pas fait l’économie d’un examen de l’article 24 sur le visage des policiers, celui sur lequel se sont concentrées de nombreuses critiques, de la presse et dans des manifestations. Le texte punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, dans le but manifeste de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique, l’image du visage d’un policier ou d’un gendarme, ou de n’importe quel autre élément d’identification.
Elle rappelle utilement que ces utilisations d’images constituent des traitements de données à caractère personnels. Or un usage à des fins malveillantes n’est pas une finalité légitime au regard de la loi de 1978. Conclusion : il est déjà possible de les réprimer.
La proposition de loi sera prochainement examinée en commission des lois, avant son examen en séance au Sénat.


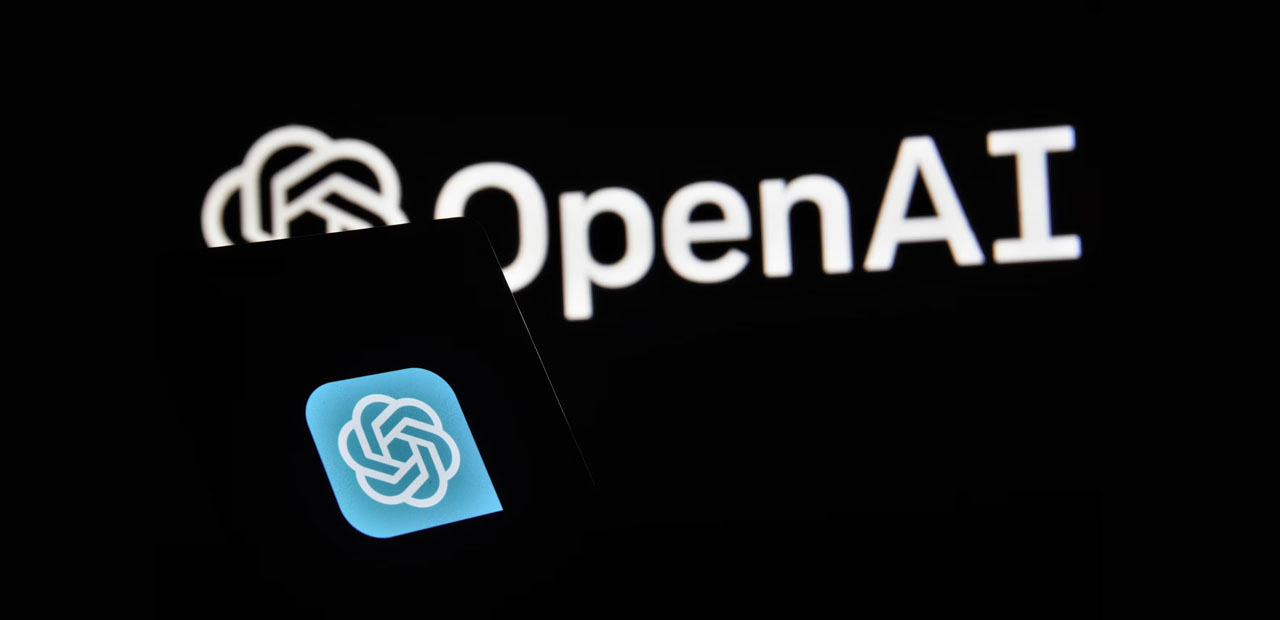



















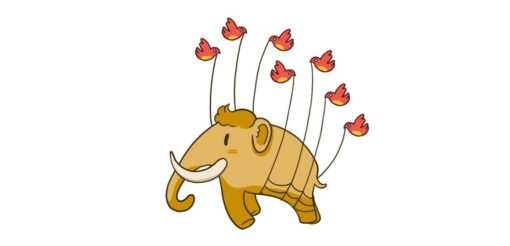




Commentaires (29)
#1
C’est une bonne chose cette délibération, mais peu de chance qu’elle soit suivie d’effets malheureusement…
Sinon, ça veut dire quoi cette phrase : « préserver les libertés individuelles et publiques attaquées à l’anonymat dans l’espace public » ??
#1.1
@Mihashi :
oui c’est pas top coté clarté, en fait : « préserver les libertés individuelles et celles de la vie publique
publiquesattaquées sur l’aspect ‘anonymat’ de cette vie publiquel’anonymat(donc dans l’espace public et non plus dans l’intimité de la vie privée) » ??#2
Ce gouvernement me fait de plus en plus flipper… Un banquier pedo cuck bbc aussi ouvert d’esprit qu’un mollusque de 85 ans, un violeur fils de patron de bar anti drogue, une mordeuse de taxi loi de pédé anti haine, ect…
C’est quoi la prochaine étape ?
#3
#4
Pose-toi une question : qui vois-tu prendre leur suite, l’année prochaine (à part eux-mêmes, et en supposant que les élections ne seront pas, comme celles de l’an dernier, reportées à plus tard) ?
#5
Et sinon, tu ne sais pas t’exprimer autrement qu’en étant ordurier et diffamant ?
Et tu voudrais être pis au sérieux ?
#6
Hé non, je reprend juste leur propos et leur actions…
J’ai franchement pas envie d’y penser…
La marine est incapable de mettre de l’eau dans son vin, le méluche est incapable de garder son calme et le reste ce n’est que des petits joueurs de limonade. Mais à vrai dire il est surtout temps d’éjecter de principe d’élire des gens. Ont sait plus ou moins ce qui marche et ce qui ne marche pas, que ça sois sur le court / moyen / long terme.
Qu’a la fin tout est tellement politique qu’un mec “normal” n’aurais jamais envie de tremper la dedans. Si vous avez des doutes je vous invite à regarder de nouveau la série “the wire”.
#7
Emmanuel macron : https://images.bfmtv.com/5uSl0jnGA7vQMjW_34kEZ8K-pvI=/7x220:4135x2542/4128x0/images/-165680.jpg . Le cuck BBC ce pose la ! Au passage les mecs étaient des dealers. Problème numéro 1 en ce qui concerne la sécurité dans notre pays. Traités à la légère.
Nicolas Darma-nin : “La drogue c’est de la merde”, “ le consommateur est un mauvais citoyen”. https://www.lavoixdunord.fr/864804/article/2020-09-14/gerald-darmanin-la-drogue-c-est-de-la-merde-ne-va-pas-legaliser-cette-merde . Mais 10 minutes plus tard il fait la promo de l’alcool : https://twitter.com/gdarmanin/status/1302214515795398657 .
Le-ti-chia evier : On a voté l’amendement des PD. https://www.valeursactuelles.com/politique/vote-lamendement-des-pd-la-deputee-lrem-laetitia-avia-accusee-dhumiliations-de-racisme-et-de-sexisme-119239 . La députée LREM Laetitia Avia accusée d’avoir mordu un chauffeur de taxi . https://www.lepoint.fr/politique/quand-laetitia-avia-deputee-lrem-mord-un-chauffeur-de-taxi-05-07-2017-2140693_20.php .
C’est plutôt à eux qu’il faudrait poser la question hein !
#8
Ça, tu oublies, au moins à moyen terme : que tu y contribues ou non, il y aura forcément quelqu’un aux commandes du pays rance de 2022 à 2027, de 2027 à 2032, et ainsi de suite. Et c’est ce quelqu’un qui décidera de ton sort pour la période concernée, et les suivantes aussi, que tu le veuilles ou non. Perso, je les enverrais aussi bien balader, mais les choses sont hélas ce qu’elles sont et continueront à être encore un long moment.
#9
Dans ce cas comment accélérer ce changement sans passer pour un extrémiste binaire ? Après j’ai rien contre le fait d’un peu gambler sur l’inconnu mais sur des sujet connu c’est juste hallucinant de voir toujours les même conneries répétées inlassablement.
Définition de folie, toussa…
A savoir que certaines mauvaise décisions peuvent avoir un impact bien plus long qu’un mandat. Et bien souvent appliqué qu’a la fin du mandat, donc en gros deux mandat dans le vent.
#10
Demande aux Gilets jaunes : ils ont essayé de changer un peu le cadre, et tout ce que ça a donné fut un gouvernement qui s’est encore plus arc-bouté sur lui-même et un système général qui, déjà ultra-stable à l’époque, s’est encore plus auto-renforcé, en devenant de plus en plus violent contre sa propre population, désormais déclarée ennemi intérieur.
Quand je dis que tu dois oublier toute idée de changement (et surtout d’amélioration) à moyen terme (et je parle en décennies, pas seulement d’années), c’est bien parce qu’il n’est plus du tout possible de recommencer un 1789 de nos jours, ni dans un futur raisonnablement envisageable : en face, ils ont très bien retenu la leçon et se sont bien assurés d’être à tout jamais à l’abri de ce genre de chose en verrouillant tout ce qui peut l’être ou constituer une éventuelle faille exploitable. Et c’est pas que ce gouvernement qui veille soigneusement à sa propre préservation : tous les pays voisins et « alliés » sont prêts à intervenir pour empêcher tout « accident » qui pourrait venir gêner par ricochet leurs petites affaires (vu que dans une économie mondialisée, les pays sont interdépendants ; si un flanche, les autres risquent aussi, et ça, il n’en est pas question).
#11
Enfin la CNIL mets un peu de raison dans cet emballement pour les “nouveaux moyens” imaginés par les législateurs.
#12
“La proposition de loi, portée par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, ouvre la possibilité pour les forces de l’ordre de déporter les images captées par les caméras mobiles à un centre de commandement, en temps réel.”
On va encore avoir des pannes des systèmes d’enregistrement à chaque bavure.
#13
*attachées
j’ai rectifié, pardon et merci du signalement
#14
En fait ça ( https://www.valeursactuelles.com/sites/default/files/styles/image_article/public/2019-07/CRS%20Sully.jpg?itok=f4J-xRLf ) c’est le meilleur exemple je pense ! Un gouvernement pas capable d’appliquer la non violence sur un mouvement à 400% pacifique.
#15
Tu trouves pas que tu généralises un petit peu (trop) ? 1 fonctionnaire de police au comportement douteux (de gros co*d) et tu accuses le gouvernement de violence…
Je vois que tu en “as gros” sur la patate au point de remettre en question l’utilité du vote dans une démocratie, il est temps de se poser, souffler et réfléchir un peu. Et diversifier ses lectures, se gaver de Valeurs Actuelles, ca ramollit le cerveau.
#16
J’ai pris le premier liens qui m’est venu sous la main et j’ai pas fait attention à la source. M’enfin ça résume bien les chose, une bonne actu publié sur un mauvais site est à la limite d’être fausse.
Au final nous sommes identiques sauf que toi tu accord encore de la valeur au gouvernement. Des mecs incapable de ne pas utiliser la violence = gros faible, point.
ps : Viens pas chialer le jours ou ça t’arrive quand tu voudra manifester.
#17
“La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords”
Euh, des caméras de vidéosurveillance fixes, ça marche pas pour surveiller des bâtiments, qui sont, par nature, fixe ???
#18
C’est un peu tard, mais avec la CNIL, on commence à avoir l’habitude.
#19
Bienvenue au 21e siècle et le fameux (soit t’es pour soit t’es contre), actuellement les gens sont tous des extrémiste fasciste (oui j’ai sorti le terme) car il se foutent totallement de l’avis de la majorité, non c’est EUX qui ont raison et les autres on d’office tord.
T’aura beau leur sortir toute les preuvent que tu veux leur extrémisme restera inchangé.
et pour répondre a d’autre personne concernant leurs propos (ils se reconnaitront) :
« Folie: faire la même chose encore et encore et attendre des résultats différents. » – Albert Einstein
#20
Ca n’engage que moi, mais je trouve que Valeurs Actuelles ne publie pas d’actus, mais que des polémiques. C’est plus divertissant qu’informant. Je leur reconnais le don d’arriver à être toujours anti-tout, ce qui nécéssite de se creuser la cervelle. Bref, je salue l’effort (“4⁄20 pour l’effort”, disait mon prof de sport).
Encore une fois, où vois-tu / as-tu entendu le gouvernement proner la violence ? Tu confonds les agissements de certains flics (peut-être très orientés politiquement, vas savoir) avec les intentions d’un gouvernement. C’est faire un amalgame. Comme si dans la police il n’y avait pas des gens de tous bords, de l’extrème gauche à l’extrème droite, et que tous ces gens représentaient le gouvernment. Non, le gouvernement n’est pas représenté par sa police, que je sache on ne change pas l’ensemble des flics de France à chaque nouveau gouvernement. On change juste la tête (jusqu’au préfets), les flics ds la rue, non.
Bin j’ai déjà taté de la lacrymo dans les manifs étudiantes d’il y a 15-20 ans, et pourtant je n’accusait pas la terre entière d’être pourrie, ni le gouvernement de l’époque (coucou JC) d’être responsable de tous les maux.
Maintenant, la majorité des manifs ne m’intéressent plus, les idées y sont trop extrèmes, trop polarisées, trop égoïstes et trop manipulées par les politiques de tous bords. Non, je préfère voter.
Et dernièrement, avec les gilets jaunes, passé un temps, j’ai eu l’impression qu’on n’entendait pas ceux qui étaient vraiment dans la merde, car ils n’avaient pas le temps/les moyens d’aller dans la rue. On entendait par contre ceux qui pouvaient se permettre le luxe d’aller manifester, tirer la couverture à eux et empécher les autres de bosser. Ca m’a sérieusement refroidi sur le principe même d’aller dans la rue.
Comme quoi on est différent, contrairement à ta phrase plus haut: toi tu ne veux plus voter, moi je ne veux plus aller dans la rue.
#20.1
#21
Si les manifestation sont aussi extrêmes c’est parce qu’ont à laisser installer la violence depuis des années. D’un autre côté ces même violence arrangent bien le gouvernement en place en laissant pourrir la situation.
Quand à voter, pourquoi pas mais j’ai pas l’impression que cela donne de bon résultat depuis 20 / 25 ans. Notre pays est pas loin de devenir un véritable “shit hole”.
Pour le reste tu à raison et ont pourrais surement en débattre des heures. Mais mine de rien j’ai pas spécialement l’impression que les politiciens et surtout la gauche sois pour une amélioration du pays.
Ont à aucune ville française dans le top 100 des villes les plus sure au monde. Ce shit hole !
#22
Il s’y connait en politique politicienne, mais Arnaud Montebourg a montré qu’il n’était pas le dernier des idiots et des imbéciles, de plus il a vu de de très près ce que voulais dire vassalisation américaine et guerre économique.
De plus, il a une vraie constance sur la nécessité d’une démondialisation ou encore faire pression pour obtenir une modification des traités européens dans un sens démocratique, souverain et de protection vis à vis des puissances extérieures.
Quant à ses origines, elles sont modestes, fils de boucher bourguignon, on a pas à faire à des fils de médecin, de grande bourgeoisie et d’énarchie, ce qui est vraiment pas mal.
Par contre, vu aujourd’hui, Asselineau est entrain de se faire politiquement “assassiner” par des opposants internes. Ca ressemble pas mal à la stratégie de délégitimation comme ce que l’on a connu avec Assange. Mais bon, il était très compétent mais malheureusement trop inaudible.
#23
#24
Dire que c’est à cause de ce genre de commentaire que nous somme plus dans ce classement… Tes remarque sur mes fotez d’ortografez vaudront pas grand chose le jours ou un mec décidera de te planter pour une clope.
Mais bon tu va me dire que tu fume pas… Alors ça sera ton téléphone !
#25
Ah non, il va se faire planter parce qu’il aurait du avoir des clop sur lui au cas ou quelqu’un lui en demande, meme si il ne fume pas.
Blague (?) a part :
faut voir la réponse qu’on donne : “je suis non fumeur, désolé.”
On s’excuse de ne pas fumer presque. (je sais que ce n’est pas exactement le seul sens de cette phrase, mais même … perso ca me gêne.)
#25.1
Le danger c’est qu’un jours des mecs ce trimballent clope à la bouche avec deux paquet dans les poches, un normal et un avec des clopes blindées de mort au rat.
Mais bon ce n’est que des conneries car d’après notre gauchiste tout va bien.
#26
existe plus ou moins deja