La proposition de loi Avia contre la cyberhaine sera discutée en séance dès 9h30 mercredi jusqu’à jeudi, pour un scrutin public le 9 juillet. 370 amendements ont pour l’instant été déposés pour l’heure. Tour d’horizon des principales dispositions soutenues ou défendues par la majorité.
Inspirée par l’Allemagne, la France veut introduire dans notre droit de nouvelles dispositions pour lutter contre les propos dits « haineux ». Les plateformes auront 24 heures pour supprimer ces contenus, sous la menace d’une amende pouvant atteindre 1,25 million d’euros, infligée par un tribunal.
Voilà pour le cœur, mais dans un amendement adopté en commission des lois, la députée Laetitia Avia, auteure de ce texte voulu par Emmanuel Macron, a considérablement étendu le champ des contenus dits « cyberhaineux ».
« Outre les injures et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la prétendue race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap », sont désormais intégrés l’apologie des crimes contre l’humanité, l’apologie des crimes d’agression sexuelle, de vol aggravé, de dégradation, du terrorisme, le harcèlement sexuel ou encore la pédophilie.
Ce n’est pas tout, la députée LREM y range également les contenus pornographiques accessibles aux mineurs. En clair, en cas d’adoption, Twitter pourra être contraint de retirer dans les 24 heures une image pornographique associée à un tweet publié en pleine nuit, dès lors qu’il est simplement accessible aux mineurs. (notre actualité).
Plus ces infractions sont étendues, plus le risque d'erreur sera grand, reconnaît le représentant de Facebook en France.
Extension des contenus à retirer en 24 heures
Le CSA se voit dans le même temps confier la casquette de régulateur des plateformes. Il pourra leur imposer de se conformer à ses « recommandations », qui n’ont la douceur, que le nom : en cas de défaillance, l’autorité leur infligera si elle le souhaite une sanction pouvant atteindre 4 % de leur chiffre d’affaires mondial. Des sanctions que les députés LREM veulent systématiquement publiques.
Cette extension du périmètre inquiète les acteurs du secteur. L’ASIC, Syntec Numérique et TECH IN France, dans un communiqué, expliquent qu’elle « ne correspond pas à l’ambition initialement affichée de lutter plus explicitement et efficacement contre les propos manifestement haineux sur Internet ».
De plus, « son exhaustivité nuirait très probablement au traitement des infractions initialement visées ». Ainsi, ils demandent à ce que soit défini « un champ d’application suffisamment précis et qui tienne compte de la diversité des modèles économiques du secteur numérique ».
L'Internet, espace de non-droit
Selon Cedric O, secrétaire d’État au numérique, en tout cas, il est normal que le législateur intervienne, au motif qu’« il faut maintenant réguler ces nouveaux espaces (…), jusqu’ici on a eu des règles très strictes pour la télévision et quasiment aucune règle pour Internet ». Des propos tenus sur BFMTV. Et une vraie fausse information puisqu’Internet est tout sauf un espace de non-droit. Ce qu’un secrétaire d’État chargé du numérique ne peut raisonnablement ignorer.
En préparation de l’examen en séance, le groupe LREM, qui dispose de la majorité à l’Assemblée nationale, a déposé d’autres amendements qui devraient être adoptés.
L’un propose d’habiliter les associations luttant contre les discriminations à exercer les droits reconnus à la partie civile. « Cette disposition sera de nature à renforcer l’effectivité de l’obligation de retrait en 24 heures des contenus manifestement haineux. »
Allègement du formalisme des notifications
Dans une autre rustine, le groupe veut considérablement alléger le formalisme des notifications adressées aux plateformes, afin de dénoncer un contenu haineux (ou pédopornographique ou pornographique) dans les règles.
La loi sur la confiance dans l’économie numérique est très pointilleuse sur le sujet. Mais ces contraintes formelles seront réputées satisfaites dès lors que la notification vient d'un utilisateur inscrit à la plateforme en cause. « Cet amendement vise à clarifier la simplification du formalisme attaché aux notifications, explique le groupe, en particulier pour permettre à des utilisateurs d’effectuer un signalement lorsqu’ils sont connectés sur une plateforme, sans formalisme supplémentaire ».
Le gouvernement a déposé un amendement similaire. Deux conditions sont posées : l’utilisateur devra être « connecté au moment de procéder à la notification » et « l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ».
Une liste noire de contenus qui ne pourront plus réapparaître
Dans l’amendement 349, les mêmes LREM veulent contraindre cette fois les plateformes à empêcher la rediffusion d’un contenu une première fois notifié et retiré. « Nous proposons, ainsi, aux plateformes de déployer les moyens nécessaires pour empêcher qu’un contenu illicite devienne viral. Elles ont donc le choix des outils de détection. »
S’ils ne mettent pas en place les moyens nécessaires, alors le CSA pourra passer par la case « sanctions ». Remarquons que pour empêcher la réapparition, les plateformes auront concrètement une alternative : ou bien faire un traitement manuel, mais c’est impossible eu égard à l’ampleur des contenus mis en ligne chaque seconde. Ou, plus sérieusement, générer une base d’empreintes pour surveiller l’ensemble des remises en ligne.
L’amendement n’est pas neutre d’autant qu’il n’est assorti d’aucune limite temporelle. Google ou Twitter devront « striker » des écrits, une vidéo, un lien ou une image par exemple porno dénoncée par telle association, puis interdire sa réapparition aujourd’hui comme durant un siècle.
Évidemment, un traitement automatisé risque de passer outre le contexte de cette remise en ligne (travaux de recherches sur la sexualité ou les propos « haineux », articles de presse, etc.). Là encore, par le charme de cette proposition de loi, le retrait devient la norme. Il reviendra à la victime d’une surcensure de plaider finalement sa cause pour espérer passer entre les grilles de ce tamis.
De larges pouvoirs au profit du CSA
Le groupe LREM espère muscler davantage encore les pouvoirs du CSA. Celui-ci devrait, à leurs yeux, pouvoir recueillir « auprès de opérateurs de plateforme en ligne (…) toutes les informations nécessaires au contrôle [de leurs] obligations ». Le conseil pourrait ainsi scruter les moyens mis en œuvre pour empêcher la réapparition des contenus, voir exiger au moyen de ses « recommandations » telle ou telle solution technique.
Une véritable petite perquisition administrative qui se passera de l’intervention préalable du juge. Celui-ci n’interviendra de fait qu’a posteriori.
Avec de telles dispositions se prépare l’avènement d’un gigantesque contrôle parental obligatoire, piloté par le CSA, sous couvert de lutte contre la haine.
Un observatoire de la haine en ligne, un parquet spécialisé
Le même parti majoritaire veut introduire un « observatoire de la haine en ligne ». Sa mission ? Analyser « l’évolution des contenus illicites et de leur diffusion », et émettre « des propositions pour les prévenir s’appuyant, notamment, sur le suivi de la réponse pénale, des actions de sensibilisation, et de l'accompagnement des victimes. »
Remarquons que le gouvernement profite de cette fenêtre parlementaire pour intégrer un parquet et une juridiction spécialisés sur la haine en ligne. Il sera adossé « au déploiement de la future plateforme de dépôt de plainte en ligne qui résulte du nouvel article 15-3-1 du code de procédure pénale issu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ».
« Cet amendement, poursuit l’exécutif, permettra à la Chancellerie de disposer d’une base juridique solide afin de définir une politique pénale renouvelée pour lutter plus efficacement contre la cyberhaine notamment en permettant la spécialisation d’un parquet et d’une juridiction en la matière, à l’occasion du déploiement de la future plateforme de dépôt de plainte en ligne ».
Plus de pubs sur les miroirs des sites bloqués judiciairement
La proposition de loi Avia entend également faciliter les actions contre les miroirs. L’autorité administrative (sans doute l’OCLCTIC) aura la capacité de contraindre FAI et moteurs à étendre une décision aux répliques d’un site « haineux » déjà bloqué par une décision judiciaire.
Le groupe LREM veut muscler cette mesure par le concept de « follow the money » : « Dès lors qu’un site aura été condamné par la justice pour diffusion des contenus de haine visés par la présente loi et dont les sites « miroirs » auront, le cas échéant, été également bloqués à la demande de l’autorité administrative, les annonceurs et les prestataires de services de publicité en ligne sont tenus de ne pas diffuser leurs campagnes de communication sur ces sites spécifiquement identifiés et pour la durée prévue par le juge et l’autorité administrative ».
Les sociétés qui oublient cette interdiction pourront être sanctionnées par une amende.
Les autres amendements n’ont que peu, voire aucune chance de passer. Éric Ciotti veut par exemple contraindre les plateformes intermédiaires à glaner de chaque utilisateur souhaitant accéder à leurs services, une pièce d’identité.
« Concrètement, si un individu veut ouvrir un compte Twitter, Facebook, etc.… il devra au préalable fournir une pièce d’identité au site Internet ainsi qu’une déclaration de responsabilité pour les propos qu’il tient, assure l'élu LR dans l'exposé des motifs. L’objectif est double : celui qui publie un message sera non seulement identifiable immédiatement, mais aussi responsable des contenus qu’il aura publiés. Cela sera de nature à remédier au sentiment d’impunité qui existe pour les auteurs de propos haineux sur Internet ».
Il veut également que les plateformes qui ne suppriment pas un contenu soient condamnées à un maximum non de 1,25 million d’euros, mais 37,5 millions d’euros, « conformément aux recommandations du rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet de septembre 2018. »
Ces dernières propositions vouées à l’échec ont une utilité : faire passer les autres dispositions comme plus douces, plus sympathiques.

























Commentaires (45)
#1
Notez bien qu’a chaque fois personne ne veut donner des chiffres précis sur cette haine. Je suppose que ça doit toucher au maximum 0.1% des internautes, pourquoi faire donc chier les 99.9% restant ?
#2
« Outre les injures et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la prétendue race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap », sont désormais intégrés l’apologie des crimes contre l’humanité, l’apologie des crimes d’agression sexuelle, de vol aggravé, de dégradation, du terrorisme, le harcèlement sexuel ou encore la pédophilie.
Plus ces infractions sont étendues, plus le risque d’erreur sera grand…
#3
C’est pas une Loi, c’est un agrégea de cavaliers législatifs:
 " />
" />
. j’affirme sans rien comprendre que l’on part d’une zone de non droit,
. je connais rien aux outils juridiques donc je te colle le CSA, plus un comité théodule, plus des infractions pénales, et même que je t’ajoute l’obligation de retrait en 24h je me fous de savoir comment y aura bien un truc qui marche dans le lot,
. je comprends rien à l’objectif du coup je te mets la lutte contre les propos haineux dans le même sac que l’apologie du vol aggravé et puis comme j’y suis je t’y colle le cul et les tags.
Bon ça risque chouia de bloquer avec le Conseil Constitutionnel par rapport à l’objectif d’intelligibilité de la Loi et de proportionnalité des moyens, dont sanctions, par rapport à l’objectif poursuivi, mais bon vu qu’ils sont habitué à se faire défoncer devant le CC, ils se disent que dans le lot, quelques mesures vont survivre, permettant d’annoncer le lendemain de la censure par le Conseil, que ce dernier est sur la même longueur d’onde qu’eux
#4
#5
les injures et provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de […], la nation, […]
… il n’y a que moi que ça choque ?! Bientôt on sera pas loin du modèle chinois…
#6
Qu’est-ce qui choque ? Es-tu sûr de bien comprendre ?
Appeler à la haine contre les Israéliens parce qu’ils sont “méchants” avec les palestiniens ou contre les allemands parce que ce sont tous des nazis, tu trouves cela acceptable ?
Après, je suis contre cette loi globalement, mais pas contre le fait que l’on trouve inacceptables de tels appels à la haine.
Et quel rapport avec la Chine ?
#7
J’adore le passage sur l’exigence de la pièce d’identité pour responsabiliser les gens.
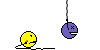 " />
" />
Vu qu’on sait déjà que ça n’arrêtera pas la haine — car nul n’a jamais vu un petit bout de truc plastifié arrêter la haine — la prochaine étape sera l’obligation pour les fabricants de souris d’électrocuter les usagers haineux pour chaque message haineux. Et si ça suffit pas, on appelle l’Hadopi et on leur coupe l’internet. Na !
#8
#9
#10
Fâché avec les infinitifs ? C’est franchement dur de te lire, je dois corriger (un infinitif !) un verbe sur 2.
 " />
" />
Faire passer un message, c’est compliqué (participe passé !), autant bien l’écrire
#11
#12
#13
#14
Critiquer Macron et LREM, c’est haineux ?
#15
#16
Personne n’appelle à la haine contre les israéliens, vous devez confondre avec le rejet de la politique du gouvernement israéliens qui elle est vraiment (très) “méchante”, vous en conviendrez.
#17
Ça dépend comment c’est fait.
Quand on parle de Macron comme étant un banquier, on en approche, surtout si l’on ajoute une histoire de complot juif.
#18
#19
c’est exactement ça !
#20
Tout va bien alors., mais bon
#21
#22
de vol aggravé
Wouhou, enfin il sera interdit d’être capitaliste et pour le salariat
#23
#24
Oui mais non !
 " />
" />
J’ai bien essayé “Darth Putin” dans la recherche d’image, mais ça ne donne que des “Darth Fakes”, tant pis …
#25
Moi, si j’étais une “plateforme”, je fermerais ma filiale française. Hop, problème réglé!
#26
Parce que tout ça n’est qu’un prétexte. cf commentaire #15
#27
#28
J’ai passé 30 minutes à lire des articles de biologie sur wikiavec ton lien. C’rst beau la culture vagabonde
#29
On trouvera forcément ce genre de cas à la marge des deux côtés, mais je parle au global, on entend plus des critiques de la colonisation que des “mort aux…”.
#30
Moins de tweets sur Twitter et moins de publications stupides sur Fessebouc et le monde se portera mieux " />
" />
 " />
" />
Sans compter que les gens perdront mons de temps à scruter leurs smartphones comme des abrutis qui n’ont pas d’autre chose à faire
#31
En effet ce n’est pas ce que j’en comprend dans les possibles interprétations qui pourront être faites de la loi.
Les exemples que vous citez me semble bien plus rentrer dans la case “xénophobie” que “injures/provocations de la nation”.
Mais avec ce texte, j’en déduis qu’il est possible de faire condamner quelqu’un parce qu’il aurait dit quelque part que “la France c’est de la merde”, “on est dans une dictature”, “on est dirigés par des fascistes”, “il faut renverser le système”… bref, tout discours un petit peu radical qui remettrait en cause l’Etat ou le système actuel pourrait être attaqué au prétexte de cette loi… et ça, je trouve que c’est inquiétant. Mais j’espère avoir mal compris et que cette interprétation n’est pas possible. (parce que tout est question de possibilité)
Concernant la Chine : avec ce type de règles de censure généralisée sur le net, on risque de dériver très rapidement (à cause des contraintes d’application) sur un web bien verrouillé, où on est totalement fichés et avec un contenu stérilisé.
On peut être sûr que tout contenu un peu dissident (parodies, reprises, caricatures, critiques politiques) risquent potentiellement d’être sur la sellette, et avec des réglementations du type “banissement à vie”, ça fait mal..!
Bien entendu, il y a quelque chose à faire vis-à-vis du contenu haineux, mais on va clairement pas dans la bonne direction, j’ai presque envie de dire “bien au contraire” : vive l’effet streisand…
#32
#33
Une connerie postée entraînant une culturation, c’est beau le Web quand même. " />
" />
#34
#35
#36
#37
#38
Oui mais donc dégoûté ou pas du vote par des gens dégoûtants ou pas, si on prends un peu d’altitude ce qu’on voit c’est qu’il faut éviter la contestation dite stérile, c’est-à-dire celle faite dans le seul but de contester sans construction derrière.
 " />
" />
Pour référence, voir le CNR : c’est bien avant d’aller scalper du nazi qu’il ont construit un programme pour l’après guerre (idem à la Révolution française d’ailleurs, et encore pareil lors de l’Indépendance américaine).
Donc admettons qu’on arrête de voter passke ça sert à rien, qu’on refuse les partis passk’ils font partie du système, et qu’on brûle la commission avec sa graisse… Voilà c’est fait…. Et après ? …. On laisse le vide à qui veut bien l’occuper ? … C’est pas les volontaires qui manquent : seront-ils moins “nocifs” ?
Ça me semble dangereux/risqué tout ça passke la faiblesse du nihilisme est que les autres ne le sont pas du tout… du coup je préfère aller voter, et dire qu’il vaut mieux voter.
#39
#40
Et du coup voici 20 secondes à regarder…
Inspiré de ceci… une autre adaptation…
Et à part ça, il parait qu’en Suisse pendant la guerre froide ils construisaient des abri anti-atomiques de partout et que de nos jours certains sont revendus, par exemple à des particuliers, ou à une fromagerie qui s’en sert pour affiner son gruyère AOP… Et sans UE, point d’AOP, n’est-ce-pas ? 🌞
#41
#42
S’toi qui veux voir les choses en sombre… j’avais parlé du CNR pour illustrer que même face à ce qu’on exècre le plus et qu’on veut détruire, il faut prévoir un après… (et que perso c’est plus ça que je regarde plutôt la force de volonté de “détruire” quelque chose)
Ça peut aussi bien valoir un point yin yang ☯ qu’un point banane 🍌 je m’en fiche !
Après, libre à toi de donner ta langue au chat 😸 , en votant ou en ne votant pas, puisque tu dis que de toutes façons c’est blanc bonnet et bonnet blanc 🙄
#43
il va falloir trouver un éqivalent au point goodwin pour toutes loi que l’on fait passer en force en utilisant la pédophilie en argument.
#44
Il y a fort longtemps,
 )
)
dans une galaxie lointaine
mais pas trop non plus,
les latins ont peut-être déjà
inventé ce que tu cherches :
L’appel à la terreur (en latin argumentum ad metum ou argumentum in terrorem)
et ça peut dériver en :
Argumentum ad nauseam
D’après google trad, il suffit de remplacer argumentum (argument) par iuris (loi) ou leges (législation) ; donc :
iuris ad metum
leges in terrorem (ça en jette, hein ?
iuris ad nauseam
Tiens ça me rappelle aussi que si tu cherches l’antidote, c’est le ririssime reductio ad hilarium… à ne pas confondre avec le reductio ad Hitlerum qui est moins efficace, même si plus répandu, la preuve je viens juste de me faire avoir même si c’était pas ce que je voulais dire…
#45
j’ai pensé à : Point-requin !
(car ‘le Point Godwin” NE ‘colle pas’ tjrs.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin