Une proposition transpartisane pour réagir à « l’influence croissante des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques ». Voilà l’enjeu du texte tout juste enregistré au Sénat par Éliane Assassi et Arnaud Bazin, dans le sillage du rapport de la commission d’enquête de mars 2022.
« Le Gouvernement a réagi avec une grande fébrilité face à nos révélations : il a multiplié les opérations de déminage médiatique, mais également les contradictions. Surtout, il s’est contenté d’annonces. Beaucoup d’annonces, mais peu d’actions : sa circulaire du 19 janvier 2022 ne constitue qu’un mur de papier face à la multiplication des prestations de conseil. Fidèle au rapport de la commission d’enquête, notre PPL va bien plus loin que les annonces du Gouvernement ». Les propos sont signés Eliane Assassi, la sénatrice auteure du rapport sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.
La proposition de loi « encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques », cosignée par 16 sénateurs de tous bords politiques, dresse une photographie accablante des problèmes soulevés par ces prestations privées.
De l'« opacité » avec un État sans « vision globale de ses prestations de conseil, qui restent le plus souvent inconnues des citoyens, mais également des fonctionnaires ». Un foisonnement « incontrôlé » de prestations, avec plus d'un milliard d'euros dépensés en 2021, ou encore la pratique des accords-cadres. De vraies « boîtes noires » où « les bons de commande ne sont pas publiés et restent "sous les radars", ce qui renforce le climat d'opacité ».
S’y ajoute une dépossession de l’État avec ces « missions stratégiques sont "déléguées" à des prestataires privés, pourtant dépourvus de légitimité démocratique ». Les consultants chargés de transformer l'administration sont aussi épinglés pour leurs méthodes dites « disruptives », à coup de « post-it, gommettes, serious games, etc. ». Des pratiques « souvent mal vécues par les fonctionnaires ».
Enfin, s’ajoutent des risques déontologiques que ces sénateurs estiment non maîtrisés : « les consultants conseillent simultanément plusieurs clients, dont les intérêts peuvent être divergents », et « en l'absence de déclaration d'intérêts, l'État ne connaît pas la liste de leurs clients ».
De même, « les cabinets recrutent d'anciens responsables publics ("pantouflage") pour renforcer leur légitimité auprès de leurs clients et s'implanter plus facilement dans le secteur public. Le recrutement d'anciens fonctionnaires peut même devenir un argument de vente, comme l'a constaté la commission d'enquête ».
La proposition de loi ne remet pas en cause l’appel à des consultants extérieurs, mais veut répondre à ces enjeux avec une série de dispositions réparties en 13 articles.
Un périmètre d'application très large
Les premières lignes définissent le périmètre de la loi, à savoir les prestations de conseil réalisées par l’État et ses opérateurs, les autorités indépendantes et les établissements publics de santé. Tomberaient dans le giron : le conseil en stratégie, en organisation des services et en gestion des ressources humaines ou encore le conseil juridique, en communication ou en informatique.
Un vaste champ d'application permettant d'encadrer ces prestations dans de multiples scénarios. Pour « en finir avec l’opacité des prestations de conseil », la PPL veut obliger les consultants à « indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leurs prestations ».
De même, quand un document a été rédigé avec leur participation, « directe ou indirecte », il devrait mentionner cette information, outre « la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel ».
Une liste des prestations de conseil serait dressée chaque année dans le cadre de la loi de finances. Sous réserve des secrets habituels (défense nationale, sécurité des systèmes d’information, etc.), il préciserait le ministère ou l’organisme bénéficiaire, l’intitulé de l’accord-cadre, son objet ou encore le montant de la prestation.
Ces données seraient publiées « sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Une manière de faciliter l’analyse de ces informations pour dresser par exemple un historique de ces pratiques, et les sujets considérés comme d’intérêts par le gouvernement. Et « pour rendre les accords-cadres plus transparents, l'article 4 dispose que les bons de commande des prestations ou l'acte d'engagement des marchés subséquents sont publiés en données ouvertes ».
- La proposition de loi
- L’exposé des motifs
- Le communiqué de presse
- Le rapport de la commission d’enquête
Fin des prestations de conseil à titre gracieux
Dans la lignée du rapport de la commission d’enquête, la proposition de loi « interdit de proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux ». Seules les actions de mécénat seraient acceptées.
Pourquoi ? Le rapport sur les cabinets de Conseil a identifié plusieurs difficultés issues de ces pratiques : « le pro bono n’est encadré par aucun régime juridique, à l’inverse du mécénat. Le périmètre et le contenu de la prestation, l’organisation du travail, les principes déontologiques… dépendent du bon vouloir de l’administration et des cabinets de conseil ».
De même, « la signature d’une convention n’est d’ailleurs pas systématique, comme l’atteste l’exemple du sommet Tech for Good organisé par l’Élysée : aucun contrat n’a été signé pour cadrer l’intervention de McKinsey lors de l’édition 2018 ».
« Le pro bono peut s’accompagner d’un risque de contrepartie onéreuse », ajoutait le même rapport. Auditionné, Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, avait lui-même relevé que cette générosité ne devait pas constituer « en quelque sorte, une première dose d’héroïne », créant le cas échéant une situation de dépendance de l’État ou ses opérateurs.
Une évaluation de toute prestation
Pour mieux enfoncer le clou de la transparence, la proposition de loi exige une évaluation de toute prestation de conseil, y compris ses conséquences sur les politiques publiques, et un « bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles pénalités infligées au prestataire ».
Cette évaluation serait cadrée sur un modèle déterminé par décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Et évidemment, serait publiée, toujours « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
Notons que pour la CADA, ces rapports peuvent être visés par une demande de communication auprès de l'administration, ainsi que nous l'avons expérimenté avec le rapport McKinsey. Rapport que le ministère de l'Éducation ne nous a toujours pas transmis.
Fin du brainstorming behind the scene à fin de feedbacks
Coup de froid dans la « startup nation » : les différents échanges des cabinets de conseil devraient être rédigés en français, afin de limiter l’emploi de termes incompréhensibles pour les concitoyens. Adieu « benchmarking », « power-point », « BtoB », « brainstorming », le « behind the scene » ou le « feed back », et toutes ces expressions qui fleurissent au grand dam de la loi Toubon de 1994.
Afin de mieux valoriser les compétences internes « et moins recourir aux cabinets de conseil », chaque ministère devrait, dans les 6 mois puis tous les cinq ans, remettre au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant « la cartographie des ressources humaines dont il dispose, en interne et dans le cadre interministériel », « les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne » et « les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil ».
Cette photographie des forces en présence permettrait de réinternaliser les compétences plutôt que de faire appel à des prestataires extérieurs.
Lutte contre les conflits d'intérêts
Sur le terrain déontologique, dernier chapitre de la proposition de loi, l’accent est porté sur la lutte contre les conflits d’intérêts. Par exemple, « avant chaque prestation de conseil, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter ».
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pourrait être saisie pour avis de toutes questions portant sur ce sujet. Une déclaration d’intérêts serait remise par chaque prestataire et consultant décrivant notamment les missions réalisées dans le même secteur dans les cinq dernières années.
Les prestataires de conseil devraient également lui communiquer l’ensemble des « actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations », mais aussi les éventuelles actions de mécénat.
Toutes ces opérations seraient contrôlées par la HATVP, qui pourrait être saisie par l’administration concernée, une organisation syndicale de fonctionnaires, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, ainsi que par des associations agréées.
Le dernier article prévoit une série de sanctions pour les irrégularités constatées pouvant atteindre 15 000 € par manquement. Les indélicats pourraient être exclus des procédures de passation des contrats de la commande publique « pour une durée maximale de trois ans ».
Une disposition a été spécialement introduite pour prévoir « un contrôle systématique de la HATVP lorsqu'un responsable public part exercer une activité de consultant dans le secteur privé ("pantouflage") ou lorsqu'un consultant rejoint l'administration ("retropantouflage") ».
Dans un tel cas, « la HATVP pourrait rendre un avis de compatibilité, d'incompatibilité ou, cas qui resterait sans doute le plus fréquent en pratique, de compatibilité avec réserves. Cet avis lierait l'administration et l'agent intéressé, qui auraient l'obligation de le respecter ».
En outre, « lorsqu'un responsable public devient consultant, il devrait désormais rendre compte de son activité à la HATVP à intervalles réguliers (au moins tous les 6 mois) et sur une période de 3 ans ».
Protéger les données des administrations
Le chapitre V de la proposition de loi entend « assurer une meilleure protection des données de l’administration ».
Elle met en place un mécanisme de finalités dans la mesure où « les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leur prestation » ne pourront être utilisées que « dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation ». Pour bien insister, la PPL prévient que « toute utilisation pour une autre finalité est interdite ». Les données collectées pour la mission devront être supprimées dans le mois suivant la fin de la prestation.
Même si des données à caractère non personnel sont collectées, les sénateurs veulent faire intervenir la CNIL pour s’assurer du respect de ces principes. Elle pourra ainsi être saisie à cette fin par l’administration concernée.
La proposition de loi en appelle aussi à l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information pour établir « un référentiel d’audit de la sécurité des systèmes d’information attendu d’un prestataire de conseil ». Si la proposition devient loi, elle aura à certifier les prestataires indépendants pouvant conduire cet audit. Le prestataire de conseil devra fournir une attestation pour démontrer que cet audit a bien été réalisé.
Pourquoi cette intervention de l’ANSSI ? La commission d’enquête avait relevé que « la manipulation par les cabinets de conseil de données potentiellement sensibles reste une source de vulnérabilité pour l’État ». Auditionné en janvier 2022, Guillaume Poupard, directeur de l’Agence, avait lui-même souligné que ces cabinets « peuvent eux-mêmes être des cibles de cyberattaques ».
Le scénario imaginé par la commission ? Celui d’un cabinet qui ferait appel à un prestataire d’hébergement soumis à la compétence extraterritoriale du Cloud Act « et, en conséquence, être amené à devoir communiquer aux autorités américaines des données détenues par des cabinets de conseil ».
Dans un communiqué, les auteurs de la proposition de loi indiquent avoir écrit à la Première ministre « pour lui demander d’engager la procédure accélérée, seul moyen pour que la proposition de loi puisse être débattue par le Parlement dès l’été prochain. Dans l’hypothèse où le Gouvernement refuserait cette demande, le texte pourrait être examiné au Sénat à l’automne ».
Par ailleurs, un documentaire sur le rapport de la commission d’enquête sera diffusé sur Public Sénat le samedi 25 juin 2022 à 17 h 30. Il « sera également disponible sur le site Internet de la chaîne ».


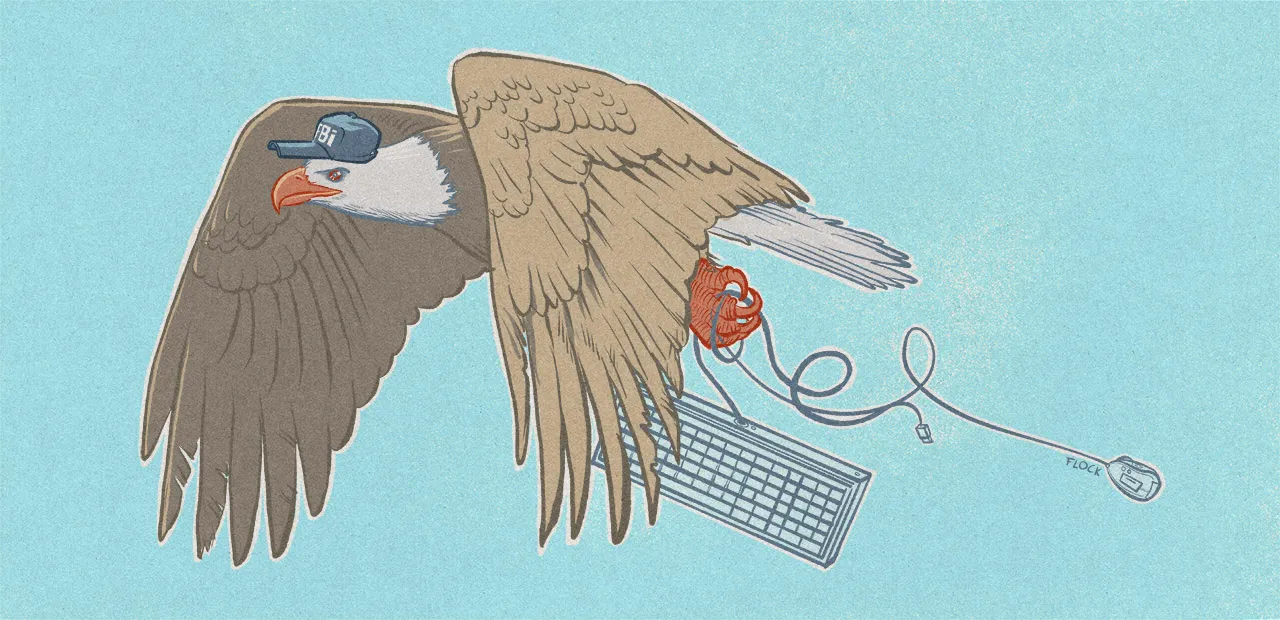
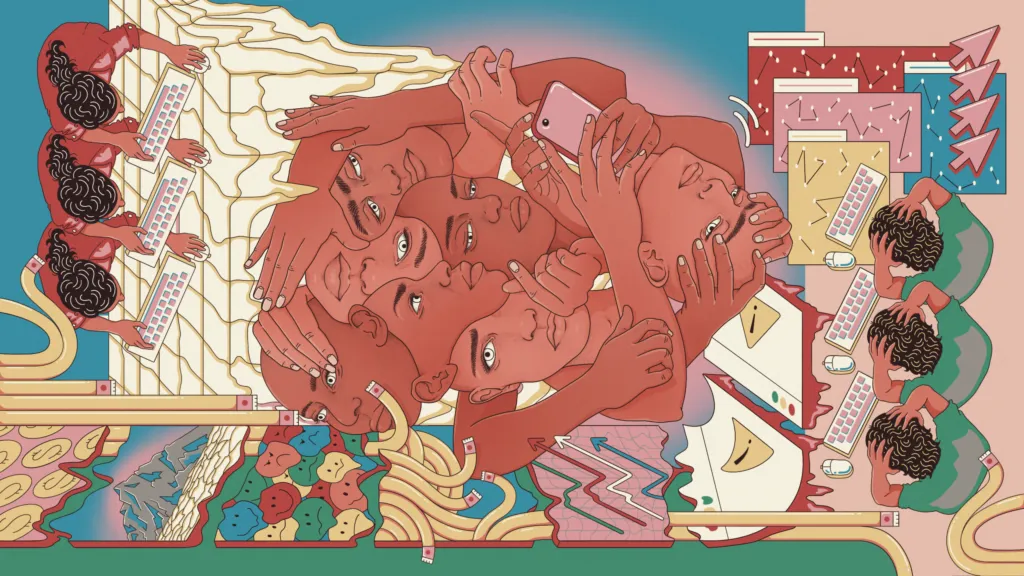
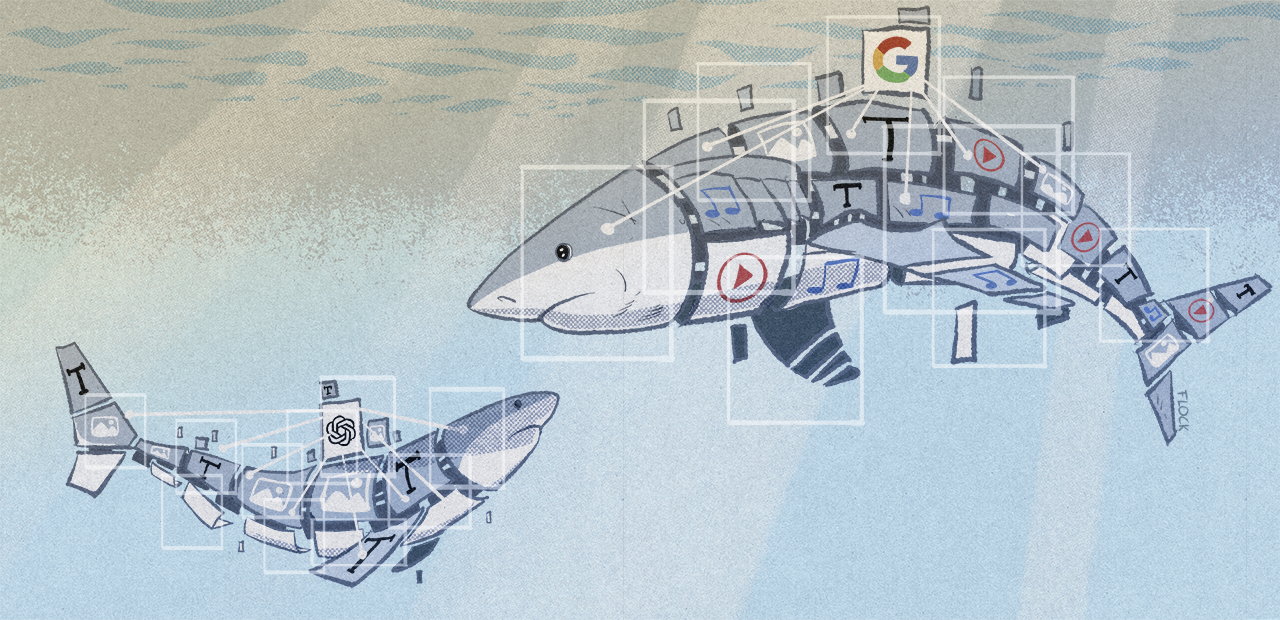

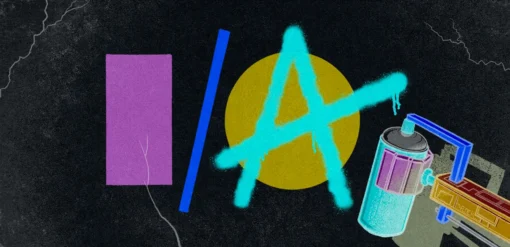

Commentaires (21)
#1
Pour moi la transparence par défaut devrait être une évidence (Après tout ces rapports sont commandés par l’état, donc nos impots, donc nous tous sommes les “clients”).
D’autre part, le conflit d’intérêt reste toujours latent : Le but d’un cabinet de conseil c’est de faire du chiffre, toujours davantage. Or ces cabinets peuvent être saisi par l’administration , mais aussi par des sociétés privés : Rien n’empêche donc que des sociétés privée “paie” pour que cabinet de conseil oriente plus ou moins ses conclusions. Et ça, comme ça reste dans le giron du privé, c’est pas communicable au public.
J’approuve la volonté des politiques de s’intéresser un peu à comment marche en pratique le terrain, vu qu’on les accuse souvent d’être dans une tour d’ivoire.
Mais par contre je suis pas sur que les “cabinets de conseil” soient les meilleurs relais en la matière….
#2
Un truc que je n’ai pas compris, est ce que les sociétés comme de conseille informatique comme Cap, Atos, Sopra etc. seront aussi concernés ?
#3
Mais…
#4
Dommage que cela reste limité à l’administration centrale. Il me semble que les administration territoriales utilisent aussi des cabinets de conseil.
La HTAP va devoir embaucher pour gérer ces déclarations d’intérêts supplémentaires. Je me rappelle que la HTAP avait avoué ne pas avoir assez de moyens humains pour la phase II de la transparence de la vie public, où elle devait contrôler les élus et directeur de cabinet des départements, des régions, des grosses agglomérations. Malheureusement, cette phase II a été annulé à cause de ce manque de ressources humaines, au détriment de la démocratie.
#5
Enfin ! J’avais l’impression que la question de la compétence n’allait jamais être abordée dans cette affaire …
Mais vu à quel point l’idée que « les fonctionnaires ça coûte trop cher » est extrêmement rependue, je pense que ça ne passera pas. Et qu’on continuera à passer par des boîtes privées et parfois étrangères, qui se cognent du pays - leurs intérêts sont ailleurs - et qui se cognent de payer leurs impôts.
Vous devez comprendre, jeunes petits idéalistes de gôche, « ça au moins ça génère de la valeur », « eux ils s’habillent en costume », « on a pas le choix parce qu’on a pas les gens compétents (parce qu’on les vire en continu depuis des décennies) » , ou 😑
J’ai peu d’espoir que le projet arrive devant l’AN. Et même si c’est le cas, peu d’espoir que ça passe pour de vrai. Dommage, ça aurait permis de prendre la température de la nouvelle assemblée …
#5.1
Erreur, on ne les vire pas, ils partent gagner 3 (voire plus) fois plus dans la boite privé qui revend sa prestation a la même société qu’il a quitté
#6
Si je comprends bien, c’est un texte du Sénat donc validé par LR. Si la NUPES et le FN valident ça peut passer…
#7
Normalement oui vu que le fameux McKinsey n’est qu’un cabinet de conseil et de prestations parmi d’autres, et surtout qu’il touche chaque année beaucoup moins de l’État que les Atos, Cap et autres Sopra.
C’est d’ailleurs ce point qui m’a laissé un peu pantois dans cette histoire sur McKinsey (certes c’est un des plus chers).
De tas de sociétés de toutes tailles, et pas que l’État, font appel à des prestations de service ou de conseil. Parce qu’au final c’est moins cher, parce que les besoins ne sont pas forcément en continu sur tous les domaines, et parce que côté informatique il y a pas mal de spécialisation (là je parle en connaissance de cause).
Vu tout ce qui est passé ces dernières décennies en terme d’avancée sur les diverses transparences (on a eu la HATVP entre autres), c’est le sens de l’histoire et ça passera.
#8
C’est “marrant” ce genre d’idée simpliste (ou qui ne voit pas l’ensemble), et ça sous-entend que le comportement des sociétés n’est pas rationnel, alors que c’est leur argent.
Si des cabinets de conseil comme McKinsey, Deloitte, Ernst & Young et pas mal d’autres existent, c’est pas juste parce qu’il y a des boîtes privées (ou publiques) qui aiment claquer de l’argent.
#8.1
C’est marrant que tu es toujours complétement dans ton idéologie libéral et ne vois même pas la réalité en face.
Comme dit dans les commentaires au-dessus, le recourt à des cabinets de conseil est uniquement la conséquence de l’idéologie :
“Un employé c’est nul et ça coute cher et un consultant c’est bien car on le vire quand on veut”
ou au format comptable
“La masse salariale c’est le MAL, c’est mieux de l’OPEX”
Tu as même une tripoté d’étude qui montre le changement de fonctionnement des sociétés ces 20 dernières années, avec la perte de sens du boulot (tout est segmenté, cloisonné, majoritairement sous-traité,tu fais souvent un travail dont tu ignore qui l’utilisera in fine), la non-reconnaissance, l’impossibilité d’évoluer dans une société de nos jours sans en changer (ce qui était TRES courant du temps de mes parents encore, et je ne suis pas si vieux).
Les bons se barrent car c’est le SEUL moyen d’évoluer, basta. Et les boites acceptent de payer des fortunes en prestation car ça passe dans l’idéologie qu’on peut dépenser en OPEX mais pas en CAPEX/masse salariale.
Et c’est particulièrement criant en informatique : Tu as été voir les offres d’emploi “salariés” en IT ? En privé comme en public ? Tu penses vraiment que quelqu’un d’à peu près compétent va y aller ? Ce sont des reconversions qui le font avec un niveau pourrie (même pas de leur faute).
C’est d’ailleurs assez drôle quand on sait que maintenant les directeurs FR ne jurent que par les méthodes de management à la GAFAM, alors que justement tout ce que disent ces boites c’est : “Les ressources compétentes sont rares, durent à acquérir et à tenir, choyez-les, donner-leur de l’autonomie, valoriser leur travail et faites-leur confiance”.
Exactement le contraire de ce qu’ils font, donc.
#9
C’est bien le problème de partir du principe que l’État est une boîte privée à but lucratif comme les autres …
… du coup effectivement je pense pas que tu puisses comprendre.
Je crois que tu as interprété le sous-entendu à ta sauce, et donc de travers. Perso j’y vois plutôt le fait que l’État sous-paye ses fonctionnaires compétents et les enferment dans le carcan réglementaire étatique, et du coup ces gens préfèrent partir dans le privé. J’en ai vu beaucoup dans ce cas-là perso. Mais c’est p’tet moi qui interprète à ma sauce et donc de travers ;)
#10
Ce n’est pas parce que l’État n’est pas une boîte privée qu’il doit dépenser son budget n’importe comment. Prendre soin de l’argent des contribuables ça me paraît normal. Rien qu’au niveau d’une commune, j’attends de mon maire et de son conseil municipal qu’il ne fasse pas n’importe quoi avec le budget municipal.
#11
Vu comme ça c’est mieux oui. On gagne mieux dans le privé quand on est au niveau cadre, après on a d’autres inconvénients (dont le chômage possible). Mais de là à gagner 3 fois plus, c’est une autre histoire. On a aussi un rapport un peu différent avec le travail (c’est pas une critique de la fonction publique ou privée).
Pour ma part j’aimerais que la mobilité soit meilleure dans le public et les compétences mieux valorisées (j’ai bossé pour quelques administrations et discuté avec des agents), mais pour diverses raisons c’est moins réactif que dans le privé.
(tu m’as fait rigoler avec « à ta sauce, et donc de travers » Petite pique que j’ai bien prise)
Petite pique que j’ai bien prise)
#12
Bien sûr, mais le fait de bien gérer son budget n’est pas propre à une entreprise privée, tu peux appliquer le même raisonnement avec n’importe quoi : y compris les associations ou les personnes physiques. Et la différence avec une entreprise privée, c’est que le but de cette dernière est d’être lucrative. Et selon moi ce n’est pas le but de l’État, et c’est pour ça qu’une comparaison entre les 2 ne me paraît pas pertinente du tout, et assez problématique.
Ce qui ne veux pas dire que l’État ne doit pas faire attention à son budget, simplement que les finalités des boîtes privées et de l’État sont très différentes (ça ne devrait même rien avoir en commun en théorie), et donc la gestion du budget aussi. S’inspirer du modèle de l’entreprise pour gérer un État, c’est assez symptomatique du marteau pour qui tous les problèmes sont des clous …
#13
C’est vrai que leurs multiples affaires de conseils à la fois aux politiques publiques et aux industries pharmaceutiques ayant déjà provoqué des centaines de milliers de morts, c’est un détail. Vraiment étrange de s’offusquer qu’ils continuent à être employés en France et à recruter nos jeunes les mieux “formés” alors qu’outre Atlantique ils puent la mort, au sens propre.
Sans parler du fait qu’EM c’est McKinsey (et BCG). Bref j’ai du mal à croire à la sincérité de ta naïveté affichée.
#14
Non.
Parce que ça permet de mettre les coûts sur des lignes d’investissement (ce que les actionnaires adorent) plutôt que dans la masse salariale (ce qui donne de l’urticaire aux actionnaires).
Et au niveau de l’Etat parce que ça permet de faire croire que diminuer le nombre de fonctionnaires c’est faire des économies.
#15
Ou pas.
Un cabinet de conseil fait du conseil, pas de l’informatique. Ca a autant de rapport entre un maraîcher et Airbus en terme de métier. Et 90% du temps, il n’y a pas de grosse spécialisation, c’est soit assistance utilisateurs / gestion de parc / applications métier, soit administration système et/ou réseau.
D’ailleurs, dans mon administration, il manque énormément de techs informatiques (pour faire de l’assistance utilisateurs et gestion de parc, principalement). Mais ca ne veut pas embaucher de fonctionnaires (dernier concours : 3 postes prévus, alors qu’il y en a au moins 30 vacants dans le pays et qu’on va avoir un certain nombre de retraités d’ici la fin de l’année). A la place, on est obligé de recourir à des contractuels. Qui coûtent plus cher qu’un fonc. Qu’il faut former à chaque fois. Et qui peuvent se barrer à chaque fin de contrat (sachant que pour avoir un CDI faut tenir au moins 5 ans, ce qui reste peu courant). Et donc avec un nouveau départ à zéro.
Enfin, ca c’est quand on arrive à en trouver…
Tout en coûtant dans les faits, souvent plus cher qu’un fonctionnaire qui connaît bien son domaine.
#16
Je peux confirmer, comme sans doute beaucoup d’autres ici, que la compétence n’a jamais été affaire de status (ni de cv ni d’âge d’ailleurs mais c’est un autre sujet). ).
).
Dans mon précédent poste j’ai personnellement dû composer avec deux incompétents tête à claque, l’un fonctionnaire, l’autre prestataire. Un partout la balle au centre (bon si je devais vraiment compter tout le monde y’aurait peut-être 10% de déséquilibre en défaveur de l’administration
#16.1
au pif (mais vraiment au pif hein) les presta incompétents soit ont les dents qui rayent le parquet, et donc arrivent à “monter” dans la hiérarchie, éventuellement jusqu’à exploser en vol, soit ils se font dégager s’ils savent pas bien broder, du coup ils disparaîtront “naturellement” de la partie visible, quand le fonctionnaire se fera peut-être “juste” caler dans un coin pour le rendre plus inoffensif, mais ils sera toujours visible
c’est juste une supposition sur la visibilité des incompétents
#17
C’est loin d’être vrai. La plupart des entreprises d’Etat (ie: SNCF) ont transféré leur masse salariale disons pour faire court, non “coeur de métier”, vers de la facturation externe pour “acheter ” des presta fournie par des cabinets externes (ie/ Altran et consorts).
Ces presta sont facturés à la journée mais employés à l’année grâce à “la nécessité de poursuivre le projet qui prend du retard ou qui réclame plus de travail que prévu”. En même temps, ces presta s’auto-évaluent et le gestionnaire interne n’a pas d’autres choix que de signé les bon pour accord. Je vois dans le projets 1 interne pour 15 externes aujourd’hui. Et je ne parle pas des presta opérationnels, là c’est un carnage.
Rappel: La facturation jour/homme d’un presta n’est pas celle d’un salarié interne.
Autre point non négligeable:
Les tueurs de coût tant apprécié par la macronie (c’est gratuit) ont fait des ravages en échange de primes dont le montant ferait bondir la plus part des citoyens.
Certains services ont été scalpé après le rapport du dit tueur.
Résultat: Un exemple, la suppression d’une entité de 10 personnes dédiée à la maintenance d’équipements d’infrastructures critiques est passé crème. Quelques mois plus tard, un équipement tombe en panne: personne ne sait comme le réparer=> Perte d’exploitation énorme durant quelques jours puis décision de changer les équipements conseillé par le cab: 384 M€ . Ah oui, c’est le même cabinet qui a fait l’audit tueur de coût et l’étude de remplacement d’infra.
Résumé:
Suppression de 10 personnes=> 5 jours de perte d’exploitation + 384M€ de dépenses imprévues + la prime du tueur de coût=> transfert de compétence source vers une entité externe qui dégagera de forts dividendes.
La note est pour l’Etat, ceux qui le finance, et après on nous dit que les hôpitaux n’ont pas de pognon.
La vraie perte que mesure bien les néolibéraux, c’est de supprimer la compétence de l’entreprise publique (ie: l’Etat) pour pouvoir la remplacer par celle qu’elle vendra au prix fort et fort longtemps.
Transfert de compétence == transfert de fond
Tu as beau être un néolibéral de base (c’est pas une injure mais un constat, tu as le droit d’être ce que tu veux), mais tu es aussi un citoyen français, (je crois). Cautionner ce genre d’action c’est tirer une balle dans les pieds de la France. Tu veux vraiment la faire tomber?
#18
On sait bien que ce n’est que de la posture. C’est pour se donner une image, un peu comme quand ils font soit disant de la méthode Agile mais c’est fait n’importe comment, mais c’est pas grave, il y a le tampon Agile et ça fait permet aux formateurs de vivre ^^.