L’Arcom devrait bénéficier de 46,6 millions d’euros de subventions. Les « Jaunes Budgétaires » relatifs aux autorités administratives indépendantes, documents annexés au projet de loi de finances pour 2022, témoignent dans le même temps d’un effondrement de la riposte graduée en 2020.
Le budget initial de la nouvelle autorité, tout juste née de l’absorption de la Hadopi par le CSA, sera adopté en début d’année 2022. Selon les premières estimations, les crédits seraient de 29,6 millions d’euros pour les frais de personnel, 16 millions d’euros pour le fonctionnement et 2,3 millions pour l’investissement. Quant au plafond d'équivalents temps plein travaillés (ETPT), il s‘établirait à 355 dont 209 au CSA et 65 à la Hadopi.
« Cette fusion, si elle doit améliorer l’efficacité de la politique publique dans le domaine de la protection des œuvres et des publics, n’a pas réellement vocation à générer d’économies majeures » considère la Commission des affaires culturelles, non sans relever toutefois une « économie de 0,8 million d’euros résultant de l’abandon du loyer de la Hadopi ».
En juin dernier, alors que le projet de loi Arcom n’était pas encore finalisé, la haute autorité réclamait pour 2022 une subvention publique de 9 millions d’euros pour couvrir son périmètre en cours. C’est un peu plus que les 8,65 millions d’euros qui furent inscrits pour 2021. La rallonge tenait compte de la transposition de l’article 17 de la directive Droit d’auteur, relatif au filtrage sur Youtube et autres plateformes, dont la Hadopi endosse la casquette de gendarme.
Malgré les voeux de la Hadopi, le montant de la subvention finalement attribuée par le ministère de la Culture à son domaine de compétences devrait finalement être d'un peu plus de 8 millions d’euros. Un chiffre non fiable en ce sens qu’il ne tient pas encore compte des nouveaux outils de lutte contre le piratage, institués par la loi donnant naissance à l’Arcom.
Nouvelles armes contre le piratage, nouveaux investissements
Lutte contre les sites miroirs illicites, lutte contre le piratage par streaming des manifestations sportives... Les griffes de la Hadopi version Arcom, autrefois réservées au seul univers du P2P, vont déborder aussi sur le terrain du direct download et des diffusions par flux illicites.
À l’Assemblée nationale, dans la forge des débats autour du projet de loi de finances pour 2020, la Commission des affaires culturelles souligne en ce sens la nécessité de procéder à « des investissements informatiques concernant l’ensemble du champ de la régulation, relativement lourds dans le domaine de la lutte contre le piratage des évènements sportifs ».
« L’exercice de ces nouvelles missions exige le recrutement d’agents supplémentaires et le développement de nouveaux outils informatiques » constate de même le CSA, dans le rapport sur les Autorités administratives et publiques indépendantes.
En attendant ce nouvel An 1 de l'Arcom, la Hadopi note avoir connu une baisse de ses dépenses de fonctionnement. Elles « correspondent principalement à la sous exécution des crédits alloués à la mise en oeuvre de la procédure de réponse graduée liée à la diminution du nombre de saisines de la Haute Autorité, à la baisse du taux d’identification des fournisseurs d’accès à internet et aux effets de la crise sanitaire ».
Moins de riposte graduée durant l'année du confinement
En clair, la riposte graduée a connu une baisse en 2020, année pourtant marquée par le confinement durant plusieurs mois de toute la population française.
Pour apprécier ce mouvement, inutile de scruter les chiffres clés de la riposte graduée diffusés par la Haute autorité : depuis 2 ou 3 ans, ces données ne sont mises en ligne qu'au compte-goutte. Le dernier bulletin d’information remonte par exemple à mars 2020. Le précédent... à septembre 2019.
Il faut plutôt plonger son nez dans ces « Jaunes budgétaires ». On y découvre en particulier que la Hadopi a adressé l’an passé 210 275 premières recommandations (les fameux courriers d’avertissement). Et seulement 61 175 lettres remises contre signature.

Des chiffres en chute libre lorsqu’on les compare aux années précédentes, beaucoup plus fastes. En 2017 par exemple, la Hadopi avait adressé huit fois plus de premiers avertissements qu’en 2020. L’an passé, le nombre de deuxième avertissements a été divisé par plus de deux.
Pour 2021, les chiffres qui se dessinent sont encore plus bas, du moins aux deux premiers stades :
- Nombre de 1ères recommandations envoyées en 2021 (janvier-mai) : 69 555
- Nombre de 2èmes recommandations envoyées en 2021 (janvier-mai) : 19 263
Par contre, dans le même temps, le volume des transmissions au parquet s’est alourdi, passant de 922 en 2017 à 1 847 en 2020. Signe que la Hadopi a encore et toujours voulu témoigner d’une politique beaucoup plus rugueuse à l’égard des abonnés. Une réponse aux ayants droit qui ont pu critiquer dans le passé un système jugé beaucoup trop doux.
« Fléchissement en volume » : les explications de la Hadopi
Comment expliquer la fonte des lettres d'avertissement ? Contactée, Pauline Blassel, secrétaire générale de la Hadopi préfère parler de « fléchissement en volume » plutôt que d’un effondrement.
Ce « fléchissement », donc, résulterait de « l’effet combiné de divers facteurs (recul des usages illicites constatés notamment sur les réseaux pair à pair, progression constante de l’offre légale, problématiques rencontrées dans l’identification des abonnés en raison du partage d’adresses IPv4 pratiqué par un nombre accru de FAI affectant l’équilibre de la chaîne de traitement des saisines initiales en provenance des ayants droit) »
En somme les ayants droit collecteraient toujours autant d’adresses IP en amont de la procédure, mais la Hadopi parviendrait de moins en moins à identifier les titulaires d’abonnements du fait d’une mise en partage des IP avec d’autres abonnés. La fameuse problématique du port source, qui colle aux baskets de l’institution depuis son cri primal.
En mars 2021, la Hadopi nous indiquait que 30 % des IP dénoncées par les ayants droit n’étaient pas identifiés. Ce seul chiffre ne peut donc expliquer la baisse actuelle.
Pauline Blassel assure néanmoins que la riposte graduée « porte ses fruits dans des proportions toujours plus appréciables ». Ainsi, « le taux de non-réitération à l’issue de la deuxième recommandation a notamment progressé de 6 points entre 2019 et 2020, en passant de 81,7 à 87,8 % ».
Reste à savoir si ces abonnés menacés ont couru, carte bancaire à la main, sur Spotify ou Netflix, voire à la FNAC... ou bien se sont contentés de consulter les sites de streaming.
L’an passé, alors que l’envoi des premières recommandations est entièrement automatisé, les 19 agents en charge de la riposte graduée ont en tout cas traité chacun 3 220 deuxièmes recommandations dans les 288 jours travaillés.
Selon un rapide calcul, cela représente un peu plus de 14 lettres traitées par jour, auxquelles il faut ajouter les dossiers en troisième phase, préalable à la transmission au parquet, qui exigent un traitement au cas par cas, en plus des demandes d'information et de rectification adressées par les abonnés.


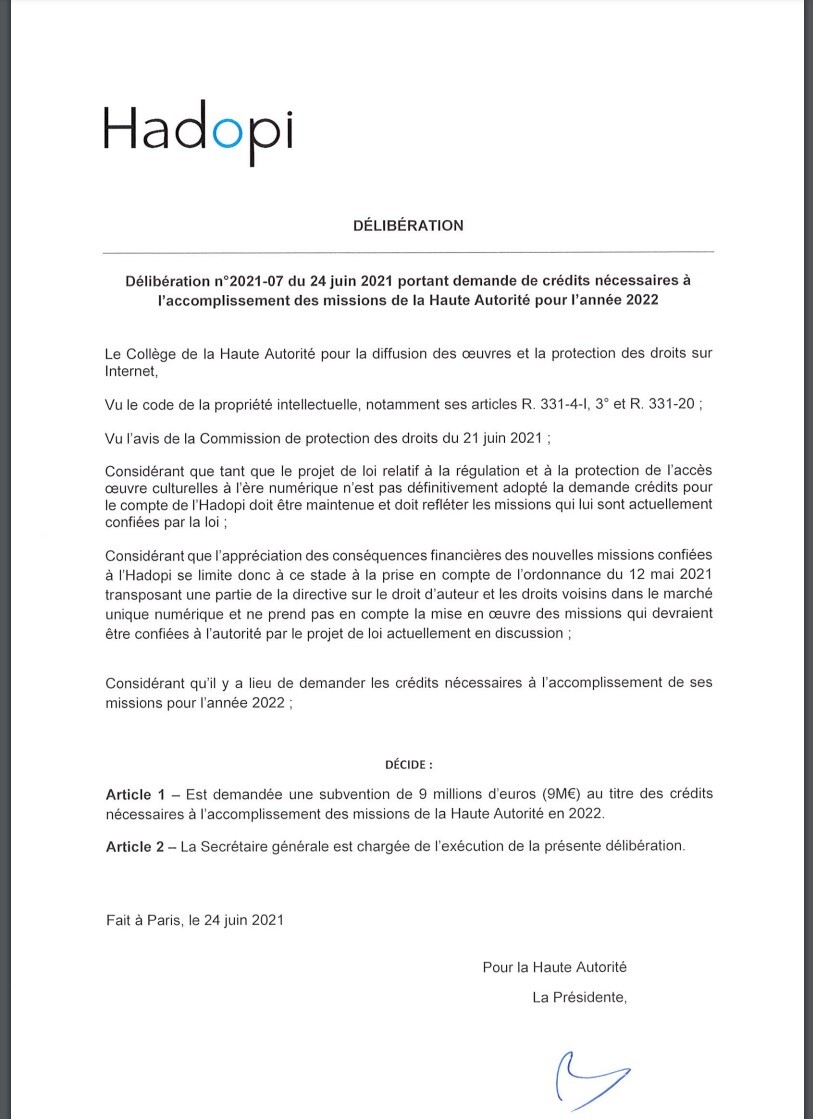



























Commentaires (36)
#1
Maintenant que le secteur privé, très majoritairement US, s´est emparé avec succès du concept de licence globale, ils ont l´air bien con avec leur chasse au torrent.
Encore une occasion ratée d’aller dans le sens de l´histoire.
C´est pourtant pas faute de les avoir prévenus dès le début.
#2
tant mieux si c’est le secteur privé qui s’en est emparé. Si ça avait été l’état, on aurait eu une usine à gaz (qui a parlé de Salto? )
)
#2.1
Jusqu’à ce qu´ils se rendent compte de ce qu´ils perdent et qu´ils pondent une version à eux, nulle mais made in France, à coup d´argent siphonné à gauche à droite, avec tous les discours habituels d´exception culturelle, de souveraineté mal placée, et de “bouh le vilain géant américain qui vient manger le pain de nos pauvres, pauvres artistes”.
On les connaît par cœur.
#2.2
Salto il y a un filet. Là, c’est plutôt un parachute.
#3
C’est surtout que plus personne veut télécharger les bouses françaises…
C’est aussi ça, l’exception culturelle française : le droit de faire des films d’auteur de merde. Le dernier exemple en date, c’est le film de Guillaume Canet.
#3.1
Les bourses étrangères sont également concernées :)
Faut pas être exigeant pour parler de svod comme d’une “licence globale”, les catalogues sont d’une pauvreté affligeante… et si on va sur des styles plus précis (animation, documentaires, divertissement, …) les nouvelles chaînes de la TNT sont presque brillantes …
#4
T´es pas assez sensible aux Bovis pour comprendre l´œuvre de ce grand homme.
#5
Spotify ça a quand même une bonne dégaine de licence globale privée. Et je doute qu´un député lambda qui y a 10 ans hurlait contre ce principe soit un jour en mesure de proposer mieux foutu ou plus complet.
Niveau vidéo y a quand même du choix, jusque dans des plateformes très spécialisées (ex. Shadowz).
On peut critiquer la pauvreté de certains catalogues, ça reste toujours plus intéressant que ce qu´HADOPI a mis en place depuis tout ce temps, avec tout ce pognon.
#6
Si on parle de licence globale, c’est quand même à mettre en relation avec la redevance. À quand sa suppression, comme on n’a aucune contrepartie…
Est-ce qu’un jour, je vais bien me marrer quand je verrais tous ces parasites tomber un à un quand le monde ralentira à marche forcé puisqu’il ne sera plus soutenable tel qu’on le connaît aujourd’hui?
#7
Pas étonnant avec toutes ces pubs Nord VPN ;)
#8
Bref technique :
4rd et MAP T/E sauvent Les abonnés, et TMG ne respecte pas la RFC 6302 d’Alain Durand.
Bref culturel:
On est passé au monde de la culture jetable streammée.
#9
Bof, ces offres sont bourrées de DRM, ça ne vaut absolument pas la liberté des fichiers qu’on trouve en P2P. Je ne pense pas qu’on puisse dire que Netflix et Spotify soit bons pour préserver les libertés numériques, au contraire même.
#9.1
Netflic et Netflic sont dans un bateau… on connaît la suite office.
#9.2
Je ne dis pas le contraire.
Je dis que le législateur s´est trompé de combat et a par conséquent perdu.
De plus il ne rattrapera plus jamais ceux qui ont pris la place, malgré leurs défauts évidents.
#10
Ce qui est amusant avec le French Bashing c’est que certains n’hésitent pas à raconter n’importe quoi.
Deezer c’est français
Canal aussi et d’ailleurs si tu veux avoir un minimum de choix en films potables, il faut passer par eux.
Bref, bader les US et basher la France c’est super tendance.
#10.1
Ah mais tu as raison, j´avais oublié que Deezer et Canal avaient été créés par la HADOPI.
Pardon.
N´hésite pas à continuer d´isoler des bouts de propos pour nourrir ton propre bashing, c´est de loin ce que tu fais de mieux sur ce site depuis toujours.
Un savoir-faire inégalable.
#11
En tant que stéréotype, tu es parfait
#11.1
N’importe quoi signifie une disqualification.
Passer par eux [qui sont français] : disqualification du reste
C’est bien résumé, les US sont une partie du reste….
C’est pas moi qui bash c’est l’autre.
CQFD
Avec 3 netflic le bateau a déjà coulé. Perdu, retentez votre chance en 2022.
#11.2
Encore un commentaire d’une grande plus-value à ce que je vois. Des problèmes dans la semaine pour ressentir le besoin de se défouler ?
#12
Non, Spotify et équivalents n’ont rien à voir avec la licence globale telle qu’elle fut spécifiée au début des années 2000 par la SPEDIDAM et l’ADAMI. Le concept de la licence globale introduit, moyennant rétribution, un droit aux internautes d’échanger les contenus entre eux de manière légale à des fins non commerciales.
Les plateformes de musique en ligne ou de SVAD ne permettent que de consommer le contenu, à aucun moment tu ne peux le récupérer et le repartager de façon légale (récupérer le contenu d’un replay d’une chaîne de TV est couvert par l’exception de copie privée, rediffuser ce contenu est à ce jour illégal). Le contenu qu’elles proposent est limité selon les droits d’exploitations dont elles disposent.
De ce fait, ils n’ont donc rien à voir avec l’idée de la licence globale qui se voulait universelle.
#12.1
Oui mais là encore…
Comment dire. J’ai l´impression de pas être clair. Désolé.
Vu que ce système privé existe maintenant et est très puissant, nous n´aurons jamais de vraie licence globale.
Parce qu´au moment où le législateur avait la place de la mettre en place, il a préféré nous coller la HADOPI.
#13
Mais elle a été votée !
https://lafibre.info/piratage/la-licence-globale-en-partie-adoptee-par-lassemblee-p2p-legaliseee/
https://www.senat.fr/rap/r14-600/r14-6004.html
C’est juste que le gouvernement (l’exécutif, donc, qui n’est même pas censé s’occuper de lois) n’a pas supporté et l’a fait supprimer, bafouant ainsi (et déjà à l’époque) leur propre système institutionnel. Mais bon, ils sont pas à ça prêt, et l’on prouvé à mainte reprise depuis.
C’est une des raisons pour lesquelles je me fout un peu de leurs décisions, il n’y a rien de démocratique dans le fonctionnement actuel - ils n’y a que des mots, peu à peu vidés de leur sens.
Pauline Blassel assure néanmoins que la riposte graduée « porte ses fruits dans des proportions toujours plus appréciables ». Ainsi, « le taux de non-réitération à l’issue de la deuxième recommandation a notamment progressé de 6 points entre 2019 et 2020
Je me demande réellement si c’est un discours à destination des journalistes, ou bien si ils croient vraiment à leurs boniments.
NordVPN & Netflix a sans doute été plus efficace que la Hadopi sur le sujet…
#14
Bandcamp te permet de DL tes albums localement dans plusieurs formats comme le FLAC, et ensuite j’en fais ce que je veux, dont les partager, par le chemin officiel, tu peux acheter un album pour un ami.
#14.1
La licence globale proposée à l’époque avait fait partie du projet de loi de la DADVSI, mais forcément il y a eu levée de bouclier dans tous les sens. HADOPI n’est qu’une résultante du manque d’ambition et de regard visionnaire des parties prenantes.
Je ne connais pas cette plateforme, mais à première vue ça me semble très différent d’un Spotify et compagnie puisque ce sont les artistes qui se produisent directement dessus. Donc à ce niveau, j’imagine que la licence accordée avec les fichiers téléchargés est à la discrétion des artistes ? (et donc les conditions de réutilisation avec)
Après, techniquement, les albums que j’achète sur certaines plateformes et qui sont libres de DRM permettent la recopie. Cependant, faire une copie pour autrui, ça va un peu au delà du cadre de la copie privée et ne me semble pas très légal en l’état actuel.
#15
En général, je ne fais pas de copies de mes albums numériques pour autrui parce que personnne IRL m’en demande mais ça ne me dérangerait pas de le faire, ou le proposer, pour être franc, je m’en tape si cela dépasse le cadre de la copie privée et ce n’est pas une loi qui va me dire ce que je peux faire ou non avec le contenu enregistré sur mon PC, après je précise que je ne fais jamais de copies pour les partager sur les réseaux P2P, j’ai essayé une fois mais mon fichier avait été refusé, depuis j’ai jamais réessayé.
#16
C’était justement l’un des buts de la licence globale proposée en début 2000, légaliser les échanges entre internautes moyennant une rétribution prélevée sur l’abonnement Internet.
Grosso merdo, comme la redevance copie privée, mais forfaitaire et couvrant tous les usages et retirant l’insécurité juridique autour de ces pratiques. Au lieu de ça, les acteurs du secteur ont préféré HADOPI, qui n’a rien changé ni amélioré.
#16.1
Maintenant on a un coefficient keynésien sur le reconditionné
#17
Yep c’était l’idée, cela dit pour la rétribution prélevée sur l’abonnement Internet machin, je vois pas comment ça aurait pu être techniquement possible, à moins de pister tout le monde et faire payer même ceux qui ne partagent pas.
Comment imposer un forfait à ce genre de pratique ? C’est la question, de toute façon c’est tombé à l’eau, et effectivement la HADOPI n’a rien changé ni amélioré, ça sera pareille pour l’ARCOM, on change juste le nom.
#18
Oula
Il existe des services en France complémentaires des services américains.
Critiquer l’un (la France) pour bader l’autre c’est être tendance, ça fait classe.
Ca y est t’as compris ?
Question naïve: à combien estimes tu cette rétribution qui inclut musique + films/séries
Tu penses que 30€ de rétribution mensuelle (estimation très basse) pour tout le monde c’est mieux que le système actuel où tu paies ce que tu utilises ?
Les acteurs du secteur ont préféré mettre HADOPI d’un côté et améliorer les offres de l’autre.
Tu estimes donc que rien n’a changé dans les offres ?
#19
Je suis du même avis, ca serait foireux et techniquement compliqué à moins de pister tout le monde et faire payer tout le monde, ça ne fonctionne pas.
Qui a amélioré les offres ? Certainement pas la Hadopi pour commencer, qui n’a joué aucun rôle là dedans, on pourrait dire que des plateformes comme Netlfix ont améliorés l’offre, le problème, c’est que d’autres plateformes ont vues le jour et c’est partie en sucette, budget qui peut être très conséquant, blocage géographique, défragmentation, moins de contrôles, pistage etc, aucunes solutions légales actuelles n’offrent la même liberté et même la qualité des solutions pirates, hormis peut-être concernant la commodité, pour la musique je vois de la qualité et un intérêt avec des plateformes comme Bandcamp que je soutiens totalement.
#20
Il y a aussi qobuz.com pour acheter des albums , en plus de Bancamp. Je suis tombé dessus hier en cherchant le premier album de Skáld que je ne trouvais nul part.
#21
A quel moment ai-je dit que la licence globale était mieux que le système actuel ? J’ai expliqué ce qu’est la licence globale telle qu’elle fut spécifiée au début des années 2000 et qu’elle fut rejetée par les acteurs du secteur qui ont préféré une haute autorité inutile (ça c’est mon avis personnel sur ce point précis).
Si tu veux des bases de recherche sur les différentes études et idées relatives à la collecte, tu peux commencer ici. Il y a déjà eu pas mal de travaux sur le sujet.
J’estime que HADOPI n’a rien changé dans les offres. HADOPI n’a ni créé, ni favorisé l’apparition des plateformes de streaming musical et vidéo. Sinon il faudra me démontrer en quoi elle l’a fait.
Deezer est né en 2007, Spotify en 2006, Amazon Music en 2007. La Haute autorité a été instaurée en 2009, tous ces acteurs existaient donc avant. Côté SVAD, c’est clairement plus tardif avec OCS que j’ai vu arriver en 2009 et le reste a été créé ou s’est introduit en France durant la décennie 2010 (après, la chronologie des médias en France n’a pas aidé à leur développement, et n’aide toujours pas).
De mon point de vue, ce sont les acteurs de la distribution qui ont fait évoluer l’offre de la façon qu’on la connaît aujourd’hui, pas HADOPI.
#22
L’offre ayant été représentée par Hadopi, le choix d’entériner les mtp revient à Hadopi.
En définitive on presiste à masquer qu’on est passés de supports assimilables à des copies distribuées à un système de distribution de droits.
La licence globale est partielle mais c’est bien cette idée qui persiste à relativiser la redevance pour copie privée par la mutation des droits, pas des supports.
Les plateformes ne distribuent pas de contenus, il faut entendre par là que l’offre n’a pas fondamentalement changée mais la distribution s’en éloigne assurément. (effet de distortion recherché).
#23
C’est déjà le cas avec la RCP, donc bon…
#24
“En mars 2021, la Hadopi nous indiquait que 30 % des IP dénoncées par les ayants droit n’étaient pas identifiés”
CECI
explique
CELA
« le taux de non-réitération à l’issue de la deuxième recommandation a notamment progressé de 6 points entre 2019 et 2020, en passant de 81,7 à 87,8 % »
S’ils n’arrivent pas à attraper tout le monde, ceux qui se font prendre peuvent… utiliser les mêmes méthodes que ceux qui esquivent (VPN par exemple, ou direct DL).
#25
Leur rapport indique le nombre de transmissions au parquet mais rien de plus…
1847 transmissions en 2020, combien de réellement poursuivis ? combien de condamnations ?
Hadopi ne communiquant pas dessus, j’imagine que la réponse est probablement proche de zéro, et j’aimerais bien la connaitre…