Comme promis en janvier dernier l’association Regards Citoyens a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. L’enjeu ? Obtenir les relevés bancaires des députés pour gérer leur indemnité représentative de frais de mandat (ou IRFM) de décembre 2016 à avril 2017.
À l’été 2019, l’organisation en charge de « Nos Députés » avait subi un échec devant le Conseil d’État. Alors que celle-ci souhaitait obtenir copie des relevés bancaires de l’ensemble des parlementaires pour la période de décembre 2016 à avril 2017, la haute juridiction administrative a estimé que l'indemnité, « destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député » est « indissociable » de leurs fonctions.
Or ces fonctions « se rattachent à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement ». Face au bouclier de la souverainté nationale, impossible du coup d’évoquer la loi CADA pour rendre transparent « l’usage de cet argent public », et notamment pour « rétablir la confiance des citoyens dans la bonne utilisation des moyens publics mis à la disposition des élus pour leurs mandats ».
D'ailleurs, seuls 10 députés avaient répondu favorablement à ses demandes de communication, mais pas les 564 autres. Une atteinte « au droit de savoir » dénonçait encore l’association.
Une logique de transparence
Après un long périple, sa demande fut tour à tour rejetée par la CADA, par le tribunal administratif de Paris et repoussée enfin par le Conseil d’État qui a d’ailleurs refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité.
Après trois ans de recours et de ballotage, Regards Citoyens a donc décidé de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme. « Alors que l’ensemble des administrations françaises sont tenues de justifier leurs dépenses, notamment devant les parlementaires, ceux-ci ne rendaient compte à personne de leurs dépenses professionnelles ».
Elle souhaite encore et toujours « pousser le Parlement vers une logique de transparence démocratique avantageuse pour tous ». La publication du relevé détaillé des dépenses « permettrait à la fois d’illustrer de manière concrète et détaillée la légitimité de la très grande majorité d’entre elles, de repérer les abus grâce au regard des citoyens, journalistes ou autres lanceurs d’alertes, et ainsi de limiter le nombre d’opérations de contrôle par les institutions » (notre actualité).
Une possible atteinte à la liberté d'expression
Sa requête a été enregistrée à la CEDH. Elle en appelle à l’article 10 de la Convention qui consacre le droit à la liberté d'expression, lequel comprend celui « de recevoir ou de communiquer des informations ». Elle rappelle que selon ce texte, des restrictions peuvent être imposées, au droit de recevoir des informations d'intérêt général, à condition d’être prévues par la loi, d’être proportionnelles et nécessaires dans une société démocratique.
Regards Citoyens considère que la France a manqué à ces trois étages. D’un, le Conseil d’État « ne s'est fondé sur aucune restriction prévue par la loi pour refuser la communication des documents ». De deux, la juridiction « n’a pas opéré de test de proportionnalité, puisqu'elle n'a pas mis en balance les intérêts en présence : le statut des parlementaires d'une part, et la liberté d'information caractérisée par le droit d'accès à ces documents d'autre part ». De trois, « l’accès aux documents ici demandés est incontestablement nécessaire à la pleine information des citoyens ».
Elle juge encore et toujours essentiel « que les parlementaires se montrent exemplaires en matière de transparence ». Alors que les scandales médiatiques s’empilent au fil des ans, autour de ces stratégiques frais de mandat, elle regrette que « la politique financière du Parlement [soit] toujours aussi opaque ».
Une longue route avant un éventuel arrêt
La requête a été enregistrée par le greffe de la CEDH (le document). C’est une première étape, mais loin d’être la dernière avant un possible arrêt. Comme nous le précise le juriste Nicolas Hervieux, la cour va poursuivre son examen pour déterminer si elle passe en phase 2, la phase contradictoire où elle pourrait prendre une décision de communication de cette requête au gouvernement français.
Tant que cette décision de débat contradictoire n’est pas prise, il persiste un risque majeur de rejet (funeste sort qui frappe une large majorité des dossiers). La cour a en effet la possibilité de déclarer irrecevables les procédures qui ne lui sembleraient pas manifestement bien fondées.


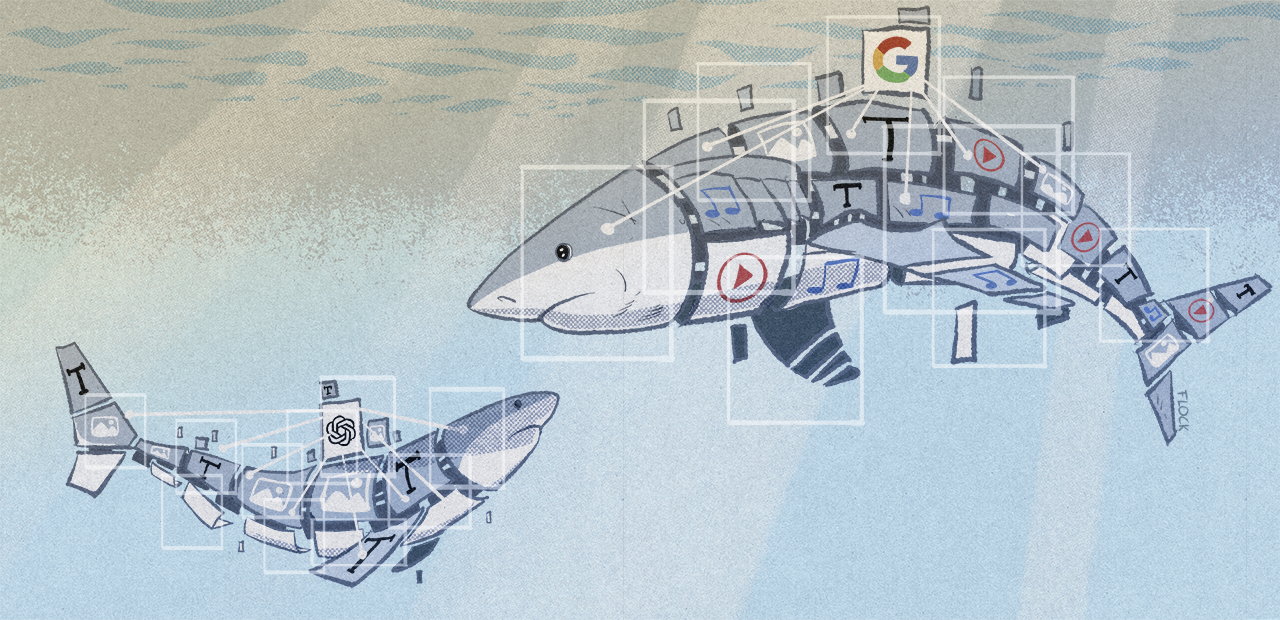

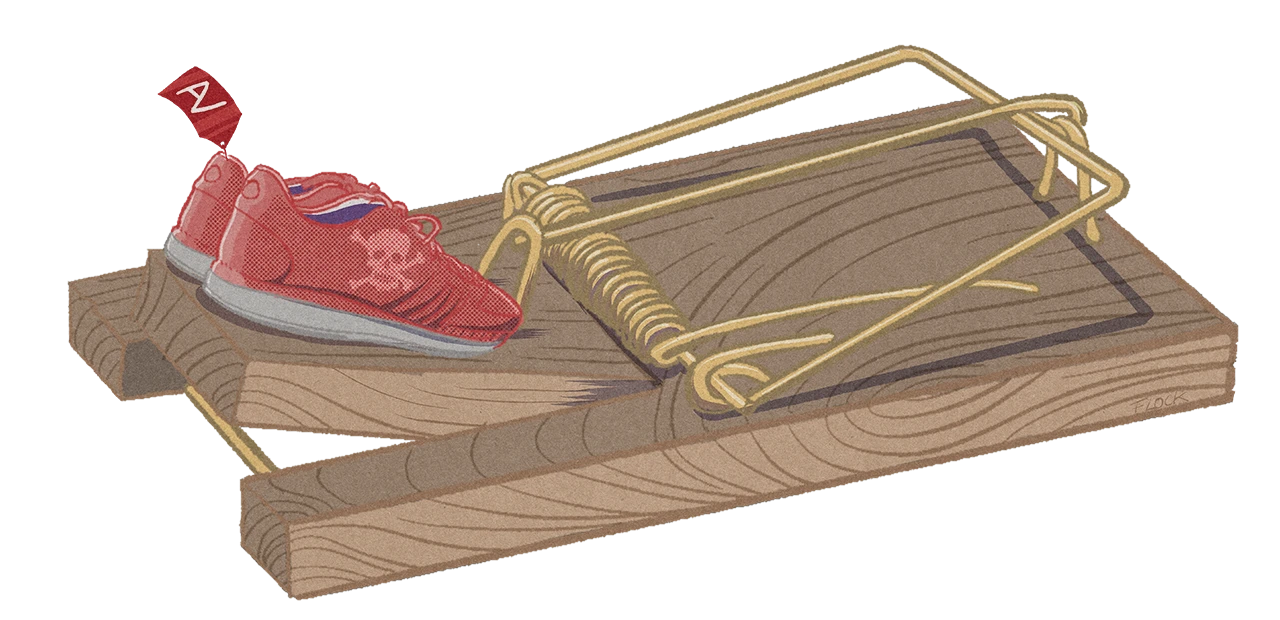
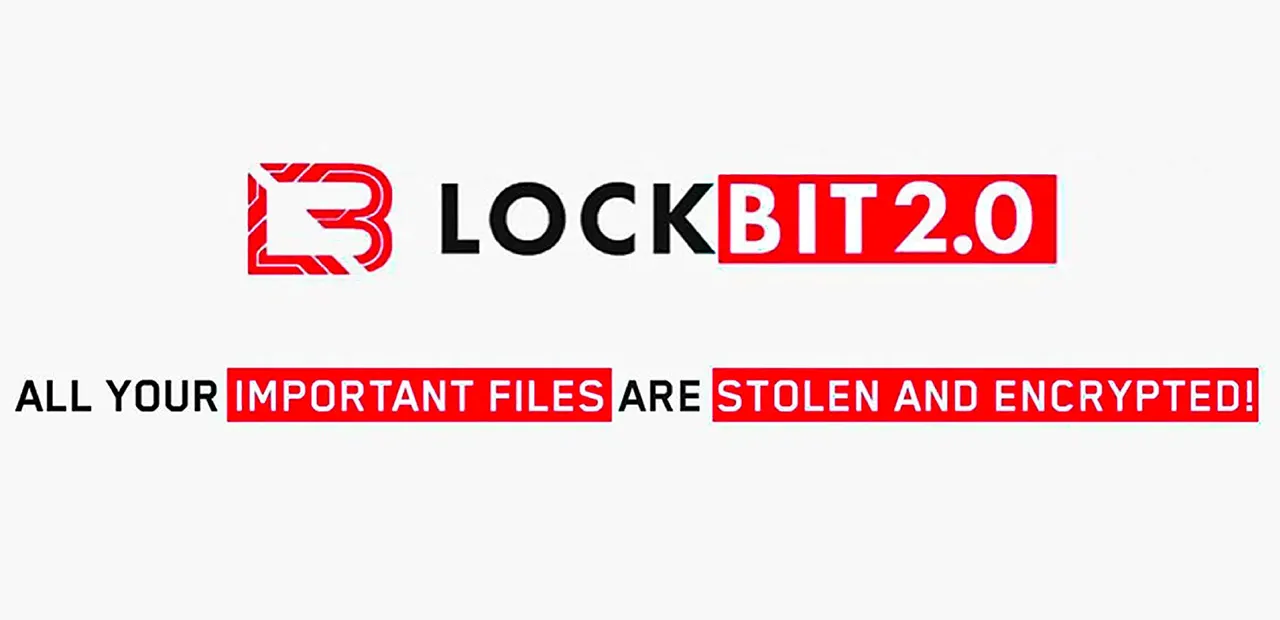
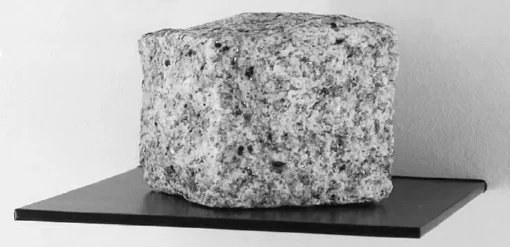


Commentaires (46)
#1
10 députés sur 564 ?
 " />
" />
on s’améliore , il me semblait que c’était 7
Miracle miracle
#2
Si il suffit d’une loi pour rendre cela acceptable aux yeux de la CJUE, je parierais ma chemise qu’une loi sera votée avant un débat contradictoire devant les juges européens.
#3
République bananière : pendant que les dépités festoient à 5 k€ par mois, le quidam trinque.
On attend avec impatience un commentaire relativiste, constructiviste, gradualiste, progressiste mais fumeux d’OlivierJ pour nous seriner que la transparence avance, que les choses vont mieux, et gnagnagni et gnagnagna.
#4
Quel est le lien même lointain avec le numérique ?
#5
Je t’invite à lire la partie «Mentions légales» du site sur lequel tu commentes. " />
" />
Arriveras-tu à lire (et à comprendre) la phrase suivante : «Produire une information utile au citoyen».
#6
Je pense que c’est le site nosdeputes.fr qui est édité par cette association. J’imagine que les informations demandées auraient été publiés sur ce site.
De manière plus générale, cela parle de la perception de la transparence qui est totalement bouleversée par le web.
#7
Tu ne connais pas l’association Regards Citoyens depuis le temps que Next inpact en parle ?
Tu devrais lire les articles de temps en temps, ça t’informerait un peu avant de lâcher tes commentaires. Je vais t’aider un peu, tu me fais de la peine sur ce coup-là : OpenData, ça t’aide comme indice ?
NB: je sais que c’est dur pour quelqu’un comme toi de t’intéresser à d’affreux communistes contestataires trollesques, mais fais un effort quand même.
#8
‘tain mais sérieux, quand t’es sensé être au service de la société, travailler avec l’argent de la société, et être payé avec (accessoirement), c’est vraiment trop demander que de demander des comptes ? Le minimum de transparence ?
Que les principaux intéressés rechignent, c’est honteux, mais au moins ils ont une raison : ils défendent leurs intérêts personnels, leur privilège de mener le train de vie qu’ils veulent sans rendre de comptes à personne. Mais maintenant pourquoi diable est-ce que les autres instances (CADA, tribunal administratif, Conseil d’État, etc.) défendent bec et ongle les intérêts personnels de ces derniers ?
Cette transparence est la norme dans de nombreux autres pays, et ils ne s’en portent pas plus mal. Bref, c’est bien beau de jouer les Cassandres comme quoi « le citoyen n’a plus confiance dans la républiques et ses institutions, il vote les extrêmes, il faut rétablir la confiance de toute urgence, blablabla » mais c’est les mêmes qui se permettent à ces pratiques qui flirtent avec la corruption institutionnalisée de perdurer …
#9
« l’usage de cet argent public »,
 " />
" />
 " />
" />
 " />
" />
et
« rétablir la confiance* des citoyens dans la bonne utilisation des moyens publics
mis à la disposition des élus pour leurs mandats ».
c’est bien de LE leur rappeler de temps-en-temps
car ils ont tendance à l’oublier, trop vite,…ça !!!
ou alors, ils bossent dans le privé, mais là, aussi, faudra rendre-des-comptes au…patron !
“mince…pas moyens d’y échapper” !
* on dirait qu’ils n’en veulent pas ?
(seuls ‘10’ = pff !!! )
#10
Bon je n’y connais rien en droit loi ou législatif , donc je ne sais pas si c’est possible
Mais il me semble qu’en faisant passer une loi rendant obligatoire de publier le détail des frais par le biais d’un 49⁄3 ( vu qu’autrement ça ne passera jamaisis) , rendrait pour une fois le 49⁄3 populaire auprès de la population
Mais bon je suppose que je suis un peu trop binaire
#11
Cette course à la transparence publique me parait malsaine car cela devient déraisonnable.
Il est essentiel que les dépenses d’argent public soient contrôlées. Mais entre publier cela sur internet aux yeux de tous, et le faire contrôler par un contrôleur de gestion, c’est bien différent. Cela ne me parait pas sein que chaque commerce, chaque restaurant dans lequel un personnage public a ses habitudes soit dévoilé sur internet ainsi.
Dans le privé, tout le management ne sait pas ce qu’il y a sur mes notes de frais. Uniquement mon responsable et le contrôleur de gestion.
Ils feraient mieux de faire appliquer des sanctions quand le contrôle de l’assemblé remarque une irrégularité plutôt que de vouloir que tout soit publié au grand jour.
#12
#13
#14
Sauf qu’un parlementaire n’est pas un fonctionnaire, ni même un haut-fonctionnaire. Avoir du pouvoir, être élu de la Nation est un privilège en soi, ce n’est pas un job, c’est un mandat d’agir à la place de (et de représenter) la population.
Un salarié ou un fonctionnaire rend des comptes à sa hiérarchie, à son boss. Donc, il réfère de ses frais professionnels à sa hiérarchie, à son boss (et au comptable/contrôleur de gestion du boss).
#15
Tu te trompes grassement. Tu vas être surpris en lisant ça :
https://irfm.regardscitoyens.org/parlementaires?q=R%C3%A9ponse%20positive
#16
oui et non
 " />
" />
Quand un Melenchon fait un esclandre à la télé en disant qu’il ne veut pas faire une note de frais pour boire son café à la gare en attendant son train , il ne se rend même plus compte que sa tasse de café il devrait se la payer lui même. Ce ne sont pas des frais de réprésentation ça ! C’est carrément indécent.
Pour moi c’est ça qui fait que je demande à savoir ce qu’ils en font, leur discours étant pour le moins irréaliste.
( alors je suis d’accord qu’il n’y a pas besoin de savoir les détails ni de les étaler , mais pour l”instant ils en font un usage complètement inconnu , et moi je n’ai encore jamais facturé un tasse de café en attendant un train ou un avion, mais seulement mes repas, je me demande bien ce qu’aurait dit mon patron! )
Et puis ça existe dans plein de pays qui ne sont pas spécifiquement des états policiers
#17
Pour ceux que ça INtéresse, la députée Paula Forteza est l’une des député(e)s en avance sur son époque en OpenData parlementaire :
https://forteza.fr/irfm/
> Consultez l’outil : https://transparence.parlement-ouvert.fr
#18
Il faut avoir conscience aussi qu’un parlementaire n’a de comptes à rendre qu’à la population en vertu de la séparation des pouvoirs et de son immunité parlementaire. C’est également un employeur.
À qui va-t-il rendre des comptes si ses “faux frais” sont gardés confidentiels ?
Réponse : à personne.
#19
Je redis ce que j’ai déjà dit sur une news similaire.
Je suis d’accord sur le principe, mais dans ce cas il faut que cela soit la règle pour la totalité de l’argent public utilisé en France.
Que les citoyens aient un controle absolu sur l’argent dépensé par les députés et que les députés aient un regard sur l’utilisation de l’argent public par chaque citoyen. Comme cela plus de fraude possible des 2 côtés.
#20
#21
carbier, j’ai bien reçu la notification de ta réponse. Tu m’en vois désolé, mais je n’ai pas envie de lire ce que tu peux me raconter, ça doit être du même tonneau que d’habitude. Je te lirais peut-être un jour (qui sait?) si je suis d’humeur à t’envoyer sur les roses. Pour l’heure c’est le week end alors j’ai plus envie d’être désinvolte et léger que méprisant.
#22
#23
Ce n’est pas tout à fait ça.
Un député peut tout à fait abuser du montant qui lui est alloué, mais il peut aussi avoir de légitimes raisons d’organiser un déjeuner avec des intervenants (bon, encore que, on pourrait en discuter, mais c’est encore un autre débat sur la frontière entre approfondissement d’un sujet et lobbyisme/clientélisme. Tout comme un débat sur la pertinence de garder ou non confidentielles certaines réflexions préparatoires à la présentation d’un projet de loi).
Tout comme un chef d’entreprise, un député peut aussi vouloir garder une certaine liberté et une certaine discrétion sur les lieux qu’il favorisent pour des entretiens professionnels. N’oublions pas qu’il y a aussi bon nombre de racleux qui peuvent vouloir venir l’importuner.
De ce fait, je serais très favorable à une publicisation des frais aux quatre vents mais uniquement sur les dates / types / montants. Pour le public, qui n’a pas forcément tout le contexte en mains, ce serait suffisant pour repérer les cas les plus suspects et demander un approfondissement, par un contrôleur indépendant (pouvoir judiciaire de préférence XD) qui lui aurait le cas échéant accès à l’ensemble des pièces du contexte (mais non autorisation de les publiciser) pour rendre son avis.
#24
#25
#26
Oui, ça peut être un peu touchy de divulguer où M. Le Député prend son sandwich tous les jours. Il suffit de ne pas le faire.
Mon patron me paie mon repas du midi et il ne sait pas où je mange. C’est bien que c’est possible …
… et justement, ça tombe bien ils sont députés, peuvent proposer et voter des lois. Je suis certain que personne ne leur en voudra si ils votent une loi qui transforme une partie de leur indemnité en tickets restos (ou l’équivalent avec un nom moins classe-moyenne si ça leur chante) ou si on leur remboursait leurs déplacements au km. Comme ça personne ne saurait où ils vont ni où ils mangent, et ils pourraient dépenser sans compter dans la rénovation du théatre de quartier de Plouvic-Les-Bains.
C’est bête ils ont refusé un système de note de frais similaire au privé sous prétexte qu’ils n’ont pas que ça à faire de déclarer leurs frais.
Le problème d’une commission vs la divulgation publique, c’est justement le filtrage du détail.
En l’absence de limite officielle dans les catégories de frais, comment veux tu qu’une commission indépendante juge plus “abusé” d’utiliser 90% de son indemnité pour manger du homard à midi (repas pro) que les 1% utilisés pour offrir 20 places de karting aux jeunes de son quartier ?
#27
#28
Je me demande bien ce que Balkany faisait avec ses frais de mandat
 " />
" />
#29
J’ai MA p’tite-idée !!! " />
" />
#30
#31
#32
je suis d’accord qu’il ne doit pas être, très, précis, mais il pourrait (par exemp.) mettre :
la ‘Déontologue, de l’AN., n’a pas le temps pour contrôler 577 ‘Députés’ !
(nous…oui) !!!!!
#33
Les collègues ne connaissent rien de mes notes de frais. Parce qu’ils ne m’ont pas élu puis donné la responsabilité d’une certaine somme d’argent.
T’inquiète pas que mon employeur, lui, il vérifie bien que je ne me soit pas pris un café à 1€50 à ses frais en attendant le train (qu’il me rembourse).
En fait pour moi c’est un sacré problème si les députés pensent que leur relevé de frais de mandat contient des informations personnelles, alors qu’il s’agit par définition d’argent qui ne doit pas être utilisé à des fins personnelles justement.
Enfin, si vraiment ils ne veulent pas qu’on sache où ils mangent le midi, ils n’avaient qu’à accepter de passer aux notes de frais comme tout le monde et se faire rembourser sur facture. Une autorité indépendante les rembourserait et pourrait rapporter les catégories de dépenses sans publier le détail.
#34
#35
#36
#37
Il n’y a pas que la fraude fiscale (plus compliquée pour un particulier lambda oui), il y a aussi la fraude sociale (employeur / auto entrepreneur, etc qui ne déclare par tous les heures pour baisser ses cotisations, individu qui fait des déclarations mensongères pour bénéficier d’une prestation sociale indue, etc).
 " />
" />
Après, avant de voir le mal directement, il faut aussi prendre en considération que la définition de la fraude nécessite un acte volontaire et donc exclure l’erreur sans intention frauduleuse. Et ça c’est un peu plus difficile à faire.
Se tromper sur une déclaration, ça va vite. (qui ne s’est jamais trompé sur une note de frais ?)
Egalement, il y a un aspect oublié entre député/citoyen. Il manque les personnes morales bénéficiaires d’aides publiques, entreprises ou associations par exemple. Je pense notamment au cas des centres de formations épinglés pour avoir triché sur la déclaration de stagiaires afin de garder les aides publiques destinées à la formation professionnelle.
Et on en oublie encore beaucoup d’autre, je pense, si on veut contrôler tout ce qui obtient de l’argent public
#38
Ah si seulement tout était aussi simple…
 " />
" />
En début d’année, j’ai reçu un courriel pour me dire qu’on m’avait passé en déclaration automatique (pré-remplie et validée même si je ne vérifie pas et ne me connecte pas).
Seulement là, il faut que je déduise de mes revenus imposables une somme que je rembourse à mon établissement (cotisations retraite sur des primes). Déjà ça commence bien…
Ensuite, il faut que je déclare des primes défiscalisées dans une autre case pour qu’ils puissent calculer mon revenu fiscal de référence.
Somme qui n’est indiquée nulle part. Je suis obligé de me taper tous mes bulletins de paye concernés et de calculer moi-même le montant imposable défiscalisé (qui n’est ni le brut, ni les nets avant ou après impôt sur le revenu).
Alors que je suis fonctionnaire, payé uniquement par l’état…
(Je dévie un peu du sujet, mais ça me sidère tellement.)
#39
J’ai du mal à comprendre la notion de “montant imposable défiscalisé”… parce que pour moi, qui dit imposable, dit fiscalisé (ces adjectifs sont synonymes).
#40
Là, il s’agit de contrôle (vérification+sanction). Or l’opendata n’est pas du contrôle et encore moins de la sanction. C’est seulement de la transparence (le truc qui sert à connaître comment fonctionne le bouzin).
Et concernant les subventions versées sans contrôle de l’Etat, je suis désolé de cette situation d’autant plus que Bercy et les Parlementaires ont toutes les cartes en main pour sévir. Il faut arrêter avec ce prétexte de “la fraude”. Prétexte qui ne sert qu’à culpabiliser la société civile et à dédouaner la puissance publique de ses responsabilités, la même puissance publique qui se sert aussi de ce prétexte de “la fraude” pour renforcer encore plus la surveillance et les droits de communications des données personnelles entre organismes sociaux.
Bref, la puissance publique sait tout de nous (ou presque, je schématise), et il faut les laisser tranquilles dans leur utilisation propre des deniers publics. “Circulez! Il n’y a rien à voir”. Si ce n’est pas un système corruptif, ça s’en approche dangereusement.
#41
Ouais, c’est un peu bizarre. Je ne sais pas trop comment l’appeler, mais c’est le montant qui serait imposable s’il n’était pas défiscalisé " />.
" />.
#42
#43
#44
“Enfin, si vraiment ils ne veulent pas qu’on sache où ils mangent le midi, ils n’avaient qu’à accepter de passer aux notes de frais comme tout le monde et se faire rembourser sur facture. Une autorité indépendante les rembourserait et pourrait rapporter les catégories de dépenses sans publier le détail.”
 " />
" />  " />
" />
Ca on est complètement d’accord !
#45
#46