Alors que le manque d’accessibilité des sites publics est régulièrement dénoncé par les associations de personnes handicapées, l'exécutif vient d’édicter, sous l’impulsion de l’Union européenne, de nouvelles règles à destination des administrations. Les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros devront elles aussi s'y plier.
Contraint par une directive européenne de 2016, le gouvernement a profité de l’examen du projet de loi « Avenir professionnel », l’année dernière, pour revoir les règles relatives à l’accessibilité des sites, applications, intranets, progiciels... publics (notamment pour les personnes ayant des problèmes de vue).
Depuis la « loi Handicap » de 2005, les « services de l'État », les collectivités territoriales, ou même les « organismes délégataires d'une mission de service public » (de type La Poste ou SNCF) sont d'ores et déjà tenus de rendre leurs services de communication au public en ligne « accessibles aux personnes handicapées ». Concrètement, cela passe par exemple par des textes lisibles par des outils de synthèse vocale, des fonctionnalités accessibles au clavier, un affichage en grands caractères, etc.
Un principe d’accessibilité qui prévaudra aussi pour quelques grandes enteprises
Avec la loi « Avenir professionnel », le législateur a étendu l’année dernière cette obligation d’accessibilité à certains acteurs « para-publics », tels que les groupements d’intérêts publics. Les entreprises, de leur côté, étaient déjà censées être concernées (depuis la loi Numérique de 2016), à partir d’un certain chiffre d'affaires annuel. Seul hic : le gouvernement n’avait jamais pris le décret permettant de déterminer ce seuil...
Par le biais d’un décret « relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne », publié jeudi 25 juillet afin d’accompagner la mise en œuvre de la loi de 2018, l’exécutif a fixé à 250 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises seront désormais tenues de se plier aux mêmes règles d’accessibilité que les administrations. Ce chiffre devra être calculé à partir d’une moyenne des trois derniers exercices comptables enregistrés en France.
Très peu de sociétés devraient donc être concernées par ces dispositions. En 2016, lors de l’examen de la loi pour une République numérique, le rapporteur Luc Belot avait invité l’exécutif à opter pour un seuil de 150 millions d’euros, ce qui aurait alors correspondu « à 250 entreprises environ ».
Le gouvernement a de surcroît choisi de programmer une entrée en vigueur progressive, puisque cette nouvelle obligation prévaudra :
- À partir du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date.
- À partir du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019.
- À partir du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le « mobilier urbain numérique ».
Entre nouvelles exceptions et dérogation pour « charge disproportionnée »
Le décret liste dans la foulée toute une série de contenus étant expressément « exemptés de l'obligation d'accessibilité ». Sont notamment concernés : les « contenus audio et vidéo diffusés en direct », les « contenus des intranets et des extranets publiés avant le 23 septembre 2019 », les « contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 », etc.
Avec la loi « Avenir professionnel », le législateur a en outre prévu que l’obligation d’accessibilité ne prévale, tout acteurs confondus, que lorsque la mise en conformité ne crée pas de « charge disproportionnée » pour l’organisme concerné. Une notion relativement floue, directement issue de la directive, et qui avait suscité beaucoup d’inquiétudes lors des débats parlementaires (voir notre article).
Au travers du décret paru la semaine dernière au Journal officiel, le gouvernement a donc précisé le périmètre de cette dérogation. La « mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités » entraînera une « charge disproportionnée » dans deux cas de figure :
- Lorsque « la taille, les ressources et la nature de l'organisme concerné ne lui permettent pas de l'assurer ».
- Si « l'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées » se révèle « trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l'organisme concerné, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu ».
Manifestement dans une volonté d’apaisement, l’exécutif a tenu à préciser que les acteurs profitant d’une telle dérogation devront proposer une « alternative accessible », « dans la mesure où cela est raisonnablement possible ».
Mais pour le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), consulté sur ce qui n’était qu’un projet de décret, ces motifs « laissent la possibilité à tout acteur ne souhaitant pas prioriser l’accessibilité de le faire ». L’institution a ainsi fait part sa préoccupation auprès de l’exécutif, « toutes les réglementations non contraignantes en matière d’accessibilité (...) prises depuis 2009 » n’ayant eu « aucun effet ».
Des réformes dont l’entrée en vigueur s’étalera dans le temps, jusqu'en 2021
Autre réforme : administrations et entreprises devront désormais indiquer dès leurs pages d’accueil, par le biais d’une « mention clairement visible », si leurs sites sont oui ou non conformes aux règles d’accessibilité.
En complément, le décret prévoit qu’une « déclaration d'accessibilité » soit publiée, détaillant :
- « L'état du service de communication au public en ligne », au regard de l'obligation d'accessibilité.
- Les « éléments d'évaluation de l'organisme attestant du respect des exigences en matière d'accessibilité ».
- La liste des contenus non accessibles, « accompagnée des motifs du non-respect des exigences en matière d'accessibilité » (et présentant le cas échéant les « alternatives accessibles »).
- Les moyens mis à la disposition des internautes pour signaler « les difficultés rencontrées liées à l'accessibilité, ainsi que les voies de recours applicables ».
- Les coordonnées du responsable, la dénomination du service en ligne, ainsi que le lien vers le « schéma pluriannuel de mise en accessibilité ».
Une nouvelle fois, une entrée en vigueur progressive a été retenue par le gouvernement. Le décret précise ainsi que pour les administrations et autres acteurs « para-publics », ces nouvelles obligations s’appliqueront :
- À compter du 23 septembre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés depuis le 23 septembre 2018.
- À compter du 23 septembre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 23 septembre 2018.
- À compter du 23 juin 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.
Un dispositif de sanctions revu à la baisse par l’exécutif
Pour mettre les acteurs concernés en ordre de marche, un dispositif de sanctions pécuniaires est instauré – une première. Cette réforme avait été prévue par la loi Numérique de 2016, mais n’avait jamais vu le jour, faute de décret.
Le secrétariat d’État aux Personnes handicapées est ainsi chargé d’effectuer « un suivi annuel de la conformité des sites internet, intranet et extranet et des applications mobiles ». Si une administration ou une grande entreprise n’atteste pas de son niveau d’accessibilité (mention sur la page d’accueil, déclaration d’accessibilité...), elle sera en principe invitée à « présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance » dans les trois mois. Ce délai pourra être prorogé de 2 mois « si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ».
Au l’aune de ces éléments, le ministère pourra soit « accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de 3 mois » (pour que l’organisme mis en cause se mette en conformité), soit lui infliger une amende administrative, « le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité ».
Bien que le législateur ait souhaité que les acteurs concernés s’exposent à des amendes pouvant atteindre 25 000 euros, le gouvernement a préféré fixer un autre plafond – à 20 000 euros – par décret.
Pour les plus petites administrations, l’exécutif a même prévu que les sanctions ne pourront pas dépasser les 2 000 euros. Cela concernera notamment les communes de moins de 5 000 habitants.
Dans l’étude d’impact annexée au projet de loi « Avenir professionnel », le gouvernement expliquait vouloir « limiter les situations de transition brutale ». Mais pour le Conseil national du numérique, ce plafond de 20 000 euros « apparaît bien dérisoire au regard de la taille des entités concernées ».
« La sanction ne porte pas sur le respect ou non des standards d’accessibilité, mais uniquement sur la présence ou non, sur le site, de la déclaration d’accessibilité », déplore en outre l’institution. « La nuance est technique mais importante : un site peu accessible sera déclaré conforme s’il l’a bien affiché. »
Le manque d'ambition des pouvoirs publics pointé du doigt
« Ce nouveau décret ne va faire qu'amplifier la fracture numérique », a de son côté réagi Nicolas Mérille, de l’association APF France Handicap, auprès du Figaro. À ses yeux, les sanctions prévues par le gouvernement « ne sont absolument pas dissuasives ».
« Il est absolument inacceptable [qu’aujourd’hui], on ne soit pas capables de sortir des services de communication au public en ligne nativement accessibles. D'une part parce que c'est illégal, et d'autre part parce que les gens sont désormais montés en compétences » nous confiait en outre Fernando Pinto Da Silva, membre du CNCPH, il y a quelques mois. « On est tout à fait à même de comprendre que la mise à jour de certains sites Internet (déjà existants) puisse prendre un certain temps. Par contre, pour un nouveau service, c'est aussi gros que de mettre uniquement des escaliers dans un établissement recevant du public. »
Le Conseil national du numérique avait de son côté invité le gouvernement à allouer « des ressources humaines et financières conséquentes », dédiées à l'accessibilité numérique et à l’inclusion numérique. Autre proposition : « Inscrire la possibilité pour les administrations de désigner un référent accessibilité sur le modèle du délégué à la protection des données ».


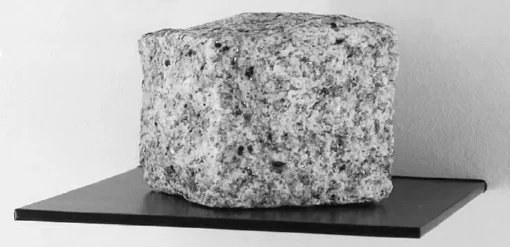





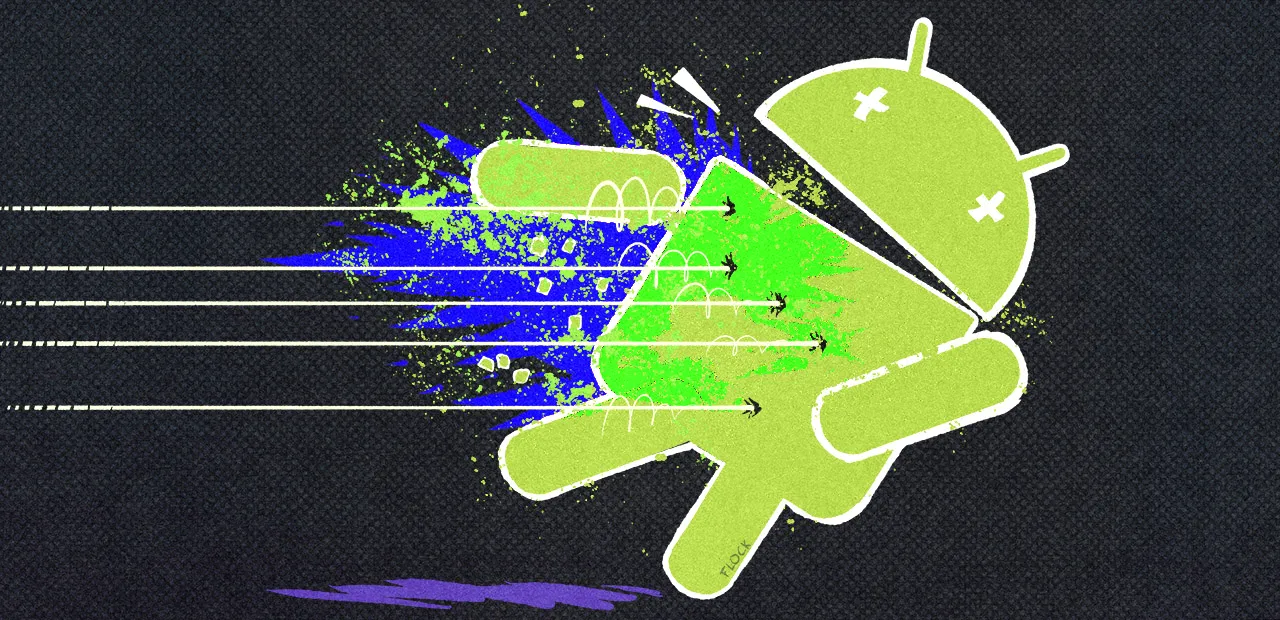

Commentaires (9)
#1
Je bosse actuellement dans le cadre d’une réfection de site public existant et je suis consterné du je-m’en-foutisme ambiant sur l’accessibilité.
 " />
" />
A la lecture du titre je pensais pouvoir me réjouir d’une impulsion donnée au niveau étatique qui aurait pu changer la donne…
Mais je rejoins à 129% l’analyse “ laissent la possibilité à tout acteur ne souhaitant pas prioriser l’accessibilité de le faire ”. Suffit de faire une estimation au doigt mouillé du nombre de visites d’acteur handicapés, en conclure que ça représente largement moins de 1%, faire une estimation du coût de mise en conformité (à priori significatif vu que jamais pris en compte auparavant), qui va arriver à, au mieux, 10% du coût total de développement du site par ailleurs (assez rare), au pire, à 70% ou plus (ouais, j’exagère pas), ce qui permettra “légitimement” en mettant en rapport l’un et l’auter de conclure que “‘estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées » se révèle « trop faible au regard de l’estimation des coûts pour l’organisme concerné, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation du service, ainsi que de l’importance du service rendu ”.
Et du coup, au fil des refontes, l’écart de coût grandira, ancrant encore plus la “légitimité” de la dérogation.
Et ne parlons pas de la distinction totalement artificielle entre “nouveau site” et “site existant”.
Quand tu changes le thème de bout en bout sans toucher au fonctionnel (ce qui certes implique que le site a été fait proprement ce qui est rare), techniquement c’est toujours le même site et pourtant les visiteurs sont paumés. Alors, nouveau site ?
Quand tu refais un site parce que ton moteur était pourri, que tu refais un lifting au passage, mais que ni les contenus ni la navigation ni les éléments principaux de charte graphique ni le nom de domaine n’ont changé, c’est un nouveau ou un ancien site ?
Quand aux sanctions, aussi bien sur le montant que sur le déclencheur, c’est un pet de moustique, pour ne pas dire une arnaque pure.
Je suis (heureusement) pas (encore ?) handicapé, mais ça ne m’empêche pas de regretter la paresse générale quand on peut deviner à quel point le manque d’accessibilité peut pénaliser le quotidien des handicapés (déjà qu’une personne lambda est quasiment exclue de la société si elle n’est pas bien plongée dans l’internet)…
Ce décret est encore pire qu’un non-dit ou un laisser faire : c’est un bon gros digital majeur bien dressé mais drapé sous un sourire faussement empathique. La politique moderne à l’état pur.
#2
Et en plus, paradoxalement, les délais fixés pour mise en conformité des anciens sites sont dérisoires, surtout pour un décret publié en août. Ils croient quoi ?
Même si une entité décide d’embaucher d’un coup toutes les ressources requises, c’est aussi compliqué - même plus - de paralléliser l’effort entre humains qu’entre machines. Même si ça devenait la priorité absolue pour tous, et qu’il y avait suffisamment de monde compétent, il faudrait AU GRAND MINIMUM 5 à 8 mois en fonction de la taille et complexité du site (notamment multilingue).
Là, pour beaucoup ça revient à dire “vous avez 45 jours” - le temps que tout le monde rentre. Du coup la gestion de crise ce sera quoi ? Vu que ce sera matériellement impossible (au lieu de compliqué) de modifier les sites, les 45 jours seront consacrés à monter l’argumentaire justifiant que c’est impossible de se mettre en conformité.
BORDEL. C’était vraiment compliqué de dire…
1. Toute administration de plus de 100 fonctionnaires ou responsable de plus de 50 000 habitants doit avoir l’ensemble des sites qu’elle gère en conformité pour mai 2020 (Idem pour entreprise de plus de 100 millions de chiffre d’affaire ou plus de 100 salariés) ?
2. Des contrôles seront fait, amende forfaitaire proportionnelle à la taille de l’entité (publique) ou du chiffre d’affaires, trimestrielle, à compter de septembre 2020.
#3
Merci pour ce précieux témoignage " />
" />
#4
De manière générale, on (nous tous, vous, toi, eux, moi… surtout toi) en a rien à foutre des handicapés. C’est pas quelques normes à la con dans le BTP qui y changeront grand chose. C’est comme s’ils… n’existaient pas.
#5
Je suis scandalisé d’apprendre que tout le web n’est pas accessible ?!
C’est “facile” de faire un site accessible il “suffit” de renseigner correctement les balises title / alt pour les liseuses d’écran, s’assurer que tout peut se faire au clavier. (tabulation pour naviguer de lien en lien, il ne doit pas rester d’action à faire à la souris uniquement)
Pour les mal voyants, il “suffit” de ne pas trop fixer de choses en px et les navigateurs s’en sortent tout seul sur les gros zoom.
=> ça fera pas un site parfaitement accessible mais ce sera utilisable, la seconde étape beaucoup plus longue étant de faire tester un aveugle et d’ajuster les libellés / ordre de tabulation pour rendre le tout ergonomique.
Ça doit être la façon naturelle de faire un site Web, il suffit de garder ça en tête quand on tune la CSS ou qu’on commence à coder un bout de JavaScript.
Il y’a 15ans en stage d’école on faisait déjà des sites accessibles sans que ce soit dans le cahier des charges : c’était pas plus compliqué, et ça permettait déjà de justifier que Flash (voir site en applet Java à l’époque) c’est de la grosse merde :)
Bon je ne fais plus trop de Web, mais j’ai l’impression que le milieu s’est fait gangrener par les frameworks, les gamins font du bootstrap / jquery n’ont aucune idée de ce qu’est une balise HTML , le DOM ou du CSS. Ils en deviennent incapable de maintenir ou faire autre chose que leur merde en bootstrap-machin-truc.
#6
Alors, je suis loin d’être un expert en accessibilité par ailleurs cependant…
Autant je suis d’accord avec toi qu’il y a des gestes simples comme dirait l’autre qui permettent sans trop de mal d’avoir un support à minima de l’accessibilité, et que ça devrait être un acquis et un réflexe, pour autant…
Après à mon sens ça apporte une grosse valeur ajoutée à ton site vu que ça t’a forcé à réellement réfléchir l’ergonomie ET de la navigation “basique” ET de tous les processus métier correspondant au contenu/service proposé mais c’est une vision à moyen/long terme. Sauf que là encore ça implique que l’équipe de dev ait un minimum la main ou au moins l’écoute du chef de projet. Or, souvent, ce sont des gens qui n’y connaissent rien qui décident de tout sous prétexte qu’ils sont du métier associé au site web (angrily truth inside). Donc ergonomie aux fraises (même pour tout un chacun soit dit en passant).
Option 1) : des couleurs adéquates sont choisies par dérogation immédiate pendant qu’une réflexion globale est engagée.
Option 2) : la direction marketing impose que les couleurs officielles soient utilisées et basta (donc soit tu risques les foudres des chefs par non-respect de l’identité, immédiatement, soit plus tard pour non-respect de l’obligation légale).
A votre avis, quelle est l’option la plus couramment retenue (à nouveau, dans mon expérience, que je crains toutefois représentative) ?
Typiquement, les attributs “alt” des images ou “title” des liens, qui nécessitent d’être conçus sur-mesure pour apporter une information pertinente. Ex con, site de news, tu mets une photo de 5 chefs d’état signant un traité. Si tu mets ça en alt, ça fera une belle jambe au mal-voyant/aveugle. Et si tu comptes utiliser la légende (caption) pour tout le monde, ça va la rendre inutilement verbeuse et descriptive pour les utilisateurs “lambda”.
–> L’accessibilité n’est pas juste une question de respect technique, c’est une contrainte éditoriale forte qui nécessite a) d’être réfléchie b) d’y avoir des moyens dédiés (puisque ça implique une surcharge plus ou moins forte d’effort rédactionnel pour chaque contenu).
J’aime autant vous dire que quand on doit annoncer une surcharge d’au minimum 5% (vachement variable en vrai ;)) pour faciliter l’accès à un public difficile à quantifier en termes de “volume” et de “potentiel commercial”, on soulève pas les foules…
Et l’argument cynique consistant à dire “mais vous savez les handicapés dans 30 ans ce sera plus de 20% de la population” marche pas non plus vu que en dehors du fait que les politiques publiques comme privées sont court-termistes en diable, soyons honnêtes pour la grande majorité des sites web une durée de vie de 5 ans avant refonte c’est déjà bien. ^^
#7
Bon je ne fais plus trop de Web, mais j’ai l’impression que le milieu s’est fait gangrener par les frameworks, les gamins font du bootstrap / jquery n’ont aucune idée de ce qu’est une balise HTML , le DOM ou du CSS.
Les gamins ne jurent que par wordpress et ne veulent pas toucher à du HTML ou CSS. Ceux qui touchent à du bootstrap et jquery ils ont un minimum de connaissance
#8
#9
Tu as cité une petite dizaine de choses de bon sens qui sont déjà top si mises en œuvre.
En revanche l’obligation légale pour les administrations est d’atteindre le niveau A+AA (niveau AAA n’est pas une obligation), ce qui représente un petit peu plus de 100 critères…
Laisse moi te dire que tu vas relativement facilement atteindre 80 à 90 de ces critères, et que pour diverses raisons tu vas galérer pour les critères restants qui font donc littéralement exploser la facture.
Pour l’administration centrale, je sais que le site Service Public se déclare conforme :https://www.service-public.fr/P10000
A part ce site il ne doit pas y en avoir beaucoup d’autres.
Exemple avec le site des impôts (taux global de conformité de 59 %) :https://www.impots.gouv.fr/portail/accessibilite ou encore Pôle Emploi qui a une bonne liste de critères non conformes :https://www.pole-emploi.fr/informations/declaration-de-conformite-du-site-pole-e…@/article.jspz?id=61813