Le mètre vaut un mètre, ça parait évident, mais ce n'est pas si simple à définir. Il en est de même pour les autres unités (kilogramme, seconde...). Depuis plus de 220 ans, les définitions se sont succédé dans une quête perpétuelle de précision, avec une « révolution » votée en 2018. Pour bien la comprendre, il faut remonter au XVIIIe siècle.
Vendredi dernier, une réunion très importante s'est tenue à Versailles : la 26e Conférence générale des poids et mesures (CGPM). Les 60 états membres de la Convention du Mètre y ont voté – à l'unanimité – les nouvelles définitions du Système international d’unités (SI), basées sur des constantes et la physique quantique.
Un vote historique à Versailles : quatre unités modifiées
Ce vote est historique, car pour la première fois quatre unités ont été redéfinies en même temps : le kilogramme, la mole, l’ampère et le kelvin. Le cas du kilogramme est emblématique puisque sa définition n'avait pas changé depuis la première CGPM en 1889, il y a donc près de 130 ans.
Ce vote « marque également la fin de l’utilisation d’artefact matériel pour la définition d’unités » explique le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), l'organisme en charge de la certification volontaire ou réglementaire de produits. C'était encore le cas du prototype international du kilogramme précieusement gardé par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) et valant par définition 1 kg. Le mètre a déjà abandonné son prototype depuis plusieurs dizaines d'années.

L'enjeu est important puisqu'il s'agit en effet de « refonder le SI sur ce que la physique offre aujourd’hui de plus universel et de plus intangible : les constantes fondamentales, en particulier celles de la mécanique quantique – physique de l’infiniment petit –, où la régularité des phénomènes, de même que leur précision, offrent des références à nulle autre pareille », affirme le CNRS.
En plus de se débarrasser des artefacts matériels, le nouveau système permettra d'améliorer grandement la précision des mesures, parfois avec des conséquences inattendues.
Notre dossier sur la révolution du Système international d'unités :
- De 1795 à 2018, 220 ans d'évolution du Système international d'unités
- Après la seconde et le mètre, le kilogramme fait sa révolution (quantique)
- Le kelvin, la mole et l'ampère changent aussi de définition
Au XVIIIe siècle, une révolution peut en cacher une autre
Les débuts du Système international d'unités – alias « SI » – remontent à 1795 en France, seulement quelques années après la Révolution de 1789. Le 18 germinal an III (7 avril 1795), le système métrique décimal est instauré par la loi relative aux poids et mesures.
À cette époque, plus de sept cents unités de mesure différentes existaient en France (pieds, pouces, coudées, aunes, etc.). Problème, toutes les unités ne valaient pas forcément la même longueur en fonction des personnes et des régions de France (sans parler du reste du monde).
Le mètre est alors défini comme étant la « dix millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l'équateur ». Durant la fin des années 1790, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain ont mesuré (pendant sept ans) l'arc de méridien situé entre Dunkerque et Barcelone, pour en déduire la valeur du mètre.
Des étalons du mètre dans Paris, celui de place Vendôme toujours visible
Ce changement crucial devait donc amener de l'uniformité. Afin de permettre à tout le monde d'apprécier la longueur d'un mètre et se familiariser avec cette unité, 16 étalons avaient été déposés dans Paris. Aujourd'hui, celui sur la façade du ministère de la Justice Place Vendôme est toujours visible.

Au passage, le litre est défini comme « la contenance d'un cube de la dixième partie du mètre ». Le gramme est également fixé en fonction du mètre : « le poids absolu d'un volume d'eau pure, égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante ». C'est également à cette époque que le système monétaire passait au franc.
Pour le Bureau international des poids et mesure, « la création du Système métrique décimal au moment de la Révolution française et le dépôt qui en a résulté, le 22 juin 1799, de deux étalons en platine représentant le mètre et le kilogramme aux Archives de la République à Paris peuvent être considérés comme la première étape ayant conduit au Système international d'unités actuel ».
« En France, après quelques mesures contradictoires, la loi du 4 juillet 1837, sous le ministère de Guizot, permet l'adoption exclusive du système métrique décimal. Il aura fallu près d'un demi-siècle pour aboutir à l'adoption d'un système créé pourtant dans l'enthousiasme sous la Révolution », explique le LNE.
Convention du Mètre et création du Bureau international des poids et mesures
Avant de continuer à remonter l'histoire des unités, faisons un bon dans le temps jusqu'en 1860. Les adhésions au système métrique décimal se multiplient et un nombre conséquent de pays l'adoptent. « Néanmoins, ces pays sont dépendants de la France chaque fois qu'il s'agit d'obtenir des copies exactes des étalons du mètre et du kilogramme. Cette subordination à la France, ajoutée au manque d'uniformité dans l'établissement des copies, risque de compromettre l'unification souhaitée ».
Afin de proposer une collaboration internationale, la Convention du Mètre est signée par 17 pays le 20 mai 1875 : l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Pérou, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège, la Suisse, la Turquie et le Venezuela. Pour la petite histoire, le Brésil ne l'avait pas ratifiée à l'époque.
Cette convention a mis en place le Bureau international des poids et mesures (BIPM), une organisation intergouvernementale « permettant aux États membres d'avoir une action commune sur toutes les questions se rapportant aux unités de mesure ». Elle définit également le Comité international des poids et mesures (CIPM) et la Conférence des poids et mesure (CGPM). Aujourd'hui, le BIPM compte soixante États membres et 42 États associés.
Ce traité est toujours en vigueur, mais il a été légèrement modifié en 1921, notamment pour étendre les attributions et responsabilités du BIPM à d'autres domaines de la physique. Le CNRS rappelle qu'il s'agit du « plus ancien traité international aujourd’hui en vigueur ».
Le BIPM a son siège près de Paris, dans le parc de Saint-Cloud. « Son entretien est assuré à frais communs par les États membres de la Convention du Mètre » explique le Bureau. En 1875 également, le gouvernement français concède à titre gratuit le Pavillon de Breteuil et le terrain environnant pour le fonctionnement du BIPM. La convention a été amendée en 1930 (avec l'extension du terrain concédé) puis en 1964 (pour clarifier des conditions d'utilisation par le BIPM).
Immunités et inviolabilité du BIPM
En 1969, un accord de siège est signé avec le gouvernement français, qui reconnait « des privilèges et immunités au BIPM, en particulier la personnalité juridique du BIPM, l'inviolabilité de ses locaux et la facilitation de l'entrée et du séjour sur le territoire français des personnes participant au travail du BIPM pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de celui-ci, par exemple représentants des États membres auprès de la CGPM, membres du CIPM, membres du personnel ».
Dans les détails administratifs, le BIPM est sous la surveillance du Comité international des poids et mesures (CIPM), lui-même placé sous l'autorité de la Conférence générale des poids et mesures (CGPM). Elle se réunit tous les quatre ans en général. La dernière se déroulait justement la semaine dernière, du 13 au 16 novembre 2018. Toutes les décisions les plus importantes sont donc validées pendant ces réunions.
Du CGS au MKS(A) pour arriver au SI avec six unités, puis sept
Revenons en 1874 : la British Association for the Advancement of Science (BAAS, désormais BSA), avec l'aide de Maxwell et Thomson, introduit le CGS (Centimètre, Gramme et Seconde), un système d'unités tridimensionnel cohérent. « C'est en grande partie sur l'utilisation de ce système que se fonda, par la suite, le développement expérimental des sciences physiques » explique le BIPM (qui n'existait pas encore, vous suivez ?).
De deux unités (mètre et kilogramme), le système métrique que nous utilisons encore aujourd'hui passe à trois mesures avec l'ajout de la seconde en 1889. Il devint alors MKS (Mètre, Kilogramme et Seconde), à mettre en face du CGS. La seconde était alors définie comme valant 1/86 400e du jour solaire moyen.
En 1960, une deuxième définition est adoptée par la 11e CGPM, suite à une décision du Comité international des poids et mesures de 1956. Elle est certes plus précise, mais toujours pas basée sur des constantes : « La seconde est la fraction 1/31 556 925,9747 de l'année tropique pour 1900 janvier 0 à 12 heures de temps des éphémérides ». Il faudra ensuite attendre 1967 pour que la première révolution n'ait lieu : la seconde passait alors « officiellement de l'échelle astronomique à l'échelle quantique », mais nous y reviendrons.
Dans les années 50, de nouvelles unités sont ajoutées au Système international d'unités : l'ampère pour les courants électriques (1946), le degré kelvin pour la température thermodynamique (1954) et la candela (ou « bougie nouvelle ») pour l'intensité lumineuse (1954).
Notez que le Comité international des poids et mesure avait approuvé dès 1946 l'ajout de l'ampère, conduisant alors à un nouveau système MKSA (mètre, kilogramme, seconde et ampère).
Voici leurs définitions à l'époque :
- Intensité du courant électrique (ampère) : « intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 x 10-7 unité MKS de force [newton] par mètre de longueur ».
- Température (kelvin) : « définir l'échelle thermodynamique au moyen du point triple de l'eau comme point fixe fondamental, en lui attribuant la température 273,16 degrés Kelvin, exactement ».
- Luminosité (candela) : « la grandeur de la bougie nouvelle est telle que la brillance du radiateur intégral à la température de solidification du platine, soit de 60 bougies nouvelles par centimètre carré ».
En 1960, lors de la 11e CGPM, il a été décidé de changer de nom pour passer au Système international d'unités (SI au lieu d'un hypothétique MKSAKC), le rendant ainsi universel sans dépendre des noms et du nombre d'unités le composant. Bonne idée puisqu'une septième (et pour le moment dernière) unité fit son entrée dans le SI en 1971 : la mole, pour la quantité de matière.
Voici sa définition :
- Quantité de matière (mole) : « quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 ». En 1980, le CIPM précise que dans cette définition de la mole, « il est entendu que l'on se réfère à des atomes de carbone 12 non liés, au repos et dans leur état fondamental ».
Durant la 14e CGPM, sont également fixés les (sous-)multiples des unités, de pico (10^-12) à téra (10^12). La commission rappelle aussi qu'il existe deux « unités supplémentaires » avec les radians et stéradian (pour un angle solide). Il y a également des dizaines d'unités dérivées, toutes exprimées en fonction des unités du SI : la superficie (m^2), le volume (m^3), la vitesse (m/s), l'accélération (m x s-^2), la force (kg x m x s^-2), le travail (kg x m^2 x s^-2), la résistance électrique (kg x m^2 x s^−3 x A^−2), etc.

De petits ajustements avant les grands bouleversements
Depuis plus de 100 ans, le BIPM n'a de cesse d'essayer d'améliorer la précision des unités, dont voici quelques exemples.
En 1901, la 3e CGPM déclare une nouvelle définition du litre pour les « déterminations de haute précision » : il s'agit du « volume occupé par la masse de 1 kilogramme d'eau pure, à son maximum de densité et sous la pression atmosphérique normale ».
La 7e CGPM apportait des précisions sur la manière de mesurer le mètre : « la distance, à 0°, des axes des deux traits médians tracés sur la barre de platine iridié déposée au Bureau international des poids et mesures, et déclarée Prototype du mètre par la Première Conférence générale des poids et mesures, cette règle étant soumise à la pression atmosphérique normale et supportée par deux rouleaux d'au moins un centimètre de diamètre, situés symétriquement dans un même plan horizontal et à la distance de 571 mm l'un de l'autre ».
En 1967, la 13e CGPM valide le changement de « degré kelvin » pour « kelvin » tout simplement car « l'unité de température thermodynamique et l'unité d'intervalle de température sont une même unité qui devrait être désignée par un nom unique et par un symbole unique ».
En même temps, la définition de la candela était modifiée pour plus de « clarté » : « l'intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d'une surface de 1/600 000 mètre carré d'un corps noir à la température de congélation du platine sous la pression de 101 325 newtons par mètre carré ».
Aux XXe et XXIe, toutes les unités passent aux constantes de la nature
La première révolution importante dans les unités de mesure remonte à 1967 lorsque la seconde est définie par rapport à une constante physique. En 1979, c'est au tour de la candela, puis enfin au mètre en 1983. Trois des quatre unités du SI ont donc sauté le pas au XXe siècle. En 2018, rebelote pour le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole. C'est alors la première fois dans l'histoire que quatre unités sont redéfinies d'un coup.
Elles se basent désormais sur des constantes de la physique : la constante de Planck h pour le kilogramme, la charge élémentaire e pour l'ampère, la constante de Boltzmann pour le kelvin et enfin la constante (ou nombre) d'Avogadro pour la mole. Les sept unités du SI ont donc achevé leur transformation.
Pour arriver à ce résultat et graver dans le marbre la valeur des constantes associées (qui dépendaient auparavant des incertitudes de mesures), les chercheurs de plusieurs laboratoires à travers le monde ont travaillé pendant des dizaines d'années en multipliant les expériences. « Même si ces changements sont imperceptibles dans notre quotidien, ils ouvrent de nouvelles perspectives et accompagnent les progrès technologiques » se réjouit le Laboratoire national de métrologie et d'essais.
L'avenir peut maintenant nous réserver des surprises. Marc Himbert, du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), nous en donne un exemple : « le GPS aurait été quasi impossible à développer sans la redéfinition du mètre, en 1983. Mais celle-ci ne le préfigurait aucunement ».

























Commentaires (76)
#1
Des émissions qui en parle :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-07-novembre-201…
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-05-novemb…
#2
Avoir le respect de lire les articles avant de commenter (fût-ce pour copier/coller des liens), c’est bien aussi  " />
" />
#3
En même temps, la définition de la candela était modifiée pour plus de « clarté » : « l’intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d’une surface de 1⁄600 000 mètre carré d’un corps noir à la température de congélation du platine sous la pression de 101 325 newtons par mètre carré ».
C’est sur que c’est plus clair comme ça
#4
Ben quoi, ça ne t’éclaire pas " />
" />
#5
bah moi j’suis déçu : vos confrères parlaient aussi de la taupe, et là rien, nada, pas sérieux tout ça " />
" />
 " />
" />
 " />
" />
Trêve de troll, joli boulot
#6
#7
Quand tu découvres que candela vient de chandelle après toutes ces années " />
" />
 " />
" />
Ben quoi, on ne voit jamais l’étymologie en cours
#8
Très beau boulot " />
" />
 " />
" /> " />
" />
#9
La mole … que de beau souvenir de lycée …
#10
super l’article " />
" />
 " /> bon après j’ai laissé tombé la branche S
" /> bon après j’ai laissé tombé la branche S  " /> )
" /> )
(la mole, le concept que j’ai jamais pu blairer en physique
#11
#12
Excellent dossier pour parfaire sa culture générale " />
" />
 " />
" />
#13
Epenser avait fait une série de très bonnes vidéos sur le SI
#14
Moi je dit respect, parce qu’il y a des parties qui sont assez lourde à lire (et à comprendre), donc les écrire sans perdre le fil c’est une prouesse " />
" />
 " />
" />
Très bon article en tout cas
#15
Non, c’était vraiment à chier. Entre approximations, erreurs, et omission de beaucoup d’informations importantes (notamment, rien sur la révision votée la semaine dernière)… j’étais plus que déçu qu’il ait ainsi bâclé le sujet.
#16
#17
Pour rappel, ça fait 30 ans que les métrologues travaillent sur cette révision. La 25e CGPM de 2014 en parlait longuement (à part les valeurs définitives, tout était déjà connu à l’époque). La 24e, en 2011, aussi. La page wikipédia correspondante existe depuis 2012. Des tas de vidéos en parlaient depuis longtemps : veritasium a sorti une vidéo sur le sujet en 2013, pour ne citer que lui.
#18
Pour un point de vu plus technique sur le sujet (avec explication de la nouvelle méthode & explication des différentes constantes physique utilisées), j’ai publié trois articles, dont le dernier (avec les liens vers les deux autres) est là :
— Ampère, kelvin, mole : ce qui change, en plus du kilogramme
Autrement, histoire d’ajouter une petite anecdote marrante, sachez que la barre de platine iridiée ayant représenté le mètre mesure en fait 102 cm de long.
Il y a simplement deux marques tracées à la pointe qui délimitent le mètre.
Aussi, pour que la mesure du mètre soit valide, cette barre devait être posée symétriquement sur un socle composée de deux tiges (deux endroits où le socle touchait la barre de platine) de diamètre 1 cm (minimum) distants de 57,1 cm ,le tout à 0 °C et à 1 atm de pression.
(PS : tout ceci est actuellement visible au Musée des Arts et Métiers (Paris), qui a monté une expo dédiées).
#19
J’attends toujours de croiser un jour une candela (ou une unité dérivée). Je me demande vraiment qui l’utilise un peu sérieusement en physique.
#20
Le lux, le lumen, etc. sont les unités dérivées de la candela.
Tu trouves ces unités sur les lampes : tu peux acheter une ampoule 1 000 lumen, 2 000 lumen, etc.
Ce paramètre est aussi utilisé sur la luminosité des écrans de portable (dans les tests, parfois).
Il est utilisé dans les domaines où l’éclairage est réglementé : éclairage public, feux tricolores, peut-être lors du contrôle technique auto (?).
Dans les domaines de projection (cinéma, vidéoprojecteur, etc.) le choix des ampoules également important, et probablement en photographie aussi.
Dans le domaine de l’énergie, en particulier solaire, il est important de savoir quel est l’éclairement pour pouvoir placer les panneaux au bon endroit, et pouvoir savoir si une installation va être rentable ou pas.
#21
Avec un peu de méthode, Lagrange les aurait fait varier ces constantes. " />
" />
#22
Intéressant tout cela. Merci pour l’article !
#23
je me demande pourquoi le mètre de 1983 a pu permettre au GPS d’exister surtout que la position phi et g est impérial et non pas métrique ?
 " />
" />
une bonne âme pour un bref résumé ?
#24
Oui, mais qu’apporte les lux par rapport à des Watts ? Si je me souviens bien, la candela est utilisée par rapport à la sensibilité de l’œil humain. Donc je comprend bien qu’on l’utilise pour tout ce qui est photo et signalisation, mais pour des panneaux solaires, je ne vois pas pourquoi on prendrait cette unité plutôt qu’une intensité lumineuse.
#25
La mole, c’est mon cours de demain en seconde. Les élèves détestent en général. Je vais leur parler de ces changements, c’était déjà prévu.
#26
Je suppose que la vitesse de la lumière soit suffisamment précise. Le principe du GPS est de mesurer que le temps que met la lumière entre le capteur et les satellites, de position connue. En connaissant la vitesse de la lumière, on peut remonter à la distance entre les satellites et le capteur, et par triangulation à détermirner la position.
Je suppose qu’avec l’ancienne définition du mètre, la vitesse de la lumière c n’était pas connue avec assez de précision. Si on pouvait mesurer le mètre-étalon à 10^-5 près (c’est déjà pas mal, ça veut dire qu’il fallait faire des répliques à dix micromètres près), ça donne des erreurs sur le GPS d’au moins 100m (sans prendre en compte les autres incertitudes). Dans le système moderne, c est fixé, et par définition, il n’y a plus d’incertitudes dessus.
#27
Je suis assez d’accord, je m’attendais à mieux de sa part, ses pastilles sur le SI sont vides, Scilabus s’en sort mieux !
#28
#29
+1
#30
La candela est lié à la perception humaine, oui : la longueur d’onde utilisée pour mesurer une candela est 540 THz, qui est dans le vert, la couleur pour laquelle l’œil est le plus sensible.
C’est aussi très proche du pic dans le spectre solaire (la longueur d’onde pour laquelle l’intensité émise par le soleil est la plus forte). Évolutivement, ce n’est pas un hasard.
Enfin, que l’on fasse la mesure en W/m² ou en Lux, ça revient au même à une fonction près.
#31
Beau travail de vulgarisation et clarification !
Merci !
#32
Dans la vrai vie on utilise un peu plus que 7 unités.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unités_dérivées_du_Système_int…
Mais l’avantage, c’est qu’elles sont toutes liées au SI. D’ailleurs, même les unités impériales ont été modifié pour dérivé du SI. Même les pays qui ne font pas partis du SI n’ont pas intérêt à voir leurs propres unités dériver et le plus simple c’est que ça soit des dérivées du SI.
En tout cas, je préfère tout de même le SI, plus simple, à ça :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/English_length_units_graph.p…
#33
Tout ça alors qu’il existe un système d’unité culturellement universel Système pifométrique
#34
On est d’accord que dimensionnellement, la candela est équivalente à une intensité lumineuse ? Le SI ne sert qu’à fixer le nombre qui sert la à la conversion entre les deux, de la même façon que la mole est dimensionellement seulement un nombre, et que le SI sert juste à se mettre d’accord sur la constante d’Avogadro.
#35
Merci pour l’article clair et complet !
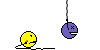 " />
" />
 " />
" />
Vivement celui sur le kilogramme maintenant, allez vite vite
#36
“Le kilogramme est également fixé en fonction du mètre : « le poids absolu d’un volume d’eau pure, égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante ». ”
“Le kilogramme est également fixé en fonction du mètre : « le poids absolu d’un volume d’eau pure, égal au cube de la dixième partie du mètre, et à la température de la glace fondante ». ”
#37
banana for scale ?
sinon ‘doit y avoir une blague graveleuse à faire avec demie-mole mais je trouve pas…
#38
pardon.
#39
Durant la fin des années 1790, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain ont mesuré (pendant sept ans) l’arc de méridien situé entre Dunkerque et Barcelone, pour en déduire la valeur du mètre.
Et du coup, c’est mesuré en quoi (quelle unité) ?
#40
[…]de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide
 " />
" />
Je ne comprends pas ce que veut dire négligeable dans cette phrase. C’est tiré de la définition de l’ampère, dans l’article. Tout est d’une exactitude scientifique, mais la définition rajoute une sorte de flou. Négligeable est à l’appréciation de chacun, non ?
Bon, il faut dire aussi que je suis à moitié perdu dans tous ces détails scientifiques
#41
Eh bien, avec les unités de l’époque : pieds, lignes, ou fraction d’une toise. Voir « Histoire du mètre » sur wikipédia pour plus de précision.
#42
Idéalement, ils seraient de section nulle. Dans la pratique, ils doivent être d’une section la plus petite possible pour ne pas cramer en étant traversés par un courant de 1A.
#43
#44
Eh bien, avec les unités de l’époque : pieds, lignes, ou fraction d’une
toise. Voir « Histoire du mètre » sur wikipédia pour plus de précisions.
#45
Merci pour la précision, je comprends un peu mieux :)
#46
#47
Merci pour cet article hyper intéressant. Aucun regret de m’être abonné  " />
" />
#48
J’avais bien aimé la comparaison avec la douzaine d’oeufs… Ça m’avait bien aidé à l’époque.
#49
Tu as raison, leur intitulé correspond à la définition du gramme, j’ai d’ailleurs signalé ce point à NXI (tout à l’heure seulement).
#50
#51
#52
C’est le gramme qui a été défini comme tel à l’époque.
#53
#54
Superbe article! Chapeau !
#55
#56
Merci, tu as embelli ma journée  " />
" />
#57
#58
Parce que les écrans ne sont pas spécifiés en cm mais en pouces, que les bateux sont en pieds et leur volume en tonneaux.
Mais ca reste des multiple du SI donc facile a se retrouver.
#59
Le gars qui ne veut pas comprendre… tu as bien conscience qu’il n’y a aucune raison qu’il en soit ainsi ? Il est parfaitement possible de spécifier les écrans en centimètres. Alors pourquoi en irait-il autrement ? Parce que les Américains n’en font qu’à leur tête ? L’invention du mètre, la décimalisation, tout ça, ça a aussi été créé pour qu’on n’ait plus à s’embêter à multiplier par 2,54, ou à se familiariser avec moult unités pour une même grandeur.
Oui parce que, techniquement toute longueur est multiple d’une autre. En maths on réserve le terme « multiple » pour les entiers, dans le SI pour les puissances de dix. Le pouce n’est donc absolument pas un multiple du mètre…
#60
#61
“En 1969, un accord de siège est signé avec le gouvernement français, qui reconnait « des privilèges et immunités au BIPM, en particulier la personnalité juridique du BIPM,
l’inviolabilité de ses locaux et la facilitation de l’entrée et du séjour sur le territoire français des personnes participant au travail du BIPM pendant la durée de leurs fonctions ou
missions auprès de celui-ci, par exemple représentants des États membres auprès de la CGPM, membres du CIPM, membres du personnel ».”
Voilà un bon point de départ pour un scénario
…
#62
#63
Bien sur qu’il y a des raisons historiques au choix des unités. Le poids de l’histoire ne s’efface pas en quelques secondes.
Le passage en cm pour la taille des écrans impliquerait de renormaliser toutes les tailles d’écran sur des cm exacts et non pas des , ( Qui veut acheter un écran de 60,96 cm de diagonale ?)
Donc passage d’écran 24 pouces à 61 cm => Implique juste de changer l’ensemble de la chaine de fabrication soit à peine quelques milliards … une broutille
Rien que le passage à l’euro en france à pris plusieurs années pour une unité qu’on manipule tous les jours à plusieurs reprises.
Les habitudes et référentiel ne se changent pas en claquant des doigts
#64
#65
Tu ne dois pas faire très attention quand tu achètes un écran alors…
Les luminosités sont toujours en cd/m² (candelas par mètre carré, anciennement appelés “nits” ) :
https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/comparatif-tv-televiseurs-hd-lcd-led…
#66
#67
Tu publies ?
Pour la SF, pourquoi pas le mégamètre ?
On devrait peut-être continuer par MP (si c’est possible ?), on dérive un peu ;)
#68
#69
Un écran de 24 pouces fait rarement 24,0 pouces. Il fait plutôt 24 pouces à un cheval près. Il y a un bail, les diagonales des téléviseurs étaient exprimées en cm à un poil près et ça ne choquait personne.
#70
En SF, les unités de distance sont souvent en temps que met la lumière pour se propager à cette distance :
~1 seconde-lumière : distance moyenne Terre-Lune
~8 minutes-lumière : distance moyenne Soleil-Terre
~4 à 20 minutes-lumière : distance Terre-Mars (selon mes calculs)
Et pour les unités de temps, elles sont des fois en puissances décimales de la seconde (quand on n’est plus dans des situations où la Terre est centrale :
kiloseconde : 16 minutes 40 secondes
Mégaseconde : ~11.6 jours Terriens
#71
Si je ne me trompe pas, les diagonales des téléviseurs exprimées en cm, c’est une loi récente?
D’ailleurs c’est assez choquant de se balader dans un supermarché et de voir des écrans (TV) en cm d’un côté du rayon, et des écrans en pouces (PC, ordiphone) de l’autre côté du rayon !
#72
N’empêche, le système douzenal est quand même mieux que le système décimal !
Et on aurait mieux fait de prendre une unité dérivant du corps humain (utile pour des mesures de tous les jours, même approximatives!)
Mais bon, avec la Révolution, l’envie de jeter tout l’ancien système (sans trier le bon grain de l’ivraie) devait être très pressante !
(Et puis de nos jours, on en tire le bénéfice avec le raccourci bine pratique : 2^10 ~ 10^3…)
#73
Grr, système de commentaires empêchant l’édition après une certaine date ! " />
" />
C’est aussi probablement parce que ce sont les bourgeois (commerçants, artisans…) qui ont fait la révolution, et le système décimal était très populaire parmi eux suite à la publication d’un livre il y a quelque siècles de cela :
http://www.univ-irem.fr/spip.php?article1359
#74
#75
#76
Tu as tout a fait raison en fait, c’est plus parlant (comme toujours, tant qu’on reste dans une histoire où la Terre a toujours une importance centrale, ce qui est généralement le cas lorsqu’on est dans le système solaire… sauf peut-être dans le cas d’une histoire spécifique au système Terre-Lune?)