Une surface commerciale doit-elle payer la rémunération équitable aux sociétés de gestion collective quand elle diffuse des musiques dites « libres » issues de la plateforme Jamendo ? Une audience s’est déroulée jeudi devant la cour d’appel de Paris. Compte rendu.
Une partie du modèle de Jamendo était au départ simplissime. Dans une main, un site qui héberge des musiques que les créateurs ne veulent pas confier aux sociétés de gestion collective. Dans l’autre, des catalogues proposés aux surfaces commerciales pour sonoriser leurs rayons, loin des ponctions exigées par ces intermédiaires.
En 2009, l’enseigne Tapis Saint Maclou a signé un contrat avec Jamendo. Seulement, quatre ans plus tard, la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (SPRE) lui a réclamé plus de 120 000 euros au titre de cette redevance, via des agents SACEM qui collaborent avec elle.
Comment une redevance peut-elle frapper la musique libre ?
Cette rémunération est organisée par l’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est due notamment dès lors que de la musique enregistrée est diffusée dans des lieux sonorisés ouverts au public.
Or, pour la société de gestion collective, la loi ne fait aucune distinction entre la musique « libre de droits » et la musique sous catalogue des sociétés de perception et de répartition.
Tout le monde doit payer s'agissant d'une licence globale obligatoire, dont les fruits sont répartis pour moitié entre artistes interprètes (ADAMI et SPEDIDAM) et producteurs (SCPP et SPPF).
Après réclamation de la SPRE, l’enseigne a demandé la résiliation du contrat avec MusicMatic (maison-mère de Jamendo) tout en lui demandant de lui payer cette somme puisqu’elle s’engageait à fournir des contenus libres de droits. Tout ce beau monde s‘est retrouvé devant le tribunal de grande instance de Paris.
Devant le TGI de Paris, l'échec de Jamendo
Le 6 mars 2015, le TGI de Paris a d’abord rejeté la demande de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Jamendo au motif que jamais l’article L214-1 du CPI n’oblige les artistes à adhérer à une société de gestion collective pour être rétribués.
Il n’y a donc aucune atteinte au droit de propriété. Au contraire, grâce à cette disposition, ils peuvent recevoir « un complément de rémunération en contrepartie de leur création ».
Le 18 novembre 2016, la même juridiction a rejeté les prétentions de Jamendo/MusicMatic. Et puisque dans son contrat, MusicMatic France s'était engagée à protéger l'enseigne de toute action en revendication, la plateforme a été tenue à garantir Tapis Saint Maclou de cette condamnation.
En appel, Jamendo dénonce un « vol »
Jeudi dernier, la Cour d’appel de Paris a entendu chacune des parties. À cette occasion, Jamendo-Music Matic a redéposé une demande de questions préjudicielles afin de faire éprouver la conformité de ce système par la Cour de justice de l’Union européenne.
Les avocats de la plateforme ont d’abord réitéré leurs critiques : la rémunération équitable organise une forme d’expropriation des droits exclusifs au profit d’une rémunération orchestrée par les sociétés de gestion collective. Issu de la loi de 1985, ce mécanisme répondait initialement à un souci pragmatique d’éviter à chacun une négociation individuelle.
Mais plus de 30 ans plus tard, avec le développement d’Internet, reste-t-il tenable face au succès des licences Creative Commons ? Le point dur concerne finalement la conventionnalité d’une licence globale obligatoire à la française qui « revient à confisquer, voler le droit des artistes interprètes et jeter leurs droits individuels ».
Pour démonter un peu plus le régime national, la plateforme a produit une cinquantaine d’attestations où autant de créateurs affiliés à Jamendo affirment ne rien avoir touché des sociétés de gestion collective.
Dit autrement, si le code n’oblige pas à être membre d’une société de gestion collective, le système n’est pas efficient, contrairement à ce qui est soutenu. « L’affaire a débuté voilà cinq ans, nous n’avons toujours aucune information sur la manière dont les sociétés de gestion répartissent aux non membres. Si nous avons reçu des attestations de leur part, où ils affirment qu’ils n’est pas nécessaire d’être associé, nous n’avons jamais eu d’autres explications à ce sujet ».
En contraste, « le système Jamendo est transparent, les contrats sont publics, on sait ce qui est fait avec les œuvres et la rémunération due est versée trimestriellement ».
Le droit français à l'épreuve de la justice européenne
La question préjudicielle sollicitée revient à savoir si la France peut interdire aux titulaires de gérer leurs droits de manière individuelle.
Certes, la rémunération équitable est une option ouverte aux États membres par la directive 2006/115 (article 8 paragraphe 2), mais un considérant prévient que « le droit d'auteur et la protection par les droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d'exploitation ».
En outre, « la continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes (…) exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié ». Mieux, le texte demande « une protection juridique appropriée » qui soit à même « de garantir efficacement la possibilité de percevoir ».
Enfin, le considérant 12 juge « nécessaire d'introduire un régime qui assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent conserver la possibilité de confier la gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui les représentent ».
En France, nulle « possibilité » mais bien une règle impérative. Certes, voilà une directive d’harmonisation a minima, où les États membres peuvent donc opter pour des mesures plus restrictives « mais le système ne prévoit pas une protection juridique appropriée pour offrir la possibilité de percevoir un revenu. Les modalités vont donc à l’encontre de l’esprit et du texte de la directive » insiste Jamendo.
« En fin de compte, a conclu la plateforme, la loi française confère un droit exclusif de gestion non autorisé par la directive, disproportionné et nullement justifié », alors que le site se targue d’offrir une meilleure visibilité, une rémunération assurée.
L’avocat de Saint-Maclou s’est reporté à la décision de la cour s’agissant de la question préjudicielle. La société a néanmoins réitéré qu’en signant un contrat de musiques libres, elle considère ne pas avoir à payer la rémunération équitable. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement s’agissant du paiement solidaire de Jamendo-Music Matic.
Se méfier des « chevaliers blancs », qui « promettent de la liberté »
Les propos de Me Jean Martin, avocat de la SPRE, et accessoirement intervenant régulier au CSPLA, ont été plus vifs. Celui-ci a épinglé ces nouvelles technologies qui voudraient donner des libertés créatrices communes, mais « en réalité s’affranchir des obligations légales ».
« Il faut se méfier de ceux qui promettent de la liberté » a-t-il griffé, avant de dénoncer « un chevalier blanc [qui] au nom de la liberté des artistes voudrait faire juger que toute la pratique de la rémunération équitable n’est pas conforme au droit communautaire ».
Jean Martin a surtout opposé à Jamendo ses propres contrats où des clauses interdisent aux membres de percevoir la moindre autre somme. Délicat donc de s’étonner que « ses » artistes n’aient rien touché.
Mieux, selon lui, ces mêmes contrats les obligent à n'être liés de quelques manières que ce soient à aucune société de gestion collective. Ils accordent en plus à Jamendo le soin de percevoir la rémunération équitable... « On nous dit que c’est une honte, mais ce sont eux qui ont organisé la captation de la rémunération équitable ! » a tambouriné le représentant de la SPRE : « Voilà le système Jamendo. Un chevalier blanc. Un esprit de dossiers et de la procédure ».
L’avocat a surtout débordé d’arguments pour inciter la cour à ne pas transmettre la question préjudicielle. « On vous demande de dire si la loi française est compatible avec le droit de l’Union européenne quand elle empêche les non-membres de percevoir la rémunération équitable. A-t-on une disposition qui réserverait ces sommes aux seuls membres des sociétés de gestion collective ? Elle n’existe pas ! »
Une marge de manoeuvre laissée aux États membres
Selon sa grille de lecture, la directive n’orchestre aucun mode d’exercice de ces droits. Ni interdiction, ni obligation. « L’Union a laissé aux États membres la liberté sur les aspects non harmonisés ». Décrivant une CJUE très sollicitée, il recommande aux juges nationaux de garder le sujet au Palais de justice de Paris, et donc de ne surtout pas transmettre.
On le comprend : un scénario inverse menacerait la manne des sociétés de gestion collective, bien au-delà des sommes mises sur le tapis Saint Maclou. En 2016, la SPRE a ainsi perçu 121 millions d’euros...
L’arrêt de la cour d’appel sera rendu le 23 mars prochain.

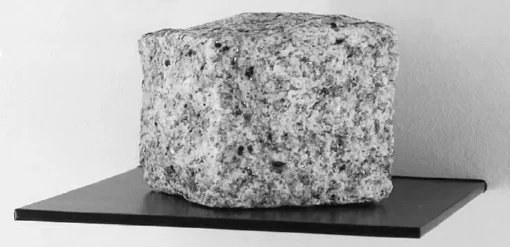





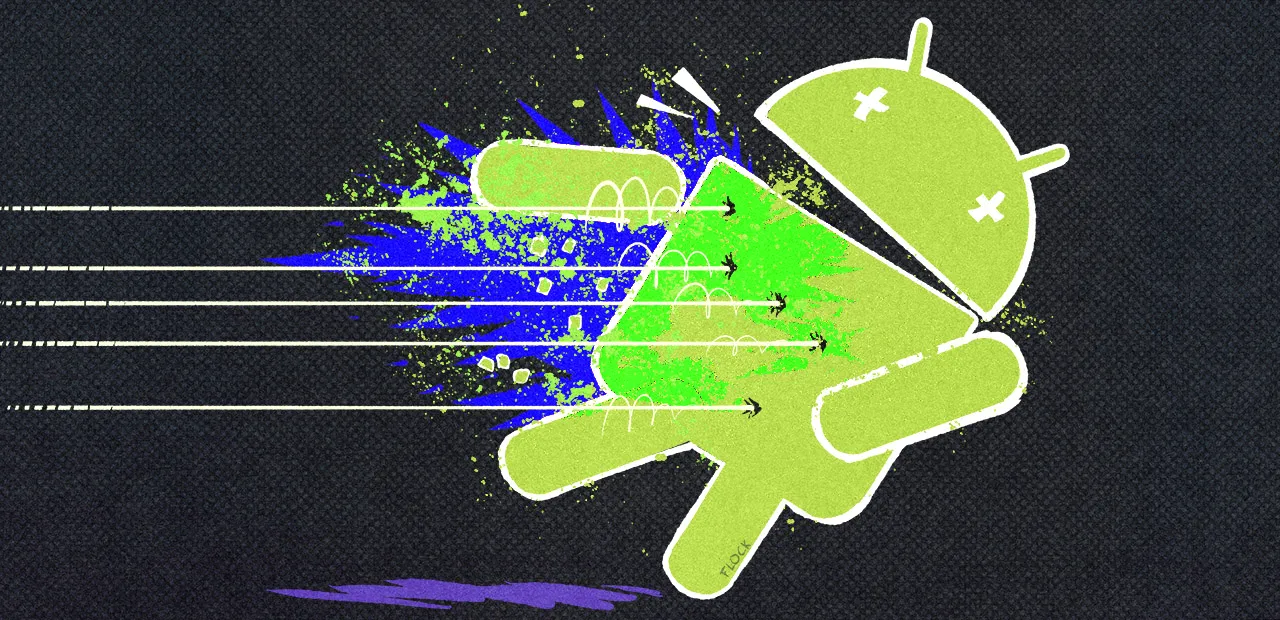

Commentaires (23)
#1
En tout cas le coup de devoir payer une redevance tout en sachant qu’on n’en touchera jamais rien (car pas affilié) s’apparente bel et bien à une spoliation.
Comme si on devait payer sa mutuelle d’entreprise tout en ayant choisi de ne pas s’affilier…là au moins c’est bien fait puisqu’ils est obligatoire de s’affilier (sauf si on en a une autre).
Après ça peut être légal, mais on s’attend pas à voir ce genre de comportement pour la musique ! (Comme payer pour les maladies orphelines quand on en a pas une soi-même pas exemple, mais d’un point de vue solidarité/éthique ça se tient)
Je suis étonné qu’il n’y ait pas encore eu de correction législative…la puissance de lobby des ayant-droit est impressionnante !
#2
La justice comme les SPRD disent que les non-membres peuvent toucher.
Après j’aimerais connaître les moyens déployés par l’Adami, la Spedidam, la SCPP, la SPPF pour trouver l’auteur/producteur de tel morceau. Ou bien s’ils se contentent d’attendre qu’on vienne les voir.
#3
Quitte à ce que l’artiste ne touche rien, autant pirater le truc … au moins les gangsters ne toucheront rien
 " />
" />
C’est pas bien de raisonner comme ça
#4
#5
#6
Uberisation de la culture face à exploitation de la culture par des réseaux maffieux… qui va gagner?
#7
#8
En espérant que la Cour décide de transmettre. La question sur un plan purement juridique est très intéressante.
#9
« bien au-delà des sommes mises sur le tapis Saint Maclou. »
Joli ;)
#10
#11
Comme quoi, la licence globale obligatoire c’est pas forcément la solution à tous les problèmes. " />
" />
Question en passant: Y a quoi comme titres musicaux “libre de droit” connus dans le catalogue Jamendo ?
#12
#13
Quelque chose me dit que vous avez une petite idée de la réponse.
C’est quand même extraordinaire de les voir réclamer de l’argent pour absence-de-service-rendu, de même que cette absence-de-rétribution-des-bénéficiaires-de-cette-absence-service-rendu.
Super taff. Bon courage et bonne continuation !
#14
Aucun, ils ne passent pas à la radio et ne sont donc pas connus…
#15
#16
De mémoire, les Daft Punk avaient voulu s’affranchir de la SACEM et consors. Mais pour récupérer leurs droits auprès des diffuseurs (radios, télés notamment), ça a été coton. Je ne me rappelle plus le deal qu’ils ont dû faire. Ce qui est dans dingue, c’est de devoir payer pour diffuser de la musique libre de droit.
#17
Je m’interroge :
Est-il possible de créer une société de perception de droits à laquelle adhéreraient les artistes souhaitant distribuer leurs œuvres sans percevoir de droits ?
A ce moment là, on aurait une société de perception de droits, et on serait dans le cadre légal, mais la perception serait infime, juste pour maintenir le fonctionnement du système.
Si l’on se retrouve dans l’impossibilité de créer une autre société de perception de droit, on est face à un monopole attribué par l’état sur la perception de droits ? Si ça n’est pas l’état, on se rapproche d’un fonctionnement de cartel qui va écraser tous ceux qui voudraient apparaître.
#18
C’est ce que l’état appelle “l’exception française” et qu’il défend plus que les salaires des travailleurs au niveau européen, cette mafia entretient la corruption politique qui fait que l’abstention est devenu le plus gros parti et le plus légitime aujourd’hui " />
" />
#19
+1
#20
Et les consommateurs paient le prix fort et les fermiers crèvent la dalle… Cherchez l’erreur…
#21
Mais comme chacun sait, la diffusion par CD devient de plus en plus restreinte.
Par ailleurs, il n’y a pas de collecte à avoir puisque Jamendo rémunère automatiquement l’artiste.
#22
Une des nombreuses rentes organisées par l’état, dans le but d’engraisser les copains. La routine. Dommage que ce soit avec nos sous…
Pour le coup c’était très malin de la part de Saint Maclou, les gens s’en foutent dans les magasins d’entendre des musiques connues, par contre un fond musical adapté peut inciter à rester plus longtemps dans le magasin, du coup le résultat est intéressant pour un coût limité.
#23
oui mais précisément - quid des créateurs qui ne veulent pas que les sociétés de “gestion collectives” touchent des sous sur le dos de leur travail. Quel recourt pour éviter cette forme de réprésentation imposée et illégitime?