Dans le domaine du jeu vidéo, la vente dématérialisée gagne de plus en plus de terrain. La Hadopi s'est donc intéressée à ce nouveau mode de distribution pour les jeux en publiant une étude sur les différents modèles économiques existants, qu'ils soient licites ou non, mais également au comportement des consommateurs vis-à-vis de lui.
Que cela soit sur consoles, avec le Nintendo eShop, le PlayStation Store ou le Marché Xbox Live, sur PC, avec Origin ou Steam, ou encore sur mobiles avec l'App Store et Google Play, la dématérialisation fait partie intégrante du paysage vidéoludique depuis plusieurs années. Le temps où il était nécessaire d'avoir une cartouche ou un disque optique pour jouer est en passe d'être révolu, puisqu'il suffit désormais de télécharger quelques fichiers pour pouvoir profiter de presque n'importe quel titre.
Ce nouveau mode de distribution des jeux vidéo implique de nombreux changements dans l'industrie vidéoludique, que ce soit au niveau des modèles économiques, mais aussi au niveau de la chaîne de valeur, ainsi qu'au niveau des habitudes de consommation licites ou illicites des joueurs. Pour faire le tour de la question, la Hadopi s'est lancée dans une étude, qu'elle vient de publier, avec le concours du Syndicat National du Jeu Vidéo.
La dématérialisation gagne du terrain
Le premier constat de l'étude menée pour la rue du Texel enfonce une porte grande ouverte : la part de marché des jeux dématérialisés augmente d'année en année, alors que les ventes de jeux physiques baissent sur la même période. Ce constat, on peut déjà l'observer dans les résultats financiers des éditeurs, qui le soulignent depuis maintenant plusieurs années.
Lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, Electronic Arts a présenté comme à chaque fois un bref résumé de la ventilation de son chiffre d'affaires entre ventes dématérialisées et ventes physiques. Si les jeux téléchargés ne représentaient que 21 % de ses revenus sur l'exercice 2011, quatre ans plus tard, leur part devrait excéder 50 % pour un total de 2,1 milliards de dollars. Un constat que l'on retrouve également chez d'autres acteurs majeurs comme Activision ou Ubisoft, pour ne citer qu'eux.
On apprend tout de même qu'en France, le marché du jeu dématérialisé est passé de 659 millions d'euros en 2011, à 1,06 milliard d'euros en 2014, soit en moyenne une hausse de 17 % par an. Les disparités sont par contre très importantes entre les parts de marché de ce mode de distribution selon les plateformes, avec par exemple 90 % de jeux téléchargés sur PC, contre 27 % sur consoles.
Le modèle free-to-play est partout, mais d'autres alternatives existent
Selon l'étude de la Hadopi, 71 % des joueurs ayant téléchargé des jeux dématérialisés jouent à des titres free-to-play, contre 35 % seulement d'adeptes de l'achat de titres à l'unité. Pour les jeux nécessitant un abonnement, ils ne sont plus que 24 %. Sans surprise, les terminaux mobiles sont davantage utilisés pour jouer en free-to-play, tandis que consoles et PC sont plutôt utilisés pour des jeux payants.
La rue du Texel a donc cherché à savoir ce que les joueurs trouvaient de positif dans ce modèle. Les principaux points donnant satisfaction aux adeptes de free-to-play sont « la facilité d'acquisition des jeux », la « facilité d'y jouer en mobilité », ainsi que leur rapport qualité/prix (sic). Par contre, les joueurs les perçoivent comme étant de moins bonne qualité, jugent qu'ils apportent « une expérience de jeu frustrante » et qu'il n'est pas vraiment « possible de profiter de tout ce que le jeu propose ».

Heureusement, d'autres modèles existent, et la Hadopi dresse un état des lieux très juste des différentes options disponibles. Le graphique ci-dessus montre ainsi ce que chaque type d'offre propose vraiment, et quelles en sont les contreparties.
Des conséquences sur la distribution de la valeur des jeux
En plus de permettre l'éclosion de nouveaux modèles économiques, la dématérialisation n'est pas sans conséquences sur le circuit de distribution classique. Lorsque l'on achète un jeu physique, selon la Hadopi, s'appuyant sur une étude de l'European Games Developer Federation, le développeur ne touche que 8 % du prix de vente final, contre 52 % à l'éditeur, 20 % pour les grossistes et encore 20 % pour le détaillant.

La dématérialisation permettant de se passer de certains intermédiaires, notamment de l'éditeur, du détaillant, et parfois même du distributeur, les studios peuvent profiter d'une plus grosse part du prix de vente, et donc vendre leur production moins cher au consommateur final. En sachant que les plateformes de vente telles que les marchés d'applications mobiles, ou Steam, ne ponctionnent que 30 % du prix de vente final, l'opération peut donc être intéressante pour les studios, pour peu qu'ils parviennent à faire leur trou sur les quelques places de marché centralisant le plus gros des ventes.
Entre piratage et marché gris
La dématérialisation a également permis à de nouvelles pratiques à la licéité douteuse d'exploser. C'est notamment le cas de l'arrivée d'un marché gris de revente de clés étrangères, ou de la mise en place de serveurs tiers pour les jeux à abonnement. Sans oublier le piratage classique des titres, qui n'a pas disparu de la surface pour autant.
Sous le terme de « distribution grise », la Hadopi regroupe l'ensemble des grossistes situés à l'étranger, revendant des clés d'activation de jeux physiques, achetés à bas prix, là où les prix des jeux sont plus élevés. Une définition sous laquelle on reconnaîtra des enseignes connues comme G2A, Niveau 7 ou G2Play.
Ces plateformes profitent de leur situation pour obtenir un important avantage concurrentiel, en vendant parfois sous la barre des 20 euros des jeux sur PC habituellement vendus à 50 euros par les revendeurs officiels. Une situation qui ne profite pas forcément aux studios, et qui a surtout le don d'agacer les autorités fiscales, la TVA étant alors perçue dans le pays où se trouve la plateforme (même si la loi européenne à ce sujet changera au 1er janvier).
D'ailleurs, la nature licite ou illicite de ces sites n'est pas perçue clairement par leurs clients. 37 % d'entre eux « estiment que c'est forcément légal », 17 % pensent l'inverse, tandis que les 46 % restants disent « ne pas savoir ci c'est légal ou illégal ». Dans la pratique le flou est également de mise. Techniquement rien n'interdit à une entreprise d'importer en Europe des produits venant de l'extérieur de l'UE. Au sein de l'Union, la libre circulation des biens et des services fait aussi que rien n'empêche ce genre de pratiques. Au final, ces plateformes ne font qu'aller à l'encontre de leurs contrats signés avec les éditeurs, ce qui reste un acte illégal.
Enfin, concernant la pratique du piratage, l'étude montre que seuls 3 % des joueurs déclarent consommer leurs jeux de façon exclusivement illicite, contre 73 % de joueurs se procurant leurs titres de manière exclusivement licite. Un constat à des années lumières de celui exposé il y a deux ans par Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, qui disait à qui voulait bien l'entendre que 95 % des joueurs sur PC sont des pirates.



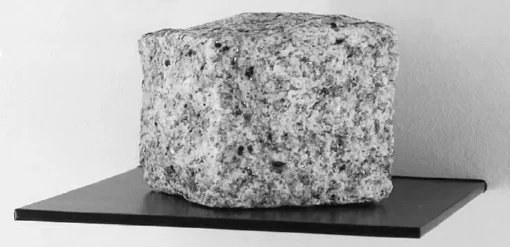





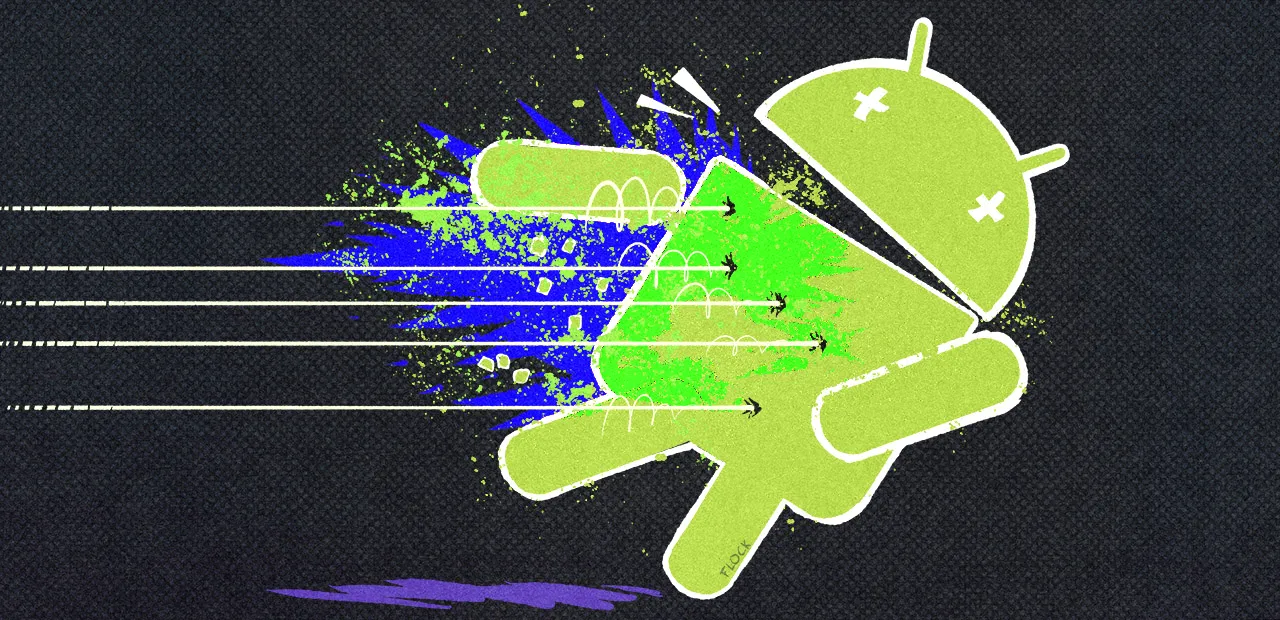

Commentaires (24)
#1
Coté marché gris, j’admet être passé du coté “obscur”… avec des jeux à 60e, je trouve le prix scandaleux !
 " />
" />
Au final les acheter à 30⁄40 je trouve que c’est le prix correct. Au moins je sais que l’économie réalisée n’est pas à 100% sur le dos des développeur (comme le piratage) mais qu’ils en touchent au moins une (bonne) partie.
Par contre, quand on voit ce que devient le model en général avec les DLC et tout ça…
#2
Pour avoir acheté des clés de Jeu sur Instant Gaming, je dois dire que je ne passe quasiment plus par les distributeurs de Jeu physiques.
Les prix sont attirants, le service est présent, et jusqu’à maintenant, je n’ai rencontré aucun problème.
Seuls des coffrets collector , apportant un réel plus pourraient encore m’intéresser (Tout comme les films/séries TV).
Une question cependant, les sites (comme celui cité plus haut) sont-ils tous considérés comme appartenant au marché gris ?
#3
Un jeu dématérialisé coûte le même prix qu’un jeu version boite?
#4
Pour faire court : ça dépend.
#5
Ca dépend?? Ca dépasse??
Ok je sors ===> [ ]
#6
Même en voulant faire court, ça dépasse " />
" />
#7
Hummmm encore ces fichues cases trop petites  " />
" />
#8
Ca rappelle des histoires de quais à la SNCF…
#9
ils avaient fait construire les trains avant de mettre les quais aux normes
#10
Donc là faut agrandir les cases
#11
En même temps Guillemot, c’est le boulet qui mettait l’intégralité des téléchargements dans le même panier. Y compris donc les téléchargements issus des pays dans lesquels la majorité de la population n’a pas les moyens de payer des jeux plusieurs dizaines d’équivalents dollars, ou dans lesquels le jeu n’est tout simplement pas distribué… " />
" />
Steam a pavé la voie de l’extinction du piratage : des prix d’entrée raisonnables, des baisses régulières et significatives + grosses promos de temps en temps… (Puis on a la chance d’avoir plein de distributeurs sur PC, dont HumbleBundle et GOG qui jouent beaucoup également).
La seule chose qui manque c’est une politique de démo systématique, m’enfin je ne vois pas trop ce que Steam pourrait faire sur ce sujet… Au pire ça ne lèse que les éditeurs concernés puisque ça incite au piratage (et perso, une fois atteint le palier de la dizaine de jeux payés >15 euros qui ne se lancent pas sur ma machine pour x raisons, je n’ai plus de scrupule à vérifier que ma machine pourra faire tourner un jeu, par tout moyen disponible…).
#12
des ingé alors peut etre, ou des directeurs qui sont pas sur le terrain.
#13
Je ne m’étais jamais posé la question de savoir si Go2Arena était légal.
 " />
" />
 " />
" />
Comme Blizzard se gave sur le prix des licences SC2 bien qu’elles soient sorties depuis plusieurs années, je les ai achetées sur Go2Arena pour les avoir moins cher.
Et je viens de comprendre donc avec cet article pourquoi ils envoyaient un scan d’un clé papier
Et on a dit merci à Steam pour avoir fait tomber le prix des jeux démat
#14
Non mais ça c’était parce qu’avec les années le béton ça travaille… " />
" />
#15
Le marché gris… Et voilà, même dans le marché des jeux video, les gris sévissent…
#16
#17
L’Hadopi se converti en un organe d’analyse ?
Même si c’est intéressant, je ne vois pas le rapport entre la fonction de cet organe d’état et l’analyse rendue.
#18
#19
Le dernier paragraphe englobe joueurs PC+Consoles sauf la dernière phrase avec Ubisoft.
Il faudrait indiquer la proportion de chaque “plateforme”.
Le PC étant surement plus représenté pour sa simplicité de téléchargement/installation
#20
Perso, ça fait longtemps que je ne pirate plus mes jeux et c’est pareil pour beaucoup de potes. Steam en est d’ailleurs pour beaucoup. Mais aussi les jeux en ligne.
#21
Article intéressant, merci @Ellierys
Sinon, 73% des joueurs qui ne se procurent que des jeux licites, j’ai du mal à croire ça quand je regarde mon entourage… Bon, après on peut diviser ça en deux :
#22
#23
Bah non, pas les sociétés de BTP privées qui sont mandatées par la SNCF " />
" />
#24
En gros, la conclusion de l’étude Hadopi, c’est qu’Yves Guillemot est malhonnête ?