Le projet de loi sur l’indépendance de l’audiovisuel actuellement au Sénat veut obliger l’ensemble des sites de vidéo à la demande et de TV de rattrapage (SMàD, service de média à la demande) à se déclarer auprès du CSA. Une idée démolie par l’ASIC, l’association du web 2.0 qui comprend YouTube et Dailymotion dans ses rangs.
David Assouline a fait adopter en commission de la Culture des amendements pour contraindre les éditeurs et distributeurs de SMàD à déclarer leur existence au CSA. Une demande poussée par le rapport Lescure. Le sénateur socialiste s’en justifie ainsi : « le CSA qui est en charge de la bonne application des obligations (…) notamment en matière de déontologie, de protection des mineurs, de production et de promotion des œuvres, a de grandes difficultés à recenser ces SMàD et à faire appliquer la législation. »
Obliger tous les services de vidéo à se déclarer au CSA
En somme, la régulation de ce secteur dépend des capacités du CSA à les identifier. En obligeant les services en ligne à se déclarer auprès de lui, Assouline veut inverser la logique. A défaut, « le travail de recensement complexe qui s’impose ainsi au Conseil présente le risque d’être partiel et de mettre en cause l’effectivité de la régulation. Il semble donc souhaitable que la loi dispose d’une obligation de déclaration préalable. »
Une régulation effective ? En matière de protection des mineurs, les textes obligent les SMàD à une classification et une signalétique identiques à celles existantes pour la TV (tous publics, -10 ans, -12 ans, -16 ans, -18 ans). Ces services en ligne doivent encore isoler les programmes « déconseillés ou interdits aux mineurs de 18 ans » dans un espace verrouillé. En outre, les SMàD d’une certaine importance doivent soutenir la création par une série de prélèvements et d’obligation d’exposition des œuvres françaises ou européennes.
Assouline le jure, main droite en l’air : « Il ne s’agit pas d’un contrôle a priori, mais de la fixation de règles minimales. Les réflexions menées dans le présent projet de loi ne visent absolument pas à instituer une forme de « gendarme de l’Internet », risquant de se transformer en néo Big Brother. »
Une autorisation préalable déguisée et donc interdite ?
Du côté des acteurs du Web comme YouTube ou Dailymotion, réunis au sein de l’Association des Services Internet Communautaires (ASIC), on tire la sonnette d’alarme. Si l'actuelle définition des SMàD laisse à ce jour de côté les sites contributifs ou ceux où la part vidéo n’est qu’accessoire, « demain, ce sont les blogueurs, les sites de e-commerce, les journaux en ligne, les jeunes créateurs, tous ces acteurs qui ont décidé d’avoir recours à la vidéo pour faire usage de leur liberté d’expression, qui vont se retrouver soumis à une censure préalable ». FUD ? Le CSA a pourtant déjà marqué son vif intérêt à contrôler les contenus de Dailymotion ou Youtube, sites contributifs par excellence.
Juridiquement, l’article 4 de la directive e-commerce de 2000 interdit expressément que les prestataires en ligne puissent être soumis à un régime d'autorisation préalable, « ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent ». Pour l’ASIC, la déclaration préalable – qui n’est pas une autorisation préalable - s'assimile ici à une exigence « ayant effet équivalents » compte tenu de la régulation qui se cache derrière.
Du côté du Sénat, David Assouline tente de contourner cette critique attendue : « la déclaration constitue une simple mesure d’information de l’autorité auprès de laquelle cette formalité doit être accomplie, sans qu’elle puisse, de ce seul fait, s’opposer à l’exercice de l’activité en question. Il ne s’agit donc pas d’une exigence contraignante ou restrictive de liberté, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, à propos de la liberté d’association. »
Il reste que le CSA par ce biais va pouvoir obliger tous les acteurs concernés à rentrer dans ses rangs, sous peine de sanctions. De plus, avec ces déclarations d’existence, il pourra préparer les premières briques du grand projet du rapport Lescure : lui confier les manettes de la régulation des contenus numériques en ligne. La connaissance précise des plateformes en ligne lui permettra de les inciter très fortement à des mesures pro actives contre les contenus illicites.






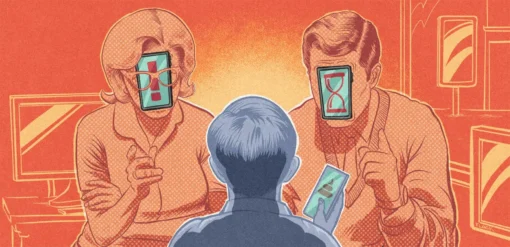

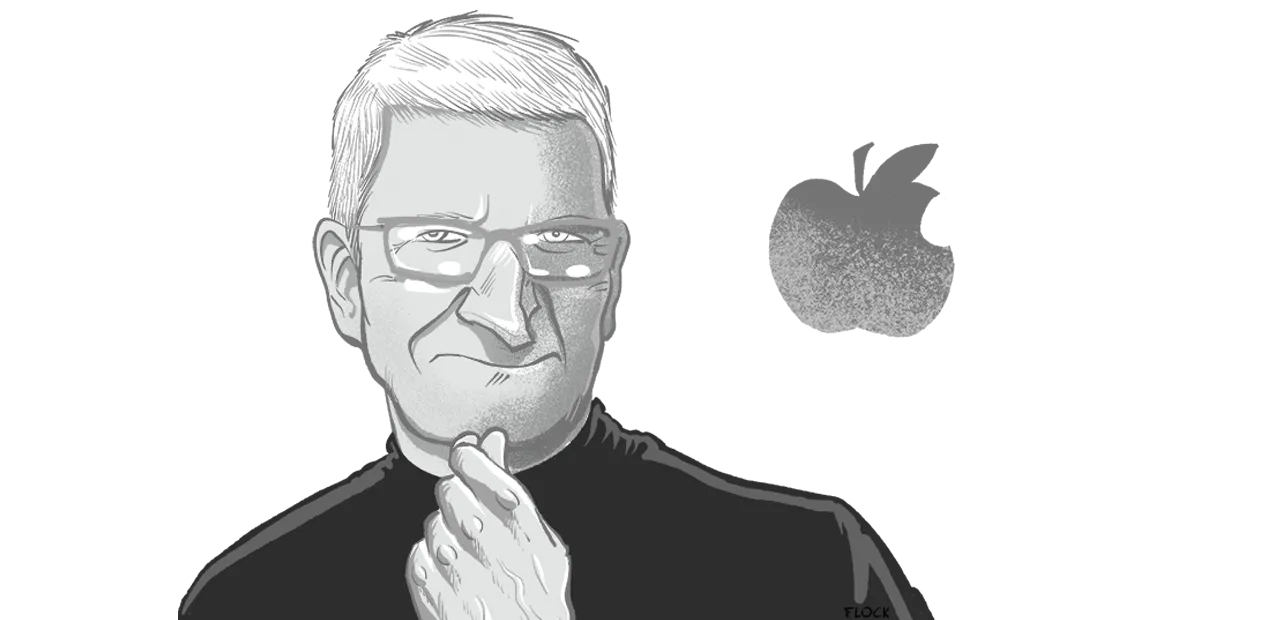
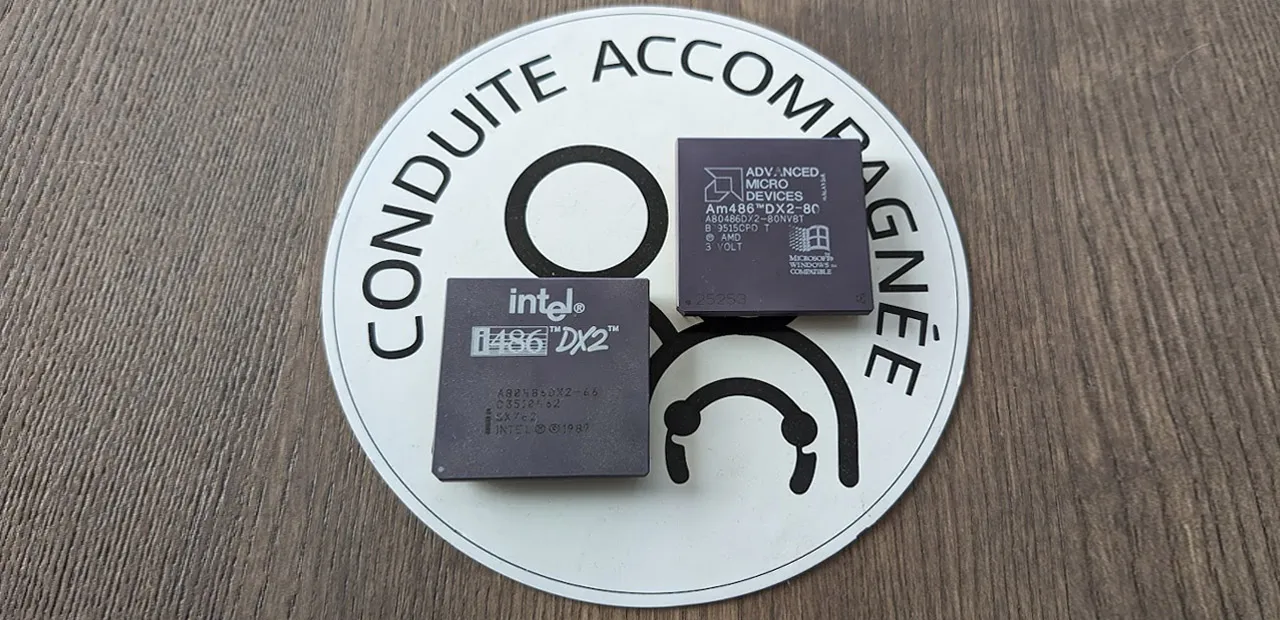
Commentaires (51)
#1
Je viens de réagir à quel pour le sigle CSA et proche d’un autre " />
" />
#2
Vu qu’il y a de la vidéo de plus en plus un peu partout, l’état par l’intermédiaire du CSA, et donc les politique et les ayants droits, veulent un droit de regards sur tout contenu du web publié depuis la France ? " />
" />
#3
les acteurs du web 2.0 refusent les tentacules du CSA
Ph’nglui mglw’nafh CSA R’lyeh wgah’nagl fhtagn.
#4
Mais sur internet, on est pas censé “chercher le contenu” ? Contrairement à la TV ou on ‘subit”.
#5
#6
On nage en plein délire…
pouvoir, pouvoir, pouvoir… c’est tout ce qui les intéresse…
#7
Assouline le jure, main droite en l’air
On sait ce que vaut une promesse de ministre.
#8
C’est ingérable leur truc, quand bien même il faudrait une déclaration préalable auprès du CSA, il se passe quoi si je monte mon site en Belgique, en Italie, au Zimbabwe ou n’importe où ailleurs qu’en France ?
Bah rien et c’est exactement ce qu’il va se passer si ce genre de loi à la con vient à passer, les acteurs du numérique vont continuer à se barrer sous d’autres cieux et ils auront bien raison.
#9
encore une institution de trop payés et qui ne sert a que dalle… et oui maintenant j’en ai marre, je trouve que bcp trop d’“organismes” coutent trop cher et cherchent trop a tout savoir pour ce que ca nous apporte.. et il serait tant que tout le monde se pose la question et arrete betement de jouer les oui-oui à rester politiquement correct.. la politique n’a rien de correcte de toute facon !
#10
Lol j’ai lu NSA au début ! " />
" />
#11
Rââh le concept qui peut pas être plus éloigné de l’esprit web.
Imaginez juste la rencontre entre ce bouzin et des sites comme HugeLOL, 9gag ou 4chan …
Si ca ne concerne que les vidéos, on peut encore passer par du gif animé pour diffuser de petites vidéos en mode “web” (et non en mode “TV”)
Mais franchement, ca me ferait bien gerber que X ne puisse plus diffuser de vidéos à Y sans l’accord de Z. On perd complètement la notion de décentralisation sur laquelle est bâti internet.
#12
DailyMotion, ce fleuron de la technologie française, contre le CSA ? Ça alors " />
" />
#13
les acteurs du web 2.0 refusent les tentacules du CSA
Yameteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
#14
Cautionner la CSA Iranienne voilà un joli programme " /> (qui fait déjà la même chose)
" /> (qui fait déjà la même chose)  " />
" />
#15
J’attends de voir une confrontation youtube/google CSA/france.
#16
#17
Vivement le retour du minitel et l’explosion du télétexte 2.0 " />
" />
#18
#19
Vidéo en ligne : les acteurs du web 2.0 refusent les tentacules du CSA
Encore un pauvre fou qui a invoquer Cthulhu dans notre monde
#20
#21
Vidéo en ligne : les acteurs du web 2.0 refusent les tentacules du CSA
La Pieuvre par neuf (pas envie de faire la démonstration)
#22
#23
J’ose espérer que les créateurs de contenu français vont s’associer et dénoncer ces agissements. Ils peuvent avoir pas mal d’influence sur les gens et les pousser à réagir. Non? Trop optimiste ? " />
" />
#24
Vidéo en ligne : les acteurs du web 2.0 refusent les tentacules du CSA
Ça va tentaculer !
#25
#26
Encore une tentative de reformer internet en quelque chose de compréhensible pour le CSA.
C’est naturellement voué à l’échec et je continue de souhaiter la mort du CSA.
#27
#28
Il ne faut les laisser mettre un pied dans la porte.
Tu leur tend la main et ils te prennent le bras.
On les connaît les promesses à Hollande. Que du vent.
#29
#30
“Je veux une lois pour que tout le monde soit obligé de me faire allégeance, de façon non contraignante, et avec le sourire*” (ainsi que de faire mon travail à ma place (c’est compliqué pour moi depuis la Suisse où je me baigne dans mon votre or)).
#31
#32
En tout cas j’ai appris une chose aujourd’hui, je ne connaissais pas Squiddly la pieuvre !
 " />
" />
 " />
" />
D’où le rapport avec les tentacules en fait !
#33
#34
EN fait c’est plutôt rigolo. Ils devraient rajouter l’envoie obligatoire d’“une copie de la vidéo en HD ou 4K!
#35
#36
En outre, les SMàD d’une certaine importance doivent soutenir la création par une série de prélèvements et d’obligation d’exposition des œuvres françaises ou européennes.
Ou comment dire : on pompe du fric pour financer un cinéma. français en phase terminale et on vous force a en faire la pub…
#37
#38
“SMàD” " />
" />
#39
#40
Les tentacules… mmh belle contrepeterie " />
" />
#41
@Marc Rees , @pcinpact ,
Étant conscient de votre indépendance et constatant qu’effectivement vous êtes les seuls à donner une information de qualité, j’avais suivi votre demande et désactivé AddBlock dans mon navigateur pour tout le site “pcinpact.com”.
Vu que certains articles sont devenus payant, j’ai en toute logique réactivé AddBlock dans mon navigateur hein.
25€/an non mais sans blagues, alors vous aussi vous donnez dans le modèle commercial des années 1990’ ?
Vous êtes sur une pente glissante…
#42
#43
Si j’ai bien compris, les quelques articles “abonnés” sont libérés ensuite au bout de 30 jours, donc on peut tout de même lire ça avec un léger décalage.
#44
#45
#46
#47
#48
comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971
Ben oui en 1971, ils étaient des experts de l’internet donc c’est bien de ressortir une décision datant de 1971.
#49
#50
Obliger tous les services de vidéo à se déclarer au CSA
CSA la nouvelle ‘Sacem’ du NET(quand la sangsue censurera avec tentacules) (espèce hybride OGMisée)
Vite ! à vos marque caméra et filmez, filmez, filmez, filmez,filmez, filmez, à saturation (corrigez vos erreurs au fur et à mesure,vous aurez peut-être un prix)
#51
Qu’est ce qu’on depense comme argent en France dans ce genre d’institution comme le CSA.
Qu’est-ce qu’on depense comme sous dans cette pseudo exception culturelle qui sert principalement à donner de l’argent aux copains du pouvoir…
Beaucoup d’argent dans la “culture” avec quel résultat ?
Du point de vue mondial : ou se situent nos artistes modernes ? nos acteurs ? nos supers réalisateurs ? nos architectes ?