L'Ademe a rendu, la semaine dernière, son avis sur les voitures électriques et les bornes de recharges. Si l'agence de la transition écologique explique qu'une voiture électrique peut avoir un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique, ce n'est pas le cas pour tous les modèles.
Dans son rapport (PDF), l'agence considère l’électrification du parc automobile français comme « l’un des leviers incontournables pour atteindre la neutralité carbone en 2050 » et affirme que les véhicules électriques peuvent émettre jusqu'à 2 à 3 fois moins de carbone si on compare leur cycle de vie complet… mais cela dépend de plusieurs facteurs.
Les SUV écartés avec une grosse batterie
En effet, pour l'Ademe, « l’impact carbone d’un véhicule électrique augmente quasiment proportionnellement à son poids ». Les SUV et les voitures lourdes ne rentrent donc pas dans les véhicules électriques conseillés par l'agence. Elle précise les conditions sur les batteries pour arriver à cette réduction de 2 à 3 fois des émissions de CO₂.
Celles-ci devraient être « de taille raisonnable », c'est-à-dire pas au-delà de 60 KWh, comme celle d'une berline de type Megane e-tech dont l'autonomie est de 470 km WLTP. Selon le rapport, une voiture « avec une batterie de taille supérieure, l’intérêt environnemental comparé à un véhicule thermique comparable n’est pas garanti et beaucoup plus tardif ».
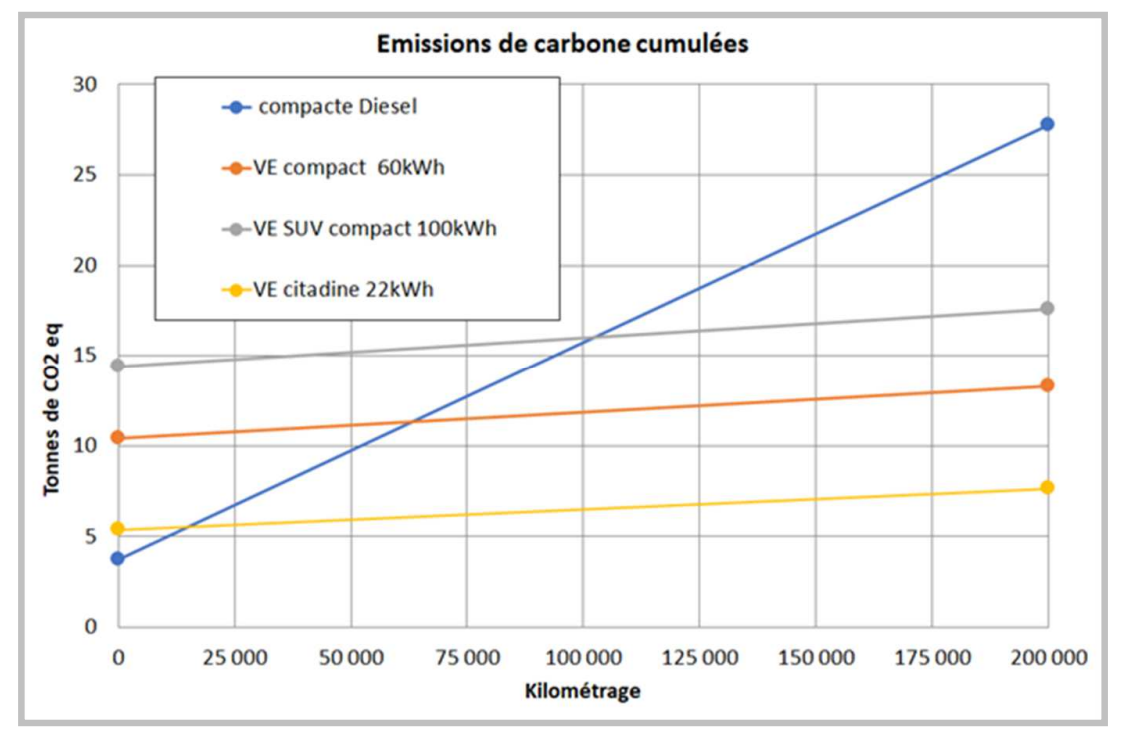
Dans le graphique ci-dessus, il est indiqué qu’il faut parcourir au moins 15 000 à 20 000 km avec une voiture électrique citadine (batterie de 22 kWh) pour que les émissions de carbone soient inférieures à celles d’une compacte diesel ; un palier que l’on peut facilement et « rapidement » atteindre. On passe à 70 000 km environ si la batterie affiche 60 kWh et enfin 100 000 km avec un véhicule électrique SUV compact de 100 kWh.
Difficile de faire de ce constat une généralité pour autant, comme le reconnait le rapport : « la consommation électrique peut varier selon la taille et le poids des véhicules dans un facteur de 1 à 2,5 ».
Le « coût complet » d'un véhicule électrique
Après l’impact écologique, passons à l’impact économique : « le coût complet d'un véhicule électrique rechargé à domicile est équivalent, voire inférieur à celui d'un véhicule thermique dès aujourd'hui », affirme l’ADEME. Selon les calculs de l’Agence, sur 15 ans, le coût complet d’un véhicule électrique compact avec une batterie de 40 kWh « est de 8 000 euros plus faible que son homologue essence ».
Le coût est par contre supérieur avec une batterie de 80 kWh ou avec une voiture hybride. Il n’est pas précisé si les calculs prennent en compte le bonus écologique de 6 000 euros (7 000 euros prochainement pour les ménages modestes), de la prime à la conversion pouvant atteindre 5 000 euros de plus et les éventuelles aides supplémentaires suivant les régions et les profils de chacun.
Là encore, impossible de tirer des conclusions à grande échelle. De plus, comme nous allons le voir juste après, la notion de voiture « rechargée à domicile » est très importante et peut influencer le coût complet du véhicule de manière non négligeable.

Domicile-travail sur batterie, quid des longs trajets ?
Partant du constat que plus la batterie est petite plus les émissions de carbone sont faibles, l'Ademe conseille de choisir une batterie « juste adaptée à l’usage majoritaire du véhicule (typiquement le domicile-travail quotidien) ».
Reste le problème des voyages plus longs, notamment pendant les vacances, avec des risques de saturation de certaines bornes de recharge, prises d’assaut par des véhicules avec une autonomie réduite devant multiplier les arrêts pour « faire le plein ».
Pour l’ADEME, il faudrait à moyen terme « engager une réflexion plus large sur le lissage de la demande de mobilité longue distance ». Des solutions « pourraient être rapidement étudiées : recourir au train, (dont il est nécessaire de renforcer l’offre et développer les services), ou organiser un service de véhicules adaptés sur les lieux touristiques, ou encore construire des alternatives occasionnelles aux grosses batteries installées dans les voitures (de type « range extender » / prolongateur d’autonomie) ».
Le rapport signale à juste titre que les solutions ne seront pas les mêmes pour une personne célibataire que pour une famille avec trois enfants lors d’un départ en vacances. C’est l’occasion de placer un mot sur les véhicules hybrides : « en attendant le déploiement d’offres de mobilité à grande distance telles qu’évoquées plus haut, la technologie des hybrides rechargeables peut être pertinente en matière de transition écologique ».
Une condition est rapidement ajoutée par l’ADEME : que tous les trajets inférieurs à l’autonomie en mode électrique soient effectivement réalisés sur les batteries exclusivement, ce qui implique de bien penser à recharger sa voiture régulièrement.
On pourra enfin remarquer que, si ces observations s'appliquent à la France dont l'énergie est très nucléarisée, elles ne peuvent être généralisées à n'importe quel pays.
Tout n’est pas rose dans l’électrique
L’empreinte environnementale d’un véhicule électrique ne comprend pas que le coût environnemental de sa conception. Si, « par définition, aucun polluant d’échappement (dont les oxydes d’azote NOx qui sont encore problématiques dans plusieurs métropoles Françaises) » n’est rejeté par les voitures électriques, d’autres sources de pollution existent.
Tous les véhicules émettent des particules (hors échappement) « résultant de l’usure des pneus, des plaquettes de frein et du revêtement routier ». Si le freinage régénératif (sur le principe de la dynamo) permet de « réduire sensiblement l’usure des plaquettes de frein », ce système est « généralement plus lourd que son équivalent thermique, ce qui augmente l’abrasion des pneus ». Cette dernière serait d’ailleurs « responsable, tout véhicule confondu, de 28 % des microparticules déversées dans l’océan chaque année (IUCN 2017) ».
Bref, l’ADEME rappelle que « l’électrification des automobiles n’en supprime donc pas toutes les nuisances ». Pour l’Agence, il est donc « crucial d’interroger la pertinence du recours à l’automobile même lorsqu'elle est électrique : le vélo ou les transports collectifs offrent aussi de nombreux avantages en terme sanitaires et environnemental, en centre-ville notamment ».
Sécuriser les approvisionnements en matières premières
Sur la conception des batteries, l'Ademe pousse à « la sécurisation des approvisionnements » du lithium, cobalt, nickel et du graphite nécessaires à leur fabrication et à une concertation au niveau européen sur le sujet. Vu la croissance du marché, si l'augmentation des performances des usines de recyclage est important, elles ne pourront pas être suffisantes.
Une batterie de voiture est considérée comme étant en « fin de vie mobilité » lorsque sa capacité de stockage initiale est diminuée de 20 à 30 %. Dans le cas des Zoe avec location de la batterie, cette dernière est changée lorsqu’elle passe sous les 75 % par exemple.
Ces batteries « en fin de vie » pour les voitures peuvent toujours être réutilisées « pour des usages moins exigeants en termes de densité d’énergie, par exemple en stockage stationnaire, sous réserve que ce réemploi ne nécessite pas d’opération trop coûteuse qui la rendrait économiquement non compétitive ».
Si elle est hors service, « la batterie est traitée dans la filière industrielle de recyclage, soumise à la Directive Européenne 2006/66/CE “Piles et Accumulateurs”, qui exige au moins 50 % de rendement de recyclage pour les batteries Lithium ». Selon l’ADEME, le taux moyen est actuellement de l’ordre de 60 %, mais la quantité à recycler reste assez faible pour le moment, et « les quantités de matières recyclées sont marginales en regard des besoins de la filière de fabrication de batteries ».
Cette directive européenne est en cours de révision. L’objectif de rendement pourrait ainsi passer à 70 %, mais surtout ajouter un « ambitieux de taux de récupération de 4 métaux d’ici au 1er janvier 2026 : 90 % pour le nickel, le cobalt et le cuivre et 35 % pour le lithium ».
L’ADEME précise que « ces chiffres font encore l’objet de discussions, compte tenu des verrous technologiques qui sont à lever pour garantir leur atteinte ». Une autre manière de dire que ce n’est pas pour tout de suite… L’objectif est à la fois de réduire le besoin de matières premières primaires et de mettre en place une fabrication « en boucle fermée » de nouvelles batteries avec des matériaux issus du recyclage d’anciennes batteries.
Plus de 69 000 bornes en métropole
Au 1er septembre 2022, on compte selon l'agence 69 428 points de recharge ouverts au public sur le territoire métropolitain, soit une moyenne d'un point de charge pour 14 véhicules. « Même si ce réseau présente un taux de croissance important (+49 % en un an), le manque "perçu" de bornes de recharge sur le territoire reste un frein majeur au déploiement de l’électromobilité », explique le rapport. 91 % de ces points de charge sont de puissance inférieure à 22 kW.
Il faut dire que le nombre de véhicules légers 100 % électriques augmente aussi : de 28 300 en 2016 à plus de 174 000 en 2021. En juillet de cette année, la France compte selon l’ADEME 620 000 véhicules électriques, « soit à peine 1,5 % du parc roulant ». Et il faut encore ajouter les voitures hybrides qui, elles aussi, peuvent avoir besoin de se recharger sur des bornes.
L'agence fait aussi remarquer que « les prix de vente au kWh sur bornes de recharge ultra rapides sont de 3 à 4 fois plus élevés qu’à son domicile ». Le rapport donne quelques chiffres : « le prix de revient en électricité pour réaliser 300 km est à l’heure actuelle d’environ 10 euros en charge normale (à domicile) et de 40 euros en charge rapide (pour 30 euros environ en mode thermique) ».
Il existe pour rappel des points de charge gratuits, notamment près de certains enseignes ou des hôtels qui espèrent ainsi attirer des clients. Ils proposent parfois la charge rapide. Il faut également que la place soit disponible.
Travailler sur d'autres axes
Si l'Ademe affirme qu'électrifier le parc des véhicules est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, elle insiste que ça ne sera pas suffisant. Trois autres axes de travail sont mis en avant :
- les changements de comportements (promotion du tourisme local, télétravail...)
- le report modal vers d’autres moyens de mobilité moins impactants que l’automobile particulière (vélo, marche, transport en commun, covoiturage, autopartage, véhicules intermédiaires)
- l’amélioration des technologies. À la fois la chaine de traction électrique, mais aussi la base roulante du véhicule : masse, dimensions, pour réduire son besoin en énergie.

























Commentaires (230)
#1
Il manque un élément selon moi dans le calcul de l’ADEME : le remplacement des batteries.
En fonction des constructeurs, la durée de vie de la batterie est entre 100 000km et 160 000km. Bref, si la comparaison peut tenir la route avec une voiture essence, il faudrait, pour une voiture diésel, considérer non pas 1 mais 2 batteries. Ce qui n’est visiblement pas le cas des courbes publiées, qui devraient alors montrer un escalier pour les véhicules électriques à partir de 100 000km.
Quoi qu’il en soit, merci l’ADAME pour ce rapport. Cela me donnera peut être un peu plus de grain à moudre quand je dis à mon entourage que le véhicule électrique n’est pas la solution, que seul un changement de comportement l’est. Le VE, c’est juste le moyen de vivre comme aujourd’hui en se donnant une fausse bonne conscience…
#1.1
Tu ne confonds pas durée de vie et garantie ?!
#1.2
La France ne se résume pas aux hyper villes comme Paris, Lille, Lyon, Marseille où il est facile de prendre un bus, un train, un metro ou un vélo…
En province, dans les petites villes et villages, quand il y a un car (même pas un bus) le matin et un le soir, c’est déjà exceptionnel. Alors se passer de voitures, ce n’est même pas envisageable. Toutes les améliorations sont bonnes à prendre même si ce n’est pas du zero pollution, c’est mieux que de laisser en l’état, jusqu’à ce qu’on trouve mieux…
#1.3
Quand je n’habitais pas à Lille, je prenais mon vélo pour rejoindre la gare la plus proche. Je n’avais pas de voiture.
Mais le fait d’avoir une voiture rend paresseux, y compris intellectuellement. On ne pense plus qu’à la bagnole comme moyen de locomotion. Y compris pour aller à la Poste qui est à 2 bornes.
#1.8
Dans ma jeunesse, j’ai habité à Charbonnières les Bains, dans la banlieue lyonnaise.
Je travaillais dans la ville d’à côté, à Marcy l’Étoile.
Ma copine de l’époque était étudiante dans une autre ville d’à côté, à Écully. Mais elle a passé une bonne partie du temps où nous avons vécu là-bas en alternance sur un site industriel loin de tout centre urbain, en Isère.
Pour elle, aller travailler en transports en commun ou en vélo n’était pas une option. L’école en vélo n’était pas envisageable non plus, il y avait une grosse vallée à franchir.
Pour moi, les TC étaient exclus (1h pour faire ces quelques km en passant par la gare de Vaise, non merci !), le vélo était envisageable par beau temps. Le problème dans ce pays, c’est que parfois, on est en intersaison ou en hiver et là, ça marche moins bien…
[edit] ce que je veux dire par là, c’est qu’il ne faut pas prendre son cas pour une généralité, que certaines choses qui sont évidentes quand on est un célibataire sans enfants le sont moins plus tard, et que tout n’est pas seulement lié au “tout voiture des années 50”.
#1.5
Ca tombe bien, je n’ai jamais dit ça. J’ai dit qu’il fallait changer les comportements. Aujourd’hui, il faut prendre conscience que si on choisit d’habiter dans un petit village, il faut en assumer les conséquences.
Le problème n’est pas de prendre la voiture. Le problème est de DEVOIR prendre la voiture. On devrait préparer l’avenir et inciter les gens à tout faire pour devenir de moins en moins dépendant de cette dernière. A la place, on trouve un palliatif qui n’est qu’illusion (il est tout simplement impossible de remplacer le parc automobile thermique actuel par un parc de véhicule électrique, car la dure réalité c’est qu’il n’y en aura pas pour tout le monde, les conférences d’Aurore Stephant à ce sujet sont très bien foutues).
En bref, des milliards vont être investi dans des infrastructures électriques au détriment de solution plus pérenne et beaucoup plus longues termistes comme les pistes cyclables. Ben oui, mais ces milliards vont nous permettre de continuer à vivre comme nous le faisons encore quelques années…
#1.18
Je sais que j’arrive laaargement après la bataille, mais lire en 2022 que le vélo ce n’est que pour les métropoles ou grandes villes demande de la contradiction ; et je mentionne ceux ayant promu le vélo pour leur donner des billes.
Comment le vélo devient l’atout gagnant des villes moyennes
Le choc énergétique appelle un plan d’urgence pour développer massivement l’usage du vélo
Quelques vidéos
Le vélo peut-il remplacer les camions de livraison en ville ?
Le vélo « longtail» pourrait-il remplacer le scooter en ville ?
« Les Roues du Possible », plaidoyer vélo pour une mobilité inclusive
#1.19
Je rejoins les propos que tu as partagés
Je n’habite pas en ville et j’utilise le vélo quotidiennement.
Nous utilisons (famille de 5) la voiture pour +/- 10.000 Km par an pour les trajets impossibles en vélo.
Outre l’aspect ecologique, je retire en fait beaucoup de plaisir de rouler dehors 2x /j sur un vélo au lieu d’être enfermé dans une voiture. C’est mon buffer boulot/maison.
Je me permet de m’auto-citer pour ceux qui aurait mon commentaire car cela rejoint le commentaire de kamui57.
#1.4
J’ai pas compris pourquoi la comparaison des 100/160k km tient la comparaison avec une voiture essence mais pas avec un diesel ? Tu sous entends que les voitures essence ont une durée de vie d’environ 100 à 150k km ?
#1.6
Disons qu’à 150000km, une voiture essence commence à être en fin de vie. Pour un diesel, c’est le double.
Du coup, en étant “optimiste”, la durée de vie d’une voiture à essence reste dans le même ordre de grandeur que pour un véhicule électrique (pour la fourchette haute). Ce qui n’est pas le cas pour un véhicule diésel.
#1.11
Ca fait quand même quelques génération qu’un véhicule essence n’est plus “rincé” une fois arrivé les 150k km. D’autant plus si l’utilisateur respecte les préconisations constructeurs.
Après sur les moteurs qui tombent actuellement dans les 150k km, on est peut être encore sur des générations de ~2010, et donc les 150k km semble en effet être la moyenne pour ces modèles.
#1.13
Tu la traites comment ta voiture essence pour qu’après seulement 150k km elle soit “en fin de vie” ?!
#1.22
Une voiture essence en fin de vie à 150000km ? merde la mienne approche les 180000, j’en fais quoi ?
#1.7
Tu confonds la garantie constructeur et la durée de vie d’une batterie.
Concernant la location des batteries, les constructeurs ont tout intérêt à nous orienter vers ce mode qui est bcp plus rentable pour eux.
Pour info :
Durée de vie —- La durée de vie de la batterie au lithium fer phosphate (LFP) est meilleure que la batterie au lithium NMC / NCA. La durée de vie théorique de la batterie au lithium NMC est de 2000 cycles, mais sa capacité s’estompe rapidement pour conserver 60% lorsqu’elle exécute 1000 cycles; même la batterie Tesla NCA la plus connue ne peut conserver que 70% de sa capacité après 3000 cycles, tandis que la batterie au lithium fer phosphate (LFP) restera à 80% après 3000 cycles.
[Sourece : https://poworks.com/fr/comparaison-de-nmc-pane-lithium-ion-et-batterie-lfp]
Donc si je ne me trompe pas, au pire en NMC 1000 cycles de 300km en moyenne = 300 000 km pour tomber à 60%. C’est largement plus que ce que parcourent la majorité des voitures.
Sur du LFP on approche du million de km !!!!
#1.9
Comme dis plus haut, je ne confond pas les deux. Ce n’est pas de ma faute si certains loueurs utilisent les données de garantie pour prévoir le changement de batterie.
Ensuite, c’est bien de parler des batteries LFP. S’il est vrai qu’elles supportent un plus grand nombre de cycle de charge, il faut souligner :
Bref, les constructeurs ont tout intérêt pour eux à utiliser du NMC / NCA. Gain de place, en efficacité, en charge, et durée de vie plus courte (donc plus de vente !).
#1.10
Les chiffres de durée de vie des batteries vont bien au dela de ça, estimés entre 300 000 et 450 000 km en fonction du nombre de cycles.
Quand on voit les moteurs actuels downsizés tomber comme des mouches (toute la branche des 3 cylindres renault/peugeot entre autres) sous les 100 000km (je viens de faire changer le 1.2PT de ma peugeot, défauts de conception connus entre la courroie humide qui entrainait le bouchage de la pompe à huile et une ovalisation des cylindres qui rend la segmentation caduque et fait casser les bougies), pas dit que le thermique soit toujours une si bonne opération
Sauf que les batteries ne sont pas remplacées tous les 150k km et que les 10 ans de retex Tesla donnent des chiffres bien plus proches de ceux estimés
#1.12
Je ne sais pas quelle est ta source d’information pour la prévision de 100 à 160 000 000 km pour la durée de vie des batteries. Ça m’a l’air passablement erronée quand on regarde les faits. Par exemple, la Tesla d’un ami à 180 000 km et la perte d’autonomie de la batterie est vraiment négligeable. Vu la vitesse progression de l’usure, elle devrait durer plus de 300 000 km.
#1.14
Mon calcul est que quand j’atteindrai la fin de ma nécessité de conduire (environs 700-800 000km selon mon kilométrage prévisible à très long terme), ma voiture (une model 3 que j’espère pousser jusque là, d’autres avant moi ayant réussi) n’aura pas eu besoin de changement de batterie (j’ai une batterie 77kwh pour une autonomie théorique de 570km).
Je serais probablement aux alentours de 50-70% d’autonomie résiduelle, mais avec même avec 300km d’autonomie c’est censé être largement suffisant.
#1.15
Quel est le nombre de recharges par cellule ?
Pour les LFP c’est aux alentours de 3000 max avant de passer sous les 80%.
Donc 3000300 = 9000000,8 = 720k en première approche.
Pour les li-ion c’est à preine 120k !
#1.16
Un exemple : selon pas mal d’articles récents, sur une Tesla (car c’est sur celles-là qu’on a le plus de recul pour le moment), on est plutôt entre 300.000 et 500.000 km avant de remplacer la batterie hein. Pas 160.000. Je ne sais pas d’où ce chiffre sort je suis intéressé par la source.
Je suis pas spécialement pro-électrique, je trouve d’ailleurs pour plein de raisons très pratiques que c’est même plutôt un retour en arrière (autonomie de -40% passé -20 degrés - oui au Québec ça caille, un plein dure en moyenne 45min/1h sans parler de l’attente si c’est plein + l’hiver c’est encore plus long, etc etc).
Mais concernant la durée de vie d’une batterie, les chiffres montrent qu’on est plutôt pas mal pour le coup.
Côté écologie, c’est apparemment loin d’être parfait si je compile un peu tous les articles que je lis sur le sujet mais ça reste sur le long terme un peu mieux. Reste à savoir comment va-t-on produire autant de batterie pour contenter tout le monde.
#1.17
les 160 000 c’est le kilométrage garanti (si en moins de 160 000 km la batterie tombe sous les 70% elle est remplacée sous garantie, c’est tout)
#1.20
Il écrit “En fonction des constructeurs, la durée de vie de la batterie est entre 100 000km et 160 000km.” donc aucune notion de garantie dans ses dires non. La durée de vie des batteries est bien plus haute. Les mots ont un sens ^^
#1.21
j’ai jamais vu de constructeur estimer la durée de vie de la batterie entre 100k et 160k km, ces chiffres je les ai vu uniquement pour la garantie desdits constructeurs
beaucoup de monde semble considérer qu’au bout de ce qui est garanti, la batterie est morte, alors que c’est totalement faux, elle “peut” légalement être moins performante et/ou avoir une capacité moindre que quand elle était neuve, ça veut pas dire qu’elle devient inutilisable du jour au lendemain.
une batterie qui à l’origine permettait de faire 120 bornes, quand elle tombe à 50% c’est clair que le véhicule ne peut plus être utilisé de la même manière, mais il peut avoir son utilité quand même pour des citadins ou des gens qui font des petits trajets
en effet il a écrit “durée de vie”, mais je n’ai jamais vu ça, pour moi c’est une erreur de compréhension, d’où ce que j’expliquais dans ma réponse
#1.23
Gotcha
En effet, surement une incompréhension générale sur le garantie != durée de vie réelle.
#2
“moins polluantes” il faut aussi arrêter de faire l’équivalence entre émissions de CO2 et pollution. Oui, c’est UNE forme de pollution, mais pas la seule.
La pollution atmosphérique locale des voitures diesel/essence est non négligeable et mérite d’être mentionnée.
#3
Le rapport ne parle pas de la différence de coût du kwh entre un particulier en pavillon et un particulier devant recharger dans les parties commune.
De ce que j’ai compris du REX d’un des abonnés de NXI ( @sebGF ) on est proche des coûts charge rapide et c’est incontournable lorsqu’on est en appartement.
Ce qui rend le véhicule électrique encore moins attractif pour les citadins (cibles du véhicule électrique)
#3.1
Je recharge à la borne publique la plus proche (aller-retour à pied et je laisse charger qq heures) et cela me coûte autour de 3 € les 350 km de recharge. Les bornes publiques AC 22 kW sont très peu chères, souvent même moins que la charge à domicile (notamment la nuit), cela dépend de l’opérateur. Ne pas confondre avec les borne DC qui sont très coûteuses effectivement, mais plutôt destinées à la recharge en voyage sur autoroute. Pour ma part en voyage je ne prends pas l’autoroute et je charge dans les villages. C’est une erreur de vouloir utiliser un VE comme un thermique. On peut, mais ce n’est pas optimal. En prenant son temps on fait de grosses économies. C’est un autre mode de vie, mais c’est le sens de la sobriété.
#4
*Trois autres axes de travail sont mis en avant :
Intéressant.
Je pense que ceux qui peuvent déjà faire du “report modal” le font.
Ceux qui ne peuvent pas, que ce soit à cause de problèmes de santé ou de distance, ou de difficulté de terrain ou autre …. ne le feront pas plus que maintenant.
Quant aux transports en commun, ils sont devenu abscent de tout espace hors urbain.
Pour ce que j’en ai vu, dans les grandes villes le gros des véhicules ce sont les utilitaires : Transport de marchandise, artisants, …Tout le monde a une bonne raison d’être là. C’est le mode de vie qui a été poussé après guerre, ça ce change pas en un claquement de doigts. (On voit ce qui se passe lors d’un léger creux dans l’approvisionnement de pétrole).
Quant au télétravail, déjà ça concerne pas tout le monde loin de là, et pour ceux qui pourraient, encore faut il que l’employeur 1/ accepte et 2/ , surtout, fasse ce qu’il faut en terme de moyens informatique & de formation. Pas gagné…
#5
Ce n’est pas ce que je constate.
Y compris par ces temps de prétendue pénurie de carburant. Par exemple, mon voisin de bureau (célibataire sans enfant) habite comme moi à 5 minutes à pied d’une station de métro et à même durée à vélo. Durant cette prétendue période de pénurie, ce qui change c’est la conversation à la machine à café. Je parle des activités que j’ai faites durant mon week-end, il fait la listes des stations services qu’il a visitées.
#6
Non. du tout.
Il existe 2 cas : on est propriétaire de sa batterie, ou on la loue :
Sans compter que les chiffres données par les constructeurs comportent toujours des petites lignes (en cas d’usage normal, en évitant les cycles de charge complets, les bornes à recharges rapide qui ont tendance à faire monter en température les batteries (ce qu’elles n’aiment pas), attention à l’hiver, etc…)
#7
Et quand il n’y a pas de gare ?
Quand tu dois aller d’un point A à un point B qui ne se trouve pas en centre ville ?
J’ai l’impression que d’avoir un vélo ne rend pas plus lucide ou tolérant.
PS: pour être tout à fait clair, dans les grandes villes comme Lille, la voiture est clairement optionnelle. Par contre à la campagne ou en peri urbain de villes de taille moyenne, elle ne l’est pas.
#8
Pour en revenir à l’article, il est clair qu’un SUV de 2 tonnes avec une batterie de 100 kwh n’est en rien une plus value en termes d’émissions de GES mais aussi en termes de consommation énergétique.
#9
Bref, ce qu’on apprend, c’est que la voiture n’est pas un moyen de déplacement durable, quelque soit son carburant. Et qu’un SUV, c’est pire (en électrique comme en thermique). Quoi de neuf ?
Peut-être qu’on pourrait non pas mettre le paquet sur les primes à l’achat d’un VE, mais proposer des moyens de transports alternatifs à la voiture plus efficaces, notamment à la campagne ?
Si je fais 8000kms de vélo par an pour ne pas avoir de voiture, je peux comprendre que tout le monde n’est pas prêt à en faire autant, notamment quand on vieillit ou qu’on a des pbs de santé, faire 15 bornes en vélo matin et soir pour aller bosser ou faire ses courses…. il faut d’autres alternatives !
#9.1
A mon avis avec 8000 km par an tu fais plus que 30 km/jour, tu dois aussi faire des randoonées de plusieurs dizaines de km.
Et puis le vélo pour ramener un colis encombrant de plusieurs kg, pas top.
#9.2
Oui, je suis également apiculteur amateur. Je me déplace dans mes rucher en vélo - électrique - également. Pas de pb pour déplacer des ruches et du matériel apicole en vélo non plus (mais bon, en amateur hein. Donc maxi 150 kg sur la remorque - soit 2 ruches au moment du déplacement).
Je fais également des randos en vélo couché.
C’est évidemment possible de se déplacer en vélo, pour plein de choses. Mais c’est un engagement qu’on ne peut pas demander à tout le monde, il faut donc des alternatives pour sortir du réflexe voiture.
#10
Étude assez dépassée, entre les chiffres qui sont loin de la littérature scientifique et le parallèle très discutable entre la capacité de la batterie et le type de VE, genre des SUV avec des petites batteries, ça existe (kona et e-Niro 39 kWh), des berlines avec des énormes batteries aussi (Tesla Model S 100). Ce qui est important, c’est l’efficience du véhicule, donc sa chaîne de traction et son aérodynamisme (là où le SUV peut poser problème mais pas que : un e-Niro est plus efficient qu’une Zoe, bien que SUV et plus lourd).
La littérature scientifique converge bien sur le fait que le VE permet des gains substantiels d’émissions à l’heure actuelle, sans parler du fait que la plupart des mix énergétiques vont plutôt vers la décarbonation que l’inverse.
#11
Edit :
@carbier
D’un autre côté, si ton SUV de 2T et 100kWh (donc Merco ou BMW) remplace la même chose qui roulait au diesel ou à l’essence, tu as un gain énorme d’émissions, même s’il est évidemment souhaitable d’essayer de faire plus petit (Renault n’y est pas mal arrivé avec sa Megan E-Tech).
@fdorin
Un VE, ça a une durée de vie supérieure à la plupart des diesels, surtout que ton diesel à 300000km, son système de dépollution est niqué, t’as déjà changé la distrib, probablement la vanne EGR et qql autres pièces. Et il a cramé pour minimum 15000L de carburant, soit ~48T émises de CO2.
Edit2 : j’ai cliqué sur répondre au lieu de Editer…
#12
Pas de gare, c’est pas souvent. Et pour aller d’un point A à un point B, dans l’essentiel des cas, le vélo est un moyen de transport très efficace.
Comme dans la banlieue de Seclin, où j’ai habité 10 ans dont 6 sans bagnole?
Si tout simplement ceux qui peuvent lâcher leur bagnole le faisaient, il y aurait bien moins de nuisances liées à la bagnole, en particulier ces nuisances sonores des collègues qui râlent contre les bouchons en refusant de comprendre qu’ils font partie du problème.
Les raisons de ceux-là à ne pas lâcher leur caisse sont connues: individualisme, paresse…
#12.1
Merci donc de confirmer ce que je disais concernant la lucidité et la tolérance.
Tu habites dans une région avec une densité de population très élevée (les Hauts de France)
Seclin par exemple c’est 10500 habitants soit une ville moyenne dans laquelle tu dois avoir tout à portée de vélo.
Il existe des départements et des régions qui ne sont pas dans ton cas, loin de la même.
La raison pour laquelle il n’y a pas de gare c’est n’est pas du au tout voiture, mais à la faible densité de population qui a fait que le train non seulement n’était pas rentable mais en plus aurait un ratio consommation énergétique/voyageur transporté pire qu’une voiture électrique.
Bref, tu es dans ton monde et tu crois que tout le monde vis ta vie.
Cela ne sert donc à rien de discuter.
#12.2
Au contraire, le train est toujours très efficace en terme d’énergie. En termes financiers, en général c’est très bon (c’est juste que les routes sont financées avec les impôts, alors que les rails de moins en moins).
Et l’idée c’est pas d’avoir une gare au pied de chaque maison, mais proche, et faire de l’intermodalité : oui, tu peux prendre le vélo, un bus, un tram, ou même ta voiture pour aller à la gare la plus proche, ce sera toujours mieux que de faire tout le trajet en voiture.
Un autre point, c’est de faire revivre les bourgs, et même les hameaux, avec du commerce de proximité.
Il faut donc un réseau plus dense et des trains plus réguliers, et surtout, moins chers (du moins, payés par la collectivité).
#13
Bien sur que si vu le nombre d’infrastructures de transport en commun qui ont été démantelées à cause de ce tout voiture.
Ce tout voiture a aussi favorisé un urbanisme d’une stupidité sans nom. Entre les cités de logements ou les lotissements de pavillons dans lesquels il n’y a ni commerce, ni service, ni entreprise.
#13.1
ben non… j’ai donné l’exemple bête d’un couple ou monsieur travaille d’un côté et madame de l’autre. La solution, ça serait quoi ? Que l’un des deux change de travail pour qu’ils puissent s’installer l’un à côté de l’autre ?
Côté “urbanisme stupide”, tu penses au cas des entreprises Seveso qu’on veut voir loin des villes ? Ça veut dire qu’il faut construire des villes juste à côté pour que les personnes qui y travaillent puissent y vivre ? En vrai, ça me rappelle effectivement un type d’urbanisme qui a eu cours au XIXe siècle, avec les cités ouvrières, le paternalisme patronal, etc. Ça serait ça, la solution ?
#13.3
Et remettre en place des infras de TC au lieu de continuer à subventionner la bagnole?
En un siècle, on a fermé plus de 38 000 kilomètres comprenant au moins 18 000 kilomètres du réseau d’intérêt général et la quasi-totalité des 20 291 kilomètres du réseau d’intérêt local.
Pour ce qui est des usines Seveso, il y en a énormément en ville. Et quand elles sont en ZI, pourquoi il n’y a pas une ligne de train ou de bus pour que les employés puissent s’y rendre ?
Pourquoi dans les lotissements pavillonnaires qu’on construit encore aujourd’hui, il n’y a toujours pas un emplacement pour une boulangerie, une boucherie, un primeur?
#13.4
Vrai sur la fermeture de lignes de trains - mon père m’a assez parlé de la méthode de la SNCF dans les années 70 consistant à changer l’heure d’un train bien rempli juste assez pour le rendre totalement inintéressant (en lui faisant rater une correspondance ou un début / une fin d’horaire de boulot).
Ce qui n’enlève rien au problème des trajets banlieue / banlieue (ou entre villages à la campagne) : les transports en commun sont organisés en étoile autour d’un centre, si tu dois aller au centre et te prendre 1h dans la vue pour pouvoir rejoindre le patelin voisin, c’est pas envisageanle. Le pire : l’absence de ligne transversale est rationnelle : avoir un bus qui fait la navette à vide 90% du temps pour que la fréquence soit suffisante coûte cher et n’a aucun intérêt pour l’environnement.
#13.5
Un peu de lecture pour comprendre que cette situation est la conséquence du tout voiture voulu par les politiques.
Ca n’a pas toujours été le cas. Et il n’y a pas que le train qu’on a démantelé, il y avait beaucoup de lignes d’autocars/autobus qui ne passaient pas par les centres villes.
Pour le bus non intéressant d’un point de vue écologique, j’en doute.
#13.6
Ben déjà, si le bus est intéressant, il roulera pas à vide 90 % du temps en fait… du moins, à moyen terme (au début il y a une inertie).
C’est le principe du trafic induit, ça ne fonctionne pas que pour les voitures. Le trafic induit est en général un report modal de nos jours. Faire un bus fréquent et peu cher le rendra plus intéressant que la voiture.
Si tu fais un bus fréquent mais cher, ben les gens continueront de prendre leur voiture et il tournera à vide, oui. Mais proposer une offre intéressante provoquera une modification de la demande, et partout où c’est fait correctement (Suisse, Pays-Bas, Chine, opérations ponctuelles de gratuité / réduction du tarif des TC), ils créent l’infrastructure avant, et l’utilisation vient naturellement ensuite.
#13.7
tu veux dire que ça te paraît plus écologique de faire rouler un bus de 20 tonnes pou transporter 3 pelés à 22h30 que de faire rouler 3 voitures pour les mêmes ?
Attention, entendons-nous bien parce-que je ne crois pas avoir été clair là-dessus : je n’ai absolument rien contre la mise en place de lignes régulières de bus. Mais si on veut que ladite ligne soit utilisée, il faut des passages fréquents et à peu près fiables. Et malheureusement, cette exigence de passages fréquents va à l’encontre d’un usage réellement écologique, surtout aux horaires extrêmes (milieu de matinée ou d’après-midi, fin de soirée…).
il semblerait que non, pour la Pologne : une Zoé ne sera jamais rentable côté émissions de CO2, du coup les autres véhicules seront encore pires !
Je suis intéressé, tu aurais des liens vers des publications scientifiques sur le sujet, s’il te plaît ?
#13.2
Certes, l’urbanisme fortement critiquable est renforcé par la facilité d’accès à un véhicule automobile, mais pas que. C’est aussi un choix d’un “rêve” - celui du pavillon bon marché entouré d’une toute petite surface de pelouse - qui a été vendu aux français, et qui fait qu’on a “tartiné du lotissement au km” pour reprendre les mots de Bruno Fortier.
Le rêve d’accession à la propriété, même d’un petit pavillon miteux en banlieue où ils sont tous pareils sagement aligné dans une zone, comme tu le dis, sans commerce, service, entreprise, n’est pas que lié à la voiture… mais à un urbanisme débridé à l’américaine. Un modèle passé de mode !
#14
Un véhicule électrique à beau avoir une durée de vie supérieure, la fabrication d’une batterie représente à elle seule la moitié des équivalents CO2 de la fabrication de la voiture électrique. C’est à dire que rien que la batterie à un bilan CO2 équivalent à celui de la production d’une… voiture thermique !. En bref, si la batterie est changée tous les 150 000 km, le bilan est bien loin d’être aussi idyllique qu’annoncé.
#15
Moi, j’ai jamais compris l’intérêt des SUV en tant que tel.
Déjà en véhicule thermique, un possesseur peut me dire l’intérêt ?
En électrique, c’est encore plus une connerie à mes yeux : lourd, probablement inadapté aux routes, roule généralement à vide.
C’est plus un achat “pour se faire plaisir” que réellement pour la planète.
Rouler “plus haut que les autres” (comme dans les sphères sociales, on est plus heureux que ceux d’en-dessous), avec un véhicule haut de gamme tout en se donnant bonne conscience …
J’ai l’occasion de voir régulièrement des gros SUV très haut de gamme, le machin ressemble plus à mini-bus qu’autre chose. Ayant une petite citadine, je fais probablement pitié à coté mais quitte à avoir une conscience écolo, autant prendre une Zoé.
Perso, je quitterai probablement le thermique quand on aura une alternative hydrogène, le stockage par batterie est un concept que je trouve plutôt foireux …
#15.1
Pareil !! Autant le monospace je comprends pour les familles par rapport à une berline 5 portes mais le SUV, vraiment le truc inutile qui surpollue pour rien. Et le point qui m’a toujours fait halluciner dans le SUV, c’est le S…Sport… Quand on voit en général la tronche des propriétaires de ces machins là, c’est vraiment pas le mot “sport” qui me vient à l’esprit….
#16
Et de négliger de contester les caractères légaux applicables à ce type de véhicules servant de repport modal.
On s’interroge donc sur la performativitér commerciale et carrée de la verte chiffonade pseudo-officielle de ce “petit” monde d’hypocrates. Ou pas.
#17
Tu peux arrêter de raconter n’importe quoi stp ? Depuis quand on change la batterie tous les 150k km ?
Quant au surcoût à la production, il est largement effacé par les gains au roulage.
#18
C’est toi qui dis ça? Amusant. Quel que soit le sujet, tu ne cherches jamais à discuter, tu est borné et ne fait qu’affirmer de façon péremptoire, et souvent en déformant les propos des autres.
Qu’est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase “Si tout simplement ceux qui peuvent lâcher leur bagnole le faisaient” ?
#18.1
Comme sur d’autres sujets, tu as une bien courte vue… Je suis d’accord avec Carbier, tu es dans ton monde et tu crois que tout le monde vis ta vie.
As-tu imaginé qu’il y a des gens en France qui vivent dans des villages, éloignés des villes, dans des régions montagneuses ? Ce n’est pas ça qui manque les montagnes en France (Alpes, Pyrénées, Jura, Massif central…). Tu penses que faire plusieurs dizaines de km en vélo quotidiennement en côte c’est quelque choses d’envisageable ?
Les situations, comme les gens, sont multiples. Il ne faut pas être dogmatique. Le vélo est une solution dans certains cas, le tien, certainement pas pour toutes les situations…
#18.2
J’adore l’argument de la montagne, alors que la Suisse a le meilleur réseau ferré et que le vélo s’y développe dans des villes pas particulièrement plates… et au pire un VAE fait le travail (oui électrique, oui à batterie, mais ça reste mieux que n’importe quelle voiture).
#19
????!!!!
Les moteurs à essence tiennent bien plus que 150 000 km depuis bien longtemps.
Le problème des voitures thermiques n’est plus vraiment le moteur.
Une des nombreuses questions est : vaut-il mieux acheter une voiture d’occasion ou une voiture neuve ?
#20
Ouaip: d’ailleurs si les citadins prennent leur voiture pour s’échapper des villes tous les week end, c’est aussi parcequ’on leur a “vendu” du rève.
Certaines personnes aiment et souhaitent être citadins, d’autres non. Mais les souhaits et les rêves de chacun sont forcément dictés par des “puissances” extérieures car tout le monde a les mêmes envies à la base.
#21
Relis ce que j’ai écrit et ce que tu affirmes et tu auras ta réponse.
Je dis: tout le monde (loin de la) ne peut pas utiliser un vélo ou avoir accès à un TC pour faire ses trajets quotidiens dans des délais raisonnables.
Tu affirmes que ceux qui ne le font pas sont des paresseux qui ne comprennent rien.
#22
“Si le freinage régénératif (sur le principe de la dynamo) permet de « réduire sensiblement l’usure des plaquettes de frein », ce système est « généralement plus lourd que son équivalent thermique, ce qui augmente l’abrasion des pneus ».”
Je ne comprends pas bien ce n’est pas le moteur électrique qui est réversible et sert de dynamo ?
#22.1
Oui c’est mal tourné.
Le “freinage” régénératif, comme son adjectif l’indique, permet de récupérer le moment d’inertie sans générer de frottements (vide entre stator et rotor dans le moteur electrique à induction ou aimants permanents).
Les plaquettes de la VE, bien qu’ayant plus de pression au freinage seul (compte tenu du surpoids) se dégradent plus vite ou bien sont surdimensionnées
Mais cela n’empêche donc pas de comparer la voiture électrique à la voiture thermique sur le plan des émissions de particules dégagées par l’abrasion des plaquettes sur le disque de frein qui fatalement vont se retrouver dans l’air des chaussées.
Sinon, le frein moteur d’une voiture thermique n’émet pas non plus de particules mais récupère ces particules dans le carter de boite de vitesse au niveau du disque d’embrayage. Parfois aussi dans l’huile de boite donc.
Le gros problème des VE c’est donc l’usure des pneus lorsque la voiture roule. Même en surdimension le taux de particules est proportionel au poids du véhicule à gommes identiques.
#23
Non. Encore une fois tu déformes mes propos. C’est ta grande spécialité de déformer les propos de tes interlocuteurs.
#23.1
Ben j’ai compris pareli que lui, tu es très vindicatif dans tes propos…
Je pense que tous ceux qui prennent la voiture ici sur ce fil le font pour de bonnes raisons, et que les alternatives s’il y en a, ne sont pas viables.
Que ce soit en termes de travail dans le couple dans des directions complètement opposées, ou l’un des 2 très éloigné, ou de garde partagé, avec l’école dans un autre patelin, etc…
Il n’y a pas une seule situation, et dit toi bien que la tienne risque d’être une exception par rapport à la moyenne nationale :)
#23.2
Toi non plus tu ne comprends pas la phrase “si tous ceux qui peuvent le faire…” ?
#24
Oui
Non, c’est bien au-delà. Du genre 300-400000 km à priori (tesla est bien au-delà).
Par contre, en durée de vie, à 6-7 ans on doit sentir la batterie vieillir. Donc sur 15ans, je trouve effectivement que l’ADEME a “oublié” un bon gros changement de batterie (à 3-10k€ selon modèle)
#25
?? Ca sort d’où ça?
Je vois régulièrement des essences qui ont 300-400 000km (205, R5), d’ailleurs elles sont toutes ressorties avec l’augmentation du diesel :)
#26
On peut déménager à vélo, donc je ne vois pas vraiment le problème pour le colis de plusieurs kg.
#27
La mode et le paraître. C’est la seule “utilité” réelle des Sans Utilité Véritable.
M’enfin là la mode commence à changer, ca a tendance à partir sur les SUV coupés. Bientôt le retour des berlines bien moins lourdes et avec des meilleurs Cx/SCx!
#28
Biais du survivant :)
Beaucoup de voitures de l’époque sont parties à la casse ou en pièces détachées depuis longtemps, on ne voit que celles qui ont pu survivre jusqu’ici (une petite portion de ce qui s’est vendu à l’époque. Et comme il s’en est vendu énormément, il en reste toujours un certain nombre roulantes). Il y en a forcément dans le lot où avec une part de chance et d’attention sur le matériel, ca tient plus longtemps.
D’ailleurs, je suis à peu près persuadé qu’on peut trouver qques voitures équipés de moteurs TSI qui ronronnent à la perfection malgré un kilométrage élevé, alors qu’ils sont largement connus et réputés pour être de véritables merdes qui tombent facilement en panne…
#28.1
Je suppose que tu as fais une étude approfondie du parc routier roulant pour nous affirmer cela ?
Les chiffres officiels montrent qu’il y a plus de 13 millions de voitures en France qui ont AU MOINS plus de 11 ans. Cela fait près de 35% du parc roulant.
Sachant qu’en plus les vieilles occasions qui sont difficilement commercialisables en France, partent à l’étranger pour poursuivre leur vie.
Il y a bien des choses à dire sur les voitures sans être obligé de tomber dans les a priori non sourcés.
#28.2
Quelqu’un avait donné une explication en #26: les moteurs essence anciens sont beaucoup plus robustes que les actuels.
Les normes antipollution récentes ont conduit à un “downsizing” des moteurs qui sont désormais chez beaucoup de constructeurs généralistes, y compris pour des “grosses” voitures type SUV, des 1.2 ou 1.3L à 3 cylindres, qui sont fragiles. Il sera probablement être rare de voir une voiture essence des années >2015 dépasser les 200 000 km.
#29
Oui, enfin 205 ou R5, ça fait un peu plus que 11 ans
#30
J’adore les analogies où on compare un pays de la taille d’une de nos régions dont la densité de population est 2 fois supérieure à la France et qui a un PIB par habitant 2 fois supérieur au notre avec la France.
#30.1
Si le pays a la taille d’une région, suffit de répéter autant de fois qu’on a de régions. Et je vois pas le rapport entre le PIB et la capacité de faire du vélo en côte.
Si tu tiens à aller sur ce plan, historiquement, la France a eu un réseau ferré extrêmement plus dense avec une population moindre, du coup bon. L’arrivé du routier (carburant peu cher à l’époque, et financement des routes par l’État) a porté un sérieux coup. Alors on a créé la SNCF. Et ça marchait drôlement bien, même avec un réseau moindre que les années 20.
Depuis environ 30 ans, on démoli la SNCF (la privatisation du fret a été une catastrophe, et séparer les différentes branches a pas fait du bien du non plus), ça aide pas à reprendre le pas sur le routier.
Mais bon, le routier est en train de se vautrer de lui-même. Si on fait un effort sur le ferroviaire, on peut le rendre très largement compétitif (parce qu’ironiquement, il est plus rentable, à condition d’être géré à grande échelle).
#31
MINIMUM 11 ans.
Sachant qu’une voiture roule en moyenne 12 000 km par an en France. Même si tu baisses à 8 000 par an, cela fait au minimum 96 000 km par véhicule.
#32
Et comment tu veux mailler le territoire ?
En étoile avec le passage obligé par une gare centrale pour aller d’un point A à un point B.
Ou en toile d’araignée avec des lignes intercommunales partout ?
La seule qui pourrait concurrencer la voiture est la seconde, mais maintenant il faudra annoncer le cout aux français et le cadencement.
Si tu prends l’exemple du métro: il est massivement utilisé dans les grandes villes car il est maillé en toile d’araignée et très cadencé.
#32.1
Précisément, oui. Tu peux faire des étoiles locales, mais au niveau national il faut que ce soit en toile d’araignée. Et un cadencement élevé (15-30 minutes dans les gares les moins bien desservies je dirais).
Oui, ce sera un gros investissement par contre. Mais pas pire que celui qui a été fait pour les autoroutes à l’époque. Et rentable à long terme (à peu près tout, une fois rapporté par passager (ou tonne en fret) et km parcouru coûte bien moins cher que le transport routier). C’est juste un gros investissement, et un ROI sur des décennies (ce qui fait que c’est pas évident à visualiser, je l’accorde).
Et on n’est pas obligés de faire du 0 routier. Des bus cadencés pourraient être une solution envisageable aussi (une navette pour aller à la gare la plus proche, par exemple. Je connais des bleds où ça s’est fait récemment (mais annulé parce que le billet de train est actuellement bien trop cher)).
#33
Bon sang, le français est une belle langue logique (à l’exception des masculins féminins).

C’est à Vélo parce que vous êtes dessus et non dedans.
#33.1
Sauf les mécanophiles
#34
Toi non plus tu ne comprends pas la phrase “si tous ceux qui peuvent le faire…” ?
#35
Tous les véhicules ne sont pas des Tesla. Il y a eu beaucoup de changement de batterie sur certaines marques comme la Zoé. Certains automobiliste malchanceux ont même eu plusieurs changement de batterie en moins de 10 ans.
Et la prolifération des bornes à recharge rapide, que l’on voit depuis quelques temps maintenant, à tendance également à raccourcir la durée de vie des batteries (vérifiez chez les constructeurs, ils disent bien d’éviter d’utiliser ce genre de borne !).
Le rapport de l’ADEME dit justement que non (et sans prise en compte d’un jeu de batterie supplémentaire). Le rapport dit que cela dépend fortement du type de véhicule (coucou les SUVs)
Qui plus est, cela dépend également de comment est produite l’électricité. En France, où on a beaucoup de nucléaire, c’est souvent rentable. En Pologne, avec le charbon, beaucoup moins…
#36
La “bonne raison” étant souvent le simple dégoût de l’effort (surtout quand on prend la voiture pour faire des trajets qui dépassent rarement les 5km).
SUV est surtout un terme qui a été galvaudé. Les “vrais” SUV, à l’origine ce sont les 4x4 qui peuvent rouler partout et faire du franchissement (style les vieilles Jeep américaines, ou le Land Rover Defender). Puis les marketeux se sont mis à coller ce terme à tout ce qui en approche par l’apparence, mais sans la fonctionnalité qui va avec…
#37
Après, concernant les 205/R5, il a certainement raison quand même. J’ai deux voitures de 13 ans (bientôt 14), elles ne passeront peut-être pas le contrôle technique à cause de la rouille.
Par contre, dire qu’une voiture est morte après 150000 ou 200000km, de mon expérience, ce n’est pas vrai. Pour moi c’est plus l’âge qui pèse que les km.
#38
j’ai du mal à comprendre que personne ne parle de la catastrophe écologique resultant des exploitations des metaux rares nécéssaires aux batteries…. et que surtout ca ne soit pas pris en compte pour la partie “écologique”.
Incompréhensible
#38.1
Parce que c’est en-dehors de la France, donc c’est un problème qui n’existe pas.
#38.4
C’est bien ce qu’il me semblait …
#38.2
S’il n’y avait que les terres rares !
Et si ça ne concernait que les voitures électriques, vu l’électronique des véhicules thermiques.
Et si ça ne concernait que les voitures…
#38.3
Parce que tout ca n’est que fakenews :)
https://vimeo.com/ondemand/acontresensap (payant)
Mais bien résumé dans ce podcast
https://podcasts.audiomeans.fr/les-doigts-dans-la-prise-8ab96bdbc2bc/la-voiture-electrique-polluee-par-l-intox-59964d1495e4
#39
C’est très vague ce que tu dis. Je suis (du verbe suivre) pas mal l’actualité des véhicules électriques depuis plusieurs années, je ne me rappelle pas d’avoir entendu parler d’une quelconque faiblesse généralisée de batteries. Tu as un peu plus de données chiffrées ?
Comme tu le fais remarquer, c’est moins rentable en Pologne (pourtant le pire pays pour le charbon)… mais cela reste rentable.
#40
N’importe quoi, je ne mettrais même pas ma main à couper que Tesla soit dans les plus fiables, au contraire.
Ouais, ils recommandent de ne pas charger que rapidement, mais pas d’éviter ces bornes (et l’expérience montre que les constructeurs sont plutôt conservateurs dans leur discours et leur paramétrage des packs batterie)
Le rapport de l’ADEME (comme à son habitude) dit de la merde en contradiction avec les publications scientifiques.
J’aimerais bien voir la catastrophe autrement que par le prisme anti VE de Guillaume Pitron et Carlos Tavares… Sinon, on peut aussi parler de la catastrophe écologique de l’exploitation des énergies fossiles, qui finissent qui plus est dans l’atmosphère.
Le lithium : sous-produit de l’exploitation du phosphate (pour les engrais)
Le Cobalt : mines à 90% industrielles avec les inconvénients de toute mine (ni plus, ni moins). Les exploitations familiales (les fameuses avec enfants) tendent à disparaître (ben oui, un enfant ça creuse moins vite qu’une excavatrice industrielle et il faut le nourrir).
Le Manganèse : encore un métal, certes en tension, mais extrait comme tout métal.
J’ai l’impression que tu confonds avec l’exploitation des terres rares et leur traitement qui dévastent des régions importantes en Chine.
#41
On voit de tout sur ce sujet. Et comme tu le dis, c’est incompréhensible.
Déjà, je crois qu’il y a plusieurs compositions de batteries. Ensuite, certains parlent de métaux rares et d’autres de terres rares. Et les “terres rares” ne sont ni des terres, ni rares (cf Wikipédia. Donc de quel(s) élément(s) parle-t-on ?
Après, est-ce c’est un problème spécifique à un pays et sa réglementation ?
Et pour terminer, on renvoie souvent à la composition des pots catalytiques, très consommateurs de tels éléments, au point qu’il y a des vagues de vols.
#42
Malheureusement non. Je tiens cela d’une municipalité, qui avait un parc d’une dizaine de voiture électrique (des Zoé justement). Le responsable me disait qu’ils avaient beaucoup de soucis avec. Parfois, on pouvait mettre cela sur le dos d’un problème de fabrication (quand la batterie est changée au bout de 1000km, c’est qu’il y a un problème). Mais parfois non (de manière très aléatoire, les changements avaient lieu souvent entre 3 et 5 ans, pour des km assez éloigné des chiffres que l’on voit aujourd’hui (parfois à 10 000 km, parfois à 50 000). Et d’autres tenaient sans aucun soucis.
C’était certes, il y a quelques années, mais les voitures de ces années là sont encore en circulation. Il serait donc malhonnête de ne pas les prendre en compte.
Ma remarque était ironique. Le “beaucoup moins rentable” il fallait le comprendre comme pas rentable du tout, et même pire. (quoique j’admets que pour la Pologne, je ne sais pas si c’est toujours le cas, comme ils sont aussi en cours de décarbonation, mais il y a quelques années, c’était encore vrai !)
#42.1
Ok, une ancienne expérience pas trop bonne pour cette municipalité et son parc de 10 voitures.
Sur la chaîne YT du réveilleur, dans ce passage, on voit que dans le cas de la Pologne (2x pire que l’Allemagne, x14 pire que la France), les émissions de CO2 sont kifkif avec un véhicule thermique.
Et l’avantage du véhicule électrique dans un pays tel que la Pologne, c’est qu’il suffit que ce pays décarbone un peu son électricité, pour que automatiquement, cela décarbone le parc de VE déjà existant là-bas.
#43
Je prends l’exemple de Tesla :
Je ne lis pas ce que je veux lire donc le rapport de base c’est de la merde ? C’est quoi cette démarche ? Des publications scientifiques, il y en a des 2 côtés, et qui se contredisent. Cela rend justement le travail d’autant plus difficile pour avoir une (bonne) opinion.
Fut un temps, on avait la même chose pour le tabac…
#44
Un bus ne pèse pas 20 tonnes à vide.
Il n’y a pas que les bus, même sur les lignes régulières. Les entreprises ne sont pas stupides. Sur les lignes les plus plus fréquentées (ou aux horaires de pointe) on mettra des bus doubles articulés, des simples, voire des minibus ailleurs.
S’il y a 3 personnes dans un bus ce n’est qu’à un instant T, ça ne correspond pas au nombre de personnes transportées sur la ligne.
Dans la MEL, il y a même des lignes où des véhicules ne circulent que sur demande.
#44.1
Ma source sur cette affirmation - j’admets n’avoir par regardé plus loin, d’autres sites parlent de 10t à vide. Erreur de ma part qui n’invalide pas l’ensemble de la remarque non plus. Changer de type de bus sur une seule ligne, ça se fait parfois mais en tant qu’usager je ne l’ai pas vu souvent, pourtant j’ai pris le bus régulièrement pendant quelques années - certains étaient bien bondés, d’autres sur la même ligne bien vides, en fonction de l’heure.
Et ça veut dire avoir une flotte de véhicules conséquente pour pouvoir l’adapter directement à l’occupation de la ligne. Ça serait peut-être une bonne idée. Certaines villes le font peut-être. Mais il y a du boulot pour généraliser !
Tu as raison sur le “jamais”, il était de trop. J’aurais du préciser : “dans la situation qui prévalait au moment de la vidéo” - qui a déjà quelques années.
Je souscris aussi à ce que dit Renault dans le commentaire suivant : le mix électrique peut changer. Bémol : si la Pologne a effectivement une belle marge de progression, dans le cas de la France, l’ajout forcé de sources non pilotables fait qu’en termes d’émissions de CO2 on ne va pas aller dans le bon sens, malheureusement. Quant à l’Allemagne, la seule solution serait de remplacer le charbon par du gaz… Ils ont essayé, ils se sont pris un mur géopolitique… Parce-que niveau vent ils sont loin d’être mauvais, mais quand ça ne souffle pas…
#45
J’ai la même source que toi. J’y vois du positif. Dans un des pires pays (2x que l’Allemagne et 14x plus que la France), le VE est égal à la voiture thermique pour les émissions de CO2 à l’utilisation. Dans les autres pays, c’est très largement rentable.
Et je serais moins affirmatif sur “jamais rentable” car les émissions de CO2 d’une ZOE peuvent baisser dans les prochaines années en cas d’évolution du mix de la Pologne. Alors que c’est figé pour la voiture thermique.
#46
Attention à ne pas oublier une chose importante dans l’électrification.
Une voiture que tu achètes va vivre 10-15 ans au minimum. Probablement plus.
Dans sa vie, son mode de propulsion ne sera probablement jamais changé. Ta voiture à essence roulera à l’essence, ta voiture électrique à l’électricité, etc. Les cas de reconversion existent mais sont relativement marginaux.
Notons que ce qui va suivre est similaire à la production de chaleur entre une chaudière à mazout, gaz d’un côté et les pompes à chaleur ou les réseaux de chaleur d’autre part.
Du coup quand tu achètes ta voiture thermique, pendant ces 10-15 ans, ses émissions de CO2 pour la consommation d’essence ne bougera presque pas. Sauf bon technologique qui permet de produire de l’essence à l’échelle industrielle à partir de rien (ce qui est très peu probable).
Pour l’électrique, c’est très différent. En 10-15 ans on l’a vu en Europe, les émissions de CO2 du kWh électrique baissent de manière régulière et progressive et cela va continuer. Car pendant ce temps on installe des éoliennes, panneaux solaires voire centrales nucléaires ou hydrauliques en fermant des centrales à charbon. Pour la voiture c’est transparent, et cela se fait au fur et à mesure de sa vie.
Donc si par exemple les émissions de CO2 de la Pologne en 2022 sont trop élevées pour compenser, cela ne sera sans doute plus vrai en 2030 ou au delà, or une voiture de 2022 roulera probablement à cette échéance encore.
C’est l’avantage du réseau électrique, sa production à l’échelle du continent ce sont des centaines de milliers de centrales seulement (principalement à cause des éoliennes et panneaux solaires d’ailleurs). Contre des centaines de millions de moteurs pour les voitures. Il est bien plus simple de moderniser progressivement le réseau électrique pour qu’il pollue moins et que de fait les voitures polluent moins que de remotoriser des millions de voitures en circulation le jour où la bascule est écologiquement la plus pertinente.
Les voitures thermiques émettrons peu ou prou la même quantité de CO2 pour faire un kilomètre durant toute sa vie, pour une voiture électrique dans la plupart des pays du monde cela sera probablement décroissant à court et moyen terme.
#47
1- C’est un peu plus complexe que cela car la France n’est pas une simple juxtaposition de régions concernant les déplacements. Sinon la notion de pays ne servirait à rien.
Tu peux être amené à te déplacer d’un bout à l’autre de ton pays pour des raisons personnelles et/ou professionnelles.
Et la densité de population joue aussi beaucoup: plus la densité de population est importante et moins l’accès au service est dispersé et éloigné par exemple.
2- Le PIB ne joue pas par rapport au vélo mais par rapport à la capacité de faire des investissements et à maintenir des lignes à perte par exemple.
#47.1
Tu peux aussi être amené à voyager hors du pays… et les trajets longue distance sont normalement plus rares (sinon c’est un autre problème), et passer par un hub est moins gênant dans ce cas.
Mais clairement, la taille du pays ne pose pas vraiment de problème, la densité non plus, en pratique. Non que ça ne pose aucun problème, mais ça n’empêche absolument pas de faire un réseau ferré digne de ce nom.
Pour la rentabilité, comme indiqué plusieurs fois, on gagnera à long terme de toute façon à repasser au train (qui fait des économies d’échelle sur le matériel roulant, et parce que le chemin de fer, même avec caténaires, s’use bien moins qu’un pneu n’use le bitume, particulièrement pour le fret). Le fait d’avoir un PIB plus faible devrait justement être un argument pour passer au ferroviaire massivement…
J’admets ne pas avoir les chiffres en France aujourd’hui, faudrait que je trouve ça, mais de façon générale les gens sous-estiment massivement le coût de l’infrastructure routière (du moins en Amérique du nord, mais je vois pas pourquoi ce serait différent en Europe, ça reste la principale raison d’utiliser des camions plutôt que des trains…).
#47.2
D’ailleurs, si on veut comparer plus « proprement », la Suisse a plus de rails au km² et par habitant.
Les Pays-Bas en ont plus par km² mais moins par habitant, là la densité joue probablement plus déjà.
#48
La France fait figure d’exception dans le sens où temporairement cela peut monter, mais à terme cela devrait être plus bas quand même en réduisant l’usage du gaz fossile et du charbon à moins d’heures par an qu’aujou’d’hui. Voir les scénarios de RTE pour 2050.
Mais l’électricité en France étant décarbonée, le gain est réel dès aujourd’hui, la France n’est pas tellement dans mon viseur aujourd’hui.
On peut critiquer l’Allemagne et dire qu’en gardant le nucléaire plutôt que le charbon ça serait descendu plus vite pour moins cher. Mais malgré tout, l’électricité allemande est aujourd’hui moins polluante qu’il y a 10 ou 15 ans. Et dans 10 ou 15 ans ce sera aussi vrai par rapport à aujourd’hui.
Le problème actuel vis à vis du gaz sera un problème de court terme. Or ici on parle d’horizons bien plus longs.
#48.1
On ne peut déscendre en dessous de 50g EQ CO2 par kwh (physique de base).
Donc plus il y a de fous (de la roue) moins il y a de riz.
#49
Mais comme on ne fait qu’en parler, et ce depuis des décennies, ce sera trop tard.
#49.1
De quoi tu parles précisément ?
La transition du système électrique européen et donc allemand est bien en marche. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas l’observer. C’est peut être un peu trop lent et insuffisant vis à vis des objectifs climatiques de 2050, mais le soucis n’est pas tellement la transition du système électrique mais les autres domaines qui bougent peu (dont la mobilité) et la baisse de consommation d’énergie qui est trop faible de manière globale. Mais ce n’est pas tellement le sujet dont on parle ici en commentaire.
#49.2
On est d’accord, c’est bien trop lent, ça fait des décennies qu’on procrastine.
Et le changement du mode de propulsion des voitures, c’est plutôt contre-productif vu comme c’est fait. Forcer à mettre à la casse des véhicules tout à fait fonctionnels en forçant à produire massivement des véhicules plus lourds est un non-sens. Au passage, on subventionne massivement l’industrie chinoise à grands coups de primes.
#50
Et pourquoi on ne pourrait pas ? Tu as lu les rapports de RTE ?
Si tu baisses l’usage du thermique au strict minimum, tu peux envisager l’emploi du biogaz par exemple pour combler les pointes ou manquent temporaire de vent et d’ensoleillement. Ce qui émet beaucoup moins que du gaz fossile et participe de fait à baisser les émissions de la France même dans la situation actuelle car on supprimerait le peu de gaz et de charbon fossile qu’on emploie à ce jour.
#51
Les véhicules réellement familiaux sont exclus de l’étude…
J’entends familiaux par embarquant au moins quatre personnes de plus de 1m80 (pas des nains les mômes) et une mâle d’au moins 500 litres et pour être sérieux une autonomie de 500 km pour de la routes classiques (90 / 110 km/h) et 20% d’autoroute.
Et comme l’Étude prévoit une utilisation sur 15 ans ON doit pouvoir (rêver) espérer avoir un crédit sur 10 ans ????
PS: Crédit à 0.00% Garanti par l’État (par les braves contribuables).
#52
Le gaz issu de la méthanisation c’est bien mais sur le papier. Dans la réalité, il y a tellement de fuites de méthane dans les installations que c’est pire que le CO2 du gaz fossile “économisé”.
Par ailleurs, et particulièrement en Allemagne, on autorise à mettre des céréales dans ces méthaniseurs (jusqu’à 50% en Allemagne). Bref, on utilise des surfaces agricoles (en Allemagne on en crée de nouvelles monocultures à des endroits où il y avait des prairies, des zones humides…), ou on utilise des denrées alimentaires pour de l’énergie. Tout aussi stupide que l’éthanol ou le “bio”diesel.
#53
Pour le coup, la conversion du véhicule (thermique > électrique / hydrogène) aurait du sens, non ?
#54
Je ne pense pas.
Le gain de l’électrique est intéressant sur plusieurs aspects
On l’oublie un peu mais en 2035 il est très très probable que l’accès au pétrole pour satisfaire nos besoins sera plus difficile qu’aujourd’hui (on arrive peu ou prou à augmenter la production pour suivre la demande, cela ne durera pas éternellement). Donc faire en sorte que notre économie et nos déplacements soient moins sensibles aux variations de production de pétrole comme on a pu le subir cette année est une bonne chose. Cela aurait dû être fait dans les années 70 mais bon.
De plus, beaucoup de voitures sont renouvelées naturellement, on a pas attendu les voitures électriques pour mettre à la casse des voiture techniquement exploitables, ou pour acheter une neuve alors que l’ancienne roule encore bien. Étant donné le gain, cela ne me choque pas qu’on le fasse en partie en marche forcée. Car la plupart des voitures qui roulent aujourd’hui en thermique ne seront pas sur les routes européennes d’ici 2035 de toute façon, normes ou pas.
#55
Le dernier paragraphe mériterait à lui seul un article.
De fait, il est illusoire de penser qu’on pourrait remplacer toutes les voitures thermiques par des électriques, même en prenant les plus petits modèles (type Zoe), le réseau électrique actuel ne tiendrait pas.
La seule solution c’est effectivement de réduire notre dépendance à la voiture partout où c’est possible dans un premier temps.
J’ai 50 ans, et pourtant j’ai connu une époque où les élèves des communes alentours n’étaient pas amenés en voiture dans les écoles, collèges et lycées, il y avait des abris à vélo et des lignes de bus scolaires, on pouvait faire nos courses ailleurs que dans des zones commerciales lointaines, et on pouvait marcher sur les trottoirs qui sont désormais inaccessibles aux poussettes, fauteuils et parfois piétons car dans chaque foyer dans ma ville de 4000 âmes il y a quasiment autant de voitures que d’habitants.
Et j’habite dans une zone assez dense, une population pauvre, le bassin minier, où il n’y a aucune excuse pour ne pas développer d’avantage les mobilités actives, au plus grand bénéfice des bourses et de la santé de chacun.
#56
Hummer EV : 9,063 lbs, soit 4 tonnes, à vide, 900Kgs de barrerie Les USA n’ont pas les mêmes valeurs
Les USA n’ont pas les mêmes valeurs 
#57
Certainement, mais ça ne semble pas intéresser le politique, il suffit de voir les difficultés d’homologation des kits et des véhicules rétrofités.
#58
Pas du tout.
Il faudrait en tout cas une démonstration plus sérieuse car l’état de l’art sur la décarbonations de l’économie se base sur ces techniques (car de toute façon les déchets non traités par exemple génèrent du méthane, autant s’en servir).
Évidemment le biogaz dont on parle ici n’est pas issue majoritairement de culture comme en Allemagne (ce qui est effectivement aberrant). En France c’est interdit d’avoir plus de 15% issus de culture dédiés de mémoire.
On parle évidemment du gisement basé sur des déchets agricoles, déchets alimentaires (tri sélectif des déchets organiques généralisé en 2025 en UE et en France), boues des stations d’épuration, etc. Qui dans ce cas là a évidemment un bilan bien plus faible que le fossile même en tenant compte des fuites.
Car de toute façon le gisement du biogaz est plus faible que celui du gaz fossile telle que consommée dans l’UE aujourd’hui, donc faudra consommer moins de gaz en 2050 même s’il est bio.
#59
Ah, ça, on en a fait des âneries pour subventionner l’industrie automobile sans le dire. Ces dernières 30 années: Balladurette, Jupette, prime au diesel puis vignette Crit’Air pour pénaliser le diesel…
Si tout ce pognon était allé au déploiement d’autres solutions de mobilité, on ne serait pas à se demander quand (et pas si) les gilets jaunes vont remettre leur chasuble.
#60
C’est quand même bien positif au final cette étude : vu le graphe, même un gros SUV avec sa grosse batterie finit par avoir un meilleur bilan carbone qu’une compacte thermique… donc ca met + ou - de temps, mais on finit toujours par rentabiliser (carboniquement parlant, si je puis dire..) l’option électrique.
Après oui, bon, on comprend que plus la voiture est légère moins elle consomme de matière première pour sa construction, et d’énergie pour se déplacer, certes… certes… en même temps on s’y attendait un peu non ??
A propos de “gros SUV” sur lesquels il est à la mode de taper un peu partout: Il faudrait mettre un peu à jour les clichés : en France, la plupart du temps, un “SUV”, c’est pas un Q7 ou un Ford Ranger de 2t3, c’est plutôt un Duster, un 3008⁄5008 ou autre Captur / Kadjar et ça a remplacé les Scénics et autre Kangoo pour faire “voiture familiale”. Regarder les specifs : un Duster ça fait 1t3 et ca bouffe 5.5l/100.. Bref, ce n’est rien d’extravaguant par rapport aux berlines ou monospaces “classique” - pour mémoire un Scénic en 2022 c’est 1t42 à 1t53, pour 6.3l/100 et 143 g de CO²
Tout ca pour dire que passer son temps à taper sur les SUV (alors qu’on arrive déjà pas à définir clairement ce qu’est un SUV) ça laisse penser que le problème c’est les SUV.
Alors que non, le problème, c’est la bagnole (alimentée aux énergie fossiles). Que ce soit un SUV, un coupé sport ou un monospace ne change strictement rien au probleme. Et dans un second temps, l’autre probleme c’est sans doute l’usage de la bagnole, tout court…. mais c’est un autre sujet.
#61
Toi, tu devrais te renseigner un peu. Et il se trouve que l’entreprise qui est le plus régulièrement mise en défaut lors de contrôle est Enedis.
4%. Il suffit que 4% du méthane produit parte dans l’atmosphère pour que tout le gain soit perdu.
15% c’est déjà 15% de trop. On produit artificiellement des déchets pour les recycler, c’est d’une stupidité sans non. Ce sont tous les gens qui vont crever de faim faute d’accès aux céréales russes et ukrainiennes qui vont être contents de savoir qu’on fabrique de l’électricité avec.
Pas si les fuites sont supérieures à 4%.
J’avais vu un reportage sur Arte où elles étaient estimées par les organismes officiels chargés de contrôles à 6 à 8%
Et c’est certainement pas la voie qu’on est en train d’emprunter.
#62
La conjugaison facile…
#62.1
C’est à peu près cela. Ajoute que tu as changé deux fois de voitures pour rien - sauf pour les profits des constructeurs. Et que ça fait deux voitures construites de plus alors que la première aurait fait le taf. Et que tes deux nouvelles voitures ont une durée de vie très incertaine.
Il faudrait des voitures hybrides très légères, moins de 900 kg, avec une petite batterie permettant de faire 60 km en parcours urbain. On saurait les construire, mais les constructeurs produisent des tanks suréquipés dont le trois cylindres turbo et la batterie ne dureront guère.
Fou de voir l’engouement pour Tesla ! Elon Musk a juste produit un nouveau type de véhicules de luxe, peu fiable au demeurant, et non généralisable. Car où se procurer les métaux rares nécessaires à leur construction et où les recharger ensuite si on les multipliait ?
#63
Quel est le rapport entre Enedis (distributeur d’électricité) et la méthanisation (production d’énergie)
#63.1
Enedis est un des plus gros propriétaire d’installations de méthanisation d’Europe.
#63.2
Tu as une source ? Enedis n’a pas vocation à produire de l’énergie, c’est interdit par la CRE
#63.3
Arf, au temps pour moi, j’ai confondu avec Engie.
#64
Sauf que le gaz soit produit par biométhanisation ou par voie fossile, les infra sont les mêmes après production (et des fuites dans les puits de gaz fossile et de pétrole, ça ne manque pas). D’autant plus que les déchets non méthanisés produisent du méthane qui n’est pas valorisé.
Donc ça ne peut pas être pire que le gaz actuellement consommé. Et réduire ces fuites on sait faire.
Bref, je ne vois pas en quoi l’argument est pertinent.
Je ne dis pas que c’est bien, mais cela n’est pas sans raison, c’est pour aussi donner un départ histoire d’avoir une variété et une stabilité de production pour rentabiliser et mettre en place la filière.
C’est voué à disparaître, notamment grâce à l’apport des déchets organiques.
Je ne dis pas que c’est parfait, car rien ne l’est, mais aucun scénario de décarbonation ne se passe de ces techniques, et c’est pour de bonnes raisons. Il faudra aussi que l’UE interdise la biométhanisation à base de culture dédiée comme elle ‘la progressivement fait pour le biocarburant.
#65
Seuls ceux qui fermentent, donc en anaérobie.
Il y a bien d’autres façons de valoriser les déchets agricoles sous forme de fertilisants, ça évite d’utiliser des engrais d’origine pétrole.
Le tout sans artificialiser encore des sols pour produire des céréales juste pour les méthaniser.
C’est tellement voué à disparaître que la part autorisée est en constante augmentation.
Résultat, pour faire du biodiesel, Total importe de l’huile de palme, c’est les orangs-outangs qui sont contents.
Tout ce green washing n’est que prétexte à ne pas traiter le sujet sérieusement. C’est du même niveau que “l’objectif de neutralité carbone” de nombreux industriels. Un prétexte pour ne rien faire aujourd’hui (voir émettre plus), puisqu’on a un objectif à 30 ans (objectif totalement irréaliste au passage).
#66
Tu caricatures pas mal.
Reprenons, en biométhanisant tu récupères le méthane de la décomposition pour faire de l’énergie et la matière sèche peut servir (selon les cas, pour les boues des stations d’épuration c’est plus difficile) à fertiliser les sols. Les agriculteurs qui biométhanisent leurs déchets agricoles achètent peu ou plus d’engrais pour leur culture et produisent de l’énergie pour leur installation voire aux alentours.
Donc oui tu peux faire d’une pierre deux coups.
Et c’est pareil pour des déchets qui actuellement finissent en déchargent et qui pourraient être biométhanisés…
Pas du tout, du moins pas en France et cela discute beaucoup à l’échelle de l’UE comme pour le biocarburant à l’époque.
Lis par exemple ce rapport du Sénat :https://www.senat.fr/rap/r20-872/r20-872_mono.html#toc273
On autorise 15% de culture dédiée et pour l’instant on en est à 5% en France. Car en fait économiquement c’est peu pertinent les cultures dédiées, le gaz revendu est trop peu cher pour cela. En fait c’est surtout utile pour gérer les invendus (trop grande quantité, trop d’éléments difficiles à vendre car ne répondant pas aux cahiers de charge car trop petits, pourris, etc.).
Sauf que cela n’a rien à voir, les filières ne sont absolument pas les mêmes… J’ai vraiment l’impression que tu t’arrêtes sur la biométhanisation des années 2000 où c’était le début avec de nombreuses erreurs. Et donc comment c’est géré en Allemagne, mais personne ne présente le modèle allemand comme la voie à suivre dans les scénarios de transition.
Je ne vois pas le rapport, tout ceci est soutenu par l’ensemble des acteurs qui plaident pour une baisse de consommation d’énergie (et de gaz) et un changement de mode de vie. Mais bon, continue ton homme de paille…
#67
L’ancien véhicule est revendu d’occasion et utilisé jusqu’à la fin de sa durée de vie utile. Au final le parc de voiture est converti progressivement à l’électrique et il n’y a pas de gachi.
Par ailleurs, les véhicules électriques ont une durée de vie supérieure aux thermiques, et nécéssitent beaucoup moins d’entretient, ayant très peu de pièces mobiles en comparaison des thermiques.
Posséder un véhicule électrique est rentable rapidement (quelques années) si on considère les économies sur le carburant et le gain sur l’entretient et la fiabilité.
Les hybrides sont moins efficaces et plus complexes que les électiques, et sont le plus souvent propuslées principalement en brulant de l’essence. Les hybrides ne règlent pas le problème de fond des emissions de CO2.
Les problèmes d’accès aux métaux rares existent, mais sont largement exagérés et l’empèchent pas le développment des VE.
Il est clair qu’il faudra déployer des infrastructures de recharge et de production d’électricité pour les VE à toutes les échelles. On l’a bien fait pour les voitures thermiques, on le fera pour les VE.
#68
Ca dépend de l’installation en fait. Dans le cas de ma copro, on passe par un opérateur qui a tiré la ligne dédiée, installé le compteur, et pose les bornes au fur et à mesure des nouveaux clients. Après toutes les déductions d’aides et crédits d’impôts, ma borne a coûté quelques 300€. Et l’offre dont je dispose est à forfait à 30€/mois pour 2MW de quota… Sachant que j’ai un véhicule électrique qui a une autonomie de 450km (mon véhicule précédent en essence était à 500, donc la différence est nulle pour ainsi dire - toutes deux des berlines compactes), je ne recharge qu’une fois par semaine et je peux aussi charger au taff, toutes les places ont des prises (vive les bâtiments récents).
Après, une borne plus puissante coûte plus chère, mais le forfait reste de l’ordre de 50 à 60€/mois, ce qui est très loin des tarifs d’une charge rapide sur autoroute. Je n’ai pas encore pratiqué, mais les estimations que je voyais me donnaient une idée de 50/60€ pour ma voiture en une vingtaine de minutes. Ca revient au prix du plein de SP95 que je faisais dans ma précédente avant que les prix ne s’envolent.
Le calcul est à faire pour chaque profil au final, et il varie selon le type de véhicule, et la vitesse à laquelle on peut pouvoir le recharger. Dans mon cas, je suis clairement gagnant par rapport à l’essence pour lequel j’étais à quelques 160€/mois.
Pour les copropriétés, cela dépend des programmes mais certaines résidences un peu plus haut de gamme proposent des box plutôt que des places de parking. Ces box sont généralement équipés d’une prise électrique, ce qui permet d’éviter de passer par la case borne de recharge (sauf si on veut plus de patate que le courant domestique).
#68.1
Cela dépend surtout du contrat :
D’où que ne souhaitant pas créer de concurrence déloyale entre automobilistes le marché des “pertes thermiques” prend de l’ampleur… en un mot c’est du vol sans conséquence.
#68.2
Je me réponds à moi même :)
Je suppose que tu parlais de 2MWh lissé sur l’année.
Sur la base d’un plein à 50 kWh ça fait un peu plus de 3 “pleins” par mois pour 30 €.
Pour que ça soit rentable il faudrait rouler 1000 km/mois pour consommer autant en ne rechargeant que chez toi.
#68.3
En fait j’ai eu un doute et depuis c’est passé à 25€/mois (et rien le premier en fait, comme y’a eu des défauts d’installation j’ai râlé et ai eu un mois offert). Comme d’autres personnes ont souscrit depuis on bénéficie d’une remise.
J’ai encore assez peu de recul puisque la bascule est récente (fin aout), mais si je me base sur un constat simple qui est le prix “à la pompe”, je suis passé de 180 à 25€/mois. Et le gain n’est pas que financier, c’est aussi beaucoup plus confortable, reposant, et très fun à conduire (j’aime les voitures joueuses). Et en cette période, c’est aussi un véritable soulagement.
Bref, perso j’estime avoir gagné au change pour un montant en LOA identique à mon précédent véhicule (car dans la même gamme). Assurément je regrette la précédente qui avait un plaisir de conduite d’enfer, mais je ne regrette aucunement le choix d’être passé à l’électrique qui offre une expérience différente et tout aussi fun.
Oui, je suis un monstre qui a encore l’automobile plaisir, et n’ai absolument aucune considération pour l’avis d’autrui à mon sujet
#68.4
180 €/mois, à première vue tu fais plus de 1000 km/mois (estimation sur la base de 10l/100 km 1,8€ l)
Avec ma Yaris Hybride je suis plus proche de 50€/mois (mais je roule moins que toi et sans doute plus pépère).
Pour m’éclater j’ai le scooter (2l/100 km)
#68.5
Tu fais une estimation plutôt bonne, ma conso moyenne était dans les 13L/100 du fait de la ville et des bouchons lillois du matin. La différence par contre est que je suis sur un gabarit différent d’une Yaris, je préfère les berlines compactes tendance sportives. Mais un moteur puissant ne consomme pas plus pour autant vu qu’avec son accélération plus rapide on atteint rapidement la limite de la voie. J’avais déjà une assez bonne éco-conduite sur du thermique, déjà proche de la conduite d’une électrique (un collègue qui avait une Tesla depuis une paire d’années me l’avait fait remarqué).
Après dans les à côté, il y a aussi les frais de révision qui diminuent drastiquement. Sur mon précédent véhicule, j’étais à une par an ou 10 000km. Donc une par an dans tous les cas pour un montant moyen de 250€
Là, je suis censé n’en avoir qu’une sur les 3 ans du contrat de LOA et l’estimation qui m’a été donnée était dans la fourchette 200/250€ aussi (je sais pas ce qu’ils font pour ce prix sur une caisse électrique, mais bon, faut bien qu’ils vivent du service… et passer à une seule sur la durée de possession est une bonne compensation).
Et vu qu’elle a un défaut de jeunesse qui doit passer en SAV, je vais en profiter et faire mon chieur histoire de demander une petite compensation du désagrément.
#69
Aucun calcul d’équivalent CO2 n’est valide sans compter nos morts.
RTE comme de nombreuses entreprises a démontré qu’elle ne connaissait strictement rien à la mécanique quantique et occupe une place entre parrain et caïd d’un point de vue véracité des données.
Bref : je ne me baserais pas trop sur leurs rapports vue l’ampleur floue que peut avoir une ambition nationale.
Pour le coup, EDF ou Engie sont plus près de la vérité que leur livreur.
Par application de la photosynthèse l’EQ CO2 du biogaz est catastrophique.
D’où l’intéret de compter séparément kW.h et colombs au carré… un peu comme les mensonges au sujet du nucléaire dont la masse du combustible arrange bien lorsqu’on présente les choses sous des “rapports” permettanr de nier l’intérêt d’un autre métal plus honnête (et donc impoli comme l’est le lithium) une fois intégré au calcul d’empreinte.
#70
Mais qu’est-ce que tu racontes ?
Je ne vois pas le rapport avec la mécanique quantique ici… Le rapport est plutôt sérieux et sourcé à défaut d’être parfait. Mais bon, c’est plus facile de taper sur le nom plutôt que de développer des arguments solides…
Mais puisqu’on parle de déchets et non de cultures dédiées, où est l’importance de la photosynthèse ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, je n’ai sans doute pas assez d’atomes intriqués pour te comprendre.
#71
Application basique du principe de la symétrie bi-latérale à nos émission reconnues “anthropiques”.
Si nous étions des étoiles de mer à 5 bras alors on s’attendrait à un autre résultat prédictible…
Aucun verbe au futur n’est parfait, par définition.
Avec tout le pétrole déjà vaporisé dans l’armosphère tu nous proposes donc de recommencer le 20ème siècle.
Logique shadok donc : on repompe.
Je dis simplement que tout est relatif. Ce qu’on veut faire ne recouvre certainement pas les désirs falsifiés de quelques “technos” évoluant dans des systèmes décisionnels à la limite du naufrage permanent par manque de sagesse.
#72
Je ne suis pas d’accord. Ma Mégane limited neuve payée 16000€ correctement équipée il y a 8 ans. Aujourd’hui une Mégane etech correctement équipé, c’est 40k€ incluant le bonus de l’état.
120000 bornes à 5.5L/100 de moyenne, ça fait 6600L => ~10000€ de carburant + 1000€ de distri. Je tiens pas compte des 200~250€ par an d’entretien car c’est kifkif sur toutes les EV en dehors des Tesla qui n’oblige pas les RdV d’entretien.
27k€ tout compris contre 40k€ sans compter l’élec.
Je veux bien que l’essence coûte cher, pollue, etc… mais la voiture EV, c’est reste encore un luxe que tout le monde ne peut pas s’offrir. A cela, il faut ajouter l’autonomie, 1200 km sur la thermique, 400 sur la EV, voire 200~250km sur autoroute, de quoi perdre 2j de vacances rien que pour s’y rendre.
Alors pour préciser, je ne suis pas pro thermique, anti EV. Ma prochaine voiture (la citadine) sera electrique, car j’ai les moyens et c’est parfaitement adapté à une utilisation en ville, mais encore une fois, c’est un luxe.
#73
Ok, tu utilises des mots savants pour finalement dire des propos creux et sans intérêts.
Bah, non.
L’agriculture, notre consommation et nos stations d’épuration génèrent par définition des déchets. C’est inévitable. Quoique tu fasses pour les limiter il y en aura toujours.
Le biogaz c’est une forme de valorisation de ceux-ci. C’est tout, et comme je l’ai dit, le gisement maximum est en entre 33 et 66% de la consommation de gaz actuelle dans l’UE). Donc clairement le but n’est pas de dire on fait comme avant sans réfléchir. Le but est d’avoir un maximum d’options pour rendre le futur le plus agréable et soutenable possible.
Mais bon, je suis ravis de voir ici qu’on prend le GIEC (parmi d’autres) comme des grands pourvoyeurs de green washing et de volonté de continuer comme si de rien n’était.
Lisez un peu c’est un peu plus sourcé et intéressant : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf
Sections 6.4.2.6 pour la bioénergie et 6.4.2.10 pour la génération à partir de déchets (ce dont je parle).
Je cite:
“Anaerobic digestion technology has a positive environmental impact and the ability to reduce GHG emissions (Ayodele et al. 2018; Cudjoe et al.6
2020). The by-product of the anaerobic digestion process could be used as a nutrient-rich fertilizer for enhancing soil richness for agricultural purposes (Wainaina et al. 2020).”
Ce qui n’est pas vraiment mon cas, ce serait bien que tu sortes de vrais arguments.
#74
Il faut prendre le coût global… Tu parles de subventions , aides & tout : Ce sont des coûts que tu as payé quand même, sur une fiche d’impôt et en TVA à chaque caddie, c’est tout. C’est juste dilué.
#74.1
Je fais un retour d’expérience, pas une analyse financière. Et vu ce que je paye en impôts versus ce que je récupère, oui, je suis conscient de tout ça, t’inquiète.
#75
Pourquoi tu devrais avoir forcément une Mégane ?
Il y a des concurrents moins chers qui arrivent, et des modèles plus bas de gamme comme chez Dacia.
Alors oui, ça peut être plus petit, moins équipé mais ça reste plus abordable. A un moment il faudra faire des choix, faudra sans doute renoncer à bien des choses pour la planète.
Et le marché de l’occasion va se développer, le thermique repose beaucoup sur ce marché aussi, beaucoup ne veulent pas et ne peuvent pas se payer leur voiture neuve quelque soit le mode de propulsion. Il ne faut pas oublier ce détail.
On peut se poser la question de faire des trajets de grande vacances en voiture. Certains pourraient envisager le train, ou d’aller moins loin.
Ensuite, on peut aussi voir qu’avec la recharge rapide, en 30 minutes toutes les deux heures (on doit faire une pause toutes les deux heures, je le rappelle) et tu repars. Tu perds un peu de temps, mais de là à doubler le temps de trajet il ne faut pas exagérer…
Et dimensionner sa voiture de quotidien pour des trajets que tu fais 2 fois par an, c’est un choix qui coûte cher, pour les thermiques aussi.
Je ne trouve pas que les électriques soient un si grand luxe. Les modèles plus abordables existent. Alors oui, il faut faire des compromis notamment sur l’autonomie. Mais bon on parle de crise énergétique et climatique qui nous pendent au nez d’ici 2050, faut savoir mettre en perspective la nécessité de certaines choses. Dont l’autonomie à 1000 km, le 1 000 km à 50-60€, les vacances à l’autre bout du pays en voiture, tous les équipements, etc.
Bref, faudra renoncer de toute façon tôt ou tard.
#76
Par exemple, un peu de tout ici (incluant des publis scientifiques) :
https://www.lereveilleur.com/la-voiture-electrique-est-elle-ecologique/
https://www.lereveilleur.com/voiture-electrique-un-probleme-de-batterie/
Le Réveilleur est une source fiable, il fait de l’état de l’art et essaie de faire une synthèse crédible et compréhensible.
#76.1
sympa, je te demande des sources et tu me renvoie vers des sources que j’ai déjà données plus haut, en fait précisément dans le post auquel tu réponds.
Et clairement, je ne vois pas en quoi ce qui est dans le rapport de l’ADEME est en contradiction avec ce que dit le Réveilleur, l’allure des courbes est sensiblement la même, dans son analyse de la VE il se contente d’un seul modèle alors que l’ADEME parle de plusieurs profils différents mais sinon, je ne vois pas. D’autant plus que la vidéo du Réveilleur sur le sujet commence à dater un peu, la situation a un peu évolué depuis - même si ce n’est pas énorme.
#77
Aujourd’hui, ta megane neuve vaut 30750€. Donc la version E-Tech est loin d’être inintéressante.
1200 km sur une thermique, c’est clairement pas chez tout le monde. Tu as un réservoir de 70L ?
#78
Je prend la Mégane, car c’est la voiture que j’ai et dont l’équivalent existe aussi en VE, histoire de comparer des voitures de taille/gamme équivalente.
Je suis d’accord, mais c’est pas le débat ici. La news parle de thermique vs VE. En attendant que les alternatives de transports existent, il faut bien aller au supermarché ou bosser en bagnole, faute de TC.
Argument en faveur du thermique. Tu trouves des véhicules correct à 7000/8000€ en thermique d’occasion, alors que l’offre est très pauvre / très cher en VE.
Pour ma part, et comme beaucoup, les voyages de vacances, c’est souvent 4 personnes. Donc les places sont rentabilisé, et c’est 2 fois par an. Je suis clairement pas sure que ce soit ce genre de trajet qui pollue le plus quand on le ramène à l’individue sur le nombre de trajet.
Je vais me faire l’avocat du diable en faveur du thermique (que je ne suis pas, j’essaye juste d’être objectif). Avec ma femme, on se relai, donc pas besoin de pause toutes les deux heures. Et personnellement, ça me dérange pas de conduire de 8h à midi d’une traite après une bonne nuit. Et quand on fait la pause, c’est nous qui décidons, pas les bornes. Typiquement si les gamins dorment, on préfère s’arrêter plus tard.
De plus tu parlais de voiture moins cher, donc avec petite batterie, soit une pause toutes les heures… Bref, non clairement, rouler en VE, il faut avoir un gros portefeuille.
Je reprend l’exemple de la Mégane, voiture moyenne, 4 vraies place, qui permet de partir en vacance, aller bosser, faire les courses, ramener du volumineux de Casto ou Ikea, à 5,5L/100, voire 5L/100 avec des pneus éco-machin. Je suis pas sure qu’une citadine thermique consomme vraiment moins.
C’est toujours pas le débat, mais je suis d’accord avec ta conclusion. Le fait est que les alternatives arrivent progressivement, donc vouloir dès aujourd’hui, en 2022, vivre comme on vivra en 2050 alors que rien n’est encore adapté (transport alternatif et réseau électrique), c’est se faire des noeuds au cerveau. Ma prochaine voiture sera un VE, quand la thermique aura fait son temps, et la VE sera probablement morte avant 2050 elle aussi… On parle aujourd’hui de coupure de délestage électrique lors des pics d’hiver, alors imagine si chacun chargeait sa voiture à 6kVa…
On voit comment 2050 sera fait, durant les 25 prochaines année, les gens vont favorisé les habitations proche des commerces, vont renouveler leur véhicule en VE, le réseau électrique va être renforcé, et on va se passer de plus en plus des futilités et faire une croix sur les vacances au sport d’hiver (toute façon, il n’y aura plus de neige en France). Mais entre temps, il faut laisser le temps.
#79
En voiture de série en fin de gamme (limited edition 3 quand la gamme 4 est sortie), peut-être un peu moins, mais pour être honnête, je pensais pas autant.
60L je pense, quand je fait du 90⁄110 (Bretagne), elle m’indique 1200 borne.
#80
Je rêve d’un monde où l’urgence reprendrait son sens. En faits, notre pollution excessive vient de ce que nous n’avons presque jamais le temps de rien. Nous voulons tout, tout de suite, et pour cette raison, devons êtres réguliers et ponctuels, tous en même temps, tous au même lieu (de travail, ou de consommation). Et toujours plus vite.
Dans mon travail, j’ai vu la proportion de demandes “urgentes” augmenter considérablement. Des clients commerciaux qui se réveillent en retard, et veulent leur raccordement dans les 24 heures. Évidemment, j’ai toujours envie de leur faire plaisir, de leur faire voir à quel point c’est mieux chez nous. Mais une bonne partie n’a pas connecté son router dans les 3 mois qui suivent (et il payent quand même leurs factures). Parce que leurs processus sont décorrélés de leurs propres réalités matérielles !
Alors j’applique la facturation standard. Pas d’erreur du fournisseur = facturation du traitement express (cher). Et là bizarrement, 9 demande sur 10 n’est plus si urgente que cela. Ça leur coûte moins cher, ils sont moins stressés, et nous aussi. Au lieu de déplacer un technicien en urgence, on optimise les passages réguliers dans les centraux, et la terre continue de tourner tranquillement.
Bref, si tout n’était pas si urgent, et si la sacro-sainte “productivité” reprenait sa place (oui, là-bas, tout au fond), nous aurions le temps de prendre le car, et de vivre lentement.
#81
Beaucoup de ces trajets peuvent être réduits ou faits avec moins de voitures.
Alors bien sûr, pas pour tout le monde, mais on part de loin. De trop loin.
Il faut voir à plus long terme, l’électrique en est littéralement à ses débuts alors que le thermique en est à 80 ans de développement effréné. Il faudra un peu de temps, mais cela arrivera.
Il est évident que pour l’instant il y aura beaucoup plus d’entreprises, riches ou gens avec un leasing qui auront une électrique que les pauvres. Mais avec le temps ces véhicules alimenteront l’occasion comme les autres modes de propulsions ce qui rendra le tout plus abordable.
Le soucis n’est pas souvent le trajet en lui même.
Le soucis c’est que pour un trajet annuel, tu achètes une voiture qui sera surdimensionné pour les 363 autres jours de l’année. Cela a un coût environnemental mais aussi financier car modèle plus gros, plus de consommation de ressources comme d’énergie, etc.
Si tu acceptes de prendre plus petit en allant moins loin (ou avec moins de confort) voire en louant une voiture pour l’occasion, c’est finalement bénéfique et c’est ça la logique.
C’est assez dangereux au niveau de la concentration (ce n’est pas pour rien que c’est dans le code de la route).
Pour la conduite relaie, oui, mais pas tout le monde ne peut le faire d’une part, et surtout tu peux en profiter pour aller aux toilettes, manger / boire, consulter ton téléphone (actu, messageries, etc.) tranquilou le temps que ça charge. Cela se fait très bien, cela passe vite 20-30 minutes..
Je comprends, mais bon on parle quand même de choses pas anodines. Dans le sens tu parles du confort d’un vacances annuel au détriment économique, énergétique et environnemental de ton pays et du monde entier en fait. C’est un choix, mais tu trouves que c’est un argument si important devant ces problématiques et cet enjeux ? Je pense que c’est important de rappeler les conséquences pour rappeler que les arguments forts pour les voitures thermiques ont un coût annexes très élevé.
Tu peux aussi aller moins loin.
On n’a pas besoin de faire 1000 bornes chaque année pour avoir des vacances sympas. Dans un rayon raisonnable de moins de 500 bornes tu as souvent de quoi faire par exemple.
Pour Casto / Ikéa, tu peux louer une camionnette. ;) Pareil pour les vacances dans le fond, tu peux louer une autre voiture pour le déplacement ou sur place. Et une voiture du quotidien a besoin de beaucoup moins de place.
On peut trouver des solutions, c’est moins pratique, potentiellement un poil plus cher financièrement, mais bon, on a rien sans rien.
Sauf que du temps, on n’en a pas tant que ça. Le législateur pose une limite forte à partir de 2035 ce qui laisse un peu de temps pour que le tout mature un peu (on ne changera pas la société en 5 ans, c’est évident).
Ce que je critique c’est la volonté d’avoir tous les avantages du thermique avec une VE, cela est très improbable même à terme. Du coup il faut réfléchir aux critères vraiment importants et mettre en perspective les conséquences de privilégier le conforte du thermique.
#82
Je suis globalement d’accord avec tes messages mais dire que l’électrique en est littéralement à ses débuts, c’est oublier qu’au milieu du 19e siècle, les voitures étaient toutes électriques.
Ensuite, le pétrole a pris le dessus mais les voitures électriques étaient bien développées. Il y avait même une société de taxis à Paris qui avait un atelier de changement rapide de batteries pour assurer le service.
Il y a eu des choix techniques et politiques qui nous ont amenés à la situation d’aujourd’hui.
#83
Je vois souvent cet argument mais il est en fait assez mauvais.
On ne peut pas comparer l’automobile de 1850 à 1914 à l’automobile aujourd’hui. Ce qu’on attend d’eux, le volume d’utilisation, des usages, les technologies, etc. n’ont plus grand chose à voir. À l’époque aussi les voitures à pétrole c’était assez naze, personne n’en voudrait aujourd’hui. Même une voiture des années 80 en vrai (en dehors de l’aspect fun bien entendu)…
L’électrique avait atteint un plafond technologique, le pétrole était très pratique et abondant (et vraiment peu cher). Il a donc logiquement gagné, mais on connaît le revers de la médaille qui fait qu’on doit s’en passer le plus vite possible.
On n’aurait clairement pas eu des performances acceptables de l’électrique avant les progrès sur les matériaux et l’électronique donc pas avant les années 70-80 au minimum. C’est bien tard. Et encore, les premiers prototypes jouets des années 90 (souvenons-nous de la Saxo électrique) étaient loin des standards thermiques. Et beaucoup des progrès des batteries viennent en fait de l’informatique même si c’est à une échelle moindre.
Du coup de fait l’automobile électrique est à ses débuts, on peut dire que ça a 15 ans de vraie maturité. Ce ne sont pas les débuts lors du siècle précédent qui changent grand chose à cela, et surtout comme cela ne fait que 10-15 ans que des modèles électriques se vendent à grand échelle, bah le marché de l’occasion est encore très très peu fourni en modèles. Cela changera mais faut un peu de temps que le marché se renouvelle.
#84
Et ceux qui roulent en supercar continueront à brûler du pétrole.
#85
Non. Je te dis la vérité.
Par exemple, quand on a utilisé les boues de stations d’épuration, c’est impossible d’utiliser les résidus comme engrais.
Par exemple, certaines entreprises achètent à la grande distribution des produits qui allaient aux associations avant (produits alimentaires dont la date limite approche). On nourrissait des gens avec ces produits, maintenant, on en fait du “bio” gaz.
En Bretagne, qui ne manque pas d’élevages et de soucis avec le lisier, les effluents d’élevage ne représentent que 60% de l’alimentation des méthaniseurs.
Ce n’est que du green washing.
Sauf qu’on fabrique ces déchets. Tout simplement. Et que ça a un impact sur l’environnement.
Continue à nier. Si c’est à 50% en Allemagne, ce sera 50% dans l’UE.
C’est tellement vrai que c’est 50% de cultures intermédiaires à vocation énergétique en Allemagne. Il y a des champs de maïs dont la seule vocation est d’alimenter des méthaniseurs. Parce que les déjections animales ne permettent pas d’avoir des rendements intéressants pour les industriels. On ne parle pas du fermier qui récupère la bouse de ses vaches, l’image qu’on essaie de nous vendre, on parle de véritables usines, pilotées par des industriels et qui veulent du rendement. Le gaz trop peu cher, c’est encore ton déni de la réalité. Jusque 139€/MWh.
C’est archi-faux.
Bien sûr que oui, ça a à voir. Puisqu’on n’a pas le droit de cultiver pour faire de l’énergie en France, on importe des cultures pour faire de l’énergie. On va faire pareil pour le “bio”gaz. On n’a pas le droit de cultiver du maïs? Importons-le !
C’est toi qui es resté dans le passé à imaginer que c’est l’éleveur du coin qui méthanise la bouse de ses vaches. Je ne savais pas qu’Engie, par exemple, était éleveur. C’est une industrie massive qui a besoin de rendements pour satisfaire ses actionnaires et qui pour cela est prête tout. De la négligence au sujet de la sécurité (ça coûte!) aux petits arrangements avec la loi pour alimenter les méthaniseurs avec des produits qui augmentent leur rendement.
Et c’est une industrie fortement polluante pour les rivières.
Ce qui est effarant, c’est la bienveillance des politiques. En 2018, il y a eu un contrôle du méthaniseur d’Arzal, dans le Morbihan, après plusieurs pollutions du cours d’eau de Kerollet: le contenu des cuves y a été tout simplement vidé à plusieurs reprises. De nombreuses infractions ont été relevées. Pas de contrôle des eaux rejetées, mais surtout une autorisation pour 28 tonnes de déchets par jour (loin de la bouse du fermier, hein…) mais 43 tonnes réellement utilisées.
La bonne décision, suite à tous ces manquements aurait été d’ordonner la fermeture du site. Eh ben non, on a organisé une enquête pour son agrandissement.
Mouarf ! Des gens dont les revenus viennent de la fourniture d’énergie qui plaident pour une baisse de la consommation… dans quel monde vis-tu ? La tronche des actionnaires de Total quand on va dire à l’AG que l’objectif c’est réduire la fourniture d’énergie et arrêter de polluer massivement !
C’est beau comme les pubs pour les bagnoles avec une petite mention disant que c’est mieux de prendre son vélo.
#86
Oh oui, importons des Dacia fabriquées en Chine grâce au “bonus écologique” ! Pourquoi se contenter d’importer les batteries ?
“A un moment”. C’est beau la procrastination. Plus de 30 ans qu’on dit “A un moment”.
Tu vois, quand tu fais un effort… J’ai toujours halluciné quand j’entendais des gens qui roulaient au quotidien dans des breaks parce que c’était pratique pour aller en vacances.
D’ici 2050 ? Je pensais qu’on était déjà dedans. Mais oui, attendons 2050 pour envisager un changement de comportement
#86.1
Je me demande pourquoi tu continues à poster des commentaires sur des supports numériques extrêmement consommateurs d’énergie.
Tu es végan aussi ?
#86.2
J’écrirais bien au courrier des lecteurs mais ça consomme beaucoup d’énergie aussi. Et il faudrait du papier, qui est une industrie très polluante.
Et non, je suis omnivore.
Par contre, je n’attends pas 2050 pour sérieusement changer beaucoup de mes habitudes, et pas simplement en ce qui concerne mes déplacements. Tu ne trouveras pas dans mon assiette de fruits ou légumes exotiques ou qui ne sont pas de saison. Ma viande vient de chez mon boucher qui offre une très bonne tracabilité et s’approvisionne chez des éleveurs locaux. Les espèces de poissons que je mange ne sont pas menacées par la surpêche (et ne sont pas d’élevage). J’ai choisis mon logement pour sa proximité avec les transports en commun et les lieux où je vais et pour ses performances énergétiques et la première chose que j’ai faite en emménageant c’est de ne mettre que des ampoules LED. Ma Playstation n’est jamais en veille, pas plus que ma télé ou mon home cinema. Je suis très vigilant sur ma consommation d’eau, au point qu’on m’a remboursé une centaines d’euros sur les charges provisionnées (dont l’eau fait partie mais on a un compteur individuel).
Aucun de ces choix n’est un sacrifice, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Ca me fait économiser beaucoup d’argent que je peux mettre dans mes loisirs. Quand on ne paie que 22€ par mois pour l’électricité, ça en fait des concerts, des pièces de théâtre, des restos, des week-ends à la mer qu’on peut s’offrir!
Et contrairement à ce que tu dis souvent, je ne cherche pas à imposer à qui que ce soit de me suivre. Mais en relatant mon expérience, je vois parfois des personnes suivre mon “exemple”. Par exemple ma chérie habite à 5 minutes d’un arrêt de bus où une ligne passe et la dépose à 200m de son travail. Jusqu’à peu, elle y allait en voiture. Maintenant, elle met le même temps (c’est le même trajet par la même route!) mais elle lit ou échange avec ses amis sur les réseaux sociaux. Son seul regret est de n’avoir pas fait ce choix plus tôt. Ca lui coûte moins cher, ça économise du stress. Et ça fait une bagnole de moins rue du Faubourg d’Arras, un encombrement de moins pour ceux qui ne bénéficient pas de TC pour rejoindre Lille. Comme je disais hier, si simplement ceux qui ont la possibilité de le faire revoyaient leurs choix, tout le monde y gagnerait.
#86.3
Le pire c’est que je suis d’accord avec toi.
J’ai passé une partie de mes études à Lille en prenant uniquement le métro et la marche à pied.
Quand je me déplace en ville, je me gare en périphérie au terminus et je prends le tram ou le métro suivant où je vais.
Je consomme des produits locaux et de saison (très peu de plats préparés): j’ai la chance d’avoir une petite boutique qui vend tous les produits frais des producteurs alentours.
Etc. etc.
C’est juste que je te trouve très dur envers tes compatriotes.
A Paris par exemple, plus de la moitié des déplacements se font à pied, 1⁄3 en TC et moins de 10% en voiture.
Et si tu compares par rapport aux autres pays, on doit faire des efforts mais la responsabilité n’est pas entièrement française.
J’ai mis la Suisse pour répondre aussi à un autre interlocuteur. Et la Norvège qui est sensée être à la pointe du “combat”.
#86.4
On en revient à “si tous ceux qui peuvent…”.
Et ceux qui peuvent sont souvent les plus aisés. Mais tu les vois dans le métro plutôt qu’au volant de leur berline allemande ?
Mon beau-frère qui est cantonnier dans un bled paumé de Savoie et est d’astreinte pour déneiger, je ne lui demande pas de lâcher son 4x4 pour un vélo.
Il y a un gros biais dans ton lien. Si la Chine a des émissions en augmentation pendant que l’occident voit les siennes baisser, ce n’est pas (que) pour sa consommation intérieure. On délocalise la pollution et la production de GES. Et pour en revenir au sujet de l’article, on importe les batteries (voire les véhicules). Le coût social et environnemental serait insupportable ici. Pire: financièrement on se rendrait compte de la valeur réelle.
C’est un problème qui concerne chaque habitant de notre planète. Que chacun prenne ses responsabilités. La pompe qui fonctionne au pétrole pour alimenter en eau un village (je sais, c’est cliché) d’Afrique est plus légitime qu’un Hummer, une limousine ou même la Twingo de mon voisin qui va chercher ses gosses à l’école à 800m.
C’est pas gagné quand je lis les propos par exemple de @Renault (il porte bien son pseudo). On trouvera bien avant 30 ans des solutions… Même si on trouvait ces solutions (on nous en parle depuis 70 ans au sujet des déchets nucléaires), moins on pollue aujourd’hui, moins il y aura à retraiter demain. C’est une Lapalissade, mais c’est la réalité. Un truc qui passe mal dans le crâne de l’interlocuteur susnommé qui va s’acheter un VE plutôt que renoncer à son avocat (1000l d’eau par kilo plus le pétrole pour le transporter) crevettes (importées du Vietnam où elles sont produites dans des conditions désastreuses).
#86.5
Je me permets de te répondre car cet argument est souvent avancé lors de débat sur l’écologie et le “chacun doit faire sa part”
Avoir les moyens facilite certainement la mise en place de solutions pour émettre moins de CO2, notamment pour faire des travaux dans son habitation : meilleure isolation, nouvelle chaudière, panneaux solaires…
Pourtant, on constate que les « classes supérieures » ont une empreinte écologique plus élevée que la moyenne, malgré leur niveau de vie plus aisé et une sensibilité aux questions environnementales. [1] Elles ont adopté certains comportements (achats en vrac, diminution de la consommation de viande), mais ça ne suffit pas car, dans d’autres domaines, elles consomment beaucoup (voiture et avion par exemple).
Bref, les choix que l’on pose en matière de consommation ont une grande importance. Il ne suffit pas d’avoir les moyens de s’offrir les équipements les plus économes en énergie. Il faut aussi changer certaines habitudes et remettre en cause le modèle consumériste.
Sources :
[1] : https://www.credoc.fr/publications/consommation-durable-lengagement-de-facade-des-classes-superieures
https://www.ecoconso.be
#87
OK :-)
#88
Ca représente combien de “pleins” ?
#89
Et donc ? Autant récupérer le gaz qu’il y a dedans, c’est plus facile pour l’incinérer ensuite.
Et note que c’est en discussion pour s’en resservir sous réserve d’analyses.
Tu apprendras déjà que les méthaniseurs ne sont pas en nombre suffisant aujourd’hui pour tout prendre en charge. Et si tu t’étais renseigné tu saurais que cela fonctionne mieux quand tu mélanges divers type d’intrants (par exemple du lisier avec des déchets végétaux). D’où le fait que tu n’as pas 100% de lisier de cochon malgré les quantités abondantes dans la région.
Bah voyons…
Ce n’est pas le cas e France et cela n’en prend pas cette direction.
Bah voyons, encore de la mauvaise foi sans preuve. Comme si l’UE n’avait jamais rien changé et que l’Allemagne n’avait jamais du changer à cause de l’UE…
Car à force de caricaturer, tu déformes mes propos et de fait tu tombes à côté.
Le biogaz est cher, c’est effectivement environ 100€ / MWh aujourd’hui (mais à mettre en perspective qu’il traite des déchets qui sont coûteux à traiter par ailleurs).
Mais la nourriture a une densité énergétique faible (c’est pour ça qu’on n’a pas juste du carburant alimentaire pour alimenter nos moteurs). Cultiver pour produire du biogaz n’est économiquement pas très viable même avec un tel prix pour le gaz, car ça coûte tout aussi cher en engrais + travail.
L’Allemagne n’a des cultures dédiées que par des subventions qui l’y autorisent.
Comme si c’était la seule alternative possible…
Regarde, la France ne le fait toujours pas car ce n’est pas rentable, pourquoi on le ferait demain ?
Et pourtant dans ma région c’est bien le cas.
Et il y aura forcément des installations industrielles, je ne vois pas le gros mot dedans.
Cela ne me choque pas que la production et l’injection de gaz qui a besoin de capitaux de départ attire la collaboration ou l’implication d’Engie dont c’est le coeur de métier. Cela ne contredit rien.
Donc parce que l’autorité règlementaire merde, faut tout jeter ?
Comme l’autorité règlementaire a fauté sur à peu près tous les sujets du monde, on ne fait plus rien ? On va tous vivre dans une grotte car des immeubles / maisons se sont effondrés, des ponts aussi, des lignes de train ont eu des impacts négatifs sur l’environnement, etc.
Ce n’est pas ma vision des choses, la fausse dichotomie très peu pour moi.
J’ignorais que le GIEC était dans ce cas, sans doute tous des corrompus !
Bref, je vais m’arrêter avec toi ici, j’ai apporté des arguments sourcés, une position assez mesurée que tu caricatures à tour de bras. Je ne vois pas l’intérêt de poursuivre dans cette voie, c’est assez lourd et sans intérêt.
#89.1
Tu refuses de voir la réalité en face. La méthanisation, c’est dans les faits une fausse bonne idée.
La réalité des intrants, les pollutions induites, le fait que tout cela ne puisse être rentable que si c’est massivement subventionné (au détriment de réelles solutions d’économies d’énergie).
C’est incroyable ces oeillères. On utilise des invendus de la grande distribution au lieu de les distribuer à ceux qui ont faim, on détruit la bio-diversité de sols pour faire de la culture intensive de CIVE. Et l’argument ultime de la mauvaise foi “on va vivre dans une grotte”. Ou parler du GIEC qui ne fait que constater, pas conseiller.
En attendant, je vois des panneaux lumineux publicitaires partout. Des camions parce qu’on continue à détruire le ferroutage. L’abandon de lignes de train. La subvention de l’essence ou celle de l’achat de voitures.
Dormez, braves gens. On utilise la bouse de vache pour faire du gaz qui peut alimenter les cargos de soja transgéniques brésiliens, cause importante de déforestation, pour que les dites vaches mangent dans des fermes closes plutôt que brouter en plein air. On importe des batteries chinoises parce que leur fabrication serait insupportable en Europe vu ce qu’on inflige à l’environnement et aux ouvriers. Fermez les yeux, les agences de communications vont vous raconter une belle histoire. Laissez nous continuer à caresser le cercle, ça le rend de plus en plus vicieux, mais ça rapporte tellement d’argent…
#90
C’est très bien ce que tu fais, c’est ce que mes parents ont toujours fait et m’ont appris en allant faire les courses de proximité, avoir notre maison avec un potager et quelques poules , en éteignant les lumières inutiles ou en coupant l’eau du robinet (pas le choix nous avions énormément de coupures d’eau et d’électricité
, en éteignant les lumières inutiles ou en coupant l’eau du robinet (pas le choix nous avions énormément de coupures d’eau et d’électricité  ),et ce que tu fais n’est que du bon sens (dans certaines options), mais en 2022, tout le monde ne peut malheureusement pas aller son boucher, ou vivre comme toi….
),et ce que tu fais n’est que du bon sens (dans certaines options), mais en 2022, tout le monde ne peut malheureusement pas aller son boucher, ou vivre comme toi….
Dans l’hypothèse d’un changement d’activité professionnelle ou d’entreprise, déménagerais-tu pour te retrouver dans le même cadre de déplacement profession-lieu de résidence ?
A vous qui êtes bien renseignés sur l’utilisation des véhicules électriques, comment se comporte la consommation dans le cadre d’utilisation sur des routes vallonnées ? Faut-il recharger plus souvent ?
A noter, la France ne se résume pas à la seule métropole européenne et à ses seules grandes villes avec des réseaux de transport performants (mais jamais assez pour le citoyen ) , et inclut aussi ses régions ultra-marines.
) , et inclut aussi ses régions ultra-marines.
#91
Tu vois, ce paragraphe est exactement ce que je te reproche.
Tu crées un homme de paille de ce que j’ai argumenté. Tu caricatures mon propos, sans comprendre ce que je dis.
Car je pense tout le contraire de ce que tu viens de dire à mon sujet, donc plutôt que de m’inventer une position technosolutionniste que je n’ai JAMAIS tenu ici, je t’invite plutôt à lire ce que j’ai vraiment discuté et sourcé.
#91.1
C’est pourtant l’essentiel de ton propos. Tu veux que je te cite ?
La méthanisation est un exemple fort du green washing, que tu l’acceptes ou non. On utilise pour l’alimenter des invendus alimentaires qui feraient le bonheur des banques alimentaires, on détruit la bio diversité de sols pour pratiquer la culture intensive de CIVE, et au final on incinère puis on enfouit les résidus qui sont incompatibles avec la fertilisation des sols. Et on salit l’eau. Le tout à grands coups de subventions, au détriment de solutions qui seraient réellement durables.
C’est du technosolutionnisme, c’est au détriment du pragmatisme. Combien de méthaniseurs sont nécessaires au fonctionnement de cette pollution visuelle des panneaux lumineux de pub nous incitant à consommer (encore plus de pollution) ? Tous ceux de France n’y suffisent pas.
Tes arguments ne valent pas tripette. Le prix de rachat du gaz produit par exemple. Et l’image d’Epinal que tu promeus du fermier qui met son fumier dans une cuve. Tout ça est faux.
#92
J’ai choisi d’être locataire (je suis propriétaire d’un autre logement que je propose en location) pour cette raison.
Je vis seul. Je sais que mes choix ne sont pas à la portée de tous. Mais je me répète: “si tous ceux qui peuvent…”
A noter: le problème ne se résume pas à la France, même dans sa grande diversité.
#93
On parle de technologies avec différentes possibilités, dont certaines sont vertueuses et cela est largement documenté. Et toi tu me parles de marketing de certains et de certaines pratiques qui ne sont pas celles que je défends, ni défendus par ceux qui présentent uniquement les aspects vertueux. Tu comprends la différence ?
Mais ces pratiques dont tu parles, je ne les défends pas et en France ce ,‘est d’ailleurs pas le cas.
Je défends (comme d’autres dans leur rapport, mais apparemment c’est mieux de ne pas les lire j’ai l’impression) ceux dont la provenance vient uniquement des déchets qui existent quoiqu’il arrive. D’où le fait d’ailleurs que le gisement exploitable de biogaz maximal est en deçà de la consommation de gaz actuelle, car on se base sur ce qui est raisonnablement possible d’atteindre de manière vertueuse.
Bah non, car je prône les deux axes : sobriété (baisse de consommation de produits, changement de comportements), efficacité (isolation des logements, changements de processus industriels, etc.). Cela passe par des innovations techniques aussi, mais pas que.
C’est donc justement un point de vue très pragmatique basé sur les résultats scientifiques et ce qu’on a à disposition. Je ne me fais pas d’illusions, le biométhanisation ne permettra clairement pas seule à continuer à vivre comme avant.
Tu vois, tu crois que je suis en faveur des pubs lumineuses ou d’une consommation d’énergie constante. Ce n’est pas ce que je défends.
Bah écoute, des installations de biogaz, j’en ai par chez moi, c’est petit et c’est un fermier qui gère ça sur son installation avec ses déchets de culture ou d’élevage. Il y a des grosses installations, pour gérer les déchets organiques (et non pas des invendus alimentaires encore valables), des déchets ménagers (type bois non exploitable) ou des boues de station d’épuration (qu’il faut traiter de toute façon) ou pour traiter plusieurs exploitations agricoles ensemble.
Bref, un modèle différent de ce que tu critiques, un modèle différent de ce qui se fait par endroit (et je suis d’accord qu’il ne faut pas faire ce que tu critiques). Donc le fait que tu continues dans cette voie est de la pure mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle car tu critiques une technologie plutôt que de critiquer la législation (par endroit) et le contrôle des installations ce qui sont des choses heureusement différentes.
#94
Petit grain de sel: pour connaître ceux qui récupère ce que les banques alimentaires ne prennent pas, je peux vous dire que les banques alimentaires gardent essentiellement ce qui n’a pas de DLUO et qui est en sachet.
Tout ce qui se cuisine, tout ce qui est brut (hors pâtes et riz), tout ce qui est frais est jeté/donné par la banque alimentaire car refusé par les “clients” des banques alimentaire et pas gérable.
Sinon, je suis d’accord avec les deux:
C’est un peu comme tout: on nous promet 30% d’économie, mais les meilleures solutions finissent par un mieux de 1à 5%, et encore avec l’effet que les gens y prêtent plus attention qu’avant (quand en plus la nouvelle solution n’est pas pire)
#95
Oui, tu parles d’idéal moi de réalité.
Bla bla bla. Ces déchets sont artificiels, fabriqués. Ils auraient un meilleur rôle à jouer en les distribuant aux banques alimentaires. Et en France, voile-toi les yeux tant que tu veux, ça ne changera rien, c’est la pratique courante. C’est plus facile de faire croire qu’on recycle que limiter la surproduction. C’est pourtant la surproduction le problème. A grands coups de pesticides et de chauffage ou d’éclairage de serres pour qu’en octobre tu manges des tomates. Produire des CIVE avec un rendement loin des 100% pour les foutre dans des usines loin des 100%, c’est juste du gaspillage.
Tu dis tout le contraire dans tes messages précédents, et encore dans celui-ci en disant que la méthanisation est un bien.
Chaque euro mis dans la subvention de mauvaises solution (subventions à pléthores, bonus pour acheter des bagnoles, réduction du prix au litre de l’essence) c’est un euro de moins pour les solutions qui permettraient d’envisager des solutions durables (isolation des logements, développement des TC, recherche sur le nucléaire hors réacteurs à eau pressurisée…).
Vu qu’elle ne fait qu’empirer les choses, elle n’offre aucune solution, en effet.
Eh ben dis-le. La seule énergie propre c’est celle dont on n’a pas besoin.
Parfait! prend ton petit exemple pour une généralité ! Je t’ai parlé d’un réacteur qui engloutit plusieurs dizaines de tonnes par jour et qui n’est pas le plus petit de France. La réalité, c’est ça.
Garde tes œillères, ton petit fermier, tout ça… si la méthanisation c’était le fermier du coin qui s’assure un revenu en plus, je serais pour.
Plusieurs dizaines de tonnes par jour, c’est la réalité. C’est pas la coopérative agricole qui fournit ça. Dormez braves gens, on a une belle image d’Epinal pour vous.
Je te parle de la réalité quand tu vis dans un monde de Bisounours.
La méthanisation, c’est essentiellement de grosses entreprises qui vivent de subventions, pas le fermier du coin qui a trouvé le moyen de changer la bouse de ses vaches en carburant pour son tracteur.
Et même pour ton exemple anecdotique, si ton fermier du coin n’importait pas du soja amazonien pour nourrir ses bêtes (bah oui, une vache qui chie dans un pré, quel intérêt?) indoor, ou n’utilisait pas des tonnes de fertilisants et de biocides , il gagnerait de l’argent et il polluerait moins.
Le vrai destin d’une vache c’est brouter dans une pâture et chier dans cette pâture pour que l’herbe y pousse encore, pas de vivre comme les poules pondeuses totalement artificialisées.
Tu vais la promotion du greenwashing des élevages industriels, en projetant l’infime partie de ce qu’est la méthanisation en France. La réalité, je te l’ai déjà dite.
Et tu éludes tous les arguments que je donne et qui sont factuels. Les cultures intensives de CIVE, la pollution de l’eau, les fuites de méthane largement supérieures au prétendu bénéfice de ces installations…
#96
Oui… mais non.
Les banques alimentaires récupèrent ce qu’on leur offre. Quand un industriel propose de les racheter, l’intérêt de la grande distribution est bien entendu d’accepter l’offre de rachat.
“J’ai 5 tonnes de poireaux sur les bras, tu me les prends à un euro le quintal ou je les donnes aux restos du coeur?”
Les méthaniseurs ne font pas les poubelles des banques alimentaires pour récupérer ce qui serait impropre à donner à leurs bénéficiaires. Ils vampirisent en amont. Et pas que sur le frais. Les céréales du petit déjeuner des enfants, les paquets de farine, de pâtes, de riz… des produits qui augmentent le rendement des méthaniseurs: ils sont à la fois riches carbone et secs. Du pain béni pour eux.
#97
Le fait que la vache soit locale ne la rend pas moins polluante. Le transport ne représente presque rien dans le bilan carbone d’une vache.
Si elle est laissée à chier dans une pâture, tout ce qu’elle pète de méthane est perdu et ça en fait la nourriture la plus polluante (et consommatrice en terre agricole), quel que soit le lieu de production.
“Manger local” n’est pas particulièrement écolo surtout si c’est pour manger du boeuf.
Ils ont l’air vraiment idiots ces fermiers.
#98
Pour rajouter de l’eau au moulin (en anglais) : “Cycling is ten times more important than electric cars for reaching net-zero cities” https://theconversation.com/cycling-is-ten-times-more-important-than-electric-cars-for-reaching-net-zero-cities-157163
#99
Nous sommes d’accord.
Nous sommes également d’accord. Je le déplore.
Et c’est bien mon propos aussi quand je dis “si ceux qui peuvent…”.
Je suis allé à Barcelone récemment. Ca m’a coûté 4 fois le prix en train que m’aurait couté l’avion et plus du triple en temps. Le prix… j’en fais mon affaire, je peux me le permettre. Je ne comprends pourtant pas la situation. Si on adoptait le même niveau de taxes sur le kérosène que sur l’essence, ce serait différent. Attendre du politique une cohérence entre les propos et les actes doit relever de l’utopie. Pour le temps, je l’ai occupé avec ma chérie. Le temps du voyage fait partie du “truc”. Si tu ne te rends pas compte que ça met du temps d’aller à Barcelone, tu perds la notion du fait que tu pars loin, tu perds de la saveur du voyage. On a relu des guides de voyage, échangé sur ce qu’on voudrait faire… prendre le temps, à une époque où la tendance c’est des vidéos de 30s, c’est à contre-courant du consumérisme ambiant.
#100
Tout ce greenwashing concernant les voitures électriques suscitent en moi un mélange de “doux” énervement et de lassitude.
Entre le matraquage publicitaire pour les gros SUV électriques à 50 000€ dont on nous abreuve à longueur de journée, qui non contents de n’être en rien écologique (si ça veut encore dire quelque chose) ne sont en plus pas à la portée que d’une minorité de bourses… Cherchez l’erreur.
Entre celui des entreprises qui cherchent toutes à se faire passer pour plus verte que l’herbe elle-même et à placer durable, sociale et vert dans chaque phrase comme dans ma boite qui en vient (en tout vas certains de ses collabora… pardon salariés) à publier de la com’ sur les bons petits gestes verts (coucou couper le Wi-Fi ou passer moins de temps sur le smartphone… Attends quoi ?!) ou l’amélioration de l’impact environnemental d’un de ses processus car… celui-ci fait maintenant appel au cloud !?
Etc etc franchement entre ceux qui adhérent à cette comédie par idéologie (le but c’est de continuer le business as usual ni plus ni moins) et ceux qui tombent dans le panneau et la jouent par manque de recul et d’esprit critique (et parce que ça les arrange sûrement aussi un peu d’essayer de soulager leur conscience), tout cela est pitoyable :)
Je me doute que la durée de vie de la batterie va dépendre des fabricants, du modèle ou de la conduite de l’utilisateur du véhicule mais grosso modo on doit s’attendre à quoi comme durée moyenne avant par exemple que la batterie de 60 KWh de la Megane E-Tech citée au début de l’article tombe sous ce seuil fatidique ?
#101
Quitte à manger du boeuf, qu’il ne vienne pas d’Amérique du sud ou que son alimentation en vienne.
Un boeuf qui broute de l’herbe à 20 bornes à un impact faible.
Ils le sont. Ils pleurent sur leurs revenus et produisent des la viande de mauvaise qualité.
Alors que les éleveurs chez qui mon boucher se fournit s’en sortent correctement et ne dépendent pas d’entreprises comme Bigard pour leur expliquer comment ils doivent faire et à quel prix.
#101.1
Ben non.
Manger du bœuf a un impact carbone fort. cet impact vient avant tout de l’élevage, parce que la vache rumine et ce faisant produit du méthane, qui, rappelons le, est 60 fois plus contributeur au réchauffement climatique que le CO²
Et donc face à tout ce méthane, le cout carbone du transport du beefsteack est en effet négligeable, d’où qu’il vienne.
Donc la différence d’impact entre un un steack importé d’Argentine et un autre produit à 20 bornes de chez toi, c’est la différence entre “beaucoup” et “beaucoup aussi”.
Alors certes on peut chasser la petite bête en évitant le micro-pouième du transport (pour se donner bonne conscience peut etre ?) mais le problème auquel il faut s’attaquer, c’est la grosse bête : la vache.
Note: un a le même problème avec le mouton (ruminant…) mais par contre l’impact GES d’un porc ou de la volaille est plutôt bon
#102
Sinon : https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/07/2018_09_Electric_vehicles_briefing.pdf
p.6 tu as des comparaisons avec plusieurs pays, pour la France on divise par 5. Note que le rapport date de 2018, donc l’ADEME publie en 2022 un rapport qui donne des résultats tels qu’on pouvait les obtenir avant (~2015).
Mon reproche principal c’est aussi qu’ils comparent n’importe quoi (une citadine avec un SUV compact à 100 kWh – d’ailleurs, je vois mal quel serait ce SUV compact avec une telle batterie, surtout que le rapport parle plus bas d’un “gros véhicule”) et en tirent des conclusions forcément limitées à leurs hypothèses (au passage, on ne sait même pas quels sont censés être les véhicules utilisés pour l’étude si même ils existent)
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/07/TE%20-%20draft%20report%20v04.pdf
Là, ils citent des sources scientifiques, ce que ne fait pas le rapport de l’ADEME. Tu trouves le même genre de résultats à l’EPA, au ICCT et d’autres.
Quand je dis que l’ADEME fait toujours des études à la mord moi le noeud, c’est qu’il suffit de voir l’entrisme anti-nucléaire dans leurs études sur l’énergie pour voir à quel point ils s’assoient sur la science pour écrire leurs rapports.
Oui, la situation évolué en mieux, ce n’est pas ce que reflète l’ADEME. Au passage, en tant qu’utilisateur de VE, je relève qu’elle passe totalement sous silence un bon nombre de problèmes soulevés par des batteries trop petites (<40 kWh) : vieillissement, froid, capacité utile sur longs trajets = 70%, etc.
#103
Source ?
C’est un cliché qui n’est plus vrai aujourd’hui : depuis 2019, les chinois émettent + par personne que les français, même en prenant en compte les emissions des produits importés/exportés:
https://ourworldindata.org/grapher/prod-cons-co2-per-capita?country=~CHN
6.59T de CO2/an pour un chinois (basé sur la consommation et non la production)
https://ourworldindata.org/grapher/prod-cons-co2-per-capita?country=~FRA
6.48T de CO2/an pour un français (basé sur la consommation et non la production)
Étant donné que les chinois prévoient de continuer à augmenter leurs emissions en se basant sur le moteur économique intérieur, alors que les européens prévoient d’être à 0 emissions net en 2050, l’écart devrait continuer à se creuser rapidement.
#103.1
C’est simple, une vache qui broute n’a pas besoin d’importation de soja issu de la déforestation en Amérique du sud. Et comme elle est à 20 bornes, elle n’a pas non plus besoin de prendre la route pour arriver dans mon assiette. Accessoirement, sa pâture n’est pas un sol artificialisé.
Il n’en demeure pas moins que tout ce que nous importons de Chine (et d’ailleurs) n’est pas comptabilisé dans nos émissions, ce qui biaise les chiffres.
#104
#105
Vous parlez tous du kilométrage total faisable avec la batterie. Mais dans le cas d’une utilisation faible genre < 10km/an, la batterie atteindra réellement ce chiffre ? J’ai un doute, l’âge de la batterie entre en ligne de compte car 1000 cycles de recharges de 60% à 100%, c’est pas 1000 cycles de 20% à 100%.
J’ai tout de même l’impression qu’on est plus souvent dans le premier cas avec l’habitude de certains de recharger dès qu’ils peuvent que dans l’autre ou on est attentif. Suffit de voir comment sont utilisés les smartphones.
#105.1
juste pour préciser, les cycles sont comptés en 0% -> 100%, donc si tu fais une fois 60%->100% ou 20%->100%, c’est 0.4 cycle et 0.8 cycle, qui sont comptés, c’est pas “une session de recharge = 1 cycle”
note que les batteries se dégradent plus quand elles sont utilisées dans leurs “extrémités” si tu fais 5 fois 0% -> 20% ou 80% -> 100% ça sera compté que comme un seul cycle, mais chimiquement elle sera plus abîmée que si tu fais 10 fois 50%->60% alors que c’est le même nombre de cycles
autre chose, les constructeurs mettent où ils veulent les marqueurs de %, typiquement c’est toujours des cellules de 3.7v nominaux (en lithium-ion), chargées au max c’est 4.2v (en gros), déchargée … ça dépend des fournisseurs, certains annoncent 3.5v quand d’autres descendent à 2.5, mais les constructeurs de voitures font ce qu’ils veulent, pour annoncer une grosse batterie certains vont considérer que le 0->100% c’est 2.5v -> 4.25v, ce qui va en général “user” la batterie si on attend 0% pour la charger à 100%, alors que d’autres vont peut-être choisir 3.5v -> 4.1v, ça fait moins de capacité “utile” comptée dans la batterie, mais charger de 0 à 100% fatiguera moins la batterie et sa chimie …
#105.2
Donc si on branche tous les soir alors qu’elle n’est qu’à 70% (par exemple) on va multiplier les cycles 70-100, ce qui va fatiguer plus vite la batterie, c’est bien ça ?
Je précise que je n’ai pas de VE et que je suis en télétravail depuis longtemps donc c’est plus une interrogation personnel
#105.3
tout ce que j’ai pu lire va dans ce sens, si t’as pas besoin de faire un trajet qui bouffe >60% de la batterie, c’est pas nécessaire de charger dès que tu peux au-delà de 80% (sans compter qu’au-delà de 80% l’efficacité de la charge et/ou le temps de charge est moins intéressant)
monter à 100% de temps en temps peut être utile non pas pour la batterie et sa chimie, mais pour les divers compteurs qui estiment la charge/capacité/santé de la batterie (et pour savoir de manière la plus “fiable” possible combien de kWh “EDF” tu consomme au 100km, la voiture indique une conso “interne”, mais tu peux pas connaître la conso globale du véhicule avec les pertes dues à la charge)
tout ça c’est mon interprétation, je viens de passer à une zoé mais je compte pas recharger à plus de 80% tant que j’ai pas >200 bornes à faire, et je n’ai prévu de recharger que quand je serai sous les 60 % voire 50% (tant qu’elle m’annonce une autonomie > 200km en gros, je chercherai pas à recharger), en usage habituel (j’ai pas encore rechargé depuis l’achat, c’est vraiment tout récent)
#105.4
Si je dis pas de conneries, maintenant le 100% affiché, c’est pas un vrai 100% capacité totale de la batterie, la recharge coupe avant d’atteindre la capacité physique maximum justement pour augmenter la longévité de la batterie.
Ce n’est pas le cas sur toutes les voitures, c’est plus pour les modèles haut de gamme et/ou avec grosse autonomie.
#105.5
yep c’est ce que je tentais de dire, la façon dont est calculé le pourcentage de charge est à la discrétion des fabricants en fonction de ce qu’ils veulent pouvoir mettre en avant, tu peux jouer avec les extrêmes (décharge à 2v et charge à 4.3v) pour annoncer une capacité maximale, ou être conservateur (décharge à 3.5v et charge à 4.1v) et annoncer une longévité maximale (garantie batterie sur + de km et/ou plus de temps)
les constructeurs font pareil avec les téléphones, ceux qui annoncent des plus grosses batteries jouent souvent un peu plus dans les extrèmes
#105.6
Je pense que ça dépends s’il existe un controleur de charge individuelle des cellules.
Le contrôleur pourrait répartir la charge/décharge des cellules de manières transparentes.
(pour ceux à qui ça parle, dans un fonctionnement similaire aux pages d’un SSD).
Donc s’il y a un composant qui répartie les cycles de recharge/décharge, c’est transparent.
Cela dépend de la taille des cellules, et du nombre qui sont sollicités lors de la circulation (si ça se trouve, ça ne se fait pas car pour avoir toute la puissance, il faut mobiliser toutes les cellules).
#106
L’élevage reste malgré tout indispensable.
Les animaux sont des “composteurs” naturels des déchets végétaux (qui emettent du méthane par décomposition de toute façon).
Après, qu’on mette les dit déchets dans un méthaniseur pour récupérer le gaz, on peut en débattre, mais à une échelle raisonnable, AMHA, le méthaniseur apporte plus de contraintes (construction, quantité et qualité d’intrants, gestion des résidus, maintenance…) qu’un élevage, on va dire raisonné et diversifié.
C’est l’industrialisation à outrance, qui rompt ces cycles et équilibres agricoles, qui pose problème.
#107
La différence principale est qu’en France tout est déjà artificialisé depuis longtemps, mais les boeufs français pètent tout de même leur méthane. Et par effets de vases communicants ça ne change pas grand chose pour la déforestation de manger du boeuf français ou importé.
Par ailleurs le transport ne représente quasiment rien dans le bilan carbone du boeuf (et de la plupart des aliments) donc acheter local ne change pas grand chose à ce niveau.
Mieux vaut pour l’environnement manger du poulet ou des protéines végétales (locales ou importées) que du boeuf même “local”.
Regarde les sources que j’ai donné, les chiffres prennent bien en compte les imports/exports ce qui permet la comparaison “non biaisée” (émissions basés sur la consommation):
https://ourworldindata.org/grapher/prod-cons-co2-per-capita?country=~CHN
https://ourworldindata.org/grapher/prod-cons-co2-per-capita?country=~FRA
#108
Si ils avaient pris des boeufs filles d’ailleurs, ça sentirait meilleur dans nos campagnes

#108.1
Effectivement, mais les rognons sont plus difficiles à trouver sur les génisses…
#109
Y’a un truc que je comprends pas là, tu as un hummer ou tu fais de l’humour ?
#109.1
Tu as loupé du contexte : c’était la moyenne dans les embouteillages.
Sinon en temps normal j’étais bien en dessous.
#110
Le coût des bornes de rechargement électrique et du réseau électrique à adapter et de la production électrique à augmenter à proportion, c’est juste pas envisageable.
#110.1
D’accord avec toi. Sauf sur:
Pour 2 raisons.
La première, c’est comme pour ceux qui achètent un break parce que c’est bien pratique pour aller en vacances.
La seconde c’est que l’hybride est un non sens. Quand tu es en électrique, tu dois promener le moteur thermique et le réservoir d’essence, quand tu es en thermique c’est le moteur électrique et la batterie. La voiture c’est déjà un non sens d’efficience énergétique, c’est pas une raison pour encore y accrocher des boulets.
#110.2
On achète, avec la voiture, la possibilité d’aller partout. Une électrique pure est bloquée par la recharge et le restera. Ce n’est plus tout à fait une voiture. Ma turbo-diesel qui doit avoir 12 ans consomme moins de 6 l au 100 km sur les longs trajets autoroutiers et franchit 850 km avec un plein. Aucune voiture proposée sur marché actuellement ne donne cette liberté. Des pachydermes.
Les hybrides, c’est deux moteurs pour un véhicule, donc assez stupide. Mais tous les chauffeurs de taxi qui ont une Yaris en sont ravis. Donc, les hybrides, ça fait le job. En route de montagne, par contre, je doute.
En tout cas, le poids est l’ennemi. Donc tout véhicule de plus de 900 kg devrait se voir appliquer un malus. Et de plus de 4 cylindres.
Des véhicules les plus légers possible, avec une hybridation légère pour les trajets urbains, pourquoi pas ? On saurait le faire mais on ne le fait pas. Ajoutons que les carburants de synthèse sont bien moins polluants, que seuls ces carburants - d’usage encore peu développé - devraient être vendus dans un périmètre urbain. Ce serait plus cher à la pompe mais détaxé pour les professionnels.
Entre hybridation, carburants de synthèse et transports collectifs améliorés, les villes seraient VITE moins polluées sans qu’on ait besoin de renouveler tout le parc automobile, ce qui se fait actuellement.
#111
Les génisses n’ont pas de rein?
Je roule quotidiennement en hybride, et clairement l’hybridation me fait consommer moins (je ne connais aucune voiture thermique qui me permettrait de consommer moins de 6L/100 en E85 ou 5L/100 en SP95 sur mon trajet).
Ce n’est pas parce que tu es anti-voitures que toutes les solutions trouvées sont automatique de la merde, contrairement à tes croyances le monde est tout sauf binaire…
#111.1
Ah bah, j’ai une Micra essence de 2006, en ville et proche banlieue je suis à 4.5L/100 ^^
#112
La Yaris hybride fait 100kg de plus que la thermique. C’est un fait. Transporter ces 100kg a un coût énergétique. C’en est un autre.
Je ne connais pas ton trajet.
Mais quand j’avais une voiture (Clio 2) et que je me tapais Roubaix-Valenciennes au quotidien, j’étais au dessous de 5l/100. Ma compagne, qui a des trajets essentiellement urbains, a une Kia Picanto dont l’ordinateur de bord indique une consommation moyenne de 4,5l/100.
#113
Oui j’ai voulu faire un bon mot j’aurais du dire testicules puisque les boeufs sont castrés
En gros le moteur électrique c’est pour le couple (démarrage, accélération) alors que le thermique c’est pour le run (et éventuellement le chauffage).
La batterie se recharge sur les phase de décélération ou de descente (donc au lieu de faire de la chaleur avec tes freins)
Comme le dit Patch, en ville comme sur route, tu consommes réellement 5 l au 100 km d’ailleurs le réservoir de ma Yaris ne fait que 30 l pour 600 km.
Seul bémol pour la Yaris (qui est plutôt une citadine) les trajets en autoroute où je dois rouler à moins de 130 km/h compteur pour éviter de débrayer le moteur électrique.
#113.1
quelle version de yaris ? j’avais retenu qu’au-delà de 60⁄70 le moteur électrique était largué (principalement à cause de la (micro) batterie qui pouvait pas fournir assez de jus, donc plus de cycles en électrique seul (alors qu’à 60 stabilisé elle alterne toute seule entre le thermique qui recharge un peu, et l’électrique seul qui décharge pendant quelques minutes puis ça recommence)
j’ai cru comprendre que la dernière continu ses cycles vers les 80 stabilisés, mais à 130 je vois pas ce que tu veux dire par “éviter de débrayer le moteur électrique”
edit : ma source est un pote en yaris (l’avant dernière) qui tourne entre 4 et 4.5 sur ses petits trajets habituels, régulièrement 3.8, et il à même réussi 3.3, mais en mode “super papy” lors d’un trajet par des routes de campagne
#113.2
Yaris de 2012, en gros quand tu roules à 110 et que tu montes une côte un peu longue tout à coup tu entends bien que le thermique à pris le relais.
Je ne roule quasiment jamais en électrique seul au dessus de 40 km/h mais les 2 moteurs sont biens couplés en permanence.
Pour l’autoroute, c’est juste un constat sur la consommation d’essence qui devient monstrueuse au dessus de 130 km/h
#113.3
ok je crois comprendre ce que tu veux dire, pas certain de l’exactitude technique par contre XD
de ce que j’ai compris, c’est surtout que le moteur thermique fonctionne par palier (plage de régime), quand y’a besoin de puissance, il se met a haut régime (avec le bruit bien ignoble qui va avec …), mais ça veut pas dire que l’électrique se tourne les pouces, ça dépendra de l’état de charge de la batterie (si on demande la puissance max alors que la batterie est vide, le thermique va pas charger la batterie qui fera tourner le moteur électrique … tandis que si la batterie est pleine le thermique donnera peut-être un peu moins et sera complété par l’électrique tant que la batterie sera assez chargée)
de mémoire le moteur thermique fait dans les 80 poneys, l’électrique dans les 60, mais en combiné c’est que 100, donc à la louche si la batterie est pleine et qu’on écrase la pédale, l’électrique va fournir ~60 poneys et le thermique se mettre à un palier permettant de fournir les 40 “manquants” pour totaliser 100 poneys
mais au fur et à mesure de la décharge de la batterie (ce qui est assez rapide vu sa capacité < 1kWh) la puissance fournie par le moteur électrique va baisser et le thermique passer à un palier / régime supérieur
et plus le régime est élevé, plus la conso est importante, donc pour maintenir 130 le thermique se retrouve à un régime soutenu qui va sur consommer, et va faiblement être aidé par l’électrique car la batterie a été vidée à l’accélération, et à vitesse stabilisée elle va pas se recharger lors de phases de décélération comme elle le fait en ville ou sur des routes “de campagne”
(c’est surtout des suppositions hein, si je me trompe je serai ravi d’avoir les explications correctes :) )
#113.4
C’est à peu près ça. :)
En complément le moteur électrique est plus efficace pour fournir du couple (il restitue mieux l’énergie consommée) alors que pour maintenir ton véhicule à vitesse constante, le moteur thermique est plus efficace.
Je démarre au feu 100% électrique
Je dois accélérer le moteur thermique est assisté par l’électrique
Je roule a vitesse constante, répartition de la puissance entre le thermique et l’électrique en fonction de la vitesse. Plus je vais vite, plus le thermique est prépondérant.
edit : J’oubliais, la voiture descend une côte ou freine, je recharge la batterie du moteur électrique.
#114
On dit un peu la même chose, non ?
Un taxi en Yaris ?
Perso, je serais adepte. Je prends régulièrement le taxi ou des VTC, c’est plutôt la grosse berline leur véhicule, quand une Twingo ferait largement le job.
Je vote pour ! Ca concernerait à vu de nez plus de 90% du parc. Voiture la plus vendue: Peugeot 208, une compacte qui dépasse de 200kg cette limite.
L’hybridation entrainant de fait un surpoids, je ne te suis pas.
Qu’appelles-tu carburants de synthèse?
Et les pistes cyclables réellement sûres ?
#115
Bah oui, les casses vont vite devenir des acteurs économiques majeurs vu le marché des véhicules d’occasion. /s
La batterie de VE dure souvent plus longtemps qu’une voiture à explosion complête, et une fois changée c’est reparti pour 300 000 km presque sans entretient.
Les VE sont développés car les contructeurs y ont été forcés (hors Tesla) par l’UE en les y trainants malgré leurs cris et leurs gémissements de boomers incapables d’imaginer autre chose que le monde dégueulasse et auto-desctructeur qu’ils ont construit.
Tu vas être surpris Tu serais aussi peut-être surpris de l’argent qui est mis pour développer et entretenir les infrastructures pétrolières (y compris par l’État).
Tu serais aussi peut-être surpris de l’argent qui est mis pour développer et entretenir les infrastructures pétrolières (y compris par l’État).
Non pas qu’il n’y a pas de gros défis à relever, mais ça n’est même plus un choix aujourd’hui et la transition à déjà commencée.
Le moteur à explosion a une efficacité maximale d’environ 35% (beaucoup moins au démarrage). Il n’est plus efficace qu’un moteur électrique dans aucune circonstance.
#115.1
je pense qu’il parle de la configuration retenue par le constructeur dans ce cas précis : un moteur électrique dont la vitesse de rotation max permet une vitesse du véhicule de 130 km/h va pas avoir la même “patate” quand tu vas écraser la pédale à 120 que ton vieux thermique avec boite manuelle quand tu le faisais monter dans les tours, il va donc donner l’impression d’être moins “efficace”, sauf que l’efficacité mathématique n’a pas grand chose à voir avec l’efficacité “ressentie”
#116
En incluant l’efficacité du moteur thermique qui sert à produire de l’électricité dans la centrale et l’efficacité du transfert dans les batteries ?
Les Hybrides sont autonomes, c’est le thermique et l’inertie qui rechargent la batterie du moteur électrique.
#116.1
le système hybride permettent au véhicule complet de se rapprocher du rendement du moteur thermique maximal : au lieu de faire tourner le moteur à un régime ou il est moins efficace, il tourne à un régime plus intéressant et charge une batterie, comme ça il peut être coupé un peu plus tard quand la batterie est suffisamment chargée et peut prendre le relais
en donnant 10kWh de carburant à un moteur thermique (~ 1l) et on peut récupérer au mieux ~3kWh d’énergie mécanique
en donnant 10kWh d’électricité à un moteur électrique et on peut récupérer > 7kWh d’énergie mécanique (je prend large avec des pertes depuis la batterie, un système bien optimisé ça sera >9kWh)
l’idée de l’hybride (attention, c’est la théorie de ce qu’on pourrait faire, ça peut être différent de ce que font les constructeurs, et je vais utiliser des chiffres très approximatifs pour illustrer et calculer facilement) c’est d’obtenir un truc dans le genre :
quand tu traîne dans les bouchons ou à petite vitesse, le moteur va avoir un rendement entre 5 et 15 % (comptons 10, dans cette situation le moteur à pu extraire 1kWh d’1l de carburant)
si au lieu de ça on le fait travailler un peu plus, à un régime ou il fourni 20% (ou encore mieux, 25, ou …) et qu’on récupère le delta en chargeant une batterie, le moteur a été capable d’extraire 2kWh du même litre de carburant, 1kWh est partie comme avant dans les roue, le surplus a été récupéré par la “dynamo”, même si y’a 50% de pertes d’énergie pour la conversion vers la batterie, stockage, puis restitution depuis la batterie vers un moteur électrique, on va pouvoir avoir utiliser de manière utile 1.5kWh depuis notre litre de carburant, 1 directement en “thermique”, et les 0.5 “bonus” qui sont passés par la batterie avec les pertes de conversion mais en faisant travailler le moteur à un régime plus efficace
pour quelqu’un dont les trajets permettaient au moteur de tourner à son rendement maximum de presque 30% en permanence, l’hybride n’apportera probablement pas de gain visible, mais pour qqn qui se retrouve dans des situations ou le moteur est à un très mauvais rendement, c’est “assez simple” de constater un gain
#117
Oui. Dans le pire des cas (100% d’énergie provenant des centrales à charbon, ce qui n’est pas le cas en Europe et encore moins en France) l’efficacité énergétique totale est équivalente à une voiture à essence . En UE et aux US, le mix énergétique actuel rend un VE intéressant, énergiquement et pour le climat, en comparaison d’un véhicule à explosion.
#117.1
Oui mais non.
Seule une source decarbonnée rend pertinent l’usage d’une VE.
Déplacer le combustible du capot à la centrale n’améliore donc en rien le rendement (cela aurait tendance à le dégrader d’ailleurs) et est suceptible d’émettre plus de CO2 pour tout un tas de raisons bien connues : fumisterie laxiste des exploitants de centrale au charbon, pertes par effet joule sur les lignes proportionnelles à l’accroissement de la consommation electrique du pays, dépendance “géostratégique” au gaz dans certains cas…
Le bilan n’est pas convenable.
Pour que l’europe arrête de mentir à ses usagers de la route il va en falloir des compétences en gestion de réseau electrique, des démissions à la pêle des pseudo-gestionnaires plus autoritaires que serviables, des nouveaux compteurs, une couche d’automatisation “verte” à destination des pics de prod’renouvelable etc.
On est loin d’avoir mis à la poubelle les mauvaises habitudes encouragées par une gestion strictement commerciale du réseau Européen sans recul ni questionnements scientifiques à ce sujet de la part des instances gouvernantes…
#118
Rien contre les pistes cyclables sûres. Mais, bon, mettre à vélo tous ceux qui utilisent un voiture, je n’y crois pas.
#119
Je sais, la Picanto de ma chérie fait moins de 900kg. Mais ça fait un rapport poids du véhicule/poids de la jolie femme désespérant. Plus de 90% de l’énergie consommée sert à bouger la bagnole, qui est un des modèles les plus légers commercialisés.
Je ne connaissais pas et pourquoi pas. Mais tant que ça sert à déplacer 1T de bagnole pour 100kg de charge utile, ça reste très peu efficient. Le CO2 rejeté n’est pas le seul problème que pose la bagnole. Le bruit, l’odeur, la surface au sol… , l’artificialisation des sols pour les faire rouler.
On parle d’automobile pour un truc qui n’est mobile au max que 10% du temps.
On en revient à “si ceux qui peuvent”. Et il y aura plus qui pourront s’il y a des pistes cyclables correctes.
#120
Ah ! Enfin !
On adresse enfin directement les coûts complets du produit, de la pollution du produit en intégrant l’ensemble de son cycle de vie.
Le tout-électrique signifie tout-électronique (car c’est comme cela que l’on pilote l’alimentation, la distribution de l’énergie, ainsi que l’on contrôle tout, quand bien même ce n’est pas absolument nécessaire), et tout-batterie.
Les batteries & l’électronique sont AMHA bien plus polluants que certains équipements “à l’ancienne” une fois que l’on recouvrera un peu d’honnête et que l’on se calmera de cette panique d’anticipation climatique (qui est de toutes façons couplée à de l’attentisme égoïste).
Les vrais actions écologique sont d’abord les poncifs : éviter de (faire) produire ce dont on peut se passer. Ce la va du téléphone dit intelligent aux décorations & gadget en passant par les trottinettes & vélos électriques, une véritable aberration pour l’écrasante majorité des usages.
#121
C’est pas faux.
Mais c’est une leçon dont devrait se nourrir les ayatolahs du 30kmh en ville.
Ou des véhicules électriques reconnus comme tel et en site propre. Comme les bus quoi.
La transition non-logique a bien pris dans nos villes je trouve.
#122
Le poids c’est vraiment pas une métrique intéressante. Un TGV fait aussi environ une tonne par place passager, si bien qu’un TGV même rempli à 100% déplace une tonne de matos pour 50 à 100kg d’humain. Lorsque le TGV n’est rempli qu’à 75%, c’est même 1,5 tonne apr passager. Plus que la plupart des gros SUV à la mode. Et pourtant il ne vient à personne l’idée de dire que c’est une folie énergétique ou écologique.
#122.1
Le TGV roule à 300km/h.
Il aurait une masse deux fois plus grande que ce ne serait toujours pas un problème écologique.
En revanche, rouler à 30kM.h en ville avec un pot de yahourt d’une tonne au diesel euro 6 pollue plus qu’un SUV V6 à 70kM.h. de 2 tonnes.
Le rendement n’est pas maitrisé par tout le monde…
Non.
Si considérer qu’avoir la moitié de l’Europe au fossile est une réussite alors les chinoiskifonpire vont 4x plus vite que nous pour installer la P renouvelable nécessaire à leurs VE.
Chez eux ou chez nous le VE est un non-sens dans les pays encore dépendants à + de 50% du fossile.
Pas la peine d’essayer de défendre le contraire. En revanche, j’en conbiens, en France, Grande Bretagne et un peu l’Espagne, rouler en VE a du sens.
A partir de 70% de non-émission de CO2 c’est convenable.
Donc aux US ou au Canada c’est le même topo : dans un rayon de 300km d’une centrale hydrolique ou nucléaire la VE devrait être gratuite pour tous.
C’est pas comme si les 11.000 morts de la canicule l’été dernier n’existaient pas. :/
#123
Ça tombe bien, l’électricité française (et européenne) est une des plus décarbonnée du monde - et continue à se décarbonner rapidement ce qui implique qu’un VE sera de plus en plus intéressant.
Diverses études ont par ailleurs montré et démontré qu’avec le mix énergétique actuel aux US ou en UE, un véhicule électrique réduit déjà significativement les emissions (voir simplement l’article que nous commentons par ex. 😉 ).
Il est cependant clair que la montée en charge demandera des investissements dans le réseau électrique.
#124
Je te suggère de monter dans qql VE et de voir la reprise à 120 avant de dire ça.
Dans certains cas, pas d’impact (hydro, solaire, éolien), dans un autre cas (nucléaire), cette notion est irréaliste (tu ne fissioneras pas des atomes directement dans ton moteur pour faire avancer ta voiture), et dans le reste des cas, la génération électrique a un rendement supérieur à un moteur de voiture (40 ou 45% pour le charbon, +de 50% pour le gaz). Sans oublier le coût énergétique pour produire et livrer le carburant liquide (~25% du potentiel thermique d’un litre de carburant). Tu as aussi qql pertes de transport et conversion du courant, mais globalement ça reste largement au dessus du thermique.
Il faut remplir le réservoir quand même. À ce compte là, le véhicule électrique est autonome ;-)
Alors qu’on se passe bien de le faire pour le véhicule thermique.
L’électronique est bien plus polluante que les batteries (mais en masse bien inférieure), et il y a en a aussi plein les véhicules thermiques (pour gérer l’injection, les régimes moteur et un tas d’autres paramètres qui n’existent pas dans un VE). La construction du VE reste plus énergivore et émissive, mais se compense très rapidement au roulage.
L’honnêteté commence sans doute par arrêter de multiplier par 2 tous les inconvénients du VE en passant sous silence ceux du VT…
J’ai rarement lu qqch qui commence assez bien et finit aussi mal. Un VAE ou une trottinette électrique qui permettent de remplacer des trajets en voiture, c’est tout bénéf (bien plus qu’une VE)
Apparemment les unités non plus…
Comme ils ouvrent autant de capacité de charbon et en extraient toujours plus, je ne dirais pas ça.
cf. les liens notamment vers les références citées par T&E que j’ai envoyées quelques pages plus haut.
#124.1
Il y a aussi le paramètre pertes thermiques issues du nucléaires à analyser.
En admettant qu’on déporte 20% d’énergie primaire sur nos centrales les besoins en refroidissement vont devenir énormes passé certains seuils.
Il n’est pas certain que la fillière renouvelable couvre le surcoût à terme puisque nous avons déjà 30% d’écart dans le négarif avec nos voisins sur la puissance installée.
Quant à l’énergie thermique dissipée par le véhicule electrique, plus lourd à chassis comparable, la récupération du moment d’inertie ne suffit pas non plus à me convaincre de l’utilité de tout électrifier de cette façon.
Un jour il faudra comprendre que les limites à la substitution sans effort personnel existent. Sur les transports c’est déjà atteint depuis la fin du 19ème : il faudrait plutôt faire des wagons batteries pour les TER diesel que de filer 7000 balles à Tartempion.
Mais chacun n’a pas le même sens des priorités lorsque la fièvre ne cesse ne grimper.
#125
Le nombre de tours minute d’un moteur non plus.
Quelle est donc la provenance des batteries ? Oh surprise…
J’avais posté mon calcul en brève il y a quelques jours.
Je reste sur mon avis que passer de 60 (pour un diesel) à 44% de pertes thermiques est une hérésie électrique.
Il faudrait séquencer les charges avec des heures renouvelables et vérifier l’évolution du parc automobile en adéquation avec la capacité de prod renouvelable.
Sinon on est d’accord qu’en Chine ou ailleurs les mixs ne sont pas adaptés. Le gain restant est minime et déporte un peu plus les problèmes ailleurs qu’entre les mains de l’utilisateur final : extraction immodérée du lithium + alentours enfûmés des centrales thermiques + gachis des chassis thermiques non retrofités etc.
#126
C’est bien ce que je dis, le poids n’est pas, en soi, une métrique très intéressante.
#127
Source ? Ce genre de chose ne se décrète pas au doigt mouillé en fonction d’impressions personelles..
De nombreuses études ont montré que oui, les VE sont bénéfiques en terme d’emissions même si le mix énergétique n’est pas parfait, et sont bénéfiques dans presque tous les pays d’UE et à peu près tous les états américains.
Cet outil permet de comparer les emissions de différents véhicules sur leur cycle de vie en changeant plusieurs critères.
https://www.carboncounter.com/#!/explore
On peut constater que quelque soit l’État américian où on se situe les VE restent largement bénéfiques.
Il y a aussi cette étude qui compare les emissions sur le cycle de vie en fonction du mix énergétique local. Sont comparés Europe, US, Chine et Inde.
https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/12/Global-LCA-passenger-cars-jul2021_0.pdf
Encore une fois on peut constater que les VE sont largement bénéfiques, aux US comme en Europe. C’est beaucoup moins le cas en Chine actuellement d’après cette étude, mais leur mix énergétique devrait s’améliorer dans le futur.
#128
Les ACV sont des impressions personnelles. Ce n’est pas car l’industrie déclare N qu’un labo aux équipements étalonnés + contre analyse le certifie et déclare donc que N est vrai.
Oh non.
Fais un tour sur electricity map. Multiplie la conso en kwh annoncée par ton scénario d’usage (recharge à domicile en 6 heures par exemple).
A la grosse ton résultat n’est pas très loin d’un turbo diesel en émissions de CO2 à l’exception des pays que j’ai noté.
Sur les émissions de particules de freinage et pneumatiques le gain est cependant intéressant (à peine 45%). Mais il faudrait par exemple vérifier que la substitution par de l’électrique permet de tenir les engagements de l’OMS.
Vu les niveaux actuels en métropole c’est plus vite dit que fait. Sans compter que la chaleur primaire nécessaire va se retrouver ailleurs qu’en ville. Par exemple dans le Rhone déjà bien chaud cet été. Bref.
Sans intégrer la pollution thermique ce calcul n’a aucun sens.
D’autre part les EQ CO2 ne peuvent pas se comparer à des émissions de CO2 directes… le mix américain émet du CO2 lors de la production électrique au diesel, gaz, et charbon. (la californie est l’exemple le plus évident de flexibilité foireuse).
Je n’ai pas retrouvé leurs sources.
Et je fais donc la même remarque : méthodologie douteuse.
#129
Chine, Corée, USA, et l’Europe qui monte en puissance. Croire que 100% des batteries viennent de Chine est une infox de plus contre le VE. Celui-ci fait depuis qql mois les frais d’une attaque de désinformation digne (voire pire) de ce que subit le nucléaire depuis 30 ans.
Il y a nettement plus de 60% de pertes dans un diesel. En moyenne, c’est 70%, d’un litre de carburant qui lui inclut 25% de “pertes” pour être produit et distribué. Ça donne une chaîne à environ 22.5% de rendement (le seul truc pire, ce sont les carburants liquides de synthèse).
Les pertes thermiques du nucléaire (ou de toute centrale thermique) ne sont pas nécessairement des pertes (cogénération, par exemple dans des serres chauffées à la centrale du Bugey), cet usage peut (doit) se développer pour des réseaux de chaleur (ça résoudrait un paquet de problèmes pour l’hiver).
Où y-a-t’il de l’énergie thermique à dissiper dans un VE ? Il va falloir que tu m’expliques.
Il me semble que tous les détracteurs du VE trouvent déjà que c’est un effort insurmontable de lâcher leur pétrolette affublée de tous les avantages. Moi je suis preneur d’autres solutions, mais il va falloir faire notamment mieux que 250 millions d’euros annuels pour le vélo quand on en crame littéralement plusieurs milliards par mois pour soutenir l’achat de combustible fossile (et des10es de milliards en travaux de voirie pour les voitures, etc.)
Pourquoi des wagons batteries pour les TER (ou tant qu’à aller dans le n’importe quoi, des piles à combustibles) alors que les voies ferrées sont alimentables par câbles ?
Merci ! Il y a une vraie fixette sur le poids des véhicules (uniquement depuis l’avènement du VE en fait, et uniquement en ciblant ce dernier), qui passe à côté des éléments essentiels comme l’efficience notamment l’aérodynamique qui est de loin l’élément critique en électrique.
#130
https://www.carboncounter.com/#!/explore
Le calcul intègre la pollution liée à la production d’électricité, et tous les détails sont dispos avec un minimum d’effort, incluant le papier qui explique la méthodologie et donne toutes les sources.
Le but du CO2e est de comparer l’impact sur le climat, donc en ce sens la comparaison est pertinente. Mais il est vrai que les VE ont l’avantage d’éloigner la pollution des centres urbains, ce qui n’est pas refleté dans le CO2e (comme d’autres types de pollution).
Il faut aller aux références à partir de la page 58
Il semble que ceux qui ont fait le calcul sérieusement et pas au doigt mouillé, en prenant en compte s’ensemble du cycle de vie et la production d’électricité, sont arrivé à la même conclusion : les VE sont bénéfiques pour le climat sur leur cycle de vie à peu près partout en Europe et aux US. Bien sûr le bénéfice s’accroit quand le mix électrique verdi.
#131
“Que vient faire une voiture en ville ?” reste ma première question.
Si. Et économique aussi. Et en terme d’aménagement du territoire du grand n’importe quoi. TGV Haute Picardie est un exemple.
#132
Ce n’est vraiment pas récent que je pointe le rendement grotesque de la voiture individuelle.
En tant qu’ingénieur, une telle inefficience me choque.
#133
Les personnes qui critiquaient l’embonpoint des véhicules avant que ça serve d’argument (assez pété en pratique) contre le VE sont assez rares. Et comme ça a été rappelé plus haut, c’est le cas aussi du train (TGV : >1T/passager en fonction du taux de remplissage). Pour pouvoir aller vite, et rester en sécurité, il y a quantité de systèmes mis en œuvre, donc du poids. Potentiellement, on pourrait limiter plus les vitesses pour limiter cette nécessité (et requérir un bridage hard des voitures), mais vu le résultat du passage de 90 à 80, je vais te laisser aller proposer ça à nos gentils 40M d’automobilistes ;-)