Elles promettent de livrer paquets de pâtes, bouteilles d’apéro et rouleaux de PQ sur le pas de votre porte en 10 ou 15 minutes. Mais en réalité, les start-ups du « quick commerce » ne s’engagent pas formellement sur les délais de livraison. Nous avons épluché les conditions générales de Flink, Gorillas, Getir et Gopuff.
Se faire livrer des courses à domicile en moins de 15 minutes, est-ce bien raisonnable ? Ce service, que proposent à grand renfort de publicités, une poignée de start-up dans le cœur des grandes villes, attire les critiques.
Elles portent tantôt sur la pression mise sur les livreurs chargés de tenir les délais, tantôt sur les nuisances qu’occasionnent la multiplication de leurs entrepôts dans les villes, tantôt sur l’absurde accélération de nos modes de vie ainsi encouragé.
À cet éventail de reproches, il faudra en ajouter un nouveau : la livraison ultra-rapide promise n’est pas vraiment garantie. C’est ce que l’on découvre si l’on se plonge, comme l’a fait Next INpact, dans les foires aux questions et surtout les conditions générales de vente des acteurs du « quick commerce » (c’est le nom donné à ce nouveau service).
L’écart entre le contenu de ces conditions, qui sont un document juridique-clé, et les slogans publicitaires est patent.
De « quelques » minutes à « trente » minutes, voire « deux heures »
Ainsi en grosses lettres noires, le site de Gopuff promet une « livraison de courses en quelques minutes ». Dans les petits caractères, l’entreprise américaine, qui livre à Paris, Lille et Marseille, se révèle nettement moins optimiste : le délai est « d’environ vingt à trente minutes à compter de notre accusé de réception de votre commande » (Terms&Conditions de Gopuff, rubrique « Délai de livraison »).

A gauche, la page d’accueil du site web de Gopuff, à droite un extrait des conditions générales
C’est encore pire chez Getir, présent dans cinq agglomérations de l’hexagone. Alors qu’il fait miroiter une livraison « en quasi 10 minutes », les conditions générales indiquent une tout autre limite : « Nous ferons notre possible pour vous livrer dans les deux heures au plus tard » (article 6.2 des conditions générales de service). Dix minutes ou deux heures ? Il faudrait savoir !
Au-delà de ces deux exemples – les plus caricaturaux que nous ayons repérés –, les conditions générales prennent bien soin d’amoindrir la portée des promesses publicitaires. Les documents contractuels ne se contentent pas de mentionner les accidents de la circulation et problèmes météo, « indépendants de notre volonté », qui peuvent retarder les livraisons – une précaution qui peut se comprendre.
Un délai allongé si « notre entrepôt est très occupé »
Ils indiquent aussi que le délai dans lequel les sites s’engagent à livrer n’est pas celui avancé dans les slogans. Il s’agit de celui affiché au moment précis de la commande, qui peut donc varier selon, l’afflux de clients. C’est Flink qui le précise le plus clairement (article 5 des conditions générales de vente) : « Sur nos plateformes, un délai de livraison approximatif est indiqué à titre indicatif. Le délai que nous engageons à respecter est celui indiqué à l’issue de la commande ».
« Approximatif », « indicatif » : autant de termes pour signifier qu’il ne faut pas prendre le slogan publicitaire au pied de la lettre ! Concrètement, Flink laisse espérer une livraison « en quelques minutes » (page d’accueil du site), ou « en dix minutes » (publicité dans le métro parisien). Mais pour l’acheteur, le délai pourra être bien plus long « si notre entrepôt est très occupé ou que nous manquons de livreurs », ajoute la FAQ de Flink.

Un flyer publicitaire de Flink, distribué en région parisienne
Obligations de moyens ou de résultats ?
Autre élément qui semble rendre évanescent l’engagement de délai de livraison : en substance, les contrats disent « On fait ce qu’on peut, mais on ne garantit rien ! ». Cela se vérifie chez trois des quatre acteurs dont nous avons épluchés les contrats :
- Gorillas : « Gorillas fait ses meilleurs efforts pour livrer les commandes dans les délais indiqués dans la confirmation d’expédition » (article 6 des conditions générales de vente)
- Getir (clause déjà citée) :« Nous ferons notre possible pour vous livrer dans les deux heures »
- Flink : « Nous nous efforçons de livrer le plus rapidement possible » (article 5 des conditions générales de vente)
Ces expressions visent, pour les sites, à (tenter de) se dégager d’une obligation de résultats sur le délai, au profit d’une simple obligation de moyens. Autrement dit, les promesses de livraison en 10 ou 15 minutes n’engagent que ceux qui les écoutent…
Naturellement, ces clauses ont pour fonction, pour l’entreprise, de se protéger contre les clients impatients et procéduriers, qui voudraient se plaindre d’une livraison trop longue. Elles servent de parapluie, en quelque sorte.
Des plaintes, mais pas tant que cela
Pour autant, les acteurs du « quick commerce » peinent-ils à livrer aussi rapidement qu’ils le promettent ? Un coup d’œil sur les avis de consommateurs en ligne permet de trouver des plaintes sur cet aspect.

Dans les avis sur le Play Store de Google, certains se plaignent d’être livrés en 30 ou 40 minutes au lieu des 10 minutes espérés.
Mais elles ne sont pas si nombreuses. Les mécontentements portent au moins aussi souvent sur d’autres aspects : bugs des applis, codes promotionnels ne fonctionnant pas, produits indisponibles… Et on trouve aussi des avis des clients épatés par la rapidité de livraison.
Même en l’absence de vague massive de plaintes, ces clauses surprenantes montrent que les promesses de livraison rapide sont fragiles. Elles servent surtout à capter l’attention et les clients dans un marché jeune mais très encombré. Et tant pis si le contenu réel des contrats et, parfois les délais constatés sur le terrain, sont un peu moins jolis que la vitrine publicitaire !
Le décalage entre la pub et le contrat, passible de poursuites ?
Si les acteurs sont nombreux à s’être lancés dans ce jeune secteur d’activité, l’écrémage s’est sérieusement accéléré ces dernières semaines avec la disparition ou le rachat d’acteurs comme Kol, Yango Deli ou Cajoo (dont l’appli vient de fermer, rachetée par Flink). Dans ce contexte, mener une communication loyale et en cohérence avec ses propres conditions générales de vente n’est sans doute pas la priorité de ces sociétés…
Mais la méthode n’est pas sans risques. Un tel décalage entre la promesse publicitaire et la réalité des contrats expose ces professionnels à des accusations de pratiques commerciales trompeuses. Interdites par le code de la consommation, elles sont punies de deux ans de prison et d’une amende pouvant atteindre 300 000 euros, pouvant même être portée à 10 % du chiffre d’affaires de la société.
Dans un secteur différent, celui du tourisme, les services de la Répression des fraudes ont assigné un acteur l’été dernier pour un procédé similaire. Spécialisée dans les annonces de locations de vacances, Abritel s’était vu reprocher des pratiques commerciales trompeuses, en raison d’une « communication commerciale vantant (…) la fiabilité (…) et les garanties d’utilisation de la plateforme, en contradiction avec les conditions générales d’utilisation, qui en réduisent la portée effective ».
Un tel précédent devrait inciter les acteurs du « quick commerce » à nettoyer leurs conditions générales. Ou à modérer leurs slogans publicitaires…


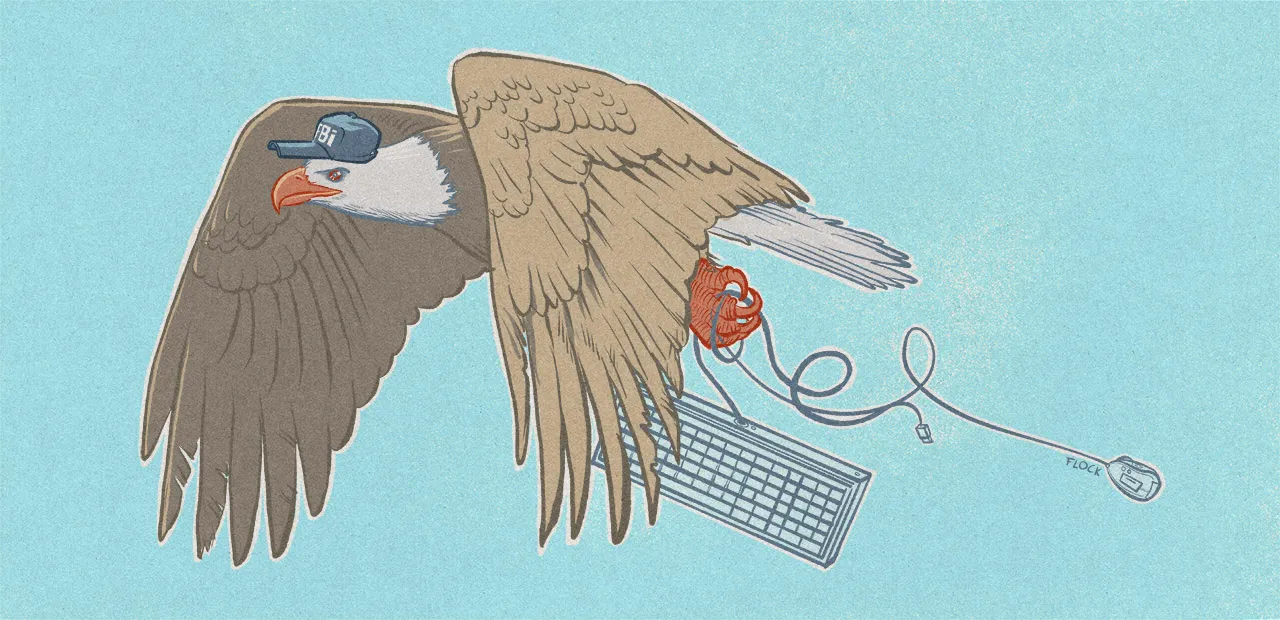
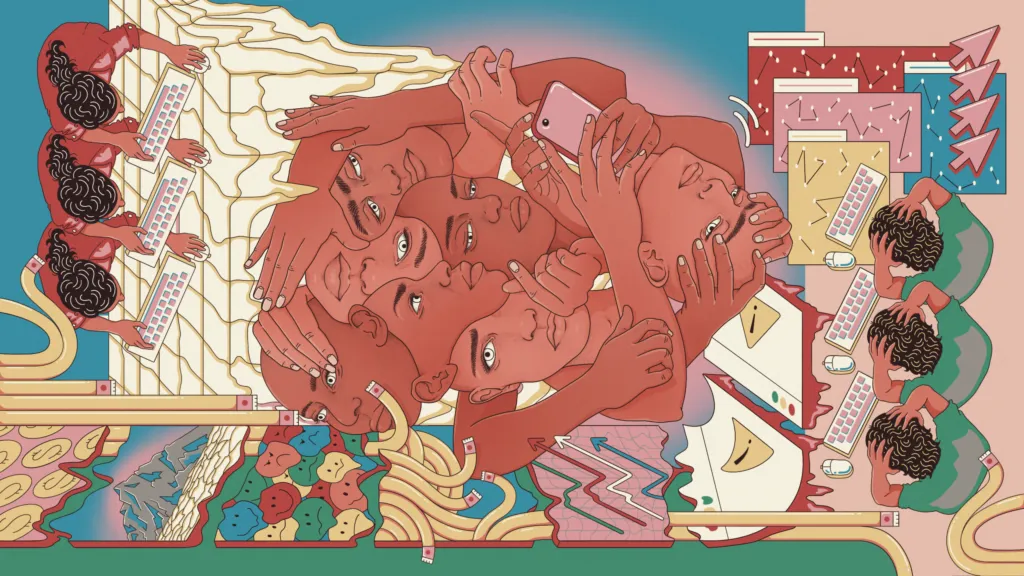
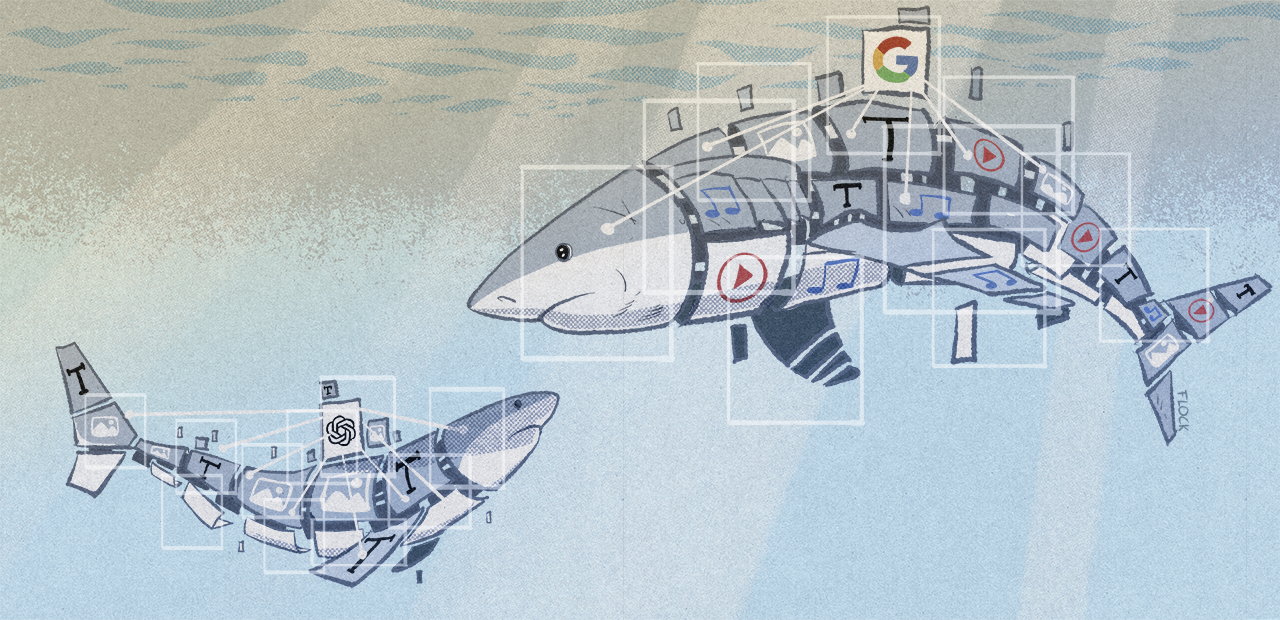

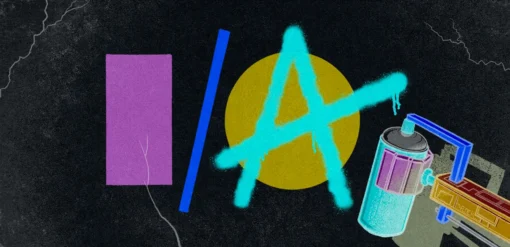

Commentaires (33)
#1
Voilà le genre de service dont je cherche l’utilité. Mais admettons que je puisse avoir besoin d’une boîte de sardine en urgence.
J’habite en ville. Le temps de prendre le PC, de passer ma commande et de la payer, c’est le temps qu’il me faut pour aller chez l’épicier. Le temps d’acheter la boîte et de rentrer sera inférieur au temps de livraison.
J’ai eu, quand j’ai été malade, envie de tester un service de courses à domicile. Deliveroo m’a livré les courses d’un supermarché proche.
Bref, je mettrais pas un kopek dans ces startups.
#1.1
C’est un de nos nombreux maux modernes : glorifier la paresse au nom de la consommation immédiate et du tout maintenant.
Perso je n’aime pas ces services et refuse de les utiliser. Tout comme je me refuse d’aller dans les commerces le dimanche. Autrefois, un commerce était “exceptionnellement” ouvert un dimanche ou jour férié. Aujourd’hui, un commerce est “exceptionnellement fermé” un jour férié. Perso ça me dérange d’entendre ça à chaque fois, je me dis qu’on a perdu quelque chose.
#1.2
C’est exactement ma pensée !
#1.3
Ca dépend. Un magasin de bricolage fermé le dimanche, c’est pénible. Quand on se lance dans des travaux et qu’on se rend compte qu’il manque quelque chose, c’est penible de perdre une semaine parce que bcp de monde rentre tard en semaine, qu’on est dimanche et que “c’est fermé”.
Par contre, pour des “courses” classiques, ou tout ce qui ne tourne pas autour des loisirs, je suis assez d’accord : l’ouverture le dimanche, ca devrait être exceptionnel. Quant à la glorification de la paresse, tout à fait d’accord aussi. Même pour les commandes en ligne, généralement, on n’a pas besoin d’être livré en 24h.
#1.4
Pour en revenir à l’article j’ai vraiment du mal à voir l’intérêt de ces services. En général, ils existent dans des zones de fortes densités de population (pour avoir une masse critique de clients) qui disposent déjà d’une forte densité de commerce de dépannage. Après je suis le type qui installe 10 fois par an deliveroo et qui au final va chercher sa nourriture à pied
#1.5
Idem, je n’aime pas la tendance de ces services: tout doit aller vite, de très nombreuses personnes deviennent impatiente dès qu’il y a de l’attente même pour quelque chose de pas urgent. Aujourd’hui dans la plus part des entreprises si tu ne réponds pas dans les 30 minutes qui suit la réception d’un mail on se fait engueuler.
Je ne vais pas dire que les années 90 c’était mieux cependant je trouve que les gens sont beaucoup plus impatients et veulent tout tout de suite, quitte à harceler et insulter.
#1.6
Je suis on ne peut plus d’accord… Et j’ai aussi vécu des situations horribles causées par cette folie de toujours vouloir avoir tout tout de suite. J’ai eu un directeur de projets de ce genre qui harcelait constamment sur des projets d’intégration que j’ai conduit. Du genre à peine tu envoies la demande aux équipes opérationnelles qu’il te dit d’aller les voir pour accélérer le pas… Alors que dix minutes avant j’ai discuté tranquillement avec le type en lui demandant “tu penses le faire pour quand ? 2 jours ? ok”. Résultat des courses, j’ai eu mon truc le lendemain sans rien demander.
Il faut dire que j’ai aussi subit ce genre d’énergumène quand j’étais admin en production… Donc j’ai toujours fait en sorte de ne pas tomber dans ce travers improductif (tu braques les gens en faisant ça, résultat ils ne feront que le minimum syndical et réaliseront ton action 2 minutes avant leur SLA).
#2
Alors qu’il fait miroiter une livraison « en quasi 10 minutes », les conditions générales
indiquent une tout autre limite : « Nous ferons notre possible pourvous livrer dans
les deux heures au plus tard » (article 6.2 des conditions générales de service)
faut pas pousser

dans cas là, je me livre moi-même !
#3
Est-ce que NXI ne pourrait pas transmettre les suspicions à l’UFC-Que-Choisir, ou une autre asso chargée de faire valoir les droits des consommateurs ? Ils pourront surement savoir si les poursuites sont possibles ou non, et éventuellement se charger d’instruire un dossier, pour arrêter ces allégations débiles …
#4
Ah, les CDG… J’ai une fois commandé un petit périphérique indiqué en stock et livré en 72h. Mais les CDG indiquaient un délai de traitement de 5-6 jours (ouvrés ou ouvrables, je sais plus). Bref 2 semaines.
(épilogue: j’ai reçu un produit de la mauvaise couleur à J+25, le commerçant a été condamné par la justice)
#5
Personne ne travaille de 9h à 19h six jours sur sept.
Oui, les commerces ouverts le dimanche, les exploités qui livrent comme des dératés en deux roues, et le “petit personnel” de manière générale c’est “pratique”.
Mais si on est un minimum droit dans ses pompes, on accepte de renoncer à faire appel à ces services et attendre quelques jours pour récupérer son truc de bricolage ou se le faire livrer dans la semaine.
D’autant que faire des travaux le dimanche, s’ils génèrent des nuisances sonores (par exemple “planter un clou”) est rigoureusement interdit par l’énorme majorité des municipalités, ou autorisés dans des périodes très courtes (genre “de 10h à midi”).
#6
J’ai toujours du mal à piger aussi ces “besoins urgents”. Est-ce que ce ne serait pas plutôt parce que se faire livrer dans l’heure est pratique parce qu’on sait qu’on sera là pour la recevoir ? Et donc que demander une livraison moins rapide mais à une heure précise pourrait correspondre à ce besoin en étant bien plus gérable ?
Je suis du même avis, une société où les gens ne trouvent plus que le dimanche pour aller dans les commerces, c’est qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
C’est pénible aussi pour le personnel de rater des occasions de voir leurs amis le dimanche pour qu’on puisse aller 3 fois dans l’année chercher le truc qui nous manque (et qui souvent coûte 2 €, donc ne rapporte rien au magasin). Et pour eux c’est pénible toute l’année.
On peut dire la même chose des ouvertures nocturnes pour les endroits où il y en a.
C’est quoi les CDG ?
#6.1
Pardon, je voulais dire jes CGV (conditions générales de vente).
#6.2
Pour le coup il y’a déjà des gens qui doivent logiquement travailler le dimanche (ex : la santé) et les magasins de bricolage, c’est selon moi dans la limite acceptable : énormément de gens ne peuvent pas bricoler les autres jours, surtout lorsqu’il s’agit de travaux exceptionnels. Pire encore, il faut pouvoir parer aux travaux d’urgence (ex : fuite d’eau, fusible grillé, WC bouché ou chasse d’eau petée, … - tous ces trucs là arrivent toujours le dimanche ou les fériés comme par magie)
Après le travail le dimanche ça peut s’organiser en rotation, avec des primes…
Ici madame bosse un dimanche sur deux (santé), mais on peut imaginer que le Castorama du coin puisse tourner avec 1⁄4 du personnel par exemple (si uniquement caisse auto).
Mais je concède qu’à part le bricolage et les restos, je vois pas trop de commerces où ça serait vraiment acceptable.
#7
Qu’est-ce qui empêche les indépendants de le faire?
#8
Non, seulement cinq jours sur sept et jusqu’à 18h.
Mais le soir, il faut rentrer faire la cuisine, manger et faire un peu de bricolage, de ménage ou s’occuper du linge avant qu’il ne soit trop tard pour faire du bruit.
Et le samedi je me repose, sors et me détends avec des amis.
Donc oui, parfois je suis content que les magasins soient ouvert le dimanche (mais j’essaye au maximum de faire mes courses en semaine).
Et je ne me fait jamais livrer du local.
Un aéroport ? (mais j’en connais qu’un seul )
)
Conditions générales, j’imagine.
#9
Si les indépendants/libéraux, ainsi que de nombreux cadres qui sont au forfait jour donc sans horaire mais devant remplir leurs missions.
En théorie, ces gens-là pourraient s’absenter une heure sur leur temps de travail, en pratique…
#9.1
Si une personne bosse 60h par semaine et qu’en plus elle doit elle même par nécessité changer son robinet ou faire des retouches de peinture j’espère que c’est une situation qui n’est que transitoire sinon autant être salarié lambda.
#9.2
Tu viens de résumer le ressentit des libéraux et autres entrepreneurs.
Sauf que ce n’est pas transitoire.
Doit tu arrives à négocier avec ton client comme SebGF, soit tu ne peux pas car ton boulot est en relation avec le public et tu sous être présent durant l’ouverture.
Notez que certains sont contraints légalement d’être ouvert/astreint le dimanche. Donc connaisse le coût social du travail le dimanche.
#9.3
Je pense tout de même que l’élargissement qu’on impose à certains professionnels (artisans, libéraux, commerçants, …) depuis quelques décennies sont plus dues à une frustration mal gérée de clients qu’autre chose. Bien sur que certains doivent permettre un accès (collectivement bien sur) 7/7j 24/24h aux usagers/clients, je pense au monde médical (médecin, pharmacie, vétérinaire, …), mais aussi à la sécurité des biens et des personnes (service de secours/incendies, police, justice, …) mais franchement avoir besoin de son expert comptable le jeudi à 23h30 (oui il y a des astreintes offertes dans certains cabinets maintenant) ou d’un lot de bougies un dimanche matin en dernière minutes ça m’échappe un peu.
Enfin bon c’est le progrès parait-il. Heureusement je suis dans une région dans laquelle le dimanche est encore à peu près respecté.
#10
+1
Perso, j’essaye de ne pas faire marcher les commerces le dimanche, j’ai des membres de ma famille qui bossent ces jours là et je ne les vois guère.
#11
En pratique j’y arrive (pas toujours, mais ces cas sont heureusement rares et raréfiés depuis le COVID). L’une des composantes essentielles d’une relation client en tant que Freelance à mes yeux, c’est la confiance. Ca s’acquiert et s’entretient, c’est difficile, mais ça permet ensuite de pouvoir échanger ouvertement avec son client et négocier ce genre de petits aménagements.
Et dans le cas d’un non accord, je prend donc la demi journée et fait comprendre que nous sommes tous deux perdants. Au lieu de me perdre une heure, le client me perd une demi journée, et moi je perd une demi journée de facturation.
#12
Parlons de l’éléphant dans la pièce :
Si les magasins possédaient des caisse automatique il serait très simple de pouvoir faire des courses à n’importe quel heure en ce qui concerne l’alimentation. Par exemple pas loin de chez moi j’ai un supermarché qui ferme à 23h et à partir de 20h c’est full automatique avec un ou deux vigile.
#13
Cela décrit bien comment fonctionne le système pour des entreprises voulant conquérir un nouveau marché.
#14
#14.1
Même sans remplir les rayons un commerce avec des caisse automatique à un grand intérêt. Quand au vol c’est la encore un problème purement technique. Caissier ou pas ça change pas grand chose la dessus.
Si ça leur permet d’avoir leur dimanche libre…
#15
Oui, les quelques fois où je fais des commandes chez Amazon, je simule la commande et regarde quand cela doit arriver et je valide le jour où la date de livraison correspond à un jour où je suis présent. Un peu rien à faire d’avoir ma commanda rapidement, je préférerais fixer la journée/demi-journée de livraison à l’avance lors de la commande
#16
Même sans obligation légale, j’ai commencé ma carrière dans le niveau 1 du support IT avec présence en HNO pour superviser la continuité de service, puis par la suite dans le N2 avec évidemment les astreintes à la clé.
Le seul côté bien avec les astreintes, c’est forcément le gain financier que ça apporte (enfin c’est variable, les internes des entreprises où j’ai presté touchaient 3 kawettes et demi là où nous était 400€ de prime la semaine + heures supp à chaque intervention…), mais derrière ça bouscule complètement son organisation personnelle. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté ce genre de mission, les dernières que j’ai fait étaient plus pour assurer un suivi de démarrage projet un weekend une fois dans l’année, ce qui est encore plus acceptable par rapport à une semaine par mois.
Si encore il me paraît normal que les services essentiels obligent à faire du 24⁄7, pour un commerce j’ai déjà plus de mal à concevoir la nécessité en dehors de répondre à un faux besoin d’instantanéité. Et il faut tout de même rappeler que la durée du travail reste légalement encadrée donc même pour des services ayant la nécessité de travailler le samedi et dimanche, ils sont, en principe, censés avoir dans la semaine leur récup.
D’ailleurs en anecdote personnelle, l’une des raisons qui m’a fait stopper de commander sur Amazon (et c’est toujours le cas, c’est mon ultime recours quand je ne trouve pas ce que je cherche ailleurs) et d’avoir été livré un dimanche pour une commande passée un samedi sans avoir mis le truc prime. Pour moi ce fut une aberration.
#17
Je suis content de voir en lisant les quelques commentaires qu’il y a plus d’une personne dans la communauté pourtant très orientée “numérique” de NextInpact qui trouve que cette situation est une aberration. Cela me rassure un peu :)
En revanche, je suis un peu déçu par l’existence même de ce genre d’article en mode “j’ai creusé les CGV pour vous”, sur ce média qui a plus d’un positionnement politique et idéologique, comme l’intro le laisse d’ailleurs penser.
Quand bien même l’article commence par “Se faire livrer des courses à domicile en moins de 15 minutes, est-ce bien raisonnable ?”, au final il ne fait que remettre en cause que les entreprises citées annoncent 10 min et peuvent livrer parfois en 2h. Comme si le problème était là… Se faire livrer son rouleau de PQ en plus de temps que prévu… C’est ça qu’on veut améliorer dans la société, vraiment ?
À trop zoomer sur le côté “Breaking news: le monde de la publicité fait usage du mensonge” on en vient à oublier le non-sens qu’est l’existence même du service/bien dont il fait publicité.
Demain on aura quoi ? Le zoom sur la fiche technique du 4x4 qui émet 257g de CO2/km au lieu d 234 dans la pub ? Il faut changer quoi du coup : la mention légale de la pub ou l’existence même de ce 4x4 à la vente ?
#17.1
Personnellement je préfère un article qui présente les faits permettant de se forger son propre avis qu’un billet d’opinion où l’avis du journaliste ne m’importe pas (je n’aime pas les articles qui frôlent l’édito qui ne dit pas son nom). D’une certaine façon, l’un sert l’autre : en présentant la réalité factuelle derrière le mythe (les 10min qui sont plutôt 1 heure), ça rend tout relatif cet impérieux besoin d’instantanéité qui est vendu par ces entreprises et fait s’interroger.
#18
Je vois le non travail du dimanche comme une démarche touchant à l’hygiène mentale de chacun face à un consumérisme qui produit des dégâts sociaux, écologiques voir même économique.
#19
je confirme, quand j’étais à mon compte avec ma petite société d’info, c’était 60h/semaine + max deux semaines de congés annuel, et ça pendant plus de 20 ans. Et puis l’opportunité d’être salarié s’est présentée. Que du bonheur. 5 semaines, quelques RTT, un salaire qui tombe tous les mois sans te préoccuper de savoir si les clients paient ou pas, URSAFF en moins, etc… si j’avais su, j’aurai sauté le pas plus tôt
#20
Pour ma part c’est l’inverse, être à mon compte c’est un meilleur salaire pour moins de travail à l’année, et du choix de temps libre entre les missions. Du coup j’ai déjà refusé des postes de salarié proposés par des clients car je n’y vois pas l’intérêt pour moi (mais je comprends que d’autres en voient un).
C’est très étonnant que dans l’informatique tu n’aie pas pu trouver un poste de salarié en 20 ans, car en effet, à ton compte dans ces conditions ce n’est pas très enviable, sauf si le salaire compense ou si tu espères un retour plus tard (et encore il faut tenir). En tout cas tant mieux pour toi que ça ait pu s’arranger.