Au Journal officiel du 31 décembre 2021, a été publiée la loi « visant à conforter l’économie du livre ». Dans le marketing parlementaire, le texte est destiné à combattre l’ogre Amazon face aux Petits-Poucet du secteur. Problème : la France a été visée par de lourdes critiques venues de la Commission européenne. Next INpact révèle son courrier incendiaire.
En mai 2021, Emmanuel Macron fustigeait les grands groupes, ceux qui « ont la possibilité de vous envoyer quasiment sans frais votre livre, quand votre libraire indépendant va vous faire payer les frais postaux ».
Fin 2021, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture pointait son doigt accusateur sur cet « opérateur [qui] propose la livraison quasi gratuite des livres ». Elle y voit « une nouvelle forme de concurrence par les prix qui ne permet plus à la loi sur le prix unique du livre de 1981 de produire son plein effet ». Et promis juré, l'article premier de la loi sur l’économie du livre « y remédie ».
La disposition phare interdit en effet la livraison gratuite de livre. Ces services de livraison vont être facturés à un prix minimum, selon une grille fixée par un futur arrêté attendu de Bercy et de la Rue de Valois.
La loi oblige en outre les sites qui vendent simultanément des livres neufs et d’occasion à bien distinguer ces deux offres, avec un affichage tarifaire ne devant « pas laisser penser au public qu’un livre neuf [puisse] être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur ».
En pleine présidence de l’UE, la France pourra toujours s’enorgueillir de défendre des milliers de David (les petits libraires) contre un Goliath (Amazon, l’américaine). Seulement, une nouvelle fois, la grille d’analyse de la Commission Européenne ne partage pas vraiment ces conclusions imaginées à Paris en vase clos face au droit de l’Union.
La missive de la Commission européenne
Suite à une procédure CADA européenne, nous avons obtenu la missive adressée par l’institution bruxelloise, document que nous révélons. La Commission y exprime de lourdes critiques au fil d’ « observations » fondées sur les grands principes issus de la directive de 2000 sur le commerce électronique.
Pour rappel, en vertu de ce texte qui régule toute l’économie du Web en Europe, chaque État peut bien réguler les entreprises installées sur son territoire. Inversement, aucun ne peut restreindre la libre circulation des services proposés depuis un autre État membre.
Le problème a rapidement été identifié s’agissant de la loi anti-Amazon française : elle s’applique « à tout vendeur de livres en France et vers la France, quel que soit le lieu d’établissement du vendeur », relève la Commission. « Cela signifie que les vendeurs de livres, en ligne et hors ligne, établis dans d’autres États membres que la France seront également couverts ».
La Commission anticipe des restrictions à la sacro-sainte libre prestation de services. Aux yeux bruxellois, le texte français peut même être source de discriminations de fait, « étant donné que les vendeurs à distance français sont plus susceptibles de disposer de l’infrastructure nécessaire pour offrir des alternatives viables à la livraison par la poste (par exemple, livraison dans des points de vente au détail ou par l’intermédiaire de points de vente physiques) ». Les détaillants en ligne installés en France pourraient ainsi être placés dans une situation plus avantageuse que ceux installés dans un autre État membre. La loi anti-Amazon, une loi pro-France ?
Des exceptions au principe du pays d'origine
Les règles posées par la directive de 2000 ne sont toutefois pas absolues. Des exceptions à la règle dite du pays d'origine sont prévues (en son article 3, point 4).
Elles permettent ainsi à un État membre de réguler également le commerce électronique des entreprises mêmes installées dans d’autres États membres.
Ces exceptions sont très spécifiques. Elles relèvent de raisons d’ordre public. Si la Commission reconnaît que la protection de la diversité culturelle entre dans ce périmètre, c’est aussi pour rappeler que le droit de l’UE exige des restrictions ciblées et proportionnées outre le respect d’une procédure particulière.
Ainsi, « avant de prendre les mesures restrictives en question, l’État membre "d’accueil" (en l’occurrence la France) devrait demander à l’État membre "d’origine" du ou des prestataires de services concernés de prendre des mesures pour résoudre le problème d’ordre public identifié ».
Et si cet État membre n’adopte pas les mesures adéquates, par exemple pour réguler Amazon au cordeau, « il doit ensuite, avec la Commission, être informé de la mesure que l’État membre "d’accueil" a l’intention de prendre ».
Des conditions que ne remplit pas la France
Dans les échanges de courriers, la France a multiplié les arguments au chevet de sa législation : elle a sans surprise secoué l’étendard de la diversité culturelle et linguistique, mais aussi a vanté la nécessité de « contrecarrer les pratiques commerciales d’une grande multinationale qui exploite la livraison quasi systématique de nouveaux livres à domicile, créant des conditions de concurrence sur les prix auxquelles les autres détaillants de livres ne peuvent s’aligner ».
Amazon n’est pas citée dans ce résumé des positions françaises dressé par la Commission, mais son nom transpire dans chacune des lignes.
Pour la France, en outre, « la situation actuelle permet à un puissant opérateur d’offrir pratiquement gratuitement la livraison de livres, exerçant ainsi une forme de concurrence par les prix avec laquelle aucun autre opérateur économique n’est en mesure de s’aligner ».
Cette situation se traduirait « inévitablement par une croissance constante de la part de marché de cet opérateur au détriment de la diversité des acteurs impliqués dans la vente au détail de livres, qui est une garantie de diversité éditoriale et donc de diversité culturelle ».
Enfin, dixit les positions françaises, « le fait que la livraison soit presque gratuite signifie également que les consommateurs peuvent utiliser ce service sans mesurer son impact sur l’environnement et sans rationaliser leurs pratiques ».
Les objectifs économiques ne justifient pas ces restrictions
La Commission a rappelé au gouvernement français que « des objectifs de nature purement économique ne sauraient justifier des restrictions aux libertés fondamentales du Traité ».
Ainsi, « la protection des librairies ou la limitation de l’incitation économique pour les consommateurs ne sauraient constituer à elles seules un objectif primordial d’intérêt général », car « ces objectifs ne peuvent être acceptés que s’ils servent de moyens appropriés et nécessaires à la réalisation d’une exigence impérative dans l’intérêt public ».
Elle concède encore que la protection des livres peut justifier des restrictions à la liberté de circulation des marchandises, mais encore faut-il que les mesures soient non discriminatoires, justifiées par des raisons impérieuses et propres à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général. Et sur ce point, la Commission fait état de ses « doutes » face au texte français.
Risque de discrimination, voire de disparition des petits libraires
Et elle s’en explique : « quelle que soit leur situation géographique, des consommateurs qui achètent via des filières à distance sont en principe en mesure d’acheter des livres dans des conditions différentes de celles qui les achètent dans des librairies, en particulier lorsque ces derniers sont en mesure de livrer des livres commandés au moyen de ventes à distance par l’intermédiaire de leurs points de vente physiques ».
Le texte français peut donc « avoir pour effet de porter atteinte à l'objectif d'égalité d'accès aux livres dans de tels cas ».
Mieux, la loi française, appliquant des conditions de vente restrictives aux circuits de vente à distance, risque de défavoriser les petits vendeurs opérant en ligne, tous ceux qui peuvent en effet « ne pas être en mesure de concurrencer les vendeurs de détail ».
La Commission craint même que la loi anti-Amazon puisse faire « disparaître du marché » ces petits vendeurs en ligne, incapables de s’aligner. Un funeste sort qui « semble également aller à l’encontre de l’objectif politique déclaré de fournir l’accès à un vaste réseau d’accès de détail », commente-t-elle poliment.
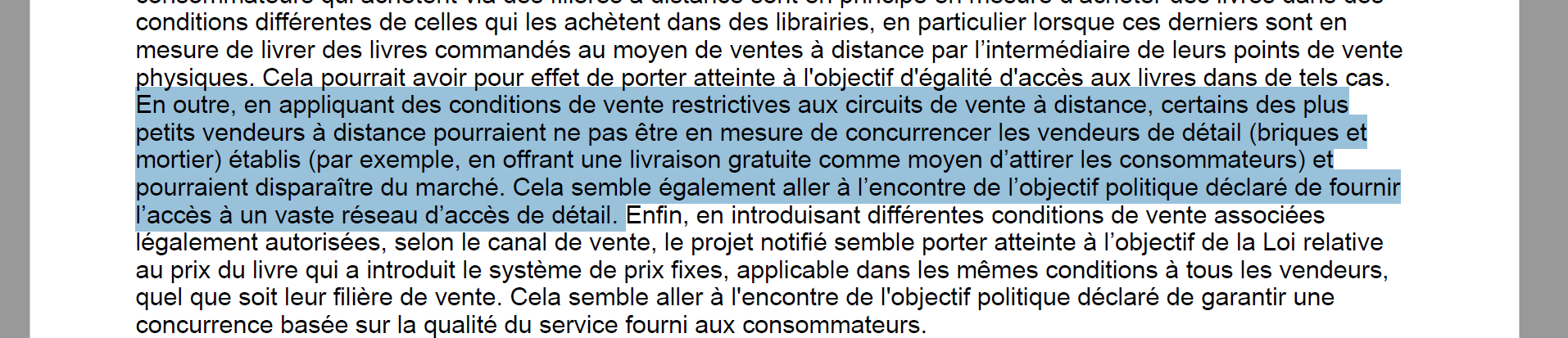
Aucune surprise. À l’Assemblée nationale, la rapporteure Géraldine Bannier (MoDem) avait déjà esquissé un « scénario optimiste » de cette loi, celui où « certaines librairies de taille moyenne parviendront à s’aligner sur ce tarif minimum et pourront ainsi devenir aussi compétitives que les entreprises qui pratiquent aujourd’hui la quasi-gratuité ».
Sans dessiner de scénario pessimiste, elle expliquait dans son rapport parlementaire que pour relever ce pari, « il leur sera toutefois nécessaire, en parallèle, d’agir sur d’autres leviers : l’organisation du réseau, la praticité des outils de commande, leur visibilité, la disponibilité des titres en "cliqué-retiré", la rapidité et la qualité de la livraison, la prescription en ligne via les réseaux sociaux notamment, etc. »
Face à l’ « incertitude consubstantielle » de cette loi alors en gestation, elle plaidait, à l’instar du Conseil d’État, en faveur d’une expertise préalable de l’Autorité de la concurrence.
En vain.
Pas d’analyse de proportionnalité
Dans sa lettre, la Commission est moins tendre : en introduisant différentes conditions de vente selon le canal de vente, cette législation peut « porter atteinte à l’objectif de la Loi relative au prix du livre qui a introduit le système de prix fixes, applicable dans les mêmes conditions à tous les vendeurs, quelle que soit leur filière de vente ».
« Cela semble aller à l'encontre de l'objectif politique déclaré de garantir une concurrence basée sur la qualité du service fourni aux consommateurs », égratigne-t-elle.
Pour justifier de ses mesures, le gouvernement français aurait enfin dû produire une analyse de proportionnalité « ainsi que des éléments précis permettant d’étayer son argumentation ».
La Commission a beau chercher dans ses mails : « les autorités françaises n’ont pas fourni une telle analyse dans le cadre de leur notification susceptible de faciliter l’appréciation de la proportionnalité de la mesure ».
En pleine PFUE, la leçon de Bruxelles
Elle adresse ainsi une petite leçon au mauvais élève européen, celui actuellement aux manettes de la présidence de l’UE : « il aurait été utile de fournir une évaluation détaillée de la manière dont les mesures proposées garantiraient l’égalité d’accès aux livres pour tous les lecteurs et de la manière dont ces mesures contribueraient à la réalisation de l’objectif de diversité culturelle ».
Elle aurait par exemple souhaité disposer des informations « sur la façon dont la pratique de la livraison gratuite affecte le volume des ventes en ligne et ceux en librairie », mais également sur les « différents coûts supportés par les vendeurs physiques et en ligne de livres et de l'impact des mesures proposées sur ces types de distribution, ainsi que sur l'effet que ces dispositions pourraient avoir sur le prix des livres après l'entrée en vigueur ».
Bruxelles aurait voulu des précisions « pour mieux comprendre dans quelle mesure les autorités françaises compétentes ont considéré des moyens moins restrictifs » pour atteindre les objectifs affichés par la loi.
Last but not least, la Commission ne dispose d’aucune information selon laquelle la France aurait suivi la procédure visant à demander par exemple à l’État membre où Amazon est installé (le Luxembourg, pour Amazon Europe Core) de prendre des mesures spécifiques.

Un texte peu en phase avec la directive sur le commerce électronique
Au final, « le projet notifié est susceptible de créer des restrictions à la fourniture transfrontière de services de la société de l’information par des prestataires établis dans un autre État membre ».
La Commission « se demande si les mesures notifiées peuvent être considérées comme proportionnées pour la poursuite d’un objectif susceptible de justifier une dérogation au principe du contrôle par l’État d’origine » et « si le projet notifié satisfait aux exigences de ciblage ».
Faute d’éléments plus solides, elle conclut que les autorités françaises n’ont pas satisfait aux exigences énoncées par la directive sur le Commerce électronique. Un constat qui pourrait servir à de futurs contentieux à l’encontre de la législation française, devant la Cour de justice de l’UE.
























Commentaires (23)
#1
Si La Poste était resté service public, il n’y avait qu’à inventer une prise en charge gratuite ou à moindre frais de l’envoi postal de livres et manuscrit, pour certaines branches du livre, et payant leurs impôts en France…
Je pense qu’en terme culturel, ca aurait pu être un investissement acceptable de la part de l’état…
#1.1
Donc tu voudrais que la poste soit au courant des impôts payés par chaque librairie ? Et se fasse le juge des tarifs payés par chacune d’entre elles ?
S’il y a litige en cours, ou un redressement, on fait comment ?
#1.2
je dis pas “connaitre les impôts” mais juste présenter un KBIS suffit à prouver qu’on est enregistré au registre du commerce et que de fait on est soumis au régime d’imposition sur les sociétés. Le code NAF suffira ensuite pour identifier les ayant droits.
Pourquoi réinventer la roue?! Les services existent, si l’état considère que “la culture doit être sauvée des grands méchants” qu’ils utilisent les outils déjà à disposition!
De plus Amazon à une capacité d’investissement, oui, mais pourquoi ?
Il ne faut pas croire, vendre un livre a prix éditeur c’est pas avoir un gros revenu, la marge représente 30% du prix affiché, à cela il faut déduire les charges. Si Amazon vends un livre “prix editeur” sans frais de transports, c’est que ses charges ils les encaisse différemment, par d’autres moyens, et actuellement c’est son activité “Hébergeur” qui rentabilise la société, pas la vente en ligne.
#1.3
Bah c’est l’état qui le considère pas moi (du moins la façon exception culturelle française)
Si c’était illégal vous ne croyez pas que l’état et le monde du livre seraient tombés sur Amazon ?
Et mon propos reste le même la livraison n’est pas gratuite. On l’a paye. Après chacun fait sa tambouille dans une sous entités de l’entreprise ou en mutualisant sur l’ensemble de son activité
#2
Sûrement pas. C’est un faut problème. La livraison n’est pas gratuite pour Amazone. C’est inclus dans leurs charges au même titre que leur SI. Si les libraires veulent mieux faire qu’ils développent leurs propres logistique
#2.1
Explique moi comment une petite librairie peut développer sa propre logistique ?
#2.2
Ironiquement, Amazon a commencé en vendant des livres ! Comme quoi c’est possible…
#3
Bon alors j’ai pas tout compris.
Ca veut dire quoi, et qu’est-ce qu’on en déduit ?
Les petits vendeurs en ligne et les vendeurs de détail, ce n’est pas la même chose ? Ou alors les seconds désignent en fait les vendeurs physiques ?
Au final, la commission dirait-elle que les petits vendeurs en ligne risquent de disparaître face à la concurrence des gros vendeurs en ligne et des vendeurs physiques qui pourraient se mettre à vendre en ligne aussi ? Et qu’ils seraient moins bien lotis qu’aujourd’hui où ils doivent déjà faire face à la gratuité des frais de port pratiqués par les gros déjà présents ?
Tout ceci est très nébuleux, avec beaucoup de conditionnel des 2 côtés. Les boules de cristal me semblent fonctionner à plein régime.
#4
1 elle n’est pas obligée de le faire toute seule
2 Amazon a énormément inversi pour ça afin d’en diminuer les coûts. Donc sous prétexte qu’ils font moins cher que la Poste il faudrait surfacturer le service ?
#4.1
non la branche Livraison d’Amazon est déficitaire. C’est du dumping comme font toutes les grosses boites. Y compris sur le cloud. Vente a perte pendant des années, compensées par d’autres activités ou du crédit/actions (coucou Spotify). Jusqu’à assécher la concurrence, et après on peux augmenter les prix. Ça n’a rien d’illégale comme tu le dis. Sauf qu’il est impossible pour une TPE de rivaliser même à plusieurs (et je parle même pas de l’évasion fiscale). Après, c’est une décision éthique/morale et au final politique de savoir si, en tant que République, on accepte ça.
#5
Pour moi le probleme principale est déjà le fait qu’il est intedit à n’importe qui d’imposer un prix sur un produit pour proteger l’interet du consomateur sauf sur les livres. La le consomateur moins important.
Maintenant en plus, on va imposer des prix de livraisons minimum que le consomateur va devoir payer en plus pour ses achats de livre, super l’interet du consomateur, pire le prix pourrait même etre supérieur au service si le gouvernement fait ce qu’il sait faire de mieux, n’importe quoi.
Que le gouvernement impose plutot aux maisons d’édition l’obligation de stock gratuit pendant 90 jours (exemple, a voir ce qui serait bien) avec livraisons le jour de la sortie à tous les clients, donc Fnac ne recoit pas avant le libraire qui pourras commander tous ce qui sort pour les avoir le jour de sortie, et alors si invendu apres 90 jours, retour a l’editeur gratuitement, aucun frais pour le libraire, a lui de commander dans les délais et c’est quasi tout.
Vu que l’editeur impose un prix de son choix, a lui de fournir un service pour que tous le monde soit egal face au client au lieu de penaliser le client.
Et la, si vraiment les clients continute à commander en ligne au lieu d’aller en librairie, faudra accepter l’idée que le libraire est mort car n’apport rien au client pour que celui ci prenne la peine de se déplacer.
#6
C’est pour rendre égal l’accès à la culture, sur le principe c’est bien fondé. La FNAC ayant en son temps cassé les prix dans les grandes agglo, il a fallu réguler, afin que l’accès à la culture ne voit pas son prix variable selon qu’on habite en ville ou à la campagne.
A savoir que cela fonctionne un peu de cette façon déjà. Sauf gratuité Editeur…
“L’éditeur” fait imprimer une grande quantité de livres qu’il stock afin de diminuer les coûts d’impressions.
Le livre est ensuite distribué à tout ceux qui en font la demande auprès de l’Editeur lui même, ou des “Diffuseurs”, tout en sachant qu’ils sont disponibles à la commande plusieurs mois avant que le livre ne soit imprimé sur des plateforme diffuseurs tel que “Electre”. ils sont ensuite acheminés par l’intermédiaire de la plateforme “Prisme” pour la plupart, avec des frais partagés “Editeur/Libraire”. Il est bien entendu que les libraires doivent “Payer” les livres à l’éditeur, c’est un contrat commercial, et l’éditeur n’est pas forcément une multinationale, certains sont des TPE, voire des “Auto éditeurs”.
Les invendus peuvent être retournés à l’éditeur ou au diffuseur gratuitement (aux frais de l’éditeur) cela s’appelle le “Droit de retour”, il est encadré dans les CGV de l’éditeur ou du diffuseur pour les délais mini/maxi, sachant que l’ouvrage doit être en rayon depuis minimum 2 mois chez le libraire pour en profiter.
Si le libraire n’à pas en stock l’ouvrage, il peut le commander à un comptoir de vente. Il sera acheminé via son canal d’approvisionnement habituel. Il devra obligatoirement le vendre sans frais supplémentaire s’il s’agit d’une vente au comptoir (compensé dans les 30% de remise en moyenne sur le prix publique).
Concernant les Ruptures de stock elles sont rares. Les seuls causes étant :
Une librairie en ligne hors Amazon ca peut exister ! Ils payent plein pot leur acheminement !
#6.1
“La mise au pilon (comprendre destruction) du stock existant afin de diminuer la “valeur des stocks” en fin d’année comptable, et donc payer moins d’impôts sur les sociétés. Il faudra alors attendre la réimpression.”

Sans déconner, ils font ça?
#7
En général, une multinationale peut faire des choses illégalement de manière légale en profitant des réglementations différentes d’un pays à l’autre et en faisant ce que j’appellerais de la fausse sous-traitance (Amazon Inc. est sous-traitant/fournisseur de Amazon EU et lui vend des produits et services sous une forme qui ne permet pas du point de vue des autorités EU de voir s’il y a par exemple vente à perte)
#8
Oh, si tu savais…
Tiens, lis ce strip de Maliki qui explique la chose, et aussi comment un auteur de bande-dessinée (qui a fini par se mettre en auto-édition pour arrêter de se faire plumer par les intermédiaires de la chaîne du livre) a réussi à écouler en une journée à peine un stock de 800 albums invendus qui étaient destinés à la destruction, faute d’avoir trouvé preneur pendant des années…
#9
Quelle part des ventes est réalisée aujourd’hui par un “petit libraire” ? Car on vise Amazon, mais la réalité c’est quand même que les ventes Fnac / Decitre doivent avoir une bonne part du gâteau. Et on peut pas vraiment dire qu’en France la Fnac soit pas capable de rivaliser avec Amazon sur les livres.
#10
Il pourrait faire comme pour le cinéma, une taxe sur la livraison, qui sert à fournir un service publique de la livraison à prix modique, en France, pour les livraisons inférieurs à un certain poids. D’ailleurs, la presse bénéficie déjà d’une telle livraison à prix subventionné.
#11
Toujours le même problème : depuis 1992, le pouvoir législatif a été transféré à une UE qui n’a cessé de défendre les GAFAM. Et c’est normal : l’UE est une création des USA pour les USA.
Amazon ne tue pas que des petites librairies : il tue le commerce dans son ensemble.
Quand vous observez une différence de prix de 30% entre une boutique physique et un prix web, on est bien d’accord qu’il y a quelque chose qui cloche, et ce n’est pas que les frais de ports qui sont en jeu… Les conditions de travail chez amazon ont largement été décriées comme esclavagistes dans plus d’un reportage.
La stratégie actuelle du géant de multiplier toujours plus les dépôts annonce la couleur et sa diversification, qui ne peut que mener qu’à la mort des revendeurs, lesquels ne peuvent de toute façon pas s’aligner.
Dans un pays souverain comme la Suisse, on tirerait la sonnette d’alarme, on ferait du protectionnisme à l’entrée, et on calmerait aussi sec les ardeurs du géant.
Mais dans une France sous le joug eurofascite, qui interdit de par ses Traités tout protectionnisme, on déroule le tapis rouge à l’envahisseur, on s’agenouille devant sa grandeur, en lui léchant les bottes, et en remuant la queue.
Pas la peine d’être un génie pour comprendre ce qui va se passer.
#12
A chacunes de vos interventions cela m’inspire cela
#12.1
Effectivement…
#13
Amazon livre en Suisse, et je n’entends pas de sirène, ils se préoccupent beaucoup moins que nous de ce genre de choses. Le protectionnisme n’est pas plus leur truc que dans l’UE, et heureusement car ils sont tellement petits que beaucoup de grosses entreprises ne jugent pas la peine d’y établir une présence et se contente d’atteindre ce marché à travers leur présence en Europe. S’ils devenaient trop protectionniste, il y a beaucoup de choses qu’ils n’auraient plus ou beaucoup plus cher.
#14
C’est pas faux …
#15
Encore une fois en France on espère sauver une industrie déficitaire avec des lois et des subventions, et encore une fois ça ne marchera pas.
Une librairie survivra si elle est capable d’apporter une plus value qui n’est pas un bête stock des ouvrages populaire.
Augmenter le tarif de livraison minimum ne sauvera aucune librairie, le temps perdu et l’argent perdu (Parking, essence) pour aller chercher le livre en librairie est trop important sur le cout d’achat pour toutes personnes qui n’est pas à proximité immédiate d’un libraire.
Au mieux ça stabilisera la part de marché d’amazon, et au pire ça fera juste diminuer le nombre de livres vendues en france ( Au profit peut etre du Kindle d’Amazon ? )