Questionné par le député Philippe Latombe (MoDeM), Éric Dupond-Moretti assurait qu’un récent arrêt de la cour de l‘UE relatif aux réquisitions des données de connexion ne concernait que l’Estonie. L’affaire a cependant intéressé au plus près les autorités françaises, au point que Paris adresse ses observations à la Cour. Next INpact dévoile ce document.
Le 3 décembre, coup de tonnerre. Le Conseil constitutionnel censure la possibilité pour le procureur de la République de requérir les données d’identification et de facturation (les « fadettes ») dans les enquêtes préliminaires.
Il a dénoncé le manque d’encadrement à cette atteinte à la vie privée, alors que ces données « fournissent sur les personnes en cause ainsi que le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée ».
Pour éviter de faire tomber comme un château de cartes toutes les enquêtes en cours, les neuf Sages ont reporté au 31 décembre 2022 la date d’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles.
Le 7 décembre en séance, le député Philippe Latombe est cependant revenu à la charge pour soulever une lourde difficulté : en attendant le 31 décembre 2022, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) risque d’être invoqué dès à présent par une armée d’avocats.
Dans cet arrêt dit « Prokuratuur » du 2 mars 2021, la CJUE a en effet jugé contraire au droit européen une législation nationale « donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer (…) l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale ».
Face au député qui s’interrogeait sur la fragilité des procédures pénales actuelles outre le manque d’effectif dans la magistrature pour contrôler plus solidement ces réquisitions, Éric Dupond-Moretti a botté en touche : « Je veux vous rassurer, l’arrêt Prokuratuur de la Cour de justice de l’Union semble ne concerner que le parquet estonien ».
Et de promettre que la législation à venir d’ici le 31 décembre 2022 « n’aura aucune incidence en termes d’effectifs de magistrats ».
Quand la France intervient dans le dossier estonien
L’argument n’a pas vraiment convaincu tant les termes de l’arrêt de la CJUE semblent bien applicables au régime français, parfaitement similaire. Et les propos rassurants du ministre de la Justice tranchent avec les gesticulations du gouvernement pour tenter d’influer la décision de la CJUE dans un sens favorable à sa propre cause.
Pour s’en convaincre, nous avons pu nous procurer les « observations » que le gouvernement avait transmises le 1er avril 2019 à la cour luxembourgeoise en amont de cet arrêt Prokuratuur.
Ces observations « sont confidentielles et ne peuvent pas faire l’objet d’une communication au public », nous avait indiqué la Cour de justice, mais nous avons malgré tout pu les récupérer pour les diffuser intégralement ci-dessous.
Autant le dire, le gouvernement français a tenté le tout pour le tout pour espérer sauver sa législation interne, dans ce dossier beaucoup moins estonien-centré que veut le faire croire le ministre de la Justice.
Les autorités françaises concèdent que l’accès aux données de connexion constitue une ingérence possiblement grave dans le droit à la vie privée ou dans le droit à la protection des données à caractère personnel.
Ingérence grave, ingérence non grave
Cette ingérence « grave » pourrait néanmoins être justifiée pour lutter contre la criminalité elle-même qualifiée de grave. « En revanche, lorsque l’ingérence que comporte un tel accès n’est pas grave, ledit accès est susceptible d’être justifié par un objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’"infractions pénales" en général ».
Paris estime donc que l’analyse de proportionnalité permettrait l’accès aux données de connexion, soit parce que l’ingérence n’est pas profonde, soit parce qu’elle est profonde, mais concerne une infraction grave.
Mieux encore, pour le gouvernement, la mesure de la gravité de l’ingérence « résulte d’un examen concret des circonstances propres à chaque espèce, lesquelles peuvent inclure la durée de la période pour laquelle les autorités ont accès à ces données ».
En clair là encore, l’exécutif a tenté d’expliquer qu’une ingérence peut être qualifiée de « non grave » parce que limitée dans le temps, quand bien même porterait-elle donc sur un large éventail de données de connexion.
Paris en quête de larges marges d'appréciation
Le gouvernement français a tout autant fait valoir aux yeux de la Cour que « les conditions matérielles et procédurales d’accès des autorités compétentes aux données à caractère personnel » conservées par les FAI et les opérateurs doivent relever de l’interprétation de chaque État, et sûrement pas d’une notion autonome du droit de l’Union.
En somme, Paris défendait une position laissant une grande marge d’appréciation à chaque État membre, aussi bien s’agissant de la liste des infractions relevant de la « criminalité grave », que pour l’appréciation de la période sur laquelle peut porter l’accès, mais également les catégories de données de connexion pouvant faire l’objet d’une réquisition.
Un « accès capital » même pour les infractions de droit commun
Dans ces mêmes observations, « le gouvernement français entend démontrer que si l’accès aux données de trafic et de localisation conservées par les fournisseurs de communications électroniques sur une certaine période est justifié et indispensable en matière de lutte contre la criminalité grave, notamment en matière de terrorisme, un tel accès s’avère également capital, au quotidien, pour la lutte contre la criminalité de droit commun ».
Au contraire, une limitation systématique de l’accès des autorités à ces données de connexion « pour une durée particulièrement réduite » et des infractions non graves « porterait gravement atteinte à l’efficacité d’un grand nombre d’enquêtes pour lesquelles les autorités compétentes, aux fins de manifestation de la vérité, doivent disposer d’un accès aux mêmes données pour une période plus longue ».
Le document révélé ci-dessous cite plusieurs exemples : « disparition inquiétante d’une personne », « harcèlement », « appels téléphoniques ou messages électroniques malveillants répétés »…
Tous ces faits exigent de « remonter dans le temps sur une période de plus d’un jour », soit pour retrouver la personne, soit pour qualifier la répétition du comportement délictuel :
« Il en va de même lorsque les modalités de participation à l’infraction impliquent une entente préalable et donc des échanges en amont de la commission d’une infraction, par exemple pour les associations de malfaiteurs, les trafics de stupéfiants ou de simples complicités ».
Et pour gagner encore davantage de liberté d’action, dans ce dossier pas si estonien, les autorités françaises soulignent que le degré de gravité d’une infraction peut être révélé non immédiatement. « D’où l’importance de ménager la possibilité pour les enquêteurs d’accéder à des données pour une durée plus ou moins longue, selon les situations auxquelles ils sont confrontés ».
Ce n’est pas tout. Ses arguments considèrent que « seules les législations des États membres sont à même de garantir, lors de la détermination des modalités d’accès aux données de trafic et de localisation, l’efficacité de ce dispositif aux fins d’assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales », sous le respect du principe de proportionnalité.
Ce même principe qui a été considéré comme inefficient par le Conseil constitutionnel, lorsqu’il a censuré les réquisitions du procureur de la République…
Paris tente de sauver le rôle du ministère public
Pour couronner l’analyse, les observations françaises indiquent que le ministère public peut parfaitement supporter la charge du contrôle préalable de ces accès aux données de connexion. La France, qui va prendre la présidence de l’UE le 1er janvier, se drape derrière le « principe de l’autonomie institutionnelle des États membres ».
Pour elle, il suffit qu’il dispose d’une « autonomie fonctionnelle » pour valider sa conformité européenne. « Le gouvernement français estime que le ministère public d’un État membre, tel que celui en cause dans le litige au principal, présente des garanties d’indépendance suffisantes pour assurer […] le contrôle préalable de l’accès des autorités nationales aux données personnelles lorsqu’un tel accès est nécessaire aux fins d’assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ».
Et les observations de citer un passage de l'arrêt « Thiam » de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant justement son système législatif :
La justice de l'UE n’a pas suivi les pistes suggérées par Paris
L’intervention française dans ce dossier estonien aurait pu sauver le rôle du procureur de la République dans notre législation. Mais la CJUE n’a pas décidé de suivre les pistes parisiennes.
Elle a jugé contraire au droit européen « une réglementation nationale permettant l’accès d’autorités publiques à un ensemble de données relatives au trafic ou de données de localisation […] à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales » lorsque cet accès n'est pas circonscrit à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique.
Et « ce indépendamment de la durée de la période pour laquelle l’accès auxdites données est sollicité et de la quantité ou de la nature des données disponibles pour une telle période ».
La même Cour a de même considéré que le droit de l’UE « s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer, le cas échéant, l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale ».
Conclusion : Paris n’a pas su sauver son système législatif. Et, ainsi que l’a relevé le juriste Nicolas Hervieu, cet arrêt concerne bien la France. Il est donc bien mobilisable par un avocat français.




















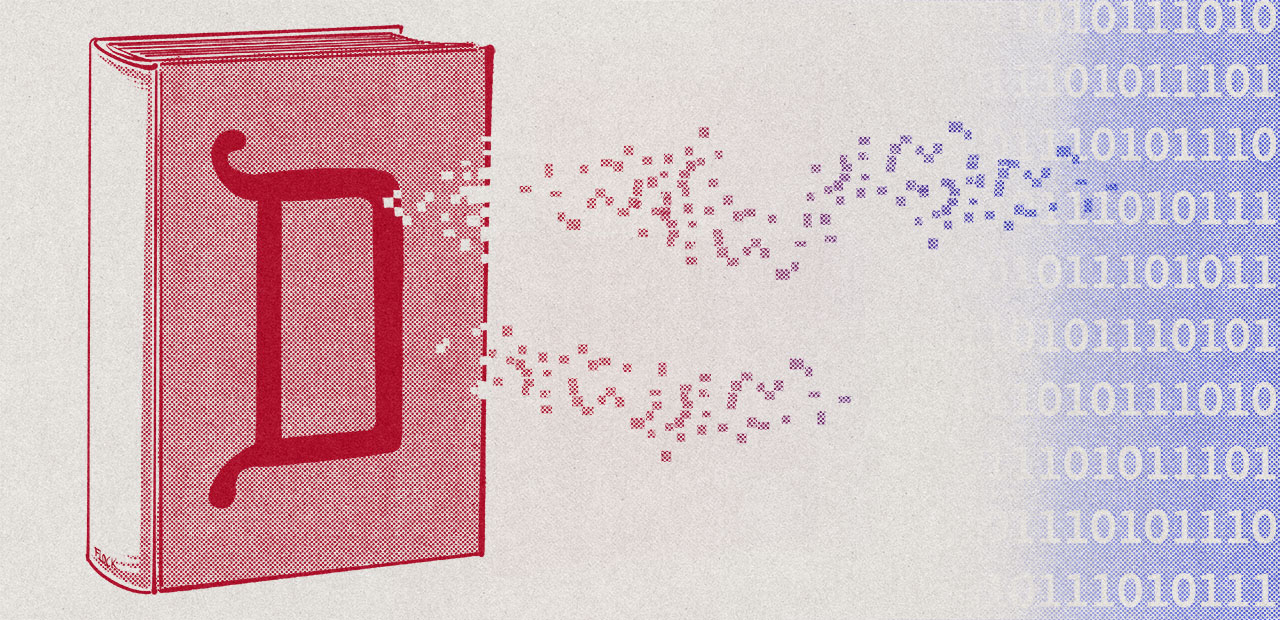
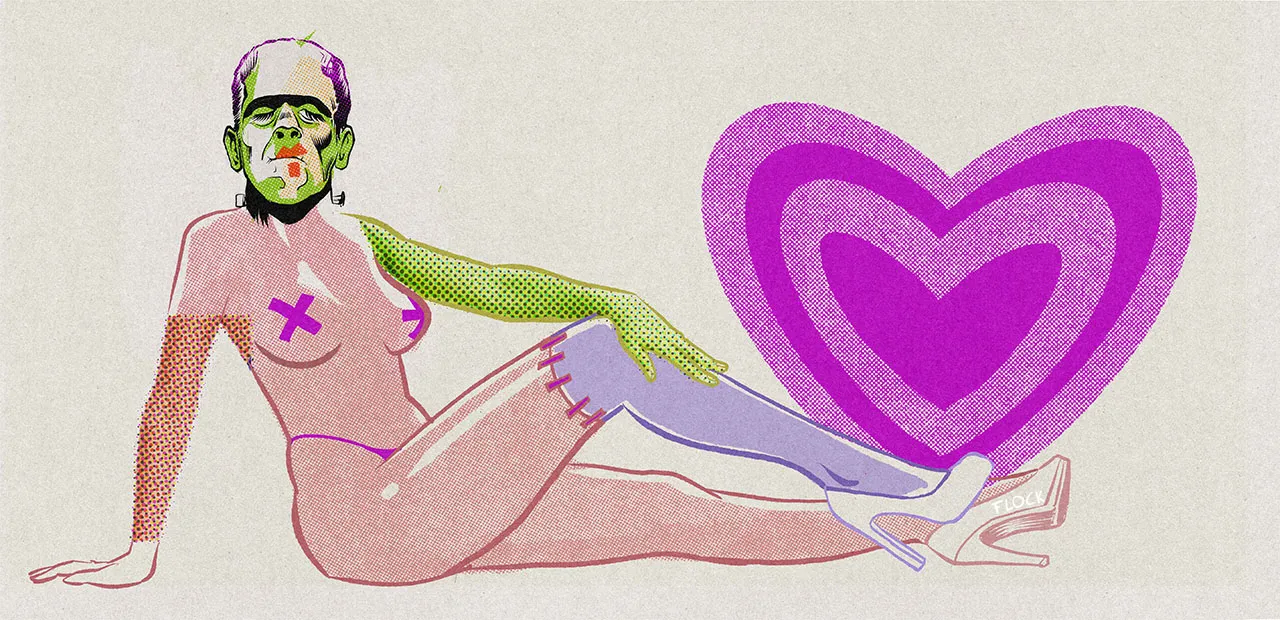
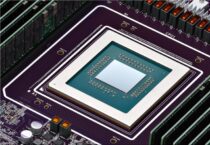






Commentaires (29)
#1
la seule VRAIE question, c’est :
tant qu’on n’aura pas répondu, clairement, à cette question, on continuera
à faire des contorsions pour appliquer/ou non le ‘DE.’ !
(je pense au ‘DA.’)
#1.1
Le droit européen prime sur le droit national dans les domaines de competence de l’UE, et dans les limites de l’identité constitutionnelle de chaque pays. C’est la position de nombreux Etats membres, dont la France. En revanche, les traités (UE y compris) ne sont pas au-dessus de la constitution. C’est un vieux conflit entre les cours constitutionnelles et la cour de l’UE (qui a la liberté d’étendre sa competence sans aucun contrôle, mais c’est un autre problème).
#1.2
il me semblai, aussi, que ‘le dernier Juge’ c’est….le Peuple
qui vote pour ‘une Constitution’, là où la Commission de Bruxelles est désignée
par les Chefs d’Etats (qui font leur tambouille entre-eux, à….27) !
“vive la Démocratie” !
#1.3
La Commission Européenne est désignée par les Chefs d’Etat qui sont eux-même des élus. Donc des représentants du peuple.
Le “chemin détourné” que tu cites pour la Hongrie n’en est pas un : la Commission Européenne est garante de l’application et du respect des traités européens (au même titre qu’en France, le Président de la République est garant de la Constitution et des institutions). Un Etat membre qui ne les respecte pas s’expose donc à des sanctions.
#1.4
La Commission Européenne est désignée par les Chefs d’État
qui sont eux-même des élus. Donc des représentants du peuple…
on nous la ressort à chaque fois cette rengaine !
( le coup du billard à 3 bandes on connait)
(plutôt que….)
#1.5
C’est le Parlement Européen qui est élu au suffrage universel.
#1.6
c’est pour ça que j’ai parlé “de la Commission” !!!
(et uniquement de cette dernière)
#1.7
L’UE c’est un ensemble de plusieurs institutions, dont la Commission Européenne (composée de Commissaires nommés par les gouvernements des Etats-membres) fait partie avec aussi le Parlement (élu au suffrage universel), le Conseil de l’Union Européenne (composé de Ministres des Etats-membres) et le Conseil Européen (composé par les Chefs d’Etats, la fameuse Présidence que Macron va porter au début de l’année 2022 pour 6 mois). Il y a d’autres institutions mais elles ne nous intéressent pas dans le cas présent.
La Commission Européenne est responsable devant le Parlement Européen, qui lui est composé d’élus au suffrage universel (et représentant près de 440 millions de citoyens), et a le pouvoir de la censurer. De plus, c’est le Parlement qui approuve les commissaires européens choisis par le Conseil Européen. Quand au Président de la Commission Européenne, il est élu par le Parlement. C’est donc un suffrage indirect.
Quand tu regardes les institutions qui composent l’UE, tu remarques qu’au final c’est très similaire à un gouvernement national. Regarder la Commission à elle seule n’a pas vraiment de sens puisqu’elle fait partie d’un ensemble où chacun a des rôles et responsabilités définies par les Traités. Responsabilités plus ou moins partagées ou envers les autres organes.
Si tu veux une bonne illustration du fonctionnement de l’UE, je t’invite à regarder le schéma proposé par Wikipedia sur le sujet. Il est très accessible et synthétise très bien les interactions et rapports entre les différents organes de l’UE.
#1.8
pour, bien, faire LA différence—> https://europedirect-reims.fr/panorama-de-lue/les-institutions-europeennes/
..qui n’est pas évidente (piou) !!!
#1.9
C’est un peu là où je voulais en venir. De ma fenêtre, j’ai souvent l’impression que les critiques adressées à l’UE (qui peuvent être légitimes pour la plupart, ça reste une cacophonie d’une vingtaine d’Etats qui essayent chacun de tirer la couverture, faut pas se leurrer) démontrent en fait une méconnaissance de son fonctionnement.
On peut critiquer, objecter, protester contre, ou vouloir quitter l’UE, après tout on reste dans un pays libre de ses opinions. Mais quand on veut dire où on devrait aller, il me paraît important de d’abord de savoir d’où on part car le chemin ne sera pas forcément le même (et qu’au fil du tracé on se rende compte que la destination n’est pas aussi séduisante qu’elle en avait l’air).
#2
Oui.
#3
En somme le souci c’est que l’autorisation vient du procureur (dépendant du ministère).
Question donc: dans le cas d’une autorisation délivrée par un juge d’instruction (indépendant), celle-ci est-elle valide?
#4
Bah voila ce qui arrive quand les ministres français veulent pré implémenté des droits européen a l’avance.
#5
Un beau numéro de centriloques. Le 22 porte bonheur… comme d’habitude. :oui2:
#6
Bof… C’est certainement pas une décision de la CJUE qui va les arrêter (ni les empêcher de dire que « c’est pas bien » que la Pologne ou la Hongrie fassent de même de leurs côtés) !
#7
Big brother un jour….
#8
C’est une fausse question car cela fait parti des traités européens… C’est comme dire si une constitution prime sur les textes législatifs. C’est dans la nature même d’une constitution
#8.1
C’est dans la nature même d’une constitution…
c’est pour ça, que ‘Bruxelles’ utilise un chemin détourné
pour faire pression sur la ‘Hongrie’ :
“SI voulez percevoir nos aides financières, vous DEVEZ accepter notre Politique…
..sur l’immigration (notamment)” !
ils devraient être plus clair : ‘OUI/NON’, (et dans ce cas) éjecter la ‘Hongrie’ !
#8.2
Le bloquage sur les subventions européennes pour la Hongrie n’a strictement rien à voir avec les sujets liés à immigration, et concerne des sujets bien plus important que celui mentionné dans l’article. Il s’agit simplement du respect des traités européens et de l’État de droit.
Bruxelles utilise simplement les outils (limités) prévus par les traités de l’UE.
Par ailleurs, il est aujourd’hui connu que le gros des subventions européennes reçus par la Hongrie sont détournées vers les réseaux mafieux et familiaux du groupe corrompu au pouvoir.
Voir par exemple:
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/09/en-hongrie-les-proches-d-orban-s-enrichissent-sur-le-dos-des-fonds-europeens_6062689_3210.html
#9
En droit, on parle de hiérarchie des normes. En gros, ça se résume à Traités > Constitution > Lois
D’où le danger d’accepter n’importe quoi comme traités, à fortiori les traités commerciaux qui généralement visent à contourner la démocratie pour favoriser le commerce, sans aucune instance d’arbitrage digne d’une démocratie. ACTA, MERCOSUR et autres sont les vrais fossoyeurs de la démocratie.
Concernant l’U.E., les traités de base sont généralement bons et reposent sur une structure assez démocratique, avec des instances et des recours, et on retrouve entre-autres la convention européenne des droits humains au cœur du projet.
Par contre, le côté économique de l’U.E. est beaucoup moins démocratique, et beaucoup plus violent. La crise démarrée avec la dette grecque a montré un système européen ne travaillant pas dans l’intérêt général, capable d’exercer une rare violence sur les états membres.
Si les droits humains et l’état de droit étaient promus dans l’U.E. avec la même violence que le pacte de stabilité, il y a belle lurette que la Pologne, la Hongrie et les autres seraient rentrés dans le rang.
“Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens.”
J-C Juncker, président de la Commission européenne
#10
Non seulement le droit européen prime depuis 1992 (en fait la trahison de notre Constitution a commencé dès les années 60), mais les français avec Maastricht en 1992 n’ont pas compris qu’ils transféraient en fait leur pouvoir législatif à Bruxelles, à une entité de commissaires non élus par aucun peuple, diktant leurs GOPÉ annuelles à chaque pays, ce qui explique pourquoi quel que soit l’européiste élu, il suivra TOUJOURS la feuille de route de Bruxelles, pour qui tout doit se vendre et s’acheter, y compris désormais la vie humaine.
Non seulement nous avons perdu notre démocratie, mais en plus, ils se couvrent eux-mêmes entre eux, avec notamment le retrait du crime de Haute Trahison du président de la République, qui a permis à sarko d’aller signe le traité de Lisbonne les mains dans la poche, avec la grande gueule qu’on lui connaît.
Ça fait 14 ans qu’Asselineau essaie d’expliquer ces mécanismes simples de l’UE, et le pourquoi du résultat totalitaire qu’on observe aujourd’hui. Rappelez-moi déjà combien de fois vous l’avez vu sur les chaînes du service public payées avec notre redevance ? 0. La seule fois où vous en avez entendu parler, c’est pour une histoire de mœurs bidon menée par d’anciens salariés éconduits et quelques traîtres bien placés dans le mouvement, pour lui coller aux basques - autrement dit, pour salir l’individu, ne trouvant aucun affaire financière à lui repprocher. Mais sur les idées politiques défendues par ce dernier, c’est mise automatique sous le tapis : tout débat sur notre appartenance à l’UE est interdit - sauf entre copains européistes, bien entendu…
#10.1
Ah, l’emploi du k pour montrer qu’on est un freedom-fighter…
Maastricht était une nécessité dans la mesure où les pays membres voulaient avancer avec une base législative commune. Ce que les Français n’ont pas compris en 1992 et semblent d’ailleurs n’avoir toujours pas compris en 2021, c’est que pour avoir une démocratie, il faut se bouger et aller voter…
Pour info, les traités internationaux, ça existe depuis bien avant l’U.E., et la prévalence sur le droit national a toujours été une nécessité pour rester dans ce genre d’accords.
Maastricht a rajouté une dose de démocratie dans l’élaboration du cadre législatif de l’U.E., créant un espace commun et public pour l’élaboration des lois de l’U.E. … sans Maastricht, on en serait encore à une situation d’opacité bien plus grande… le plus gros problème de l’U.E. est que le parlement européen n’a pas encore assez de poids, ce qui permet aux exécutifs des pays membres de rajouter une dose d’arbitraire ou de rapidement couler un texte n’allant pas dans leur sens.
Prenons par exemple le cas de l’ACTA… le PE l’a rejeté mais les états membres ont tout de même signé individuellement ce traité même si cela va contre les intérêts des citoyens.
Il est où le déficit démocratique dans cette situation; U.E. ou états membres?
Dans une situation sans Maastricht, l’ACTA n’aurait pas eu le même débat public.
#10.2
L’excuse du “c’est Bruxelles qui nous oblige” a bon dos.
A droite ou à gauche ils nous la sortent, alors qu’il y a des tonnes d’autres mesures/lois européennes non appliquées/retranscrites au niveau national.
Ceux qui “dirigent” à Bruxelles sont les mêmes qui dirigent les pays membres, et la politique est toujours la même, et c’est très facile à comprendre:
#10.3
Encore une intervention à côté de la plaque. Le sujet de l’article est quand même que l’Etat français est très limite avec l’état de droit, mais par principe (stupide) tu mets en cause l’UE qui lui signale… formidable.
Quant à la télé, sur les chaînes privées non plus on ne voit pas ton gourou. Probablement parce qu’il n’a rien d’intéressant à dire, son seul projet étant de quitter l’UE et l’Euro, sans proposition réaliste et en affirmant ne pas avoir de politique économique. Du vent et du creux, ben pour ça à la télé on a la télé-réalité.
#11
Ou auraient quitté l’UE
#12
À te lire j’ai l’impression que tu attribues la faute à ceux qui ont voté contre ce traité.
#13
Mais il me semble qu’une loi européenne doit être “traduite” en droit français avant de devenir applicable en France - est-ce que, durant une affaire, un avocat peux plaider avec une loi européenne non encore traduite ?
Car actuellement le temps de cette “traduction” varie beaucoup, selon si le gouvernement en place est plutôt positif ou négatif envers cette loi EU… (incluant les recours, les traductions biaisés, …)
Pour moi, plus on est nombreux à voter, plus le résultat a peu de chance de satisfaire les votants , d’autant moins que les votants sont très très différents culturellement.
On a d’ailleurs déjà ce problème en France : Je connais le nom de mon maire et +/- ce qu’il fait, je connais le nom de mon député mais je sais pas trop ce qu’il fait en mon nom et je sais aussi que si je veux le rencontrer ou le contacter il n’y aura pas de suite.
Je ne connais pas mon député européen, et ça m’étonnerais fortement qu’il tienne compte de mes idées pour ses votes, quand bien même j’arriverais à le contacter - donc il suis ses convictions et ses intérêts : il représente trop de gens pour que qui que ce soit puisse lui demander de comptes.
Cette “cacophonie” fait qu’au final, ceux qui prennent les décisions effectives sont les non-élus des pays.
Les politiciens sont d’habiles fonctionnaires, ils ont réussi à noyer la démocratie.
#14
Le principe d’effet direct des traités
#15
Bah en fait non, pour le coup la télé réalité a bien un programme vu que tout est scénarisé.