Le monde des crypto-monnaie se cherche un second souffle à travers de nouvelles mécaniques de consensus. Celles exploitant la capacité de stockage de nos machines ont le vent en poupe. Mais si elles ont un intérêt du point de vue énergétique, elles sont encore loin de résoudre tous les problèmes.
Si vous suivez de près ou de loin le sujet des crypto-monnaies, vous avez entendu parler de Chia Network, un projet principalement connu pour être porté par Bram Cohen, déjà à l'origine du protocole BitTorrent. Il y travaille depuis quelques années déjà, cherchant à utiliser le stockage de données comme source de consensus plutôt que la puissance de calcul. Une volonté d'alternative au « Proof of Work » (PoW) qu'il n'est pas le seul à promouvoir.
Notamment parce que le « minage » qui sert à générer des bitcoins ou des ethers par exemple, est critiqué en raison de l'énergie qu'il consomme au niveau mondial. Chacun y va donc de sa solution maison, avec ses avantages et ses inconvénients. L'idée de miser sur le stockage est d'ailleurs loin d'être nouvelle ou même spécifique à Chia.
Comme souvent dans le domaine des crypto-monnaies, l'attention générée attise les convoitises. Et le lancement de Chia Network, plutôt réussi médiatiquement, met déjà en exergue les faiblesses de ce modèle. Tout en ajoutant une couche de tension sur l'approvisionnement de composants informatiques... qui n'avait pas besoin de ça.
Blockchains, consensus et capacité de stockage
Un petit rappel avant de commencer : les cryptomonnaies reposent en général sur une blockchain publique, sorte de grand livre de transactions. Dans le cas de Bitcoin, elles ressemblent à ça. La blockchain est stockée et accessible de manière distribuée, au sein d'un ensemble de machines constituant un réseau informatique.
Autre spécificité : à la différence du système bancaire classique, une transaction n'est pas certifiée valide par un ou quelques acteurs de manière centralisée, mais par une mécanique de consensus. C'est-à-dire que les machines au sein du réseau, se « mettent d'accord » pour indiquer si une transaction est légitime ou non. La méthode diffère selon les cas. Pour Bitcoin ou Ehtereum (en attendant sa v2.0), il s'agit d'une preuve de travail (Proof of Work, PoW).
Ainsi, pour valider une transaction, des machines doivent effectuer une série de calculs complexes. C'est cela que l'on appelle le minage. Cette action nécessitant de mettre à disposition de la puissance de calcul, elle est rémunérée, via deux sources principales : les frais payés lors de chaque transaction au sein du réseau et la mécanique de création monétaire, organisée le plus souvent de manière régulière.
Les transactions sont ainsi organisées en blocs à miner. Dans les cas de Bitcoin, chaque bloc permet de récupérer 6,25 BTC, le protocole impliquant une division par deux cette valeur tous les 4 ans, jusqu'à un maximum de 21 millions en 2140. Le dernier halving (c'est le nom de cette procédure), date de mai 2020. Les blocs étant gros et complexes, il faut énormément de puissance informatique pour en venir à bout, les mineurs s'organisant en pools pour chercher les meilleurs blocs et se répartir le butin. La difficulté technique évoluant à travers le temps.
Elle suit en général la montée du cours des crypto-monnaies, qui est à l'origine ces derniers mois d'une véritable course à l'armement participant à la pénurie mondiale de puces graphiques. Car l'une des crypto-monnaies les plus rentables et les plus populaires du moment, Ethereum, se mine principalement avec des GPU.
Les fermes de minage se situant pour une bonne partie en Chine, où l'électricité est peu chère mais très carbonée, de nombreux acteurs sont montés au créneau ces dernières années pour critiquer l'impact écologique du PoW. Des alternatives ont été recherchées et trouvées, menant chacune à de nombreuses cryptomonnaies.
On pense par exemple à la preuve d'enjeu (Proof of Stake, PoS) vers laquelle Ethereum se tourne avec sa v2.0 et la Beacon chain. Le consensus est obtenu par des membres du réseau détenant une certaine quantité de monnaie (les validateurs), qui sont sélectionnés aléatoirement pour créer des blocs ou valider ceux qu'ils n'ont pas créés, et sont rémunérés pour cela (on parle alors de staking). La puissance de calcul nécessaire à ces opérations est faible.
Des mécaniques de répartition et de sélection aléatoire sont en général mise en place pour éviter que certains ne cherchent à « prendre le pouvoir », ce qui nécessiterait de détenir 51 % de la monnaie existante.
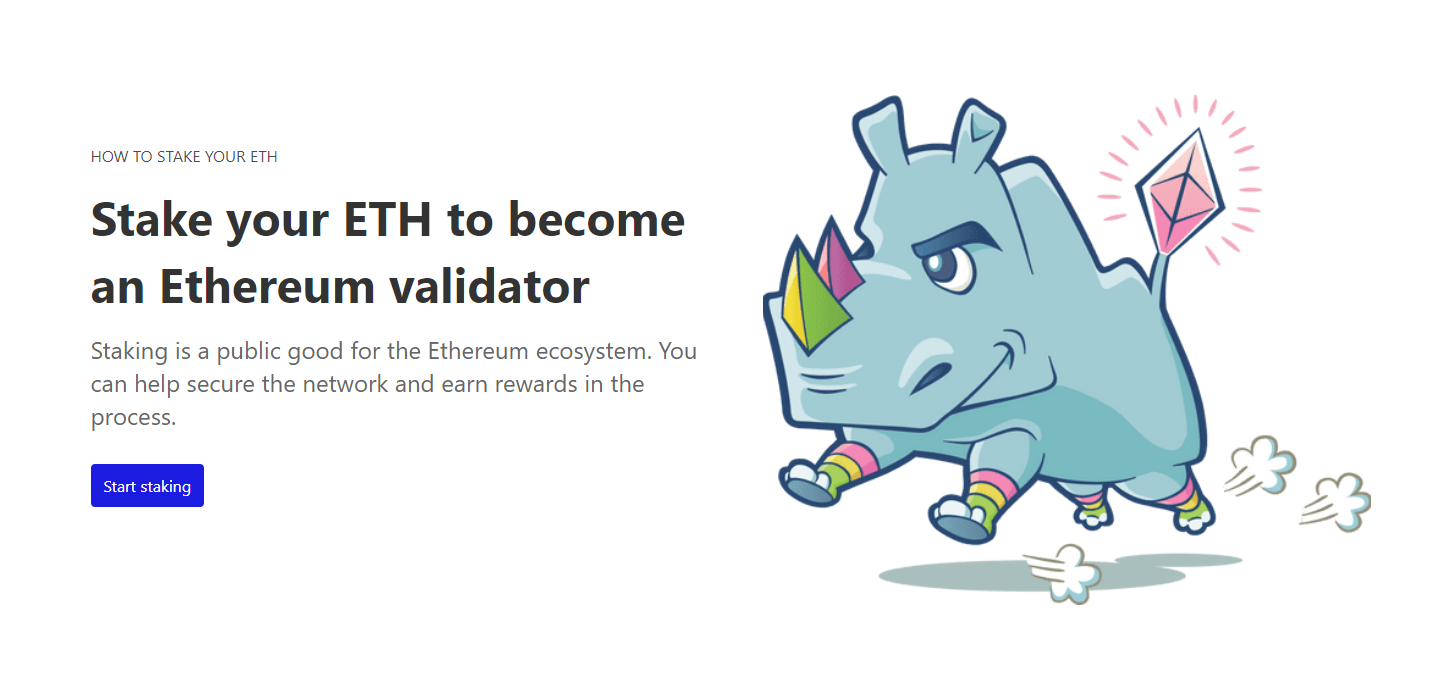
Pour sa v2.0, Ethereum mise sur le staking : vous devez détenir 32 ethers ou passer par un pool
Ces dernières années, une autre solution a séduit les développeurs, consistant à utiliser la capacité de stockage pour générer du consensus. Une solution perçue au départ comme moins coûteuse et plus économe en énergie, puisque les SSD/HDD consomment peu et peuvent avoir une très grande densité.
À travers le temps, cela a pris différentes formes, comme la preuve de capacité (Proof of Capacity, PoC) de BurstCoin, la preuve de stockage (Proof of Storage, PoS) Sia, puis la preuve d'espace et de temps (Proof of Space and Time, PoST) conceptualisée par Tal Moran et Ilan Orlov et en partie reprise par Filecoin ou Chia.
Dans ces trois cas, des données sont stockées sur la machine de l'utilisateur, avec des différences subtiles. Le PoS permet par exemple de créer des systèmes de stockage décentralisés : les membres du réseau stockent des portions de données de tiers contre rémunération, ce que propose Sia. BurstCoin et son PoC précalculent des « Plots » utilisés pour valider des blocs. Plus vous disposez de capacité de stockage par rapport à la taille du réseau, plus vous avez de chance d'être sélectionné pour la lecture de vos plots, ce qui donne droit à une rémunération.

L'illustration des notions de Proof of Space (en haut) et Proof of Time (en bas) par Chia Network
Les spécificités de Chia et ses aspects négatifs
Chia y ajoute la notion de preuve de temps (Proof of Time) qui consiste à exiger qu'une fonction séquentielle, nécessitant qu'une étape soit terminée avant de passer à la suivante, a été exécutée un certain nombre de fois. Cela permet d'éviter qu'elle ne soit traitée très rapidement par un ASIC, un CPU à plusieurs cœurs ou un GPU.
Dans le cas de Chia, cela passe par les Verifiable Delay Functions (VDF). Cette étape étant nécessaire pour valider un bloc, Chia s'assure de ne pas favoriser les machines les plus rapides. Ainsi, si un SSD performant et une bonne quantité de mémoire sont conseillés dans la phase de précalcul, la performance de la machine importe peu.
Cela demande néanmoins quelques heures pour un simple plot de 100 Go (facteur de taille k = 32) avec le client officiel, même avec des SSD rapides. Pour la phase de mise à disposition des données permettant de valider des blocs (nommée farming), un simple Raspberry Pi suffit selon les développeurs.
Pour autant, cela ne veut pas dire que tout est rose. Chia ayant été lancée à grand renfort de communication, nombreux sont ceux qui se sont jetés sur le marché des SSD pour monter des machines en masse. On a également vu de premières cartes mères spécialement adaptées au stockage à très grosse densité.
Les cellules des SSD s'usant rapidement lorsque les écritures sont intensives, leur durée de vie pourrait d'ailleurs ne pas être très longue. Les développeurs conseillent ainsi de se tourner vers des modèles pensés pour un usage dans des datacenters à l'endurance élevée, plutôt que des modèles TLC/QLC grand public à bas coût.
Résultat : plusieurs sociétés nous ont confirmé qu'il est presque impossible d'acheter du stockage actuellement, ou alors à des prix délirants. Les approvisionnements vont prendre des mois, ce qui ne sera sans doute pas sans effet sur certains marchés où la capacité de stockage est un élément clé. Avec parfois des hausses de tarif si cela dure.
Un projet aux contours encore flous
Et pour les « fermiers », quel espoir de gains ? Ils sont assez faibles, à moins d'être très patient. Le réseau Chia compte déjà près de 6 exaoctets de données. Si vous y stockez quelques To en passant par le client officiel, il vous sera annoncé que vous mettrez, au mieux, un an avant de pouvoir éventuellement valider un bloc. Et cela ne devrait pas s'arranger avec le temps, surtout que le réseau de Chia (Mainnet) n'a été lancé que le 17 mars dernier.
Certains regretteront d'autant plus la situation que toute cette capacité de stockage n'est pas mobilisée pour des données « utiles » comme avec d'autres solutions, mais uniquement pout des éléments cryptographiques servant à valider des blocs... sur un réseau où il ne se passe pour le moment pas grand-chose, puisque les usages de Chia ne sont pas encore réellement développés. Ainsi, l'aspect « green » du réseau, largement mis en avant dans la communication, semble avoir pris le pas par rapport à la question de l'utilité concrète d'un tel réseau.
Il n'y aussi que très peu de « pools » permettant de mieux répartir les gains, 64 Chia récompensant le réseau toutes les 10 minutes au rythme actuel. Cette valeur sera réduite de moitié tous les 3 ans pour les 12 prochaines années. Ensuite, le réseau restera à 4 chia toutes les dix minutes. Pour le moment, cette monnaie n'est échangeable que sur quelques rares plateformes. C'est donc un pur pari sur l'avenir, comme souvent.
L'équipe semble assumer ces choix, évoquant la volonté de voir les chia utilisés pour des transactions plus que pour la spéculation, cherchant à réduire la volatilité, ce qui ne manquera sans doute pas d'arriver tout de même à terme. Il faudra de toute façon d'abord arriver à construire un écosystème qui perdurera au fil des mois, même lorsque l'effet d'annonce sera passé. Pour cela l'équipe compte proposer de la location de chia, distribuer des actions à ses partenaires, investir dans des startups qui miseront sur Chia, etc. Elle espère ainsi entrer en bourse à terme.























Commentaires (24)
#1
Un petit détail qui peut être intéressant, une parcelle (plot) ne fait qu’environ 100 Go, mais sa génération requiert l’écriture d’environ 1 328 Go d’écritures sur le disque. Der8auer a fait un test et en une semaine il a eu 50 To d’écritures sur un seul SSD. Donc il faut vraiment pas utiliser de SSD grand publique pour ça
Après les monnaies qui sont spécialisées dans le CPU, GPU et RAM, maintenant on a le stockage, autant les SSD pour la génération de parcelles et de HDD pour leur exploitation…
Bon, on lance les paris tout de suite sur quel sera le prochain composant à être en rupture de stock parce qu’il va être utilisé pour faire du minage intensif ? Moi j’dis que ça va être un truc à base de caméra/webcam/appareil photo.
Comme la grande majorité des crypto monnaies, ça va être un beau proof of concept, mais ça va être surtout utilisé plus comme un énième outil de spéculation et va provoquer plus de mal que de bien…
#1.1
Ben vu les stats en écriture, moi je dis la ram
Je sais pas comment marche ce truc, mais ça pourrait être une solution de calculer en ramdisk (ou client adapté et ram) et stocker sur hdd ?
#2
Spéculation, encore… Les sauterelles ravagent un champ de blé et passe au suivant. De temps en temps, le faucon Musk éparpille l’essaim pour s’amuser mais il se reforme très vite trop occuper à tout bouffer le plus vite possible.
#3
Tout ce bordel juste pour créer des monnaies inutiles… C’est vraiment une perte de temps et de moyens qui pourraient être utilisés pour autre chose…
#4
En gros… Chia est une tentative d’équité, vu que ce n’est plus une question de qui a la plus grosse machine ?
Le progressisme appliqué aux cryptomonnaies ?
Oh. My. God…
Cela donnera immanquablement des résultats catastrophiques. Quand on voit ce que le progressisme donne sur le plan sociétal, j’imagine sur le plan technique.
Au moins les GPU peuvent avoir une seconde vie, même si l’électricité gâchée à les faire tourner pour de l’inutile est perdue. Les SSD par contre…
#5
Vivement que le chia soit listé sur les plateformes d’échange, qu’il puisse se péter la gueule dans la foulée, et stopper toute la spéculation sur le stockage.
Parce que c’est forcément ce qui va se passer : il y a énormément de vendeurs (tous les mineurs de chia), et en face je vois mal qui pourrait acheter une monnaie inflationniste par définition (vu qu’il n’y a pas de limite prévue au nombre de chia disponibles). Surtout qu’à partir du moment où les premières pools de minage seront montées, n’importe qui pourra en avoir facilement. Et en prime, à ce jour à part bouffer les HDD et les SSD, il n’a strictement aucune utilité, vu qu’ils n’ont pas lancé officiellement leurs services aux clients potentiels.
#6
Comme si les autres inconvénients ne suffisaient pas, le Chia ne semble pas près de pouvoir rapporter grand-chose. Par exemple, sur ce calculateur, en passant en mode avancé et en mettant une capacité initiale de zéro et une production de lopins à raison de 100 To/jour (c’est énorme), on obtient un gain estimé à 15K$ sur l’année. Ça ne couvre pas le prix du matériel, sans même parler des impôts. Or il suffirait que le cours baisse ou que le réseau grandisse plus vite que prévu pour que ça rapporte encore beaucoup moins.
Et bien sûr, le Chia est marketé à grand renfort de greenwashing, alors que la consommation du réseau est actuellement estimée à 9 GW, soit grosso modo une dizaine de réacteurs nucléaires. Écologique, on vous dit…
#6.1
Au moment où j’indique ce message, la consommation indiquée est de 10121 KW, soit 10MW, c’est loin de la puissance d’une centrale nucléaire.
Ça n’enlève rien au problème posé par cette monnaie qui va faire monter le prix du stockage pour rien.
#7
Sur les autres crypto, il y a une utilité (même si on peut toujours discuter du coût énergétique derrière), celle de valider les différents mouvements sur les blockchains. Ici, même pas, la seule chose qui tourne est du vide intersidéral…
Et c’est garanti sur mesure que le le cours va se péter la gueule à vitesse grand V. Ils ont arbitrairement mis 1000\( le chia pour attirer du monde, mais vu sa conception, dès la cotation officielle sur les plateformes d'échange, je suis à peu près sûr qu'il va passer en qques heures à moins de 1\). Je n’aurais jamais pensé qu’il consommerait autant.
Je n’aurais jamais pensé qu’il consommerait autant.
Et merci pour le lien sur la conso, c’est intéressant
#7.1
Le minage du bitcoin, c’est aussi du “vide”. Le minage lui même ne consiste qu’à trouver une valeur à rajouter au bloc pour que son hash se termine (ou commence, je ne sais plus) avec un certain nombre de zéro (nombre déterminé de tel sorte qu’il faille en moyenne 10min à l’ensemble des mineur pour trouver une solution valide).
Dans le cas d’une preuve de travail, il faut juste que le calcul soit difficile à effectuer mais facile à vérifier. Mais c’est juste une façon de résoudre le problème des généraux byzantins.
Preuve de travail, preuve d’enjeu, preuve d’espace… tout ça ont le même but que d’assurer que la falsification de l’information partagée (les blocs de la blockchain) soit difficile (ça demande juste des conditions particulières).
#8
Perso j’ai miner du chia au tout début, très bonne idée que j’ai eu, c’était une drolerie. Mais sinon c’est un projet réchauffer que le créateur a pu sortir au bon moment pour profiter du bullrun des cryptos. Le projet n’est même pas fini, le protocol de pooling n’est même pas encore disponible. Aujourdh’ui le plus gros pool (hpool - chinois évidement) possèdent plus de 51% de la capacité (ce n’est pas exactement du pooling, on crée des “plots” avec la clé privée d’une autre personne, et on prie pour qu’elle nous paie). Le côté “eco” c’est juste en comparaison avec le BTC (PoW), bien avant la démocratisation du PoS. Les mecs ont même pas essayer de changer leur slogan. Aujourdh’ui la majorité des mineurs sont des chinois, au point même que des conférences énormes sont faites en chine sans connaissance ni aval du créateur du XCH. De toute façon le réseau grandit trop vite. Le petit farmer n’ont aucune chance de quoi que ce soit.
#9
Et pourtant
#10
Vu les stats des disques qu’il est possible de trouver, ça parlerait de “tuer” un SSD standard (256Go) en 40 jours environs…
Gare au marché de l’occasion pour l’achat des SSD, c’est un coup à se faire refourguer des SSD en toute fin de vie en pensant faire une bonne affaire.
#11
Euh, le chia tient plutôt bien (~1200 eur: https://www.coingecko.com/en/coins/chia/eur) et s’échange sur des plates-formes (gate.io pour n’en citer qu’une).
Je ne défend pas l’utilité du projet mais corrige juste des informations erronées
#12
#13
La grosse escroquerie du chia, c’est que les fondateurs se sont réservé 21ans de “minage” d’avance… Autant dire que les farmer, dont plus de la moitié est détenu par une pool chinoise, ne vont pas peser lourd dans la balance.
Le cours du chia se fera suivant le besoin ou non de fiat des fondateurs…
A coté de ça, il ne faut pas chercher quoi que ce soit de rationnel dans les cryptos, car contre tout logique, on trouve quand même des gens pour en acheter. Tout le monde veut gagner un peu, ca permet de jouer à la bourse sans devoir se taper les contraintes bancaires. Et comme globalement, c’est assez facile d’arriver à vendre plus cher que le prix d’achat, c’est motivant.
#14
C’est long un programme spatial, to zeeee mooon
C’est surtout la contrainte de surveillance. Bourse tu dois suivre l’actualité en 5 langues sur 20 fronts

Par contre la bourse elle ferme le soir et week-end.
Crypto le BTC sert toujours malheureusement d’index, et du coup le seul truc à surveiller est le twitter de Musk.
#15
Avec 80 à 90% de perdants dans la finance crypto, je ne suis pas aussi affirmatif.
Et le cours du chia se fera aussi en fonction des acheteurs, comme pour tous les actifs. S’il n’y a pas d’acheteur, le cours s’effondre dans la foulée.
#15.1
Je suis curieux de savoir d’où tu tiens ce chiffre. Gagner en crypto c’est assez accessible du moment que tu agis de manière rationnelle. Je te parle pas de faire le coup du siècle et de devenir riche avec 100 balles, mais faire mieux que tous les autres placements n’est vraiment pas compliqué pour qui cherche à comprendre un peu ce qu’il fait (mais le risque est à la hauteur des gains potentiels, comme avec tout placement).
Mais jusqu’à aujourd’hui et depuis 10 ans au moins, juste conserver ses crypto est une stratégie gagnante. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais bien que c’est accessible à tous d’être gagnant.
#16
Plus j’en apprends dessus, plus je me dis que les crypto-monnaies sont du gaspillage pur et simple d’énergie et de composants.
Et en plus cela fait monter les prix pour ceux qui ont un vrai usage de ces composants.
#17
C’est vraiment déplorable, ces crypto-monnaies : du gachis de matériel, d’énergie et de ressources.
#18
Pour qu’une baleine puisse s’enrichir, faut qu’il y a un certain nombre de perdants en face… Il n’y a pas de secret. Et les baleines sont rarement perdantes. Le taux est +/- le même que pour la Bourse.
Ce que beaucoup ne font pas. La majorité des gens ne comprennent pas grand chose aux investissements, achètent quand les cours grimpent en flèche, et paniquent quand ils redescendent, y laissant pas mal de plumes au passage (ce qui est exactement ce qui s’est passé ce WE suite au tweet de Musk d’ailleurs). Ce que j’ai pu encore voir il y a qques jours, avec le JeanKevinCoin : son créateur a indiqué partout que c’était une pure blague sans aucun intérêt, qu’il n’y avait aucune liquidité dessus (il a mis qque chose comme 50€ pour plusieurs millions de jetons), qu’il n’y a strictement aucun projet derrière… Mais il a suffi d’un seul message à son sujet sur jv.com pour la faire exploser de 0,02€ à 2,5 en qques heures avant de redescendre encore plus vite…
Même les stablecoins?
Même les stablecoins?
#19
Pourquoi ne pas parler de Filecoin qui est live et utilisé depuis plusieurs mois et qui utilise un preuve d’espace temps et qui permet d’utiliser l’espace de stockage mis à disposition pour stocker des données des manière décentraliser?
#20
Pour ceux qui aimeraient une crypto qui n’est pas et ne sera pas un désastre écologique, et n’engendre aucune course que ce soit: https://duniter.org/fr/ (la Ğ1). Projet encore jeune, mais très intéressant: il n’y a pas de minage, chaque membre reçoit automatiquement une part par jour. Et le système de certification entre membres (toile de confiance) évitent les comptes dupliqués. Projet encore jeune, mais je trouve que c’est bien mieux réfléchis et bien moins sujet à devenir purement spéculatif.