La Commission des lois a adopté hier les mesures phares de la proposition de loi sur la Sécurité globale. Next INpact vous propose un compte rendu des débats, accompagné de nos explications.
Le texte issu des camps LREM sera examiné en séance du 17 au 20 novembre. Ses mesures, denses, constituent une véritable trousse à outils sécuritaire. Au menu, caméras individuelles, drones, protection des photos des policiers, aéronefs avec caméras et en premier lieu, « vidéoprotection ». La version pour la séance a été préparée hier en Commission des lois après des heures d’échanges.
Pas d’ordonnance sur la « vidéoprotection »
Dans la masse des 434 amendements déposés, le gouvernement a d'abord tenté une réforme au bulldozer de la vidéoprotection en France, espérant revoir tout ce régime par… ordonnance. En clair, par l’application de l’article 38 de la Constitution, il espérait être habilité à empiéter sur le domaine de la loi pour réformer ce régime.
Sans surprise, la rapporteure Alice Thourot (LREM) y était chaudement favorable, mais une levée de boucliers a douché ses espoirs. Habiliter le gouvernement à revoir ce régime par ordonnance franchirait « une ligne rouge », a fustigé le député MoDem PHilippe Latombe, non sans menace. « Si cet amendement est adopté, cela conditionnera très sérieusement notre vote sur l’ensemble du texte ».
Le gouvernement n’entendait en effet pas seulement toiletter, harmoniser ce chapitre, mais aussi le « moderniser ». Or, selon Philippe Latombe, « le Parlement doit avoir son mot à dire ». Et ce débat « nécessite un avis du Conseil d’État, mais aussi beaucoup de travail, car nous touchons aux droits et libertés individuelles ». Et le député Éric Diard (LR) d’embrayer : « on a l’impression que cette proposition de loi [LREM, ndlr] se transforme en projet de loi [d’origine gouvernementale, ndlr], cela nous parait inquiétant, et cet amendement en est la preuve ».
Le député Latombe a bien compris que derrière le verbe « moderniser », « le gouvernement pourrait intégrer par exemple la reconnaissance faciale ». La CNIL, qui a régulièrement appelé à un débat sur les caméras « n’a jamais demandé à ce que le gouvernement fonctionne par ordonnance ».
L’amendement gouvernemental a finalement été retiré, ce qui n’a pas empêché les parlementaires de valider quelques modifications de la « vidéoprotection », nom donné à ces caméras de vidéosurveillance implantées sur la voie publique ou dans un espace ouvert librement au public.
Techniquement, l’article 20 de la « PPL » modifie l’actuel article L. 252‑2 du Code de la sécurité intérieure s’agissant des agents de police municipale. Une fois la loi publiée au Journal officiel, et sauf modification, ils pourront officiellement visionner ces images (celles « dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques »).
Certains de ces agents, individuellement désignés et dûment habilités, pourront même être « destinataires » de ces images afin que ces contenus leur soient directement adressés, à l’instar des policiers, gendarmes, douaniers et services d’incendie et de secours.
En somme, une évolution, plus que la révolution rêvée par le gouvernement par la pirouette de l’ordonnance.
Des caméras dans les halls d’immeubles couplées aux policiers
Un article additionnel, présenté par la rapporteure Alice Thourot a également passé le cap de la commission des lois.
Aujourd’hui, sur décision de la majorité des copropriétaires, les images des caméras installées dans les parties communes des immeubles d'habitation peuvent être transmises aux policiers et gendarmes. Bien entendu, non à flux permanent, mais seulement « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes ».
L’amendement Thourot abaisse considérablement ce seuil de déclenchement : la diffusion pourra se faire « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux ».
Cette transmission s'effectuera même en temps réel « dès que les circonstances l’exigent » en vue de l'intervention de la police, de la gendarmerie ou de la police municipale. Une procédure d’urgence est même introduite, la transmission des images sera décidée par les mêmes autorités, dès lors que le gestionnaire de l’immeuble aura déclenché une alerte. Donc sans vote des copropriétaires.
Un autre article a été adopté au passage, sur initiative du gouvernement : il permet aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP « de pouvoir visionner les images déportées vers les salles d’information et de commandement de l’État, sous le strict contrôle des services de police et de gendarmerie nationales ».
Guerres des images sur les réseaux sociaux
L’article 21 de la proposition est relatif aux caméras individuelles. Ces dispositifs de captation audiovisuelle portés par les policiers et gendarmes peuvent être activés « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident » selon les circonstances de l'intervention ou le comportement des personnes concernées.
Selon le Code de la sécurité intérieure, ces enregistrements, qui relèvent des traitements de données à caractère personnel, ont pour finalité :
- la prévention des incidents au cours des interventions
- le constat des infractions
- la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
- la formation et la pédagogie des agents.
Une nouvelle finalité a été ajoutée dans la proposition de loi LREM : « l’information du public sur les circonstances de l’intervention ».
Cette réforme a fait bondir encore une fois Philippe Latombe. « L'utilisation des images de caméras individuelles ne semble pas pertinente aux fins d'information du public sur les circonstances de l'intervention. La disposition introduite par cet alinéa risque de porter atteinte au secret de l'instruction et par conséquent de nuire à l’exercice d’une justice sereine et impartiale », a-t-il défendu lors de la présentation de son amendement de suppression.
Selon lui, il ne devrait pas être possible de révéler ces images au public alors qu’on est « dans le cadre d’une information judiciaire ou d’une enquête ». Sacro-saint secret de l’instruction.
Mais pourquoi donc, le groupe LREM entend montrer ces images au public ? Selon la rapporteure, l’idée est d’autoriser le ministère de l’Intérieur à utiliser ces enregistrements pour lutter contre les images partagées sur les réseaux sociaux. Alors que ces vidéos sont accusées d’être parfois tronquées, « une vue d’ensemble pourra révéler que la scène est plus complexe ».
En appui de sa collègue, Raphaël Schellenberger, autre député LREM, vantera la nécessité d’objectiver les évènements. Il en irait selon lui de « l’acceptatibilité » de l’autorité de l’État. « Je peux comprendre que cela puisse heurter certains vieux principes de droit, qui doivent être mise à jour ». En somme, voilà une excellente réforme pour doter nos institutions « des moyens de communication adéquats ».
Pour le rapporteur Jean-Michel Fauvergue, député LREM et ancien commissaire, « il faut se déniaiser par rapport à toutes les situations. On est en train de perdre la guerre des images sur les réseaux sociaux ». Avec des images diffusées qui « vont toutes dans le même sens ». « Il faut lutter à armes égales, nous sommes dans une société moderne, il n’y pas de raison que ceux qui représentent l’autorité de l’état aient un temps de retard ». Et pour Didier Paris (LREM), tant qu’une enquête n’a pas été ouverte, les éléments sont publics.
Se déniaiser et prendre ses gouttes
Cette guerre des images nourrie par celles captées par les policiers n’a pas vraiment convaincu Danièle Obono (LFI) : « On est en train de créer une vérité étatique et gouvernementale ». « Une guerre contre qui ? Les médias ? Les citoyens ? ».
Un autre député rappellera néanmoins la scène de cette infirmière interpellée sans ménagement dans une vidéo, et qui avait jeté des projectiles sur les forces de l’ordre peu avant, dans un autre extrait.
Le député Éric Pouillat (LREM) s’est dit « outré qu’on compare l’institution, l’État, les ministères à des officiels politiques qui manipuleraient l’information. C’est les ramener à la plus vile expression, sans considération à l’égard de ceux qui nous protègent ».
« Voyez M. Latombe, concluera le député Fauvergue, qu’il est important de se déniaiser. Mme Obono décharge son fiel sur la société française, sur l’ensemble des forces de l’ordre. Il faut un contre discours à cette ultra minorité ». Au passage, l'intéressé a invité la députée Obono à « prendre ses gouttes ».
Ambiance réseaux sociaux…
Des images transmises au poste de commandement, en temps réel
Les images des caméras mobiles ne seront pas seulement utilisées pour mener des campagnes de contre-discours officiels sur Twitter ou Facebook. La PPL initiale prévoit que lorsque la sécurité de ces agents ou celle des biens et des personnes sera menacée, alors ces flux « pourront être transmis en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention ».
Mieux. Le Code de la sécurité intérieure prévient aujourd’hui que les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Un point qui avait été pris en compte par la CNIL dans sa délibération de 2016.
La proposition de loi LREM, dans sa rédaction initiale, fait sauter cette digue, ouvrant donc l’accès des agents aux vidéos captées par eux. Une mesure contestée par les députés socialistes. « Ces caméras peuvent transmettre leurs enregistrements en direct au centre de commandement, il n’apparaît pas souhaitable de permettre aux agents concernés d’intervenir sur l’enregistrement, avec les risques d’erreur ou de malveillance associés ».
Sacha Houlié (LREM) a préféré s'en tenir au droit de la preuve. Un tel accès risque de faire perdre la force probante de la captation, « la bonne foi de l'agent pouvant être remise en question ». Analyse partagée par Paul Molac (Libertés et Territoires) : cet accès va jeter un doute sur un possible bidouillage des images.
Dans le camp des partisans de cette réforme, des raisons opérationnelles sont mises en avant : il est de l’intérêt des policiers et gendarmes de revoir ces images pour retrouver une personne ou « revoir ce qu’on a vu ».
Le texte a été adopté, après affinage. Un amendement des rapporteurs a été adopté (pour tenter) de limiter les risques : cet accès ne sera limité qu’au seul cadre « d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. ». Selon les deux députés, cette version permettra d’écarter les possibilités de dévoyer le matériel. L’accès sera autorisé par exemple pour rédiger un PV et « se remémorer exactement les circonstances de l'infraction » ou « pour faire un signalement d’une personne en fuite ».
Sécurisation des images, sans chiffrement (pour l'instant)
Enfin, un alinéa de la « PPL » prévient que les caméras seront « équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention ». Théoriquement, un agent pourra donc accéder aux vidéos, mais l’intégrité de la vidéo serait garantie.
Philippe Latombe a jugé plus utile de mieux sécuriser ces passages. Il a vainement défendu ses amendements 224 et 225, qui exigeaient des fichiers « unitairement chiffrés, signés et horodatés sur le serveur de stockage », après contrôle éventuel de l’ANSSI.
La rapporteure s’y est opposée, considérant que ces modalités pratiques relevaient du seul règlement, un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. Rejet.
Le député a connu meilleure fortune avec un autre amendement : pourront être transmises au poste de commandement, les images des caméras embarquées dans les véhicules des forces de l’ordre.
Une rustine LREM passée haut la main consacre l’ensemble de ce régime aux policiers municipaux.
Relevons enfin l’amendement Molac et Aquaviva qui voulait préciser que ces caméras se devaient de poursuivre aussi un objectif de diminution des « situations de recours illégal à la force ».
Il a été rejeté, après avis défavorable des rapporteurs LREM.
Drones et autres aéronefs : des yeux électroniques dans les airs
L’article 22 vient pour sa part encadrer l’usage des drones et autres aéronefs par les forces de l’ordre. Cette réforme a été appelée du pied par le Conseil d’État lors d’une procédure initiée par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme. Au bout de ce missile sol-air, les flottes de drones déployés lors du premier confinement pour surveiller son respect sur de larges zones.
Le Conseil d’État avait relevé sans mal que ces appareils, au regard de leurs capacités techniques, engageaient des traitements de données personnelles – le visage des personnes physiques. Or, aucune autorisation n’avait été consacrée par un texte spécifique pris après avis de la CNIL. La Quadrature a dupliqué cette procédure, constatant que la Préfecture de police de Paris poursuivait ces essaims en dehors du confinement.
La « PPL » LREM apporte le cadre réclamé par le Conseil d’État, mais en l’étendant considérablement. Déjà, il concerne non seulement les images captées par les drones, mais également par l’ensemble des aéronefs (avions et hélicoptères). Surtout, les finalités initiales ont été largement étendues, dépassant le simple contrôle aérien des mesures de confinement :
- prévention d’actes de terrorisme
- constat des infractions et poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
- protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords
- sauvegarde des installations utiles à la défense nationale
- régulation des flux de transport
- surveillance des littoraux et des zones frontalières
- secours aux personnes
- formation et pédagogie des agents
« Une escalade vers la surveillance de masse et généralisée » fustige La France Insoumise, qui a esquissé des scénarios orwelliens avec à la clef des solutions de reconnaissance faciale. « Ce n’est pas le type de société que l’on veut », dixit Daniele Obono. Son amendement de suppression s’est crashé sur le tarmac LREM.
Rejet des amendements interdisant la reconnaissance faciale par drone
En quête de garanties, Phlippe Latombe n’est, pour sa part, pas parvenu à faire adopter ses amendements visant à interdire la sous-traitance de l’exploitation des images. Paul Molac a voulu spécifiquement interdire les traitements de reconnaissance faciale à partir des images chalutées depuis les airs. La rapporteure lui a répondu en substance que la question n’était pas là aujourd’hui. Circulez.
Latombe a tenté de prohiber, tout aussi préventivement, que ces aéronefs puissent capter et donc traiter les « informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Exit, puisque ces appareils serviront au constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs.
Même funeste sort lorsque le PS a souhaité protéger de ces yeux électroniques, non seulement les « domiciles », mais aussi les « immeubles et espaces privatifs ».
L'information du public
Selon le texte, le public sera informé « par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable ». Philippe Latombe a tenté d'imposer une information préalable. Rejet.
Ajoutons qu’il n’y aura pas d’information « lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». Et puisque c’est la poursuite de ces objectifs qui justifient ces traitements, il devrait être très simple de sortir systématiquement le paravant du secret.
Seule une vague information « générale », organisée par l’Intérieur, sera assurée dans tous les cas, sur initiative LREM.
Sont tout autant partis à la poubelle l’amendement qui limitait la durée de conservation des images à 15 jours, plutôt que 30, et celui imposant un principe de proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et les objectifs poursuivis.
Des finalités en définitive élargies
Par contre, d’autres amendements ont élargi le périmètre des objectifs justifiant l’envol de ces flottes de drones et autres aéronefs au-dessus de nos têtes. La liste finale, en sortie de commission, intègre les OIV et les rodéos motorisés :
- prévention d’actes de terrorisme
- constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
- protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords
- protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale (OIV et autres points d’importance vitale du Code de la défense)
- régulation des flux de transport
- surveillance contre les rodéos motorisés (amendement MoDem)
- surveillance des littoraux et des zones frontalières
- secours aux personnes
- formation et la pédagogie des agents
Cachez ce visage de policier
Dernier gros pilier de la proposition, touchant aux nouvelles technologies, la nouvelle infraction inscrite à l’article 24 du texte : jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour quiconque diffuse l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un policier et d’un gendarme « dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ».
Cette disposition inscrite au sein de la loi de 1881 a suscité là encore une forte opposition de la France Insoumise. Pour Danièle Obono, c’est une atteinte aux règles fondamentales, qui recèle « la volonté d'invisibiliser un certain nombre d'actes ».
Des députés se sont fait l'écho de la fronde des syndicats de journalistes. Et pour le député Paul Molac, il y a un « risque que, dans les faits, la diffusion de vidéos exposant des cas de pratiques illégales par la police soit rendue impossible ou extrêmement difficile. »
Contestation de Jean-Michel Fauvergue, qui dénonce des « contre-vérités » et en premier lieu la soi-disante obligation de « floutage ». L’objectif est de répondre aux menaces ou à la diffusion de coordonnées personnelles concernant des forces de l’ordre. L’ancien commissaire : « On doit protéger ceux qui nous protègent. Sous l’uniforme, il y a des hommes ». Et des femmes. « Nous n'avons pas l'intention de faire flouter les visages, on ne veut pas construire le secret ou l'immunité que fantasment certains ».
Il est vrai que le texte n’introduit pas le concept d’obligation de floutage, mais, quoi qu’en dise le parlementaire, cette solution sera bien l’une des techniques permettant de cacher un visage. Et donc d’éviter de cocher l’une des cases conditionnant l’infraction.
« Des agents sont reconnus, jetés en pâture sur les réseaux sociaux, avec des appels à des représailles. Les forces de l’ordre travaillent à visage découvert, on doit les protéger » implore la corapporteur. Pour les partisans du texte, les journalistes pourront continuer leur travail. Tous insistent pour souligner que l’infraction exige aussi la caractérisation d’une intention malveillante (« dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique »).
Les députés MoDem ne sont pas parvenus à faire retirer les mots « ou psychiques », qu’ils jugeaient excessifs, car ouverts à interprétation large. Pour Fauvergue, « on ne peut considérer que le harcèlement ne compte pas, qu'appeler à pourrir la vie d'un agent des forces de l’ordre ou ses proches ne compte pas. Je suis opposé à la suppression de l'expression ».
La boite de Pandore du « No Face »
Au fil des échanges, Paul Molac a relevé que le harcèlement était déjà une infraction. L’incitation à la violence, à la menace, l'injure avec circonstances aggravantes, etc. « cela existe déjà ! » a renchéri Danièle Obono, qui craint une vague d’autocensure.
Malgré tout, la disposition a été adoptée. Et même élargie à l’ensemble des agents (adjoints de sécurité, futurs policiers adjoints, et gendarmes adjoints volontaires), suite à cet amendement LREM.
Le même texte a fait sortir le numéro d'identification individuel (dit RIO) des éléments d’identification « puisque leur révélation n'est pas de nature à exposer les policiers et des gendarmes à des représailles comme vise à l'empêcher le présent article ».
« Si le RIO reste identifiable, cela induit que le reste de l'image doit être flouté ! » n’a pas manqué de réagir Danièle Obono.
Pourquoi seuls les policiers et gendarmes mériteraient-ils une telle protection ? Des députés ont donc déposé une pluie d’amendements pour tenter d'étendre l’article aux policiers municipaux, aux agents des douanes, aux pompiers et aux gardes champêtres. La boite de Pandore du « No Face ». Malaise et hésitation dans les camps des rapporteurs qui ont préféré réserver leur réponse à la séance. « D’ici là, on va voir si cela mouline » notamment quant à la conformité de cette extension à la Constitution de 58.
Le Défenseur des Droits, cheveu dans la soupe parlementaire
Le Défenseur des Droits n’a pas attendu. Dans un avis sorti en plein examen en Commission, il a épinglé l’ensemble des articles présentés ici.
L’accès des forces de l’ordre aux images des caméras mobiles ou la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux par l’Intérieur ? « Ces données peuvent revêtir un caractère personnel », de plus, « leur accès doit être entouré de toutes les précautions permettant le respect du droit à la vie privée ».
Les drones ? « L’usage de drones pourrait permettre l’identification de multiples individus et la collecte massive et indistincte de données à caractère personnel. Si le texte prévoit la protection de l’intérieur du domicile, le Défenseur des droits considère qu’il ne contient en aucun cas de garanties suffisantes pour préserver la vie privée ».
L’infraction relative aux photos des policiers et gendarmes « dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique » ? Des termes « bien trop imprécis pour ne pas entrer en contradiction avec le principe de légalité des délits et des peines ».
Il rappelle qu’en vertu des textes, les fonctionnaires doivent être identifiables et à visage découvert. « Des protections contre l’identification de fonctionnaires de police et militaires de gendarmerie existent (…) dans les cas où elles peuvent se justifier », par exemple pour le renseignement ou dans certains actes de procédure.
« La libre captation et diffusion d’images de fonctionnaires de police et militaire de gendarmerie en fonction, hors les exceptions évoquées plus haut, est une condition essentielle à l’information, à la confiance et au contrôle efficient de leur action ».
Prochaine étape, le 17 novembre, en séance.



















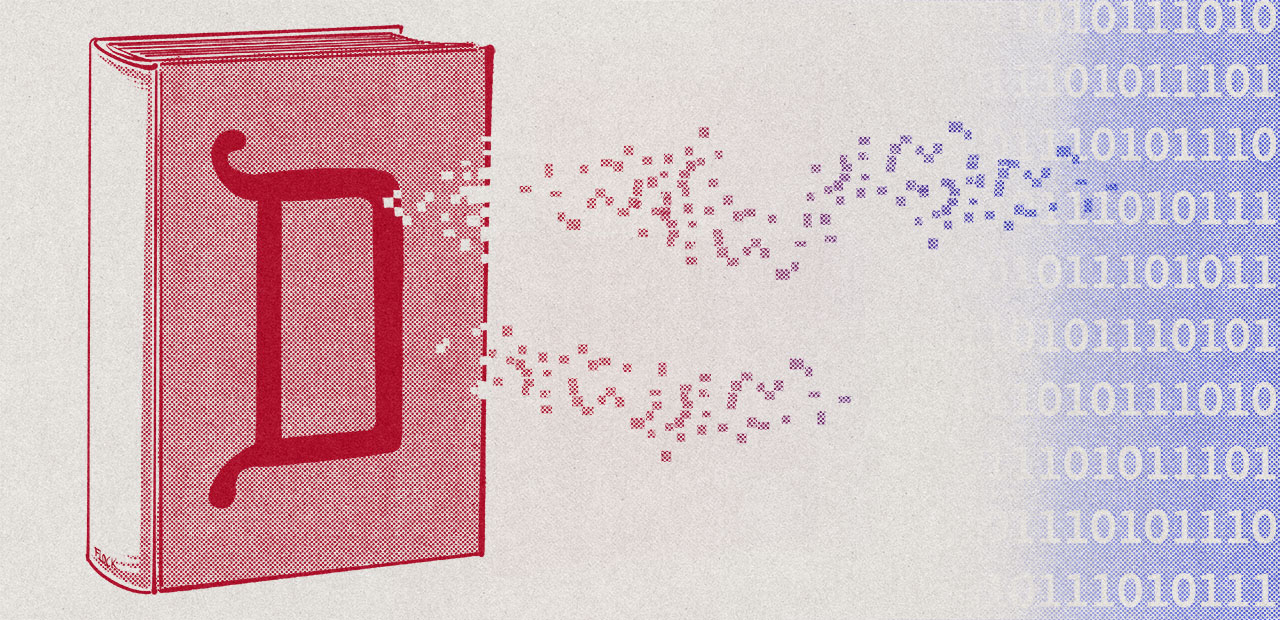
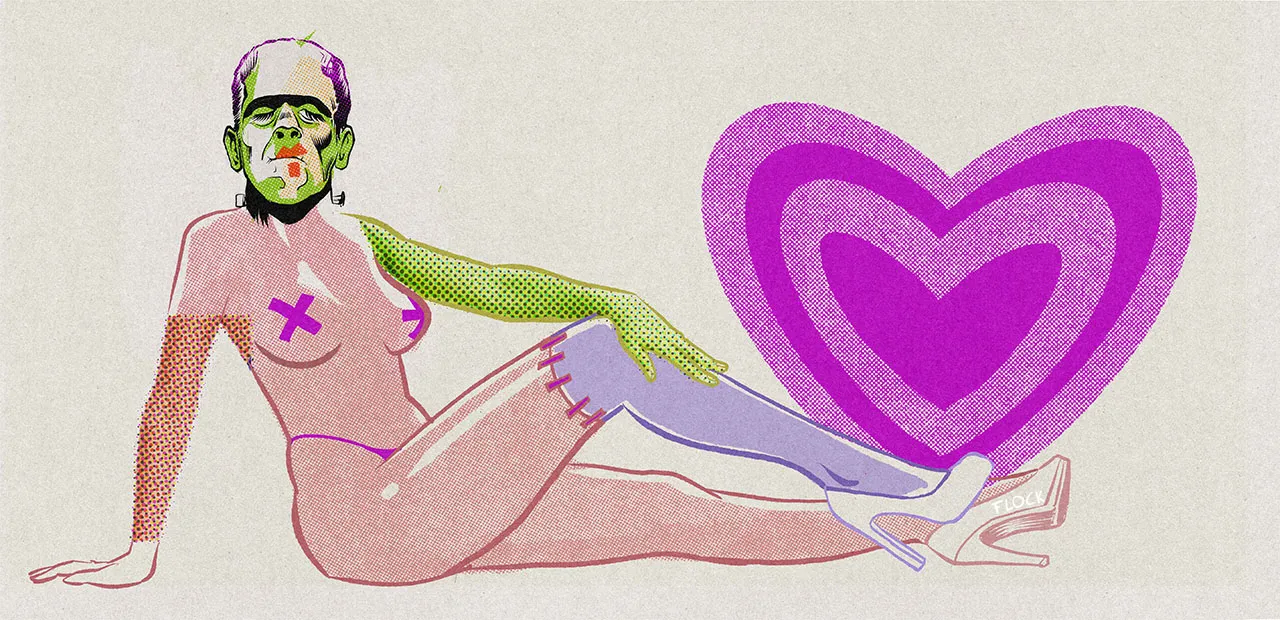
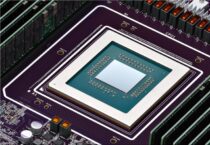






Commentaires (32)
#1
Bienvenue dans un État policier.
Plus sérieusement, on est en train de passer d’un État pas suffisamment policier, à un État trop policier. Je ne suis pas certain que le bénéfice convienne au plus grand nombre (même si ce plus grand nombre va applaudir).
#1.1
On avait déjà bien basculé dans l’Etat Policier (du moins en théorie) avec toutes ces dispositions de l’état d’urgence passées dans le droit commun en 2017.
Et pour l’état d’avant “pas suffisamment policier” selon toi, je mettrai la faute sur Sarkozy, qui a bien bousillé la police et les services secrets. (C’est pas plus de lois qu’il leur faut, mais une meilleure organisation et plus de moyens !)
#1.2
Le risque, c’est aussi que les vidéos ne soient activées que quand ça arrange les policiers.
D’autant qu’un nombre beaucoup trop important de policiers n’est pas digne de confiance.
https://www.streetpress.com/sujet/1591288577-milliers-policiers-echangent-messages-racistes-groupe-facebook-racisme-violences-sexisme
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/la-justice-ouvre-une-enquete-sur-des-messages-racistes-attribues-aux-forces-de-l-ordre_3997891.html
#2
Tout d’abord merci pour le travail de veille (thread twitter passionnant), d’analyse et de synthèse.
c’est très bien que ça soit publié, ce qui serait encore mieux, c’est que ces travaux soient diffusés dans les mass médias.
Donc pour résumer:
Les syndicats Policiers ont eu tout ce qu’ils demandaient.
La position de LREM (et du MODEM) est pitoyable d’un point de vue du respect des droits fondamentaux.
M Fauvergue est en roue libre, ce qui est très inquiétant au vu de ses anciennes et actuelles fonctions.
M Pouillat est constant dans son incompétence (ça devient une habitude, qu’il retourne à sa médiathèque).
Au final, avec cet arsenal mal fichu, une grande partie des procédures pénales va partir directement à la poubelle.
Les FDO vont être encore + détéstées (l’inégalité flagrante de droits et devoirs que porte ce texte va devenir insupportable pour nombre de nos concitoyens).
LREM ouvre (en très très) grand la porte à un procès en dérive sécuritaire et, si les choses devaient mal tourner (à savoir application telle quelle de la loi et déroute électorale en 22 portant au pouvoir un parti d’extrême droite), la France, patrie des lumières et des libertés, grande donneuse de leçons devant l’éternel, sera au niveau de la Hongrie d’Orban…
Tout ça pour complaire à 3 illuminés et rassurer les peureux qui ont abdiqué toute capacité d’analyse.
C’est consternant.
Reste aux sénateurs de finir le boulot (on peut avoir confiance dans LR et Retailleau pour durcir encore + ce dispositif).
Le Conseil constitutionnel va avoir du travail.
#3
Merci pour ce résumé. J’imagine la torture que c’est de regarder les débats en commission lorsque :
Au passage, l’intéressé à inviter la députée Obono à « prendre ses gouttes ».
Vivement la Saison 2 en séance !
#4
C’est déjà le cas, hein.
Ou alors, ceux que tu estimes encore plus à droite feraient quoi de plus?
#5
22, v’là les flics
#6
J’ai lu cet article hier soir et ça m’a tordu les tripes d’angoisse.
Bordel, le futur, c’était mieux avant.
Là, je ne crois vraiment pas qu’aucun des autres partis qui étaient dans la course à la présidence aurait pu faire pire niveau dérive sécuritaire ou pour bafouer les libertés individuelles et fondamentales.
Je ne dis pas qu’ils n’auraient pas tenté, mais qu’ils n’auraient jamais réussi.
Il y a un vrai problème, dans la prétendue “démocratie représentative” qui est la nôtre, si les députés sont placés et aux ordres comme c’est le cas ici.
Les sénateurs sont censés être des barbons conservateurs et les députés des révolutionnaires réformateurs. Là… j’sais pas bien quoi en faire :(
#7
Bien bien bien…
J’en viens à être content de la pandémie de covid, on a au moins le droit de se masquer -temporairement- le visage…
(Ceci était moitié une blague moitié un c’est-triste-mais-c’est-quand-même-la-réalité)
Plus sérieusement, merci @marc rees pour rendre le tout compréhensible par le commun des mortels.
Ca veut dire quoi ? Maintenant que le texte est passé en commission, il passe en séance, et après hop, emballé c’est pesé, ajoutez moi ça au dalloz ?
J’avais déjà posé la question dans le précédent article, mais du pas eu de réponse : quel recours a-t-on ?
J’ai étonnamment l’impression que tout le monde s’en fout de cette loi : je n’ai pas réellement vu d’articles de presse, de journaux, etc en parler.
#7.1
Summon the hero https://www.youtube.com/watch?v=i1u16BdE8tQ
#7.2
(un p’tit d’canif aux Libertés….un –> “au suivant, au suivant” !!!
https://youtu.be/NhIdt687UJs.
#8
Étant donné que ces derniers ont déjà voté pour autoriser la transmission d’image/vidéo, le caractère d’urgence de la situation est automatiquement inclus, d’autant que le gestionnaire de l’immeuble est aussi choisi par eux. Face aux nuisances actuelles dans les immeubles, cet amendement est une évolution pertinente sinon attendue.
#9
La nouvelle devise de notre belle République “travaille, consomme et ferme ta gueule”. Si le conseil constitutionnel ne fait pas son boulot, c’est mal barré.
Après cette loi est tout de même révélatrice de l’esprit d’une certaine partie de la population française qui dans sa quête effrénée d’un “papa gâteau” qui résoudrait tout les problèmes d’un coup de matraque magique, est prête à abandonner toute forme de réflexions non axées sur la répression.
La question philosophique (et pratique) que pose l’abandon de la possibilité de réinsertion d’une personne “déviante” de la norme va devenir passionnante. Parce que le tout sécuritaire nous amène inévitablement vers ce débat.
#10
Très bon article à charge.
Je n’en attendais pas moi de son rédacteur dont on sent la proximité avec les idéaux LFI.
#10.1
Ben voyons
#11
Il semble que beaucoup de journaux (surtout télévisés) évitent de critiquer trop ouvertement le gouvernement - sans doute lié aux risques que cela leur fait prendre.
Les journaux papiers sont rarement indépendants. Ce qui le sont, personne ne les lit.
Il ne faut pas oublier la stratégie du choc, qui fait que ce genre de texte fini par devenir “banal”, voir pénible pour les lecteurs - et un lecteur ennuyé, c’est un lecteur qui ne rachète pas. Dangereux pour une presse écrite déjà à l’agonie.
A coté de ça les magazines “actualité” sur le net vont te passer 300 articles sur la dernière connerie de trump ou la dernière petite phrase de Loana, car c’est ce sur quoi les gens cliquent. Les articles de fond, personne ne les lit (trop long) donc ça n’apparait plus. Donc ça fait pas de clic, donc plus de fric.
Aussi simple que ça.
Faut pas s’étonner que LREM ou LR arrivent à faire passer des lois digne de dictatures avec la novlangue qui va bien pour continuer à appeler ça une république.
Clairement, là pour moi, certaines élites en France et ailleurs ont sciemment décidé que la démocratie n’était pas un mode de gouvernement efficace pour faire face aux crises qui s’annoncent et travaillent d’arrache pied pour nous faire quitter ce régime - après tout les chinois sont pas si malheureux et ça marche bien chez eux.
C’est surtout grave pour nos descendants, qui se retrouveront dans un état féodal; j’espère qu’ils se souviendront de Macron/Sarko/…. comme on se souvient aujourd’hui de napoléon, par contre vu la trempe de ces dirigeants je suis pas sur que l’humanité se sorte des crises climatiques à venir.
Qui ressemble affreusement à Arbeit macht frei :-(
Je me demande aussi si c’est pas un certain vieillissement de la population qui fait cet effet là:
Les élus sont vieux, et (en tout cas vu mon expérience) les gens qui étaient “de gauche”, progressistes il y a 20 ans et actif deviennent rétrogrades ,répressif et doté de la science infuse une fois à la retraite (maison & merco payée) , face à ces jeunes “cons” qu’ils étaient eux même voici 2 décennies . (A nous de faire attention maintenant qu’on l’a remarqué)
Sauf que si avant ils mourraient, maintenant ils ne meurent plus. Mais ils continuent à voter. Donc clientélisme.
Pour moi ca va même plus loin, la question qui se pose est de savoir si un tel gouvernement peux supporter non pas la “réinsertion” dans une société dont ces déviants ne veulent pas, mais simplement la co-existance avec des modes de vie alternatifs (Auto-gestion, vie nomade)
#12
C’est tellement déprimant
#13
J’ai l’impression flippante de lire un scénario de film d’anticipation, mais en fait non, c’est bien réel… Et ça me fout une trouille bleue de l’avenir.
#14
#15
Les caméras à gogo c’est hélas la solution de facilité que tout le monde demande au moindre incident ….
La semaine dernière nous avons eu plusieurs voitures qui se sont vu voler des pièces (roues, etc) dans le parking de notre résidence. D’après le prestataire qui gère le portail, il y aurait eu une vague puisqu’ils ont du intervenir sur plusieurs résidences, certaines forcées à coup de voiture bélier.
Dans la notre, le premier mot qu’on a entendu : “il faut mettre de la vidéosurveillance !”.
Alors que c’est coûteux (j’avais entrepris la démarche étant au conseil syndical, 11k€ pour l’installation, puis une charge annuelle de 1500€ pour la gestion…), et ne sert qu’à posteriori donc ça fait double punition à mes yeux. Le ou les propriétaires de véhicules dégradés sont pénalisés, et l’ensemble de la résidence est financièrement pénalisée.
Mais on a encore eu des demandes de vidéosurveillance et gardiennage cette semaine.
Bref, pour revenir à l’article, trois tonnes de mesures sécuritaires inutiles aussi. Inutiles pourquoi ? Parce que derrière ils ne fileront toujours pas de moyens à sa mise en oeuvre.
Et ça, peu importe le parti qui propose ces “solutions”, le résultat sera toujours le même tant qu’ils n’auront pas compris que ça ne sert à rien d’écrire un bouquin de 40 000 pages de mesures sécuritaire si personne ne les applique.
#15.1
Le plus drôle c’est que bon nombre de caméras, par besoins d’économie et industrialisation, sont sensibles au infrarouges.
Une telle surface d’attaque par émission d’IR reste songeur quant à la capacité incantatoire du mot de vidéo-protection. On devrait plutôt parler d’infra-rouge-protection afin de bien nommer les choses et éviter les sempiternels faux sentiments de sécurité décrits. J’dis ça… j’ose mal imaginer le turbolibéral intervenu dans le fil, faire preuve de la cohérence ordinaire entre science & vie à ce sujet.
#15.2
C’est parfois à ce demander si il y à pas une liste commune des résidence qui possèdent des caméra et que les société de gestion payent des mecs pour voler quelques pièces et ensuite attendent le petit coup de fil pour installer des caméras.
Dans la mienne c’était du vol de vélo, “enfin on sais pas trop quoi”. Du coup caméra à l’entrée de la résidence pour une dans chaque bâtiment. Par contre il est vrai que depuis je n’ai plus vu la porte ouverte du local à vélo sans personne dedans depuis bien longtemps.
En même temps le local à vélo c’est juste le bordel, alors qu’avec des machins pour les placer correctement ça serais plus clean et éviterais le vol / stockage de pièces détachée.
#16
Alors donc, n’importe quel taré peut faire une vidéo abjecte et la diffuser sur les réseaux sociaux et on pape sur le gouvernement parce qu’il veut utiliser la vidéo pour diminuer les incivilités et les agressions ?
Expliquez-moi … 😂
#16.1
Il n’a absolument jamais été prouvé que la vidéo permettait de diminuer le nombre d’incivilités ou d’agressions, alors qu’il est établi que la surveillance induit de l’autocensure et réduit le droit à la vie privée, par là les libertés individuelles.
Ensuite il est question de reconnaissance faciale et d’algorithmes, ce qui n’a rien à voir avec “n’importe quel taré peut faire et diffuser une vidéo abjecte”, mais il est aussi question de drones, de captation de données à caractère personnel, d’omerta sur les opérations de police, de déni de l’avis de la CNIL qui réclamait une consultation nationale, et j’en passe et des meilleures. L’article écrit tout ça mieux que je ne saurais le faire.
J’sais même pas pourquoi je te nourris au lieu de te laisser dialoguer avec Carbier…
#16.2
MDR, l’intello du village.
#17
On a eu plusieurs vols dans notre local vélo … Les 3⁄4 du temps des vélos mal attachés (nous avons un vrai rail pour les accrocher, contrairement au tien visiblement) avec genre la chaîne sur la roue avant, ce qui se démonte en 4 secondes et ne sert à rien. Notre local vélo est aussi en transition du local poubelles, et il arrive régulièrement qu’il soit mal refermé.
Perso je préfère garder mon vélo dans mon appart, je n’ai pas confiance ni envie de le perdre parce qu’un abruti ne sait pas refermer une porte à clé.
De même pour les voitures, nous avons rappelé des centaines de fois de ne jamais laisser les badges du portail à l’intérieur … Résultat on en a plein dans la nature et désormais nous avons du opter pour un remplacement total. (90 badges à 25€ l’unité + intervention pour la programmation et déprog de chaque, hop voilà c’est fait, la seule consolation est qu’on va demander aux gens de restituer l’ancien pour constituer un stock pour un besoin de remplacement)
Donc à chaque incident de ce type, nous avons une avalanche de “mesures sécuritaires” exactement comme cet article. Réhausser les murets autour de la résidence, ajouter un second portail (nous partageons le parking avec une autre résidence qui est le point d’entrée), vidéosurveillance, etc. Que des travaux qui coûtent une fortune et dont la possibilité de les réaliser est aussi faible que l’efficacité qu’ils auront.
A côté de ça, j’avais fait faire un devis pour bloquer l’accès à l’ascenseur depuis le parking et le déverrouiller avec les badges d’entrée de porte. Le sas du parking se refermant parfois mal l’hiver à cause de l’humidité et laissant un accès open bar. 500€ pour le matériel et l’installation, et j’ai eu droit à “on est pas dans un bunker”, “c’est trop cher”, etc.
Au final, cela m’a conforté pour deux décisions :
En attendant, on a eu comme résultat de gagner 5000€ sur le budget de la copropriété (qui est de 94k€) en optimisant différents postes de dépenses qui étaient en roue libre avec le syndic. Mais ça on s’en fout.
#18
On sera en avance par rapport de la Corée du Nord. État policiers total.
#19
Là où je suis, il y a eu aussi une vague de (tentatives de) vols dans les garages, durant le 1er confinement.
Pour régler ca, ca a été fait plus intelligemment et surtout plus efficient et moins coûteux :
-Au lieu de caméras coûteuses à l’installation et l’utilisation, on a mis des factices, tellement bien imitées que si tu ne le sais pas tu penses vraiment être filmé (avec en prime un panneau solaire dessus (assez bien placé pour ne pas être visible) et une batterie pour alimenter des LED qui font croire à leur fonctionnement),
-Et on a rajouté des serrures jumelles sur chaque porte, qui coûtent quasi rien (120€ la paire à ouverture avec une clé unique pour les 2) mais sont relativement performantes.
Depuis, un seul garage a eu une tentative d’ouverture, il était dans une zone non “couverte” par les caméras factices (zone qui avait été zappée). Mais avec les serrures supplémentaires, tout ce qu’ils ont pu faire c’est déformer la porte, sans pouvoir pénétrer dans le garage. Et après lui, plus rien…
#19.1
On a mis des factices, mais ils s’en foutent totalement. Il y en a qui ont été détruites depuis, donc le côté expérimentation pour les dégradations d’une vraie montre aussi que ça serai inutilement coûteux.
Et dans notre cas c’est un parking collectif, pas des garages individuels. Ca limite grandement les possibilités hélas.
Donc à part recommander des solutions locales du type surveillance interne du véhicule ou alarme, les possibilités sont vite limitées avec un résultat non garantie.
#20
Electrisation de la carrosserie au 220V pour toute personne non validée, ca leur fera les pieds
#20.1
J’y ai songé
#21
En même temps l’Union Européenne semble vouloir introduire l’obligation de portes dérobées pour les messageries chiffrées, sous l’impulsion de Macron, semblerait-il ?
https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf (en)
https://fm4.orf.at/stories/3008930/ (ge)
autre version :
https://www.statewatch.org/media/1434/eu-council-draft-declaration-against-encryption-12143-20.pdf (en)