Après plus d’un an de travail, la Hadopi a publié son rapport contre le streaming et le direct download de contenus illicites. Le rapport a été rédigé par Mireille Imbert Quaretta, présidente de la Commission de protection des droits, la tourelle pénale de la Hadopi. « Ces pistes ne constituent pas un dispositif clé en main, mais un panel d’axes de réflexion, indique l’autorité, il appartient désormais au Collège de l’Hadopi, dans le respect de ses compétences, de décider des suites que l’institution entendra, le cas échéant, lui donner ». En attendant cet avenir, nous nous sommes penchés sur le passé pour tenter de définir les sources d’inspiration de la Hadopi au fil des différentes informations collectées notamment au sein des auditions de la Mission Lescure.
 Marie-Françoise Marais (présidente du collège de la Hadopi) et Eric Walter (secrétaire général)
Marie-Françoise Marais (présidente du collège de la Hadopi) et Eric Walter (secrétaire général)
Quand un ayant droit dénonce un site ou un contenu illicite chez un intermédiaire (notice), ce dernier doit retirer (take down). Cependant, il n’a pas l’obligation d’empêcher les réapparitions (stay down). Et pour cause, cela lui imposerait une obligation de surveillance généralisée qu’interdit le droit européen. Dans son rapport, la Hadopi propose de surveiller le retour des contenus illicites pour inciter les sites à la mise en place de mesures de filtrages (comme Content ID de YouTube). Les noms de ceux qui ne collaborent pas seraient dénoncés aux autres intermédiaires (moteurs, FAI, etc.). Ceux-là prendraient alors des mesures volontaires ou imposées par un juge (déréférecement, blocage, filtrage territorial). Enfin, la Hadopi voudrait aussi être chargée par la loi de traquer la réapparition des miroirs d’un site judiciairement bloqué. Bref, accentuer la responsabilité des hébergeurs, armer la Hadopi (ou une autorité équivalente) de nouveaux pouvoirs. La Hadopi n'est pas la seule à souhaiter ce genre de mesures...
Augmenter la responsabilité des hébergeurs
- Audition de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (majors) devant la mission Lescure le 19 décembre 2012 (l’audition, notre compte rendu)
« La HADOPI pourrait donc être chargée par la loi ou par décret de s’assurer que les sites de « Direct Download » respectent l’obligation de « Stay down » et mener notamment toute action judiciaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour les sites qui ne donneraient pas de suites positives à ses demandes » (…) Cette nouvelle mission pourrait concerner aussi les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, puisque des actions de « Take down » sont également menées par les organismes de lutte contre la piraterie vis-à-vis des moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. »
- Audition de l’UPFI et SPPF (producteurs indépendants) devant la mission Lescure le 24 octobre 2012 (l'audition, le compte rendu)
« Vous faites une première notification, un moteur de recherche agit promptement. Très bien, mais le contenu réapparait sur un autre lien immédiatement et c’est une course poursuite permanente ! (…) il suffirait de prévoir une petite modification législative (…) On vous fera des propositions concrètes là-dessus qui permettraient de mettre en place ce qu’on appelle dans notre jargon un stay down : dès lors qu’une première notification a été faite, la loi obligerait l’hébergeur, le moteur de recherche, à mettre en place de façon légale les dispositions nécessaires pour éviter que le lien réapparaisse. Et pas simplement de façon volontaire. Vous avez aujourd’hui des systèmes d’ID Content, ça fonctionne plus ou moins correctement, mais il faut aller plus loin ».
Accentuer les armes de la Hadopi sur les intermédiaires (stay down)
En août 2011 éclatait l’affaire Allostreaming (l’assignation complète, notre dossier). L’industrie du cinéma français (SEVN, FDNF, APC) a réclamé le blocage de quatre sites appartenant de la galaxie Allo (Allostreaming.com, Alloshowtv.com, Alloshare.com et Allomovie) chez les principaux FAI français (Auchan, Bouygues, Darty, Free, Numericable, Orange, SFR). L’affaire est toujours en cours et ira au fond. Ils exigent également le déréférencement des moteurs de recherches d'Orange, Microsoft Bing, Yahoo! et Google. L’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle a développé pour leur compte, et en collaboration avec TMG – prestataire en amont d’Hadopi -, un outil destiné à détecter automatiquement la réapparition de sites une première fois bloqués par un juge afin de réordonner le blocage chez les FAI ou le déréférencement dans les moteurs. Les ayants droit ont plusieurs fois insisté sur l'importance de ce dossier, directement ou en creux.
- Association des producteurs de films, audition devant la mission Lescure le 18 octobre 2012 (l’audition, notre compte rendu)
Que « l’État s’implique dans les outils qui permettent au mieux d’opérer les blocages d’accès dans les conditions techniques idoines (…) On a des solutions qui existent, qui peuvent être mises en œuvre, mais je ne rentrerai pas dans le détail compte tenu de l’action » (référence à l’affaire Allostreaming).
« La Hadopi s’occupe de téléchargement, mais il faudrait étendre ces missions au streaming ou toute autre forme qui viendrait à se développer dans le futur. C’est évident »
- Canal+, audition devant la Mission Lescure le 17 décembre 2012 (l'audition, notre compte rendu)
Il y aurait « matière à étendre la compétence d'un organisme qui soit serait l'Hadopi, soit une Hadopi rénovée aux nouvelles formes de piratage et notamment au streaming illégal. (…) Ces formes de piratage vont se déployer de manière croissante à mesure que le haut débit et le très haut débit seront présents sur l'ensemble du territoire et que vont se développer dans la population, des outils, télévisions connectées et autres, qui permettront le visionnage illégal ou le streaming illégal dans des conditions de confort accru. »
Faciliter le blocage et le déréférencement, aux frais de l’État
Actuellement, les ayants droit supportent une partie des coûts du procès Allostreaming. Si les ayants droit sont confiants, l’issu d’un procès n’est jamais assuré. Dans son rapport, la Hadopi propose après modification législative de récupérer cette charge afin de surveiller elle-même la réapparition des contenus dénoncés par les ayants droit, aux fins de blocage et de déréférencement. Elle gèrera également une liste noire des sites souvent dénoncés par les ayants droit tout en étant habilitée à agir en justice. D'où lui vient cette idée ?
- Audition de l’UPFI et SPPF (producteurs indépendants) devant la mission Lescure le 24 octobre 2012 (l'audition, notre compte rendu)
Il faudrait « renforcer les pouvoirs de l’Hadopi en matière de sanctions » afin que l’autorité vise « la vraie contrefaçon commerciale » et soit dotée d’un « pouvoir d’injonctions vis-à-vis des hébergeurs en matière de déréférencement ». La loi pourrait « donner à l’Hadopi un pouvoir d’injonction vis-à-vis de ce qu’on appelle les intermédiaires techniques pour les conduire à mieux coopérer dans la lutte contre la contrefaçon, notamment en matière de déréférencement de sites. »
- Audition du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) devant la mission Lescure le 9 octobre 2012 (l'audition, notre compte rendu)
« Il serait nécessaire d’élargir les compétences de l’autorité, en dotant la Hadopi de la capacité de procéder au déréférencement des liens illicites qui conduisent les internautes vers des services en lignes illicites ».
- Syndicat de l’édition vidéo, Livre blanc sur les enjeux et les défis de la vidéo, avril 2012 (notre compte rendu)
«Il est nécessaire que l’État prenne à sa charge, sur justificatifs, les surcoûts occasionnés par la mise en place par les intermédiaires techniques de l’Internet des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées en matière de contrefaçon comme il le fait à l’occasion de sa lutte contre d’autres violations de l’ordre public telles que la pédopornographie ou encore les jeux et paris en ligne illicites. »
- Canal+, audition devant la Mission Lescure le 17 décembre 2012 (l'audition, notre compte rendu)
« On pourrait imaginer d'exiger des moteurs de recherche qu'ils cessent de référencer des sites qui sont des sites notoirement destinés à la diffusion de contenus illégaux ». Notoirement ? La Hadopi parle pour sa part de sites « manifestement destinés à des pratiques illicites », qualificatif qui permettra de dresser un système de liste noire.
 Mireille Imbert-Quaretta (présidente de la Commission de protection des droits de la Hadopi)
Mireille Imbert-Quaretta (présidente de la Commission de protection des droits de la Hadopi)
Annonceurs, régies, organismes de paiement
La Hadopi voudrait que les intermédiaires financiers cassent ou suspendent les liens contractuels avec les sites trop souvent dénoncés par les ayants droit. Ceux-ci seraient invités à prendre ces mesures proactives, ou bien prendre le risque d’être obligés par un juge s’ils montrent peu coopératifs. La Hadopi propose des mesures équivalentes à l’égard des régies pour inciter l’adoption de « solutions de vérification des placements d’annonces sur les sites », soit le contrôle les sites où sont placardées les publicités. Quelles sont ses sources d'inspiration ?
- Syndicat de l’édition vidéo, Livre blanc sur les enjeux et les défis de la vidéo, avril 2012 (notre compte rendu)
Étudier « les modalités donnant les moyens aux annonceurs de contrôler la publication de leurs publicités sur Internet et de les responsabiliser sur leurs choix de sites internet ».
- Audition du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) devant la mission Lescure le 9 octobre 2012 (l'audition, notre compte rendu)
« Certains sites de « Direct Download sont financés totalement ou partiellement par de la publicité » et il est toujours surprenant de voir que de grandes sociétés françaises publient des annonces sur ces sites connus pour héberger un volume considérable de contenus illicites. De même que l’HADOPI accorde des labels de licéité à certains sites, elle pourrait notifier aux régies publicitaires Internet françaises les sites faisant l’objet d’un nombre important et récurrent de demandes de suppression de contenus illicites, de manière à ce que ceux-ci puissent mettre la liste des sites ainsi notifiés à disposition de leurs annonceurs » (Pascal Nègre)
- Syndicat de l’édition vidéo (SEVN) audition devant la mission Lescure le 11 octobre 2012 (l’audition, notre compte rendu)
« Empêcher les régies publicitaires de financer les sites pirates. (…) Il est absolument anormal que des régies publicitaires financent ces sites illégaux», « Étudier les modalités qui donneraient les moyens aux annonceurs de contrôler leur publicité sur internet et de les responsabiliser sur leur choix de sites internet. »
- Association des producteurs de films, audition devant la mission Lescure le 18 octobre 2012 (l’audition, notre compte rendu)
Les producteurs de films souhaitent « une mise en responsabilité des régies publicitaires dès lors qu’il y a des publicités affichées sur des sites de piratage ». « Il est anormal, alors qu’on consulte un site entièrement dédié au piratage, qu’on voit une publicité pour des grandes institutions ou des grandes entreprises françaises sans que la régie publicitaire ne s’en inquiète de quelques manières que ce soit ». Les régies devraient vérifier « sur quel site vont au final les publicités ». « Il devrait être possible de leur ordonner de ne pas fournir de moyens de paiement à des sites illégaux. Quand on paye, on a l’impression que c’est légal ! »
- Audition de l’UPFI et SPPF (producteurs indépendants) devant la mission Lescure le 24 octobre 2012 (l'audition, notre compte rendu)
« il faudrait donner davantage de moyens juridicolégaux à l’Hadopi pour lutter contre les annonceurs, les régies publicitaires, via notamment des campagnes de sensibilisation à l’égard également des organismes de paiement ». Il s’agirait de « frapper de manière plus efficace là où se situe l’argent et là où s’organise une piraterie commerciale qui n’a rien à voir avec une piraterie des internautes. »
Politiques, économistes et droit comparé
Le milieu des ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique n’est pas le seul à réclamer l’accentuation des pouvoirs de la Hadopi. Les personnages politiques ou des économistes sont également intervenus en ce sens. Le droit comparé est également riche d’enseignement puisqu’avec le projet SOPA / PIPA, les ayants droit avaient tenté déjà pareille percé outre-Atlantique.
- Les lois PIPA SOPA, États-Unis (notre actualité de juin 2011)
Ces lois prévoyaient un système de « cease and desist » ordonnant à un acteur de couper un flux ou un contenu estimé illicite et s’abstenir de le rouvrir. Les intermédiaires visées sont aussi bien les FAI que les fournisseurs de services, les moteurs de recherche, les portails de liens, les sociétés de cartes de crédit, les registres DNS ou encore les annonceurs et régies publicitaires. « La loi autoriserait des organismes privés à porter plainte contre le propriétaire d'une adresse, et à demander à un juge qu'elle soit placée préventivement sur liste noire, avant jugement » commentait alors le Monde. Ici, c’est la Hadopi qui servirait de zone tampon pour gérer elle-même cette liste noire et l’irriguer chez tous les acteurs pertinents capables de casser l’accès.
- Frédéric Mitterrand en décembre 2011 à la Conférence organisée par la Coalition française pour la diversité culturelle, présidée par Pascal Rogard (notre compte rendu).
« La lutte contre ces sites de streaming relève de la responsabilité des ayants droit. Le Code de la propriété intellectuelle leur permet de demander au juge d’ordonner toute mesure propre à mettre fin aux violations des droits d’auteurs. C’est le sens de l’action engagée par les producteurs de cinéma » (Allostreaming).
« Sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis [la Hadopi] va parallèlement s’efforcer de responsabiliser les intermédiaires qui commercent avec ces sites. Les premiers résultats doivent être prêts d’ici février 2012. Il nous faut débattre en toute franchise de ces questions avec tous les intermédiaires concernés : je pense aux intermédiaires financiers, les sociétés de carte de paiement ou de micro paiement et aux réseaux publicitaires. La Hadopi m’a indiqué qu’elle organisait dans les prochaines semaines une table ronde réunissant ces acteurs. L’objectif est que chacun soit mis publiquement en face de ses responsabilités (…)Il reviendra également à mon sens aux moteurs de recherches, aux distributeurs de service, d’assumer leur part de responsabilité dans l’accès aux contenus. »
- Nicolas Sarkozy (interview au Point en mars 2012, notre actualité)
« Je veux aller encore plus loin en complétant la loi pour prévoir le cas des intermédiaires de paiement - Visa, Mastercard, PayPal - qui permettent à ces sites d'encaisser leurs recettes et celui des annonceurs publicitaires qui traitent avec des sites aussi manifestement délinquants que MegaUpload. » Le chef de l’État citait alors l’affaire Allostreaming.
- Nicolas Sarkozy, lettre à la SACD ou lettre à l’ALPA durant la campagne présidentielle de 2012
« La réponse graduée doit être complétée par une lutte tous azimuts contre les sites illégaux installés dans les « paradis numériques » ». Comment ? « Blocage de ces sites par les fournisseurs d’accès, déréférencement par les moteurs de recherche, responsabilisation des intermédiaires de paiement, coopérations judiciaire et policière internationales pour lutter contre les criminels les plus endurcis ». (…) « une partie de ces mesures est déjà possible sur le fondement de l’actuel article L336-2 du code de la propriété intellectuelle » (article surcité par le rapport Hadopi).
- Olivier Bomsel (ex membre de la mission Olivennes, professeur à ParisTech d’Économie des Médias et des Marques) article du 6 juillet 2012 sur la responsabilité des intermédiaires (notre actualité)
Cet économiste suggère dans une étude de juillet 2012 d’augmenter la responsabilité des intermédiaires techniques ou plutôt « de laisser les juges introduire du risque dans l’application du statut d’hébergeur jusqu’à ce que le niveau perçu par les intermédiaires les contraigne à mieux internaliser les dommages sur la propriété intellectuelle causés aux tiers (…) Il importe néanmoins de préciser si tous les intermédiaires, y compris les systèmes de paiement, peuvent être soumis à une règle de due car appréciable par un juge. Dès lors, si le nombre de litiges augmente, le risque juridique va aussi augmenter. Et les actionnaires des grands intermédiaires de l’Internet se montreront rapidement sensibles à une gestion rationnelle de ce risque ». La Hadopi propose justement d’ouvrir une brèche dans ce statut et menacer via le 336-2 les FAI, moteurs ou encore registres de nom de domaine d’action en justice, si les mesures volontaires ne sont pas prises.
- Aurélie Filippetti, discours du 23 octobre 2012 devant le CSPLA (notre actualité)
« J’attends à ce titre de la mission Lescure qu’elle propose des pistes pour lutter contre le « streaming » et le téléchargement direct illégaux. L’action de l'Hadopi a été insuffisante en la matière, car nous savons que de nouvelles pratiques se sont développées ces dernières années et que le droit ne peut se contenter d’une référence à un état de la technique tel que le téléchargement en « pair à pair » ».

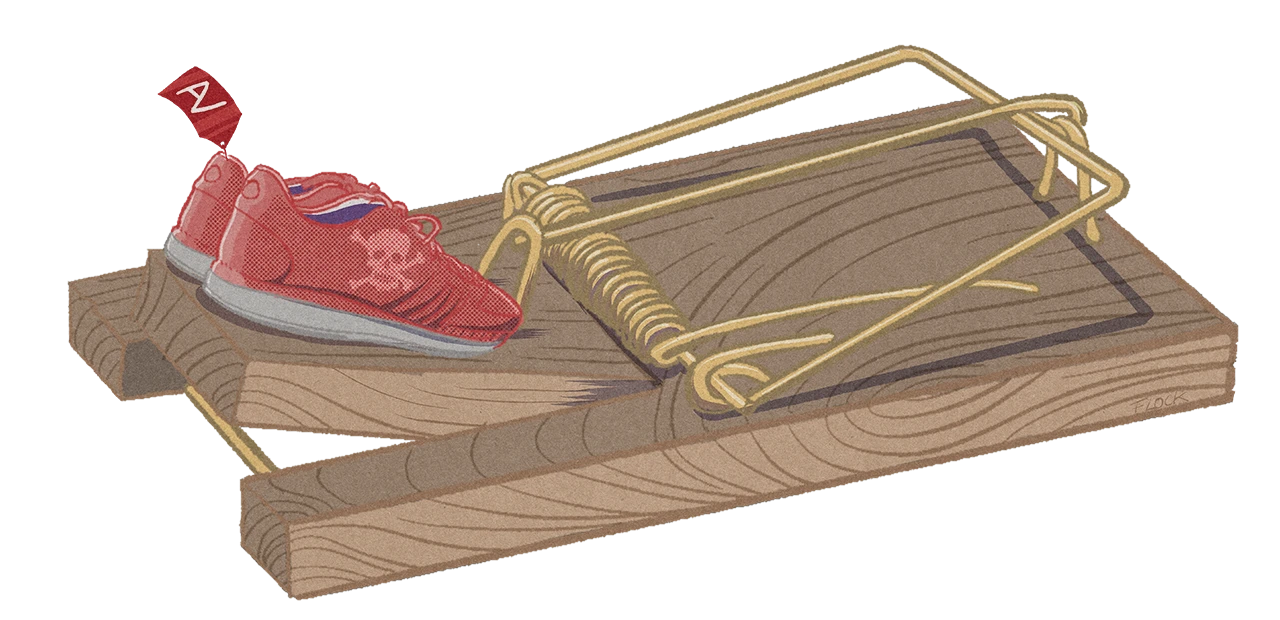
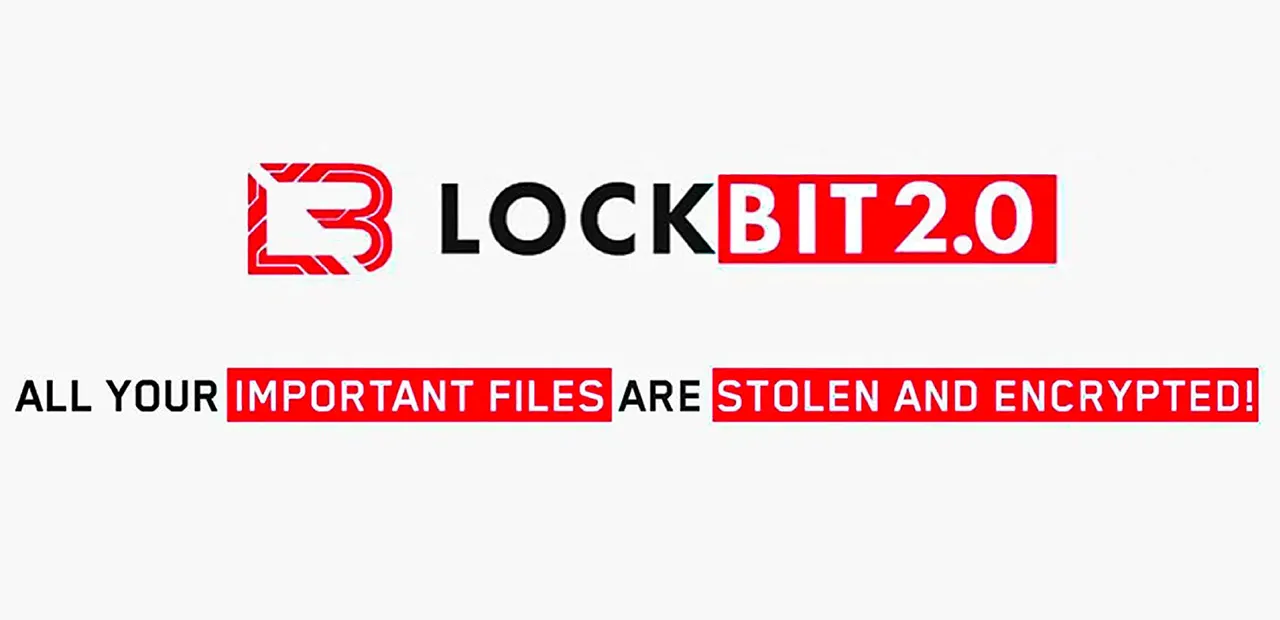
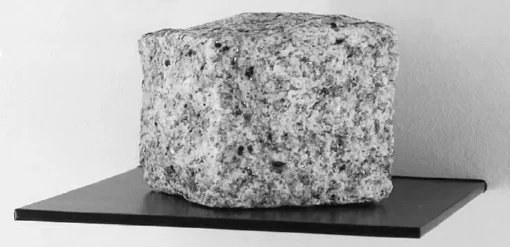





Commentaires (53)
#1
PCi n’a pas obligation de founir des sacs à vomis lorsque Marc poste de telles news ? J’ai pas encore fini de lire que j’ai, aprés plusieurs paragraphes, une méchante nausée !!!
 " />
" />
#2
Quel programme… J’en salive d’avance…
#3
Blocage, contrôle, responsabilité, juridique… Que de beaux termes !
Si on regarde du côté de la réalité aka la vie numérique des internautes ce n’est pas ce dont nous avons besoin.
Ou alors des règlements pour favoriser/imposer la diffusion légale du contenu…
En illustration, une anecdote (en anglais) arrivée aujourd’hui à un musicien blogueur hongrois que je suis un peu.
MUSIC BIZ 2013
here is a little story, yes it happened to me few minutes ago.
I wanted to BUY an MP3 I need pronto. I’ve found it in two giant MP3 stores, one of them is not selling MP3s outside of the US (geobanning), the other one is not selling this particular song in my country and they only sell it in an album bundle (geobanning and stupidity)
I really wanted to buy the song, but I had no chance, however I found it on many illegal download sites after one quick search.
I let you to come up with the moral of the story…
BUT I HAVE TO NAIL DOWN:
#4
Faciliter le blocage et le déréférencement, aux frais de l’État
C’est sûr, c’est totalement prioritaire, surtout que l’on a trop d’argent, hein !
Un an pour arriver à ça, ils feraient mieux des les faire partir en pré-retraite, ça coûterait moins cher aux contribuables.
#5
Génial, et c’est nous qui payerons pour engraisser des entreprises privées. " />
" />
#6
#7
#8
Lol, moi j’ai une solution toute faite, je regarderai plus vos bouses immondes… ni votre musique de *
Comme ca mon temps de cerveau disponible je pourrai l’utilise à autre chose…
Et puis un petit vpn chez iPredator aussi :)
#9
Ils exigent également le déréférencement des moteurs de recherches d’Orange, Microsoft Bing, Yahoo! et Google.
Pardon..
#10
#11
Personne pour coder une appli darknet pour Synology ?
Sinon, je peux passer sous I2P s’ils insistent tant que ça pour nous faire skier…
#12
#13
Et bis répétita….
Encore une fois, on ne va pas écouter les informaticiens, encore une fois on va dépenser beaucoup d’argent pour rien et ils finiront une fois de plus avec la queue entre les jambes.
Quand est ce qu’ils vont comprendre que la seule solution réaliste c’est d’adapter les business models aux nouvelles réalités.
Que de toute manière, les artistes qui ne suivront pas le mouvement du web finiront oubliés et dépassés par ceux qui ont tout compris. (Au hasard, Psy). Car il ne suffit pas d’être vendu, encore faut t’il qu’on vous connaisse.
Le drame avec leurs bêtises, c’est qu’ils perdent un temps précieux et surtout qu’ils font perdre un temps précieux à tous les acteurs français de la nouvelle économie. Car c’est bien beau de dire “les hébergeurs seront responsables”, ce sont des mots. Comme d’habitude, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Quid des conséquences directes et indirectes…
Et quand bien même ils arriveraient à empêcher le direct download et le streaming, ils seront alors confrontés à d’autres types d’échanges beaucoup plus difficiles à contrer. Voir même totalement impossibles à contrer : les échanges directs entre particuliers comme du temps de l’avant internet.
Que proposeront t’ils pour la Hadopi 5 ? Qu’on fouille les enfants à la sortie des écoles ? Des colliers anti piratages pour détecter ce que les gens écoutent ?
#14
#15
Mireille Imbert Quaretta, présidente de la Commission de protection des droits
Augmenter la responsabilité des hébergeurs
Accentuer les armes de la Hadopi sur les intermédiaires (stay down)
Faciliter le blocage et le déréférencement, aux frais de l’État
Annonceurs, régies, organismes de paiement
Politiques, économistes et droit comparé
Comment commenter ça sérieusement ?
Pascal Rogard (SACD) dénonce sur Twitter un « acharnement non thérapeutique. »
a frappé fort mais elle prouve qu’on peut faire pire.
#16
des outils, télévisions connectées et autres, qui permettront le visionnage illégal ou le streaming illégal dans des conditions de confort accru.
Dans le genre aveux “les solutions faite par des amateurs sans perfusion monétaire sont plus mieux que les notre alors que l’on est payé pour” je la trouve jolie.
Bon, si on commence à rendre intelligent les câbles et demander aux extrémités des câbles des choses nécessitant le budget de l’armée américaine, nous sommes en bonne voie pour finir de massacrer l’internet Français. Entre une qualité de connexion qui ne pourrait aller qu’en se dégradant et l’impossibilité au jeunes start-up de se lancer dans de nouveau projet fautes de pouvoir assurer les conditions requise, voila qui nous assure notre continuité dans l’inaptitude de la France à investir les nouvelles technologies…. C’est bien, on est constant en tout cas.
Et si je me rappelle bien, la Hadopi a souvent cité en exemple deezer… mais rappelez moi la légalité de deezer à ses débuts ? De même Dailymotion aurait-il pu voir le jour avec de tel contrainte ? Aurait-il résisté à la puissance de Google et son youtube ? (je sais google à acheter youtube après un certain temps, mais entre temps, ils avaient sorti google vidéo)
#17
#18
Non mais les ayants droits s’embêtent beaucoup trop : interdisons internet on gagnera du temps et de l’argent.
Avec l’interdiction d’internet pu besoin de developper la 4G/5G, ni la fibre optique et encore mieux pu besoin de s’adapter. Bref que des avantages et de toute façon, on sait très bien que il n’y a que des pirates qui utilise internet.
#19
#20
#21
#22
#23
#24
Une petite question sur le Direct Download.
Si le site de présentation du film envoyait vers un hébergeur pour télécharger un fichier qui se nomme xf689cnbw4.zip (nom générique), et que ce fichier était protégé par mot de passe. On peut imaginer plusieurs solutions pour la diffusion des mots de passe… ça rendrait déjà les choses bien plus compliquées pour la Hadopi / Ayants-droit que le système actuel qui ne protège rien et qui consiste à nommer le fichier par le nom du film. Ce qui est pratique pour le référencement, mais pas pour la longévité du lien. J’ai l’impression que rien n’a été mis en place de ce côté-là depuis des années qu’on parle d’Hadopi.
#25
1 an pour ça… et bah ça va les filles ….
#26
#27
#28
mais non, mais non Mr Ouille n’est pas une vieille sorcière qui pue…
#29
Trop long à lire !
 " />
" />
ça parle de quoi au juste ?
#30
Sur les news hadopi, PCI ne pourrait pas avertir que les images sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes ?
 " />
" /> " />
" />
Ma fille en a pour 2 ans de psychothérapie maintenant.
Je sais, pas le physique… mais la, c’est plus fort que moi désolé.
#31
#32
#33
#34
Un truc me turlupine, juste un détail.
Pourquoi a chaque fois préciser l’équivalence des termes en anglais (notice, stay down, take down, ..) ?
Parce que la HADOPI reste une institution francaise avec une portée nationale non ?
Pourquoi les hauts fonctionnaires parlent ils avec des mots anglais qui ont une parfaite équivalence en français ? Je ne pense pas qu’il y ait de mots anglais dans le code civil..
Ces mots ont ils été soufllés comme “axes de recherche” par des avis anglophones bien connus ?Et avec leur manque de compétence dans le domaine ils seraient incapables d’avoir eu une traduction correcte ?
Ok c’est con comme question, mais ça m’a tout de suite marqué. allez savoir dés qu’il s’agit de la HADOPI je me méfie, réflexe…
#35
#36
Stay down, c’est ce que je dis à mon chien.
Le Peuple serait-il un clébard, qu’on doit maintenir couché, et qu’on doit dresser, pas qu’il morde??
Les lois sont-elles faites par le Peuple, ou contre lui?
Parce que tout le monde télécharge!!
Surtout ceux qui aime(raient) aussi acheter.
Je viens de finir Boardwalk Empire s2 en mkv, (par DD,en attendant le coffret BR de la série). ça a fini comment déjà la Prohibition?
Pareil pour Homeland.. Est-ce un devoir civique de combattre les ennemis de l’intérieur?
#37
Vive Radio Caroline, la seule radio où on pouvait apprécier la musique d’un album et des concerts. dommage que je ne n’ai plus retrouvé sa trace (sur les fréquences AM), un bateau mobile sûrement arraisonné " />
" />
 " /> (il fallait être proche de la mer du Nord)
" /> (il fallait être proche de la mer du Nord)  " />
" />
(d’où achat 33 tours, évidemment l’écoute était en mono arrivant par vagues porteuses en AM, c’était le bon temps, il fallait qu’il fasse calme mais pas trop, réception sujette au aléa du temps, tempéré et régulier, c’était bon, variable, une horreur)
#38
#39
#40
#41
Rien de nouveau, mais jolie collection de perles.
Merci de la recapitulation.
Ca montre helas la volonte que l’on a en France - soyons honnetes, pas seulement ici, mais c’est bien gratine quand meme - d’encourager la liberte d’expression et d’innovation.
Voyons deja les resultats de la “mission Lescure”. Ca promet de grands moment.
Ensuite, j’imagine qu’il faudra qu’on pense a reclamer (encore une fois) un grand menage dans leurs institutions, “missions” et autres “autorites” (qui n’en ont aucune).
Et accessoirement, j’espere qu’aucun de ces politiciens ne va venir se plaindre de la perte de confiance du peuple envers la politique. Parce que jusqu’ici, ils ne font pas grand chose pour la retablir.
#42
#43
Faciliter le blocage et le déréférencement, aux frais de l’État
mais bien sûr ! tant qu’on y est pourquoi ne pas créer une taxe blocage streaming pour les beaux yeux de hadopi ?
#44
Superbe boulot de compilation, bravo Marc ! " />
" />
#45
#46
#47
#48
#49
#50
y a pas une extension qui permet de désactiver les images quand une news Hadopi est postée " />
" />
 " />
" />
#51
“Syndicat”.
J’ai l’impression d’être devant un film sur la prohibition ou de réseaux mafieux.
#52
la tourelle pénale de la Hadopi
HAHAHA c’est un char Leclerc l’Hadopi
Pénal le gouvernement n’a que ce mot à la bouche,d’ailleur en parlant de pénal
ou en est l’affaire Tapie-Lagarde, Sarkozy-Kadafi, Woerth-Bethancourt,Cahuzac-comptes à l’étranger etc…..
Ha ce sont des politiques