Le juriste Cédric Manara, professeur de droit à l'EDHEC Business School (LegalEDHEC Research Center), analyse « à chaud » le sujet du blocage des publicités activé par défaut par Free. L’intéressé, qui travaille actuellement à la rédaction d'un livre sur le droit du commerce électronique, nous dresse un panorama des différentes difficultés soulevées par ce sujet dont on découvre aujourd'hui les détails techniques.
Sauf en 2000, il n’y a pas de précédent de Free #AdGate. Que vous inspire juridiquement cette décision ?
C'est vrai qu'on se montre souvent innovant en France pour "bidouiller" internet ! Mais je dirais que la décision de Free de bloquer la publicité par défaut a au moins un parent lointain : aux États-Unis, un fournisseur d'accès avait imposé des publicités à ses abonnés, ce qui avait suscité une class action (Kirch v. Embarq, 2011). Certes la situation ici est inverse, mais elle soulève la même question de fond : le FAI peut-il contrôler l'expérience utilisateur ?
Avant de tenter de répondre, à chaud, à vos questions, je voudrais souligner qu'il est trop tôt pour mesurer entièrement les effets de la mesure annoncée aujourd'hui, et que je ne la connais que par ce qu'a pu en dire la presse depuis qu'elle a été révélée. Il semble en tout cas déjà établi qu'elle affecte tant les utilisateurs de Free que l'ensemble des acteurs d'internet.
Le système de blocage a été activé par défaut. Ce qui signifie qu'en ce moment même, des freenautes naviguent sur internet sans se rendre compte que le service auquel ils se sont abonnés a été modifié. Sur les plus de 2.500.000 abonnés de Free, tous n'ont pas encore connaissance de sa décision, et il n'est pas certain que la société cherche activement à les informer. Au-delà de ce défaut de transparence (qui pourrait être sanctionné pour manquement au devoir d'information dû tant aux consommateurs qu'aux abonnés professionnels de Free), la mesure pourrait flirter avec la pratique commerciale trompeuse. Car elle revient à modifier de manière significative le service fourni aux freenautes : peut-on en effet encore parler de fourniture d'accès à INTERNET quand il y a intervention radicale sur les données qui circulent ? On peut se rappeler, par exemple, qu'il y a quelques années un tribunal avait obligé un FAI à respecter la vitesse de transmission qu'il avait indiquée dans ses documents publicitaires (TGI Paris, 19 octobre 2004). On pourra objecter que la différence est, qu'ici, les internautes ont la possibilité de ne pas souffrir de la mesure prise par leur prestataire, en désactivant l'option de blocage de la publicité.
Mais s'ils ne sont pas ou mal informés de l'existence de cette option, il peut y avoir dissimulation d'une information substantielle au sens de l'article L. 121-1 II du Code de la consommation. Si la désactivation est compliquée à mettre en oeuvre, la sanction peut avoir un autre fondement (des opérateurs téléphoniques ont par exemple été condamnés en France pour les lourdeurs de leur procédure de déverrouillage des téléphones mobiles qu'ils mettaient à disposition).
Supprimer la publicité qui circule sur les réseaux revient-il à modifier significativement le "service internet" ?
Je partirai du postulat que... oui. D'abord parce qu'il n'existe pas un mouvement de masse pour la suppression de la pub en ligne. Il existe des critiques, il y a des internautes qui ont installé un outil de blocage, les boucliers se lèvent quand la publicité devient intrusive... mais on ne peut qu'observer qu'il n'y a pas de mouvement de fond pour bouter la publicité hors de l'internet. À partir de là, je dirai que la publicité fait partie du web.
Je le soutiendrai d'autant plus que la publicité est aussi ce qui permet de faire en sorte qu'existent de très nombreux sites ou applications. Pas seulement les éditeurs qui gagnent de l'argent avec la publicité ou les régies publicitaires, mais les éditeurs de contenus plus modestes qui peuvent ainsi payer les frais d'hébergement, de bande passante ou le renouvellement d'un nom de domaine. Comme l'argent est le nerf de la guerre, la pub est le ventricule de l'internet. Et vue sous cet angle vital, la décision de Free paraît encore plus grave !
Pourquoi plus grave ?
Car elle vise de manière directe les intermédiaires de publicité (ou plutôt certains, j'y reviendrai) et de manière indirecte les éditeurs qui y ont recours pour financer leur activité. La part de marché de Free étant ce qu'elle est, et les revenus dégagés par la publicité en ligne étant florissants en France, l'impact du système de blocage pourrait avoir un impact sévère.
Il s'agit rien moins que de faire blocage à la libre fourniture de services de communication au public en ligne, dont l'importance dans la vie économique et sociale a été soulignée par deux fois déjà par le Conseil Constitutionnel, ou dont la Cour Européenne des Droits de l'Homme a déjà souligné, par deux fois également, qu'ils facilitent la communication de l'information. Les intermédiaires de publicité fournissent un service de communication au public en ligne - un service qui a la particularité d'être limité à une bannière publicitaire ou à un bloc de texte AdSense, mais qui n'entre pas moins dans cette catégorie juridique. En outre, la publicité - aussi curieux que cela puisse paraître à certains - relève de la liberté d'expression. Si dans les faits la mesure de Free avait un effet significatif, elle reviendrait à affecter substantiellement la liberté de communication au public par voie électronique (article 1er de la LCEN) et l'une des modalités d'exercice de la liberté d'expression.
S'ajoute une dimension anticoncurrentielle : les premiers tests semblent indiquer que les services de certains prestataires de publicité sont bloqués par Free mais pas d'autres. Cette discrimination par un FAI majeur peut être à certaines conditions considérée comme un abus de position dominante.
À supposer que cette affaire soit la suite du conflit entre YouTube et Free, stratégiquement, n’y a-t-il pas risque d’embrasement ? Qu’un contrôle parental par exemple soit activé par défaut, etc. ?
À partir du moment où un fournisseur d'accès internet décide de faire du système d'exploitation de ses box, qui est le cœur de son service, une arme de bataille pour la défense de ses intérêts commerciaux, on peut imaginer toutes sortes de scénarios ! Celui que vous envisagez est l'un d'eux, on pourrait craindre pire encore.
La situation est un peu (un peu, car l'analogie à ses limites) celle d'un exploitant d'autoroutes qui refuserait les véhicules sur lesquels il y a de la publicité. Les remorques des camions portant en grand le nom du transporteur, ou les Smart habillées avec un message promotionnel resteraient à la barrière d'entrée. Si on laissait cet exploitant ainsi choisir ce qui doit circuler sur ses infrastructures, ses critères pourraient être toujours plus sélectifs ou abusifs. On interdit le transport d'explosifs sur les autoroutes comme on tolère que les FAI luttent contre les spams ou les malwares. Mais on n'accepterait pas que seuls les tanks ou les top models en cabriolet circulent sur l'A1, et on ne peut admettre que Free édite l'internet pour en dégager une catégorie de contenus.
Merci Cédric Manara.





























Commentaires (521)
#1
Le rôle du fournisseur d’accès a Internet est de fournir un accès à Internet point barre..
On ne demande pas aux sociétés d’Autoroute de laver le pare brise ou de faire la vidange..
#2
À partir du moment où un fournisseur d’accès internet décide de faire du système d’exploitation de ses box, qui est le cœur de son service, une arme de bataille pour la défense de ses intérêts commerciaux, on peut imaginer toutes sortes de scénarios !
Tout est dit
#3
La situation est un peu (un peu, car l’analogie à ses limites) celle d’un exploitant d’autoroutes qui refuserait les véhicules sur lesquels il y a de la publicité. Les remorques des camions portant en grand le nom du transporteur, ou les Smart habillées avec un message promotionnel resteraient à la barrière d’entrée.
Cette image est erroné car dans le cas de la guerre que ce livre Free / Google (car ce n’est que ça) le véhicule publicitaire use et abuse de l’autoroute donc des infrastructures sans payer le moindre centime.
#4
« un FAI peut-il contrôler l’expérience utilisateur ? »
À partir du moment ou il lui propose (et lui laisse le choix de dire non), avant tout activation, oui.
PS : et que les services publicitaires touchés le soient de façon équivalente pour tous, pas seulement pour un acteur particulier.
#5
Un FAI qui contrôle l’expérience utilisateur, qui décide pour l’utilisateur ce qui est bien ou pas, un patron qui essaie de contrôler la presse un petit peu indépendante :http://t.co/WpWLzwX4
 " />
" />
Pas de doute, on parle bien de Free
#6
Pas besoin d’un “expert” pour venir nous dire ça.. les commentaires sur tous les sites web qui traitent de cette info sont très fournis.
[jechipotte]
les internautes ont la possibilité de ne pas souffrir de la mesure prise par leur prestataire
Il faut peser ses mots, souffrir ? Personne ne souffre. Et ce ne sont pas les internautes qui subissent, « Ôh mon Dieu que je souffre de ne plus avoir de publicité ! », pas directement en tout cas, mais d’abord ceux qui tirent leurs revenus de la publicité, à commencer par Google.
[/jechipotte]
#7
LegalEDHEC l’affirme: la pub rend libre.
#8
Faudrait peut etre demander à votre conseil quel est le préjudice subit par l’abonné
Parce que c’est peu clair ici…
#9
La situation est un peu (un peu, car l’analogie à ses limites) celle d’un exploitant d’autoroutes qui refuserait les véhicules sur lesquels il y a de la publicité
Non, il n’y a pas blocage de l’accès aux serveurs, mais changement du DNS. L’analogie serait de changer les panneaux indicateurs “Google Ads” pour envoyer vers une impasse (libre à l’utilisateur d’utiliser son GPS).
#10
#11
En tout cas, ce que cette affaire montre bien, c’est que les journalistes sont tous les mêmes : tous prêts à abandonner leur (supposée) neutralité d’opinion dès qu’on touche à leur portefeuille ou à leurs intérêts.
#12
#13
Posez lui aussi la question des antispams et des antivirus.
 " />
" />
Qu’est ce qui permet à un mailer de supprimer les spams ?
Ah je vous laisse, je viens d’apprendre que Mamadou M’boume de cote d’ivoire me legue tout sa fortune
#14
#15
#16
#17
Déjà ça concerne que la V6 donc on est bien loin des 25000000 abonnés impactés
(Je suis toujours en V5)
Pour ma part, si l’option était activée sur ma freebox, je la désactiverais immédiatement.
Non par ce que j’aime la pub (on en bouffe à en dégueuler sur Internet), mais je préfère et de loin une solution logicielle que je peux contrôler et configurer (j’utilise actuellement AdBlock)
#18
#19
#20
#21
#22
L’analogie avec l’autoroute est foireuse car dans le cas présent les véhicules (les sites) peuvent toujours circuler, mais on leur colle un gros sticker noir pour masquer la pub (comme c’est le cas à la télévision à travers le floutage des marques).
Il n’y a pas de restriction d’accès.
#23
Par contre l’interview a du être réalisé avant que l’on ne constate que Free semble bloquer uniquement les régies publicitaires de google.
J’aurais bien aimé avoir l’analyse d’un juriste si c’était le cas. (distortion de concurrence ?)
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
Excellent l’exemple de l’autoroute, faut aller au bout les gars au lieu de faire des articles que pour défendre votre gagne pain, la pub google.
Si je prend l’autoroute je paye pour circuler non ? que j’ai une pub sur la voiture ou non, et encore plus si j’installe sur cette autoroute des panneaux de pub géant et que je demande même pas à l’autoroute.
Ca ne tient pas votre truc.
Internet et devenu commercial, les règles doivent changer c’est tout, la neutralité c’est juste pour que les OTT se gavent sans rien payer, meme pas leurs impots.
Arretez de vous regarder le nombril mer.de, ce système marche sur la tête, c’est un problème de partage de valeur comme toujours, et c’est pareil pour notre système boursier de mer.de et notre monde tout court.
#34
#35
faudrait peut être aussi parler du pourquoi non ?
nan parce que faut pas être dupe cette option n’est la qu’a cause du différents free/google sur le peering …
est-il normal qu’une entreprise fasse des milliards en ne paye RIEN en retour ??
Google génère un trafic monstre et fait des milliards sur ce trafic, et ce sont les fai qui doivent tout payer ? la question se pose mais peu en parle…
#36
#37
J’aimerais bien connaître la proportion d’hypocrites qui hurlent avec les loups tranquilles derrière leur AdBlock+…. la pub pour les autres, pour faire vivre le net mais surtout pas pour eux…
 " />
" />
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
Mise de coté le parti pris de l’auteur, il y a un manquement relevé par bcp ici dans l’analogie :
La situation est un peu (un peu, car l’analogie à ses limites) celle d’un exploitant d’autoroutes qui refuserait les véhicules sur lesquels il y a de la publicité. Les remorques des camions portant en grand le nom du transporteur, ou les Smart habillées avec un message promotionnel resteraient à la barrière d’entrée. Si on laissait cet exploitant ainsi choisir ce qui doit circuler sur ses infrastructures, ses critères pourraient être toujours plus sélectifs ou abusifs. On interdit le transport d’explosifs sur les autoroutes comme on tolère que les FAI luttent contre les spams ou les malwares. Mais on n’accepterait pas que seuls les tanks ou les top models en cabriolet circulent sur l’A1, et on ne peut admettre que Free édite l’internet pour en dégager une catégorie de contenus.
> ajouter le fait que les dits véhicules publicitaires usaient prématurément et quotidiennement l’asphalte et étaient les principales sources de bouchons, gênant ainsi à leur dépend, les autres usagers.
#47
#48
#49
#50
#51
.. pendant ce temps l’option de filtrage est desactivable … mais ça on l’oubli vite.
Le probleme de fond c’est l’etat de l’option par defaut, pas la possibilité de filtrage vu qu’elle est optionnel.
par defaut le tracking est activé sur les site equipé de ADsense ou autre, ca ne gene personne. Pourquoi on ne mettrait pas sur chaque site equipé de tracking une option pour l’activer ou non?
Pourquoi ne pas deja juste informer les utilisateur quand un site est equipé de tracking?
Je n’ai a ma connaissance jamais vu de site qui nous met une note d’info lors de la premier visite disant “Notre site utilise le tracking Adsense(ou autre), votre activité sera utilisé pour vous proposer de la publicite ciblée”. Alros ne parlon meme pas de l’idée d’un site qui nous dirait “Vous pouvez desactiver notre tracking dans vos preferences”
encore une fois on vois bien que les pratiques choquent dans un sens mais pas dans l’autre. Et comme par hasard de quel coté sont ces pratique … du coté du pognon.
#52
Et des camions qui roulent à 70 et qui s’amusent à se dépasser à tour de rôle pour ralentir la circulation (alors que la justice ne fait rien depuis des mois parce que ce sont des camions étrangers) " />
" />
#53
#54
Le gars a perdu toute crédibilité lorsqu’il utilise une analogie routière…
Tout expert digne de ce nom sait que c’est un retour de baton dans les dents garanti à 100%
De nombreux commentaires ci-dessus confirment mes dires.
D’ailleurs les experts… y’a qu’à la télé qu’ils sont forts…
#55
Blocage des pubs : Xavier Niel confirme à demi mot la guerre d’usure avec Google
http://www.universfreebox.com/article19259.html
#56
#57
#58
Certains n’oublient-ils pas un peu vite qu’Internet est un outil de communication où il est possible de faire du commerce, et pas un outil de commerçants pouvant éventuellement servir à communiquer ?
#59
#60
#61
#62
#63
en même temps les ordi, tel portables sont a de rares exception près, fournis avec des appli pré installées (et que même parfois on ne peut pas désinstaller a moins de rooter) et là on ne voit pas Fleur Pellerin monter au créneau …
#64
#65
#66
A la vue des commentaires on peut en conclure que Google “possède” énormément de sites internet.
 " />
" />
Vu qu’ils ne survivraient que grâce à Google et à sa pub?
Il n’existe pas autre chose que Google et les abonnements type Premium pour faire vivre un site internet?
#67
#68
#69
#70
#71
#72
De plus en plus MDR, c’est génial…
 " />
" />
Bon, au-delà de la décision unilatérale de Free et de l’implémentation “en amont” (dans la box) qui pose forcément problème, le vrai sujet n’est-il pas tout simplement la place de la pub sur le net et son omnipotence qui serait peut-être à revoir ?
Comme j’ai déjà détaillé un avis perso sur la question, je me contenterai de revenir uniquement sur ce paradoxe qui au fil des discussions sur le sujet devient de plus en plus burlesque : les plus opposés aux “grosses machineries américaines” et à tous les travers de l’économie de marché, les plus libertaires et attachés au libre arbitre absolus en sont venus à vénérer le dieu Google et toutes ses progénitures (régies et autres), aux pratiques de tracking acérées, et en résumé à toutes les boites qui représentent pourtant trait pour trait le pire de ce qu’ils combattent
La vraie question n’est elle pas : ne serait-il pas temps de remettre en question l’unicité du modèle économique, plutôt que de continuer à s’assujettir volontairement, toujours plus, et à céder aux contraintes de la page vue, du real time bidding et du CPM ?
Au minimum, la démarche très rustre et pas très heureuse de Free pourrait au moins servir à ça…
#73
#74
Personne ne s’étonne de la relation faite par cet expert :
 " />
" />
pub == liberté d’expression
et point barre.
Trop gros, même pour un vendredi !
Hallucinant tous ces gens qui ne voient dans la pub leur seul salut !
#75
J’imagine l’avenir :
Pour visualiser la vidéo youtube que vous avez sélectionné, veuillez saisir le captcha qui se trouve dans la publicité en haut de la fenêtre, pour prouver que vous avez bien visualisé notre publicité.
#76
Les télés gèrent la pub, pas les séries,documentaire,et autre producteur de contenus, non ?
Qu’un FAI fait remplace toutes les pubs par les leurs ou les enlève complètement, c’est juste le modèle marchand par excellence, le minitel 2.0 à la “App Store”.
Donc ce n’est pas une première, et encore moins qu’on le croit, puisque ça revient au concept plus large de “pillage de contenu” par des intermédiaires.
(majors, trust médiatiques, grande distribution, etc.)
Celui qui produit reçoit pas grand chose du pactole, et le pillage rapporte gros.
Tous les sites internet qui reprennent intégralement d’autre sources ? En les citant parfois, mais rarement en ajoutant de la valeur…
Je crois qu’une telle liste concernerait pas mal de sites internet.
C’est donc encore une fois auteurs, producteurs, distributeurs et autre intermédiaires, consommateurs qui devraient être réunis, et sortir de cette fausse logique de “offre et la demande” quand beaucoup d’autre critères (monopole, lobbying, facilité, puissance financière/médiatique) faussent le jeu.
Pour la neutralité des FAIs, il y a : Orange et Wikipedia:http://www.numerama.com/magazine/22182-contribuer-a-wikipedia-c-est-aussi-enrich…
#77
#78
C’est toujours le même principe pour faire accepter que les FAIs décident à la place des utilisateurs ce qui est bon ou pas pour eux on les séduits au départs par des idées “ouhaaaa quelle est géniale cette idée ce truc super machin “..
Bloquer ‘d’office’ la pub sans le consentement de l’utilisateur c’est un peu comme si une ‘bimbo venait à faire une fellation sans demander l’avis du concerner , difficile d’aller contre…
Mais dans quelques temps à force de laisser faire ce genre de chose c’est plutôt le tronc d’arbre de Mr Jean-Pierre qu’on nous mettra dans le fion sans notre consentement
#79
#80
#81
C’est amusant de constater que le blocage de la pub fait réagir (à demi-raison, c’est pas le souci) la totalité de la presse en ligne, alors qu’Orange avec son fabuleux slogan “Internet, by Orange” n’a pas fait sourciller un seul membre de cette génération spontanée de défenseur de la neutralité du net…
Alors que, à mon sens, l’approche d’Orange est bien plus pernicieuse et clairement orientée sur le contrôle des usages et du contenu présenté à l’utilisateur (là où Free, écluse de la bouse qui n’interesse personne - mais génère de l’argent, on est d’accord-)…
J’aurais aimé que ces mêmes nouveaux preux chevalier défendent avec la même vigueur, notre vie privée et s’oppose au tracking (aka espionnage) permanent auquel se livrent les google analytics et autre facebook (“J’aime”…. ou pas)… Mais difficile de défendre cette cause, quand on a livré ses utilisateurs à ces régies de pubs en échange de quelques deniers (enfin sauf pour face book, jà, ils le font gratuitement.. va comprendre)…
#82
#83
quand je vois le protectionnisme de certain face a la PUB , je me dit que tous ces film iRobot/Starshiptrooper/BladeRunner/IA/Retourvers le futur/WallE etc .. vont finir par devenir des predictions. On s’en doutait, mais je ne pensais pas que cet avenir aurait pus venir de la vonlonté meme des gens a vouloir devenir dependant de la Pub.
#84
#85
#86
Free se trompe dans sa guerre avec Google. Ce n’est pas aux fournisseurs de contenus de payer l’infrastructure. Ils rétribuent déjà les FAI en créant le contenu qui fait que les gens veulent un accès à Internet.
Sans Google et compagnie, les FAI auraient moins de clients.
#87
Finalement pas trop mécontent d’être avec l’agrume avec mon propre modem utilisant les openDNS moi …
 " />
" />
Ca me met a l’abris de certaines choses
#88
#89
#90
#91
#92
#93
Il ne manquait plus que l’interview …. Assez marrante au passage.
PCI, ne tombez pas dans la facilité journalistique.
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
#101
#102
#103
Moi ce qui m’intéresserai de savoir, c’est : sachant que j’ai fais une migration Free -> OVH mardi soir, est-ce que je peux prétexter cette affaire pour ne pas payer les frais de résiliation? " />
" />
#104
Tiens une réaction de B.Bayard
http://blog.fdn.fr/?post/2013/01/03/Free-porte-t-il-atteinte-a-la-neutralite-du-…
#105
#106
#107
D’ou ce vieille adage:
 " />
" />
Avec Free, t’as rien compris
#108
Supprimer la publicité qui circule sur les réseaux revient-il à modifier significativement le “service internet” ?
Je partirai du postulat que… oui.
Je ne connais pas grand monde qui viens sur Internet pour regarder les encarts de pubs inclus dans les sites webs. Tout comme je ne connais pas grand monde qui soit allé voir The Hobbit pour les pubs M&Ms.
Non, la publicité ne participe pas à l’expérience internet que recherche un utilisateur. Par contre, c’est une terrible épée de Damocles au dessus des sites webs qui ont battis leur business-model sur la rémunération des regies pubs.
#109
#110
#111
#112
J’ai testé … j’ai pas vue de différence sur les sites que je visites :s Toujours les quelques bannières habituelle. J’ai raté un truc ?
#113
#114
#115
J’ai lu quelque par que ceux qui utilisaient AB, ce sont des pirates " />
" />
#116
#117
Mais on parle de la pub là … " /> !!!
" /> !!!
Je comprend pas pourquoi de telles levées de bouclier…
Comment arriver à défendre la PUB???
A part les sites qui ont construit leurs revenus dessus (belle idée …) qui en a besoin, aucun consommateur/utilisateur n’a besoin de pub. D’autant qu’elles ne sont pas neutres ces pubs, alors dire qu’on banni la neutralité du net en éliminant des pubs ciblées, c’est n’importe quoi.
Par contre, pour le concept de blocage en amont de l’utilisateur, c’est à débattre oui, mais là, quand même… la pub c’est vraiment pénible un point c’est tout.
#118
#119
#120
#121
#122
débat stérile (4 news: 500, 300, 130 et 130 commentaires) entre ceux qui prennent leur argent sur internet avec la pub et les utilisateurs. C’est une situation gagnant-perdant où chacun essaye de défendre son parti pris.
#123
#124
#125
#126
#127
#128
#129
#130
#131
#132
#133
#134
#135
#136
#137
#138
#139
#140
#141
#142
En enlevant la pub le prestataire ne contrôle pas l’expérience utilisateur, il l’améliore. Point.
Toute amélioration est bonne à prendre.
Sinon vous savez que tout site qui créé un cookie a l’obligation légale d’en avertir l’utilisateur ? Vous avez déjà vu cette obligation quelque part ? Pourquoi défendre des gens qui violent la loi pour revendre nos donnée ?
#143
#144
#145
#146
#147
Pourtant, on voit bien d’autres choses plus choquantes liées à la publicité sur le net. Un exemple tout bête : Wikipédia est un site sans aucune publicité (pour des raisons évidentes de neutralité). J’utilise un mobile Orange, avec un forfait très basique. Si j’essaye d’aller sur Wikipédia depuis mon mobile en passant par le réseau 3G, quoique je fasse, j’atteris sur… ça ! Orange ne se gène pas pour ajouter des publicités et détourner le trafic d’un site fortement consulté vers son propre miroir, modifié. Et personne ne s’en plaint…
#148
Ce que dit ce juriste ne change rien à mon point de vue ((Clic !).
Actuellement, l’internaute n’a pas d’autre choix que de subir par défaut la pub.
Free propose au moins une alternative en activant par défaut la suppression des pub comme l’a conseillé la CNIL.
On inverse la tendance et c’est tant mieux !
#149
#150
#151
#152
#153
#154
#155
#156
#157
#158
#159
#160
#161
C’est clair vous avez trop raison!!
Publicité = Neutralité
Publicité = Liberté
Publicité = Qualité
Publicité = Droit
Vive la publicité sur Internet! Pourvu que quelqu’un ne me permette pas de l’enlever pas, car ça voudrait dire qu’il pourrait censurer ce que je vois. De quelle droit ferait il ça? Surtout que s’il fait ça, c’est certain, l’étape suivante, il choisira ce qui est bon pour moi ou pas et que, du coup, je pourrai rien dire, puisque j’aurai accepté qu’il m’enlève la publicité par défaut.
J’ai le droit de mater de la publicité c’est tout. D’ailleurs je vais souscrire à toutes les newsletters des partenaires maintenant ! ‘enfin, je décocherai plus la case qui est l’est automatiquement)
Avant je supportais pas me taper 50 secondes de pub avant une vidéo, ou les pops ups qui s’ouvrent plein fer, le bouton Fermer à moitié transparent, le bouton Skip en police 4 jaune clair sur fond blanc et le son qui gueule “Achete mes produits” dans le 13eme onglet, tout en bas de la page, sur un de mes 24 onglets ouverts, les cases précochées, les mots surlignés dans les articles qui ouvrent une bulle qui disparait jamais, etc…
Grâce à vous je saurai que accepter cela, c’est sauvé internet, les petits sites et la neutralité du réseau. D’ailleurs, je suis tellement pour la neutralité que je vais me renseigner sur la naturalisation Suisse.
Et évidemment, pour bien signifier mon mécontentement, au lieu de simplement désactiver le blocage proposé par mon opérateur qui me laisse le choix, je vais partir chez un opérateur qui ne propose pas ce choix et qui rajoute de la publicité sur les sites qui n’en ont pas.
Merci, c’est cool!!!
Pendant ce temps, pour n’importe quel mec qui se balance des problématiques de neutralité du réseau :
“Bonjour, je viens souscrire à un abonnement ADSL”.
-“Vous voulez le net avec publicité ou sans publicité?”
-“Sans pub c’est plus cher?”
-“euh non”
-“ben sans pubs alors, mais chuuuuuuuuutttttt! je suis Suisse”
#162
#163
Mais il n’est même pas question de responsabilité. Les mises à jour de la Freebox sont automatiques et Free ne fait pas de communication directe à leurs utilisateurs sur les mises à jour (par mail par exemple). Ils publient un changelog sur leur site et ça s’arrête là.
Clairement, quelqu’un qui était en vacances, n’aura pas suivi l’affaire et qui revient dans une semaine va se retrouver avec un service activé par défaut qu’il n’aura pas demandé et ne sera pas au courant… et se retrouvera avec l’Internet by Free.
#164
#165
#166
#167
Je veux pas foutre la merde, mais “Professeur de Droit” est un titre pour les agrégés, sinon, c’est aussi du marketing.
Pour la question de la publicité “Liberté d’expression”, il ne faut pas pousser l’interprétation de Cass. civ. 1ère 14/11/2006 trop loin. La reconnaissance de la liberté est celle de la création, du message du contenu, et pas d’une liberté fondamentale faisant de la publicité un droit absolu.
On peut tout au plus l’approcher de la liberté d’entreprendre, mais l’affirmation “En outre, la publicité - aussi curieux que cela puisse paraître à certains - relève de la liberté d’expression. Si dans les faits la mesure de Free avait un effet significatif, elle reviendrait à affecter substantiellement la liberté de communication au public par voie électronique (article 1er de la LCEN) et l’une des modalités d’exercice de la liberté d’expression.” me parait au mieux peu justifiée, sinon totalement à côté de la plaque…
La question ici n’est pas “qui contrôle le message”, mais “qui parasite le modèle économique de l’autre”. Et pour reprendre l’image de l’autoroute, et des partenariats publics-privés qui peuvent aussi coller à certains aspects de l’Internet, qui paie la dîme pour entretenir les infrastructures ? Curieusement, je connais aucune régie publicitaire qui investisse en infrastructures…
#168
#169
#170
#171
#172
#173
#174
#175
#176
#177
#178
#179
#180
#181
#182
#183
#184
#185
#186
#187
#188
#189
#190
#191
#192
#193
#194
#195
#196
#197
#198
#199
#200
#201
#202
#203
#204
#205
#206
#207
#208
#209
#210
pour une fois que je suis d’accord avec Free !!!!!
Bravo, marre de ces geants voyous qui se goinffrent depuis des paradis fiscaux et ne contribuent en rien aux infrastrctures !!!
#211
#212
#213
#214
#215
Sans aucun jugement de valeur, pour moi cela revient à une forme de censure.
#216
#217
#218
#219
#220
#221
Bon …
 " />
" />
L’exemple de l’autoroute est non seulement foireux, il est faux.
Ici, la société d’autouroute n’interdit pas la pub sur les véhicule. À aucun moment.
Que fait-elle ?
Lorsqu’on entre sur l’autoroute, elle active un mécanisme sur chaque usager qui permet à chaque usager de ne pas voir la pub éventuelles des autres usagers. À aucun moment elle n’interdit la pub sur les véhicule.
Ceci est un service, il peut être désactiver si on le souhaite.
Free, que je sache, ne bloque pas la pub en amont. Il propose un service sur chaque box, donc pour chaque abonné. Ce service peut être désactivé.
Free n’intervient pas sur le contenu, il propose un service optionel qui est de bloquer un certain type de contenu.
Là où on peut critiquer Free, c’est sur le manque d’information pour activer/désactiver ce service.
Là où on peut critiquer Free c’est sur l’ouverture de ce type d’option à tout va et pour lesquels, à terme, on pourrait avoir des tarifs d’abonnement différent. Auquel cas il y a aurait effectivement atteinte à la neutralité.
Ça, c’est le premier point.
Le second point maintenant :
Ceux qui mettent de la pub sur leurs sites ont-ils pensé aux visiteurs ? Que leurs visiteurs sont traqués, tracaés, analysés, etc ?
À aucun moment les metteurs de pub sur un site demandent au visiteur : ce site a un coût, la pub permet de le financer. Voulez-vous afficher les pubs ou non ? Si non, on peut imaginer toute sortes de contreparties (moins de contenus, abonnements, contributions, etc)
Non, on pousse des cris parce que Free active un service qui limite l’affichage de la pub, mais pour le reste, on se la joue à la Ponce Pilate …
Mes sites, il n’y a aucune pub. Je paie de ma poche pour ceux qui proposent du contenu, d’autres sont financés par les services que je propose. D’autres options sont envisageables selon les types de site, je présume.
Si on fait du web marchand pur, faut pas se moquer, c’est pas la pub qui finance le site, c’est le commerce qu’on y fait (ou alors y a un problème quelque part …).
PCi a eu l’intelligence de réfléchir à une formule vis à vis de la pub. Son modèle n’est surement pas la seule alternative possible et peut-être faudra-t’il aussi revoir cette formule à l’avenir.
#222
#223
#224
#225
#226
#227
#228
#229
#230
ça sent le procès tout ça.. " /> et les dommages intérêt à plus de 7 chiffres..
" /> et les dommages intérêt à plus de 7 chiffres..
Sérieusement Free risque d’initier un mouvement de fond chez les autres FAI et c’est la mort assuré pour des milliers de petits sites d’info, et fatalement un bon retour aux années 80, avec quelques groupes de presse qui possèdent toute l’information..
Cette mesure ravira les “free riders” mais à long terme c’est tout les français qui trinquerons car beaucoup d’emploi vont disparaitre..
#231
#232
#233
#234
La situation est un peu (un peu, car l’analogie à ses limites) celle d’un exploitant d’autoroutes qui refuserait les véhicules sur lesquels il y a de la publicité. Les remorques des camions portant en grand le nom du transporteur, ou les Smart habillées avec un message promotionnel resteraient à la barrière d’entrée. Si on laissait cet exploitant ainsi choisir ce qui doit circuler sur ses infrastructures, ses critères pourraient être toujours plus sélectifs ou abusifs. On interdit le transport d’explosifs sur les autoroutes comme on tolère que les FAI luttent contre les spams ou les malwares. Mais on n’accepterait pas que seuls les tanks ou les top models en cabriolet circulent sur l’A1, et on ne peut admettre que Free édite l’internet pour en dégager une catégorie de contenus.
C’est sur que cette analogie a ses limites. Carrément bidon même, tellement elle est peu réaliste, extrême et sans intérêt.
Quant à cette histoire, arrêtons de prendre les gens pour des idiots finis qu’on ne peut laisser à eux mêmes. Arrêtons l’infantilisation.
Le but de Free c’est de faire une offre en phase avec ses clients, de les satisfaire. Ils ont estimés que leurs clients n’aiment pas la pub, ils proposent de la filtrer par défaut.
Ce système viole-t-il le contrat avec le client ?
Free a-t-il informé ses clients des changements ?
Où donc est le problème ?
#235
#236
#237
#238
#239
#240
#241
#242
#243
#244
#245
#246
#247
#248
#249
#250
#251
#252
#253
#254
#255
#256
#257
#258
#259
Ça va faire 1500 commentaires sur le sujet, et visiblement, personne ne sera jamais d’accord.
 " />
" />
Ce qui est sûr, c’est que les pubs Free ont, elles, bien atteints leurs cibles
#260
#261
#262
#263
#264
#265
#266
#267
#268
#269
#270
#271
#272
#273
#274
#275
#276
#277
#278
#279
#280
#281
#282
#283
#284
#285
#286
Je ne sais pas comment c’est implémenté, mais je vois deux pistes :
Dans tous les cas ça me gêne.
#287
#288
#289
#290
#291
#292
#293
#294
#295
#296
#297
#298
#299
#300
#301
#302
#303
#304
#305
#306
#307
#308
#309
#310
#311
#312
#313
#314
#315
#316
#317
#318
#319
#320
#321
#322
#323
#324
#325
#326
#327
#328
#329
#330
#331
#332
Free ne bloque pas la pub, Free bloque Google soit le leader en matière de CPC et, dans un sens, celui proposant la publicité la moins intrusive. Si vous pensez que la pub sur le web se limite aux quelques bannières et adwords que vous croisez à droite et à gauche, ma foi…
#333
#334
#335
#336
#337
#338
#339
#340
#341
#342
#343
#344
#345
#346
#347
#348
#349
#350
#351
#352
Bloquer la publicité, c’est mal. La publicité nourrit les gens qui fournissent votre contenu internet gratuit. Si vous bloquez la publicité, alors PAYEZ-LES CES GENS!
Limpide.
#353
#354
#355
#356
#357
#358
#359
En résumé :
#360
#361
#362
#363
#364
#365
#366
#367
#368
#369
#370
#371
#372
#373
#374
#375
#376
#377
#378
#379
#380
#381
#382
#383
#384
#385
#386
#387
#388
#389
#390
#391
#392
#393
C’est quand même drôle ce 2 poids 2 mesures :
 " />
" />
 " />
" />
 " />
" />
Les mêmes qui nous rabâchaient y a pas longtemps, que Google n’a qu’à déréferencer la presse, ou qu’il a le droit de favoriser ses services sur Google search car c’est son moteur après tout, que ceux à qui ça ne plait pas aillent voir ailleurs, vont aujourd’hui nous dire que Free n’a pas le droit de bloquer le tracking par défaut de google sur sa box ..
Idem, c’est aussi très drôle, la manière dont la pub est devenue et indispensable d’un coup sur un site où on aimait pourtant faire allusion aux Paroles de Patrick Le Lay (TF1)
à savoir :
du temps de cerveau humain disponible!
“ …Ce que nous vendons à Coca-Cola, c?est du temps de cerveau humain disponible (…). Rien n?est plus difficile que d?obtenir cette disponibilité…”
Décidément la logique de certains dépasse l’entendement
#394
#395
#396
#397
#398
#399
#400
#401
J’ai hâte de voir l’adaptation des régies pubs…
Première solution qui me vient à l’esprit : le serveur fait un appel au serveur de la régie pub contenant les données d’execution ($_SERVER) et de requêtes, voir plus, et ajoute la réponse de l’appel au rendu html du client. Un robot qui tourne pour vérifier qu’il y a pas e magouille et roule !
Au lieu d’avoir une ligne à coller dans un fichier HTML on l’aura dans un fichier PHP….
Par contre du coup ça va commencer à donner vraiment BEAUCOUP d’infos aux annonceurs, bien plus qu’ils n’en avaient jusqu’à maintenant….
#402
#403
#404
#405
#406
#407
#408
#409
#410
#411
#412
#413
#414
#415
#416
#417
#418
#419
#420
#421
#422
#423
#424
#425
#426
#427
#428
#429
#430
#431
#432
#433
#434
#435
#436
#437
Je trouve ça bien que ce soit activé par défaut en beta… Si ça peux permettre a beaucoup de personnes étrangères aux adblockers de découvrir internet sans pub, c’est une bonne nouvelle. Ils feront leur choix quand l’option sera désactivé par défaut.
 " />
" />
 " />
" />
Et puis ça me fait marrer de voir tous ces sites d’info s’indigner la-dessus alors qu’il ont la même réaction que les majors qu’il aiment tant critiquer: Ça a même fait la une sur le huffington post
L’argent rendrait-il schizophrene?
#438
#439
#440
#441
#442
#443
#444
#445
#446
#447
#448
#449
#450
#451
#452
#453
#454
#455
#456
#457
Dans une nette majorité, je n’ai pas vu les internautes exprimer leur déception, mais plutôt leur joie. Les geeks crient quant à eux au filtrage liberticide (la liberté d’être traqué et abruti par le capitalisme), et les éditeurs de sites à la mort de leur modèle économique (les mêmes qui écrivent régulièrement leur regret que les majors n’aient pas su s’adapter au web).
Pourquoi les journaux ne parlent-ils pas de la majorité des internautes, les familles lambda, qui doivent être ravies de ne plus voir leur ordinateur ralenti et seraient mécontentes si le blocage était levé ? Pourquoi ne rappelent-ils pas la domination dangereuse de Google sur le monde électronique ? Pourquoi n’expliquent-ils pas que la perte de revenus qui affole tant les webmasters trahit directement leur dépendance à cette entreprise qui nous vend tout ce quelle peut sans payer sa part ni en impots ni en bande passante ?
Pourquoi ne profitent-ils pas de ce débat pour proposer plus de liberté aux internautes, en leur laissant le choix entre un site infesté de pubs et le paiement de quelques Euros par an pour le consulter en toute quiétude (visiteurs réguliers appréciant leur travail) ? Dans ce débat, je dirais qu’il faut compenser l’absence de pubs par le montant que ces visiteurs auraient rapporté (ca marcherait probablement moins si les sites en profitaient pour gonfler les prix).
#458
#459
#460
#461
#462
#463
#464
#465
#466
#467
#468
#469
#470
#471
#472
#473
#474
#475
#476
#477
#478
#479
#480
doublon sorry…
#481
#482
C’est marrant. Que les internautes soient les otages des régies de pub, ma foi, c’est certes pas très bien mais bon, c’est un mal nécessaire …. " />
" />
#483
La publicité est la perversion de l’économie
l’Homme a des besoins, il cherche à obtenir ce qu’il désire
l’Homme offre ses services pour obtenir des crédits qui permettent d’acheter ce dont l’Homme a besoin
l’Homme vit en société, régie par des droits et des constitutions, tant mieux !
Ainsi, l’Homme qui n’a rien à offrir peut survivre dans notre monde.
Mais complexifier le système avec la publicité pollue les 5 sens
et je suis sûr que j’oublie des tas de stratagèmes de publicitaires pour forcer les braves gens facilement manipulables à se surendetter pour avoir l’illusion du bonheur mais que la publicité rend éternellement insatisfaits, c’est un cercle vicieux…
#484
Ca marche aussi avec Bing, Twitter, Facebook, ou n’importe quel intermédiaire autour duquel a été construit un business-model. Faut accepter les limitations du modèle et faire avec: financement alternatif, contournement du blocage, accords commerciaux, …
Pour ma part, je pense que le problème actuel est surtout “technique”. A force d’abuser du lien URL externe vers une régie pub, on finit par bloquer toute la régie pub quelque soit le site.
Quand chaque site gérera l’intégralité de son contenu (pub comprise), le problème disparaitra. Mais, curieusement, les regies pubs préfèrent se passer d’intermédiaire technique.
#485
#486
Euh… D’après vous Google fait quoi (plutôt “veut” faire quoi) avec sa Google box ou les TV connectées ?
Le but non avoué de la démarche est bien la pub ciblée donc qui remplace la pub généraliste.
Pourquoi donc faire un procès à Free, qui innove en la matière, crée des emplois et concurrence une multinationale multimilliardaire ? Le procédé des pubs ciblées est ignoble, certe mais malheureusement c’est l’avenir sur nos écrans.
#487
un FAI peut-il contrôler l’expérience utilisateur?
 " />
" />
Titre racoleur.
Un moteur de recherche peut-il contrôler l’expérience utilisateur? (avec son classement de site, le fait qu’il soit soumis aux lois du pays ou sont situés les serveurs?)
Le systeme de cookie utilisé pour faire de la publicité ciblé c’est pas une intrusion dans la vie privé? (je parle pour madame michu qui sait cuisiner les cookie mais pas les desactiver)
La pub sur internet on peut la justifier, mais le manque d’ethique evident des principaux acteurs me pousse a revoir cette position.
Ad sense? j’en veux pas! Merci Free
#488
#489
Il y a une erreur dans le sujet, il n’y a pas 2.500.000 qui ont une Freebox V6.
Donc, il n’y a pas 2.500.000 qui ont le bloqueur de pubs
#490
#491
La situation est un peu (un peu, car l’analogie à ses limites) celle d’un exploitant d’autoroutes qui refuserait les véhicules sur lesquels il y a de la publicité
où l’entrée d’un supermarché avec le sachet d’un concurrent
#492
#493
#494
#495
Excellent article, n’en déplaisent à quelques pisse-froids. " />
" />
#496
hypocrisie nous voila.
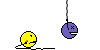 " />
" />
a lire les réactions sur les sites web parlant de l’action de FREE, je ni vois que de l’hypocrisie.
on nous sort des emplois qui vont disparaitre , des sites en difficultés , des revenues en moins pour les personnes travaillant dans le secteur de l’internet…ect…ect
beaucoup de FREEnautes non pas la box v6 , donc l’impact de cette fonction est faible voir nul sur le taux d’affichage des pub sur les pages web.
beaucoup d’internautes en revanche utilise des ad-dons de navigateurs capable de filtré les pubs, pop up et autre merveilleuse fenêtre contenant ou pas soit des spywares qui vont s’installer discrètement sur votre machine et envoyer a qui de droit des renseignements sur votre personne en fonction des fichiers personnel trouver , soit des “bestioles” qui elles vous infligerons autre chose que de la pub pour une paire de chaussure .
la démarche de FREE est certes maladroite mais est la pour tiré la sonnette d’alarme et provoque une discussion pour la remise en question sur le fonctionnement du net qui de partage a l’origine qu’elle qu’il soit est devenu commercial au détriment des internautes .
beaucoup de site utilisent vos donnez personnel a des fin commercial , soit elle vous avertissent avant et vous demande l’autorisation de le faire , soit elles le font dans votre dos et s’enrichissent sur votre personne sans pour autant dans les deux cas vous verser quoi que ce soit en échange.
alors crier au scandale en ce laissant dépouiller de vos donnés personnel par ces mêmes publicitaires…..
#497
#498
#499
#500
#501
#502
#503
#504
#505
#506
#507
écoutez BFM Radio ils ont la solution. Fin de la neutralité !!!!
#508
#509
#510
#511
#512
#513
#514
#515
#516
#517
#518