Dans le bras de fer entre éditeurs de presse et Google, l'Autorité de la Concurrence impose au moteur une série d'obligations. Autant de mesures conservatoires, en attendant la décision au fond. Explications des 72 pages de la décision.
Le ministre de la Culture « salue la décision rendue par l’Autorité de la concurrence concernant l’application de la loi sur le droit voisin par Google, qui est sans ambiguïté ». Voilà l’une des premières réactions de Franck Riester suite à la publication de la décision de l’autorité relative à la loi sur les droits voisins qu’avait écarté Google d’un claquement de doigts.
« Bien que voté, certains voulaient que ce droit reste lettre morte. Ils se sont trompés. J'engage tous les acteurs à commencer au plus vite les négociations. Ceux qui utilisent les contenus d’information doivent les rémunérer. Sans cela, il n'est pas de production d’information durable et donc pas de démocratie durable ».
Le ministre assure que « conformément aux injonctions de l’Autorité de la concurrence, il revient désormais à Google de proposer aux éditeurs une juste rémunération, à la hauteur de la valeur que le moteur de recherche retire des contenus d’information ». Mais que s’est-il passé ? Plongeons dans les 72 pages de la décision et d’abord sur son historique.
La loi sur les droits voisins entre en application, et c’est le drame
La loi sur les droits voisins est venue transposer en France l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur. Il consacre la possibilité de faire payer les sites commerciaux qui reprennent les extraits de presse au profit des éditeurs et des agences.
Seulement, alors que tous attendaient un pont d’or, Google a pris une décision pour le moins radicale : désactiver l’affichage de ces extraits sur le moteur, la page actualité, et toutes les autres ramifications de son empire. Une désactivation toute relative : les éditeurs ont pu depuis continuer à faire afficher leurs extraits, mais gratuitement. Cela s’est orchestré par le biais de balises max-snippet, max-video-preview et max-image-preview (notre actualité).
La décision avait évidemment suscité une vague d’indignation. Tous les éditeurs considéraient que Google devait reprendre les extraits, et donc payer. « Vous êtes l’objet d’une menace, d’un chantage, celui du déréférencement » enfonçait Emmanuel Macron, lui-même venu à leur chevet pour dénoncer la stratégie du moteur américain.
Le bras de fer étant bloqué sur le terrain de la loi de transposition, il s'est déporté sur les questions concurrentielles.
La plainte devant l’Autorité de la Concurrence
Le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM), l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), le Syndicat de la presse quotidienne nationale, le Syndicat de la presse quotidienne régionale, le Syndicat de la presse quotidienne départementale et enfin le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale se sont joints pour porter l’affaire devant l’Autorité de la concurrence.
En chœur, ils accusent l’entreprise en position dominante de pratiques abusives suite à la « modification brutale et unilatérale de sa politique d’affichage des contenus d’actualité », avec pour objectif de les contraindre à consentir gratuitement à la mise à disposition de leurs contenus « sous la menace d’une dégradation de l’affichage de leurs contenus dans ses services ».
Et pour cause, un titre affiché dans Google non accompagné d’un extrait a toujours moins de visibilité que celui qui est associé à ce « snipet ». L’AFP, qui a joué de tous les coudes pour favoriser l’adoption de l’article 15, a dénoncé pour sa part un contournement de l’esprit de la directive. « Ces pratiques constitueraient également un abus de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouveraient les éditeurs vis-à-vis d’elle ».
Un secteur en berne, au profit des services numériques
Dans sa décision, l’ADLC a d’abord dressé un bilan du secteur, constatant sans mal une chute des revenus publicitaires de la presse entre 2000 (plus de 10M€) à 2017 (un peu plus de 4M€), une évolution expliquée par « l’évolution des usages dans le secteur des médias, liée à l’émergence et au développement des offres numériques ». Dans le même temps, Google et Facebook ont vu leurs parts de marché grimper inexorablement.
La directive comme la loi ont fondé les droits voisins sur un principe de négociation « afin de garantir aux éditeurs et agences de presse une transparence optimale quant aux paramètres utilisés par les services de communication au public en ligne pour déterminer le montant de ces recettes », rappelle l’autorité, en appui du texte de juillet 2019.
Suite à la décision du géant américain, « la très grande majorité des éditeurs ont autorisé Google à afficher des contenus protégés sans percevoir de rémunération. Les éditeurs n’ayant pas autorisé Google à afficher des contenus protégés, pour leur part, ont subi des pertes de trafic significatives »
Selon Google, « sur un panel représentatif de 200 éditeurs de presse, les éditeurs ayant fait les démarches pour maintenir l’affichage de leurs contenus protégés représentaient en décembre 2019 environ 90 [à]100 % du trafic total redirigé par Google vers ces 200 éditeurs de presse »
L’absence d’affichage des extraits a en tout cas exposé les éditeurs à une diminution du taux de clics et « une dégradation du classement des liens vers ses contenus dans les pages de résultats de recherche de Google ». Moins de clics leste le positionnement des éditeurs dans l’algorithme et pèse donc sur la pertinence des résultats, sans oublier la dégradation du trafic vers le site de l’éditeur.
« La suppression de l’affichage des contenus protégés au sein des services de Google pour le site du journal La Voix du Nord, entre les 24 et 27 octobre 2019, a entraîné une chute du trafic en provenance de Google de l’ordre de 33 % selon l’éditeur ». Cette chute aurait été de 50 % pour le groupe La Dépêche en une seule journée.
Des pratiques susceptibles d’être anticoncurrentielles
Pour fonder sa décision, l’Autorité de la concurrence s’est appuyée sur l’article L. 464-1 du code de commerce. Il l’autorise à prendre des mesures conservatoires, lorsqu’une pratique « porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ».
Il faut avant tout que les faits dénoncés apparaissent comme susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles Après avoir vérifié plusieurs ingrédients, dont l’existence d’un marché pertinent en France, l’Autorité ne s’est pas penchée sur le fond de l’affaire, mais a voulu déterminer si les pratiques de Google étaient donc potentiellement anticoncurrentielles, non sans rappeler sa jurisprudence constante :
« Si l’existence d’une position dominante n’est pas en soi condamnable, il incombe toutefois à l’entreprise qui la détient, indépendamment des motifs d’une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée sur le marché intérieur de l’Union »
Sans donc entrer dans le fond – la question fera l’objet d’une autre décision, l’ADLC a vérifié si les conditions posées à l’article L. 420-2 du Code de commerce, lequel dresse une liste non exhaustive des pratiques dites abusives, lorsqu’elles sont mises en œuvre par un acteur en position dominante.
Alors que la loi voulait organiser une négociation entre les moteurs de recherche et les éditeurs et agences de presse, Google a annoncé « unilatéralement qu’elle ne reprendrait plus les contenus protégés des éditeurs et des agences de presse à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins »
« Cette pratique a donc abouti à contraindre les éditeurs de presse, ne disposant d’aucune alternative satisfaisante à la reprise de leurs contenus par Google, à renoncer par avance au bénéfice attendu de la Loi sur les droits voisins, à savoir autoriser, aux termes d’un processus de négociation effective, un rééquilibrage de leurs relations » commente la décision. « Google, par son comportement, met ce dernier devant un choix consistant soit à potentiellement perdre du trafic et des revenus au profit de ses concurrents qui auraient opté pour une licence gratuite, soit à les conserver en octroyant également une licence gratuite ».
Un « prix nul »
Les négociations voulues par les législateurs européen et français ont non seulement été réduites à néant, mais Google a imposé, à ses yeux, des conditions inéquitables : « l’Autorité considère que l’application par Google d’un « prix nul » à l’ensemble des éditeurs de presse pour la reprise de leurs contenus protégés n’apparaît pas comme constituant une mesure raisonnable au sens de la jurisprudence ».
Google a fait valoir que la directive n’imposait pas un droit d’obtenir une rémunération ni même la conclusion d’accords de licence. Mais en vain. L’autorité retient surtout « qu’à la différence des éditeurs de presse, Google est en mesure de retirer un gain de tout internaute accédant à du contenu d’actualité sur internet, que cet accès se fasse par une recherche sur le Search en lien avec l’actualité et donnant lieu à l’affichage de contenu protégé, ou par tout autre moyen ».
Selon le moteur, Google apporte plus de 30 % du trafic total sur les sites des éditeurs de presse, et même parfois davantage selon ces derniers. Quoi qu’il en soit, « une part prépondérante du trafic total » en conclut l’autorité. « Il ressort donc de ces études que la suppression des « snippets » occasionne bien une diminution du trafic vers les sites des éditeurs visés, ce qui tend à indiquer qu’au moins une partie du trafic généré par ces « snippets » n’est pas reconquise par d’autres canaux ».
« Dilemme du prisonnier »
Elle en déduit encore, à ce stade de la procédure, que Google a pu, par sa force concurrentielle, évincer la négociation et la rémunération des éditeurs, alors que la loi ouvrait cette possibilité au profit du secteur de la presse en ligne.
Dégradation, perte de visibilité… Le ministère de la Culture, qui est intervenu au chevet des éditeurs, parle même du dilemme du prisonnier : « En effet, tout éditeur peut ressentir qu’il a intérêt à accorder la licence la plus large possible ne serait-ce que par crainte que d’autres le fassent. Cela est corroboré par l’attitude des éditeurs de presse qui ont, dans leur grande majorité, concédé une licence gratuite, la plus large possible, à Google. »
Des conditions de transaction inéquitables, mais l’Autorité a aussi identifié une liste de pratiques discriminatoires.
Des pratiques discriminatoires, un contournement de la loi
Ces pratiques, prohibées lorsqu’une entité dispose d’une position dominante, consistent à « appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». Ici Google a appliqué le même régime à tous les acteurs. Un traitement indifférencié qui « paraît, en l’état de l’instruction, susceptible d’être dépourvu de justification objective », reproche l’Autorité.
Mieux. « Les juridictions européennes ont considéré qu’une entreprise en position dominante pouvait commettre un abus lorsque, sans violer formellement une loi, elle en détourne les finalités sans justification objective » note encore la décision, en appui d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 décembre 2012.
Cette fois, Google a utilisé « la possibilité laissée par la Loi sur les droits voisins de consentir des licences gratuites pour en faire un principe général de non-rémunération pour l’affichage des contenus protégés sur sa plateforme ». Pire, « le comportement de Google lui a permis de surcroît d’obtenir de nouvelles conditions de transaction encore plus avantageuses qu’avant l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de reprise et d’affichage des contenus protégés ».
Pourquoi ? Car dans le bras de fer qui s’est ouvert sur l’autel de la loi sur les droits voisins, de nombreux éditeurs ont ouvert totalement les vannes face au géant, l’autorisant à reprendre sans limites de longueur leurs extraits comme il le demandait, alors que le moteur imposait un plafond de 300 caractères autrefois.
« Ce contournement de la Loi sur les droits voisins est rendu possible par la position dominante dont bénéficie Google en particulier sur le marché des services de recherche généraliste, et le poids que celle-ci représente dans le trafic sur les sites des éditeurs de presse », commente la décision.
Les mesures conservatoires décidées, en attendant le fond
Au final, l’ADLC a imposé une série de mesures conservatoires. Face à une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse menaçant la viabilité économique des éditeurs, elle décide de lui imposer une série d’obligations :
- Obligation de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui en feraient la demande, et des négociations qui doivent impérativement aboutir à une proposition de rémunération de la part de Google, appréciée à la lumière de sa conformité avec la loi de 2019 et de son caractère transparent, objectif et non discriminatoire. Ces négociations porteront sur une période rétroactive au 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur du texte.
- Obligation de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération due
- Obligation de maintenir les extraits textuels et les extraits enrichis des éditeurs et agences de presse pendant la période de négociation. Google ne pourra pas s’opposer à l’affichage des contenus protégés selon les modalités choisies par ces éditeurs et agences de presse pendant la période de négociation.
- Obligation de négocier pendant trois mois à partir des demandes émises par les éditeurs
- Obligation pour Google de prendre les mesures nécessaires pour que l’existence et l’issue des négociations prévues par les Injonctions n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus protégés repris par le moteur sur ses services.
- Obligation de respecter un principe de neutralité. « Il s’agit ainsi d’éviter que Google vide de leurs effets les négociations sur les droits voisins en compensant sur d’autres activités les rémunérations versées aux éditeurs au titre des droits voisins. Il s’agit aussi d’éviter que Google ne se serve de sa position dominante sur le marché des services de recherche généraliste pour imposer, au cours des négociations avec les éditeurs et les agences de presse, le recours à certains de ses services ».
- Obligation pour Google d’adresser des rapports à l’Autorité pour lui expliquer la manière dont elle se conforme à ces obligations.
- Obligation enfin de respecter ce cadre jusqu’à la décision sur le fond.
Google peut faire appel de la décision. En attendant, l’instruction au fond va se poursuivre. Elle permettra « de déterminer si les éditeurs et agences de presse se trouvent ou non en situation de dépendance économique vis-à-vis de Google, et le cas échéant si un abus est constaté ».
Les titres peuvent entrer dans le droit voisin, selon le ministère
Enfin, au détour de la décision, une discussion a eu lieu sur le champ des droits voisins et des exceptions. Le texte, avons-nous dit, consacre un droit voisin pour la reprise de bout d’articles de presse. Il ouvre toutefois deux exceptions. Sont autorisés les actes d'hyperlien et « l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse », à condition toutefois qu’elle ne se substitue pas à ̀la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer.
Google considère que les titres de presse sont dans le champ de cette dernière exception, mais… telle n’est pas l’analyse du ministère de la Culture ou de l’ADLC : « Il n’est pourtant pas certain que les titres d’articles soient tous couverts par principe par cette exception, dès lors que le texte vise les « mots isolés ou [de] très courts extraits », ce qui pourrait inviter à une appréciation in concreto, eu égard par exemple à la longueur ou au contenu informatif des titres d’articles de presse ».
Le ministère de la Culture a détaillé ainsi sa position : « il convient de relever que l’exception ne vise pas spécifiquement les titres. Ceux-ci pourraient ne pas être couverts par l’exception soit par principe eu égard à leur caractère spécifique, soit au cas par cas en fonction du nombre de mots qu’ils contiennent ».





























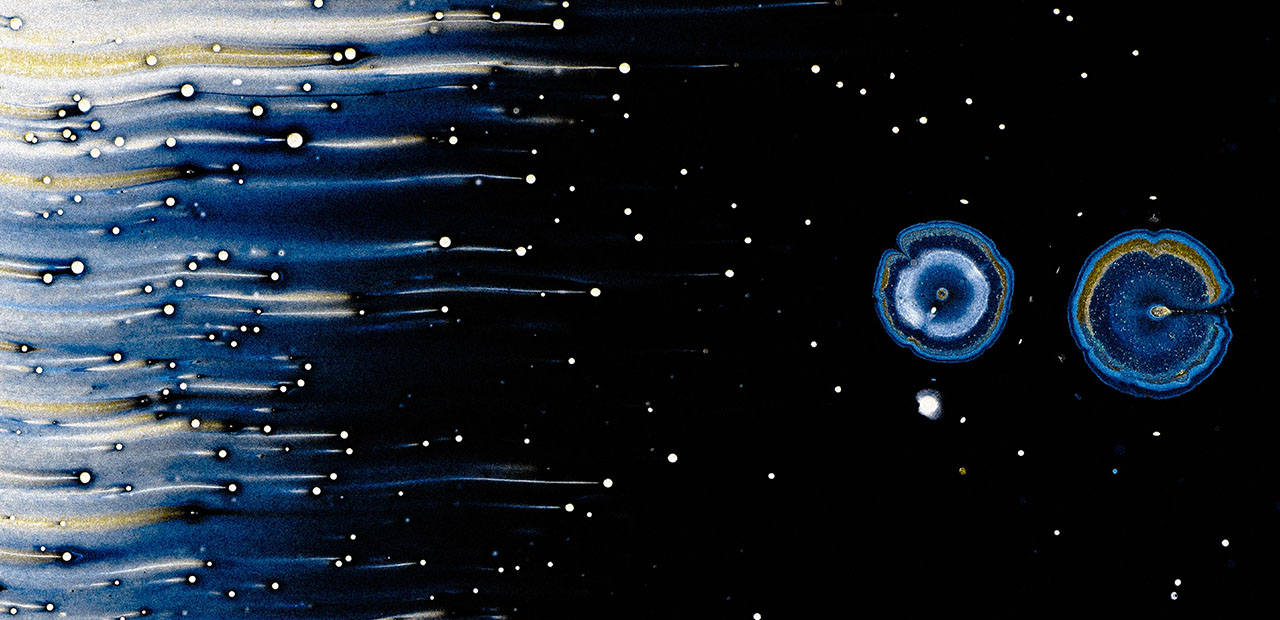


Commentaires (70)
#1
Je vois déjà la réaction de Google : plus d’image ou d’extrait, et des titres tronqués à X mots et finissant par “…”.
Et voilà, Google respecte à nouveau la loi :)
#2
Ça va tourner en rond pendant encore combien d’années ?Si Google veut respecter la loi et ne pas payer, ne peut-il pas de-link tous les sites de presse sur sa partie Fr (tous, pour ne pas faire de favoritisme) et regarder ce qu’il se passe ?
Sans être pour Google (je suis même contre sur certains points), n’est-il pas quelque peu abusé que des sites veulent être payé par les gens/sites mettant des liens vers leur contenu ?
Et là, ce n’est pas seulement Google qui peut être touché, potentiellement tous les sites faisant des liens vers des articles se voient touchés vu que les titres en eux-mêmes sont en train d’être considérés comme tel (à moins que dans la loi, il n’y ai que Google de visé - mais cela ne serait-il pas faire de la discrimination envers Google de procéder ainsi ?) ?
#3
Non, je pense que Google va faire comme en Espagne : fermeture pure et simple de google news…
#4
Ils devraient rendre le référencement des sites de presse payant.
#5
Si j’ai bien compris, la décision impose que Google ne ferme pas ce service pendant les 3 mois de négociations.
#6
#7
Et l’état a le droit d’obliger une entreprise privée à produire un service en dehors des temps de guerre? Google va envoyer son armée d’avocat ridiculiser la France sur ce point " />
" />
#8
Sauf que c’est de la vente forcée. C’est pas illégal normalement?
#9
Sinon, quel est le vrai pouvoir de cette autorité?
#10
Bon, je crois que ça va coupé. Bravo messieurs les ayants droit, vous avez perdu, et là, c’est le game over total qui vous attend.
Par contre, qu’en est il des autres moteur de recherche ?
#11
Selon le capitalisme pour lequel milite le gouvernement français: une entreprise pas rentable DOIT faire faillite, et c’est le cas de presque toute la presse écrite française qui appartient à des milliardaires mais vit de massives subventions publiques " />
" />
 " />
" />
Les mafieux du gouvernement veulent imposer aux autres leur idéologie, mais surtout pas à leur petite caste qui relaient leurs mensonges éléments de langage: faites ce que dis, pas ce que je fais
#12
« l’Autorité considère que l’application par Google d’un « prix nul » à l’ensemble des éditeurs de presse pour la reprise de leurs contenus protégés n’apparaît pas comme constituant une mesure raisonnable au sens de la jurisprudence »
Si c’est juste une question de prix, nul doute que Google saura faire preuve de mansuétude en les soulageant de quelques milliers d’euro.
#13
#14
#15
#16
ahh qu’est-ce que l’état ne ferait pas pour remettre un peu d’argent dans les poches des milliardaires qui possèdent ces journaux, investissement fait dans le but que l’état agisse dans ce sens, sur ce sujet et tant d’autres :)
#17
Hahahahaha… je l’avais dit. C’était gros comme une baraque. J’ai mon PQ et mes popcorn.
#18
#19
C’est ce qu’il a fait au début, avant il fallait se notifier pour ne pas aparaitre (opt-out), avec la loi il a virer tout le monde et leur a dit de mettre ne place des balises HTML spécifique s’ils voulaient continuer a apparaître (opt-in). Ce qui me semble raisonnable.
Mais là ils veulent obliger Google a négocier un contrat ou ils leur vendront leurs feuille de choux. Et ça avec le canon de l’état sur la tempe de Google.
Comme dit plus haut, il est possible qu’il excomunie toutes la presse Fr, mais à la différence de GNews en Espagne, là (si je dit pas de connerie) on parle aussi du moteur de recherche.
#20
Grand utilisateur de Google news, c’est un bon agrégateur de façon générale, mais… Fermez le !
S’il vous plait ! Ca leur donnera peut être une leçon…
30%-50% voir plus de trafic sur votre site et les éditeurs demandent à ce que Google les paye ????
Ma boite paye de milliers d’euros par mois pour que Google nous envoie du trafic…
Les mecs ont la chance d’avoir un service gratuit qui leur donne de la visibilité et ils veulent être payé pour ? C’est juste une honte d’être aussi cupide.
Je serais éditeur de presse, j’aurais bossé avec Google pour qu’il me mette plus souvent en avant…
#21
#22
#23
#24
#25
C’était couru d’avance. Google a perdu dès l’instant où ils ont proposé aux services de presses de les reprendre à prix gratuit. La seule position juridiquement tenable était d’arrêter de les reprendre tout court, arguant que la rémunération rendait l’opération économiquement non-viable (ou sinon, payer). C’est surprenant qu’avec leur armée d’avocats ils aient prix une décision pareille (ou alors, ils ont estimé que la sanction serait suffisamment faible et tardive…).
#26
#27
#28
#29
C
#30
Presse ? Quelle presse ? La presse est moribonde en France . Elle ne survit que grâce aux subventions de l’État qui l’utilise comme moyen de propagande
#31
#32
A priori, ça suffit largement pour l’autorité pour la concurrence.
#33
#34
Sauf qu’ici il s’agit bien de la question des droits voisins et pas d’une autre loi.
Sur la question des droits voisins Google a respecté la loi qui disait que si tu affiches tu payes. Google a dit : “je n’affiche plus donc je ne paye pas et si vous voulez que j’affiche vous devez m’autoriser à le faire”.
C’est son service il fait ce qu’il veut. Les chouineurs se sont estomaqués en criant à l’entourloupe alors que la loi a été mal ficelée dès le départ (tout le monde ici l’avait vu et pourtant on est pas tous des juriste[il me semble qu’il y en a quelques uns]).
Idem que @Patch et certains autres, j’attends de voir si Google va fermer son service News comme il l’avait fait en Espagne. Ça avait bien refroidit à l’époque.
#35
Ils se croient vraiment tout permis ces viandars !
Déjà que tous ces abrutis profitent de leur carte de presse pour se pavaner dans toute la France en ce temps de confinement.
Le pire c’est quand tu vois le clampin faire son interview devant l’Elysée (ou autre bâtiment gouvernemental) qui ne sert strictement à rien si ce n’est bouger tout une équipe de tournage et potentiellement propager le virus.
Vivement que Google leur ferme le service, j’ai hâte !
#36
#37
Aucune certitude ni prétention de ma part sur quoi que ce soit.
Ne t’en fait pas pour Google il a une armée d’avocats prêts à défendre bec et ongles ses intérêts.
Et je rejoins @Patch : j’espère que Google fera comme en Espagne.
#38
L’Autorité de la Concurrence est plus préoccupée par un éventuel abus de position dominante que par une loi au sujet des droits voisins. Ici, la décision énonce clairement la possibilité que Google enfreigne la législation relative à la concurrence (en vigueur en Europe).
#39
En lisant et relisant l’article, il y a un truc qui me laisse perplexe : “abus de position dominante” = habituellement, cet abus est apprécié parce que l’accusé fait payer la victime, lequel est obligé en raison de la position dominante.
Mais là, la position dominante, c’est un service gratuit. Du coup, je ne comprends pas de quoi abuse google, vraiment. La réponse “bon, OK, on ne vous cite plus sauf si vous nous autorisez” me semblait tout à fait juste, et je ne comprends pas pourquoi le tribunal a dit autre chose.
On pourrait aboutir à une négociation alakon, du genre : “bon, je paye vos droits voisins 10€, vous payez pour être sur la plateforme 10€”. (Là je trouverai qu’il y a abus de position dominante)
non, vraiment, il y a un truc qui m’échappe, même avec la meilleure volonté du monde.
#40
Personnellement, qui de hippopotame et de l’éléphant est le plus fort, j’en ai rien a foutre, mais je suis quand même curieux de voir le combat (même si on sait tous que c’est le rhinocéros).
#41
D’abord, rien n’a été décidé (il s’agit d’une mesure conservatoire en attendant une décision sur le fond… à moins que Google et la presse mainstream française se mettent enfin d’accord tous seuls comme des grands, à l’amiable).
#42
L’autorité de la concurrence est assez puissante, elle peut mettre des sanctions assez violentes (susceptibles d’appel, évidemment), par exemple :https://www.businessinsider.fr/les-plus-importantes-amendes-infligees-par-autori…
#43
#44
#45
Au passage et pour ma curiosité, l’arrêt de la CJUE en question semble être AstraZeneca, concernant un anti-ulcéreux.
#46
A l’époque des députés voulaient encadrer la rémunération et la répartition entre l’éditeur et l’auteur… On leur a dit que non, il faut laisser les entreprises négocier entre elle et maintenant ce même groupe pleure.
#47
D’abord, ils ne pleurent pas, ils négocient.
… un peu le même que la loi encadrant les livraisons Amazonen France.
#48
#49
Personnellement, je me fiche que Google ou l’État français ou les industriels propriétaires de presse ou le FMI ou Mary Poppins écrase l’autre ou qu’ils s’arrangent mutuellement à l’amiable. Je regarde la réalité, comme pendant les négociations entre TF1 ou BFM avec les box-opérateurs : le public de Next inpact vomit sur les ayants-droits, ça n’empêche pas que même FreeboxTV a payé pour garder le replay de TF1, TMC, BFM, RMC découvertes, etc.
AMHA l’agonie va durer longtemps, et peut-être même que Google sera démantelé façon puzzle ou façon AT&T bien avant que les médias mainstream français meurent.
#50
#51
donc la seule réponse possible de google n’est-elle pas de dire “bon, je ferme le service. Il ne me rapportait rien, s’il me coûte, ce n’est plus économiquement viable”. Ce qui aura des conséquences encore pires sur la presse, non ?
A moins que google ne doive payer pour indexer les contenus dans son moteur lui-même ? Dans ce cas, la seule réponse devrait être “alors je ne vous indexe plus”, mais là, la presse pourrait attaquer en abus de position dominante sur le mode “vous nous condamnez à mort”.
Notez que je m’interroge très sincèrement, je ne suis pas du genre trolleur, même un vendredi ;)
#52
Je pense que la position qui vise à ne plus référencer du tout est juridiquement beaucoup plus tenable.
Mais vu la situation de monopole, il n’est pas impossible que l’autorité y trouve quand même à redire. Mais ça passe d’une situation où google est sûr de perdre à une situation où google a une chance de gagner.
Évidemment, les conséquences sur la presse seront terribles, mais juridiquement ça me semble plus solide. Il y a quand même un risque non nul qu’une partie des utilisateurs se détournent de google pour cette raison, si les autres moteurs trouvent un accord.
#53
Petite question, les autres moteurs auraient-ils un interet a trouver un accord ? Ils sont un peu dans la meme situation que Google et ils indexent “gratuitement” pour la presse si je ne me trompe pas.
Meme s’ils recuperent le traffic laisse par Google sur la presse ecrite francaise et vu qu’ils paieront, seront-ils vraiment gagnants dans l’histoire? (je ne vois pas du tout l’interet pour la presse de recuperer des poussieres et Je vois mal ces compagnies mettre un departement qui ne rapporte deja pas grand chose dans le rouge en payant quelques millions chacun)
Apres les accords n’existent pas, on peut y mettre ce qu’on veut. Mais comme je le dis plus haut, je vois mal les acteurs de la presse passer des accords pour recuperer des clous. Peut-etre au debut le temps que ca rentre dans les moeurs et augmenter la rente, un peu comme pour la copie privee.
#54
Qwant a des accords en ce sens il me semble.
#55
#56
Ce sujet me fait toujours un peu rire. Je n’arrive pas imaginer que nos éditeurs et politiques n’ont toujours pas compris que la première loi du monde cest celle du plus fort. Tu traite un mec de coxxxxrd il se passe rien. Tu fais la meme chose avec le président tu va en taule. La c pareil. Tu essaye de combattre Google tu perds. Si t pas content et bien change de métier voir de planète pour ne plus etre Google dependant
#57
#58
Actuellement, Google affiche les résultats de recherche avec un court extrait, il faudrait donc faire une exception automatique pour que dans les cas des sites de presse il n’y ait que le lien ?
#59
#60
Moi j’aimerais encore mieux de la part de Google, au lieu de fermer totalement, qu’ils fassent une page disant qu’ils n’assurent plus ce service car non rentable, MAIS en mettant des liens vers les autres moteurs de recherche qui le font en solution alternative, genre Bing News, Qwant Actu etc.
 " />
" />
Ils le feront pas, mais ce serait vachement couillu et ça ferait un beau fuck à la France
#61
Merci pour le lien très intéressant.
#62
#63
DLC DTC " />
" />
#64
#65
Un jeu de pourris contres pourris, avec en bonus une loi pourrie…
Le mieux que Google puisse faire pour assassiner la concurrence, c’est payer très grassement les groupes de presse de sorte que ses concurrents ne puissent pas suivre, bref, transformer la presse Française en exclusivité Google le temps de construire l’ultime dépendance.
#66
#67
Le problème de position dominante se règle à coup de procès … pour abus de position dominante, et ultimement par la scission de Google.
Forcer Google à payer la presse n’est en aucun cas un remède à cette situation, c’est juste l’entériner contre monnaie sonnante et trébuchante, et au détriment des concurrents de Google.
#68
#69
La fermeture, la fermeture, la fermeture !
D’une pierre deux coups : non seulement cela serait la juste réponse aux caprices de ces agences de presse, mais en plus cela permettrait de réapprendre aux gens à lire les infos autrement que sur GNews.
#70
En tout cas, ça a l’air intéressant comme fonctionnement : demain je monte un petit site d’actualité style Brut ou Morandini, j’obtiens une carte de presse, je me fais référencer par Google, et pour me financer je lui demande des rentes " />
" />