« La 5G va-t-elle réellement affecter les prévisions météorologiques ? » se demande l'ANFR. Un article de la célèbre revue scientifique Nature, largement repris dans la presse internationale, laisse penser que oui. Dans les faits, c'est plus compliqué (comme souvent) et il s'agit surtout d'une attaque visant la FCC. Explications.
C'est un article intitulé « Les réseaux sans fil 5G menacent les prévisions météorologiques », mis en ligne le 26 avril 2019 par Nature, qui a mis le feu aux poudres. Dès le sous-titre le soufflet retombe un peu avec un passage au conditionnel : « la prochaine génération de technologie mobile pourrait interférer avec les observations cruciales de la Terre par satellite ».
Surprise et stupéfaction face à un risque qui n'avait pas été identifié auparavant ? Que nenni, nous en parlions déjà en août de l'année dernière lors de l'analyse des retours d'une concertation publique de l'Arcep sur « les perspectives de la 5G dans la bande des 26 GHz ».
En plus des satellites, l'armée et les faisceaux hertziens se partagent déjà une bonne partie des 24,25 à 27,5 GHz (communément appelée bande des 26 GHz)... et encore sans tenir compte de la 5G qui arrive.
Une décision des États-Unis qui dépasse ses frontières
Cette problématique est en fait remontée à la surface après la mise aux enchères aux États-Unis des blocs de fréquences dans cette bande des 26 GHz. Ils ont rapporté près deux milliards de dollars selon Nature, mais les licences n'intègrent pas de protection suffisantes pour assurer une bonne cohabitation entre la 5G et les satellites météorologiques qui utilisent les mêmes fréquences.
L'Agence nationale des fréquences a décidé de revenir sur le sujet et confirme le point de vue de Nature : « des décisions de mise aux enchères de la partie basse de la bande 26 GHz (proche de la bande passive) ont été prises sans que l’administration américaine n’étudie le brouillage des satellites d’observation de la Terre ».
En « météorologie, il n’y a qu’une atmosphère »
« Les conditions techniques de la FCC, l’équivalent de l’Arcep aux États-Unis, n’incluent donc aucune limite spécifique pour protéger la bande. Le gouvernement américain considère que leur réglementation, qui permet un brouillage des satellites 100 fois plus élevé que les limites européennes, est toutefois suffisante et ne sera pas modifiée », ajoute l'ANFR. C'est justement ce qui inquiète les agences spatiales et météorologiques mondiales.
Même si les Américains devaient être les seuls à ne pas protéger la bande, les répercussions dépasseraient largement leurs frontières. En effet, « pour la météorologie, il n’y a qu’une atmosphère et les perturbations au-dessus des États-Unis affecteraient les prévisions météorologiques pour la planète entière ».
Rien n'est encore joué pour autant et une réunion importante aura lieu en octobre et novembre : la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19) à Charm-el-Cheikh (Égypte).
L'Europe et la France veulent promouvoir leur compromis « satisfaisant »
Cette réunion est organisée tous les quatre ans par l'Union internationale des télécommunications (UIT), une organisation regroupant « 193 pays membres et plus de 700 entités du secteur privé et établissements universitaires » et qui fait donc autorité dans son domaine.
Durant la CMR-19, l'ANFR rappelle qu'il faudra « fixer les limites qui seront inscrites dans le Règlement des Radiocommunications et qui s’appliqueront à tous, y compris aux États-Unis ». La France et l'Europe y défendront « le niveau de protection que nous avions obtenu dans la réglementation européenne ».
L'Agence affirme que les conditions techniques liées aux licences dans les 26 GHz (via les autorisations de l'Arcep pour la France par exemple) « garantiront la protection des satellites d’observation de la Terre ». Pour établir ces limites, « la limite de rayonnement dans la bande passive où les satellites effectuent leur observation a fait l’objet d’études complexes, notamment de l’ANFR et de l’ESA, qui ont abouti en juillet 2018 à un compromis que la communauté de la météorologie reconnait comme satisfaisant pour garantir la pérennité de leurs observations ».
Les États-Unis « s'opposent » pour le moment à toute protection
Il y a quelques semaines, l'ANFR donnait quelques exemples des mesures mises en place. Il est notamment question d'interdire de pointer des antennes 5G vers le ciel, tandis que la limite de puissance des relais mobiles doit aussi être débattue.
« Ces limites représentent tout de même une contrainte réelle pour l’industrie 5G », reconnait l'Agence nationale des fréquences qui doit donc jongler avec les opérateurs, les industriels et les agences météorologiques. Ainsi, de nombreux pays veulent mettre en place des limites moins sévères... « sans mesurer le risque pris pour les prévisions météorologiques ou les études de l’environnement ».
C’est notamment le cas des États-Unis, ajoute l'ANFR : « alors même qu’ils exploitent de nombreux satellites observant la Terre dans cette bande, et s’opposent en outre, du moins à ce stade des négociations, à toute protection spécifique de la bande ». Bref, la réunion de la fin d'année en Égypte s'annonce pour l'instant animée.
Impossible de parler de prévisions météorologiques sans toucher un mot du niveau de performances actuel. Selon Météo France, qui procède systématiquement à l'évaluation a posteriori de ses prévisions, « la prévision du type de temps à 24 heures d'échéance sur la France est juste dans environ 90 % des cas, et la prévision de température à 24 heures d'échéance en un point donné a une précision moyenne de l'ordre de 1 à 1,25 °C. À 7 jours, la précision est de l'ordre de 3°C ».
La preuve par l'exemple : quand une borne Wi-Fi brouillait un radar météo
En guise de conclusion (et pour rappeler la sensibilité de certains appareils aux ondes), l'ANFR nous livre une histoire cocasse : une borne Wi-Fi brouillait un radar météo situé à une trentaine de kilomètres... très loin de la portée théorique maximale du signal Wi-Fi.
Météo France a remarqué un problème avec un radar à Trappes et a donc demandé à l'ANFR d'enquêter sur le sujet : « Afin d’obtenir le maximum d’informations pour caractériser le signal perturbateur, l’ANFR a effectué des mesures sur le radar, qui ont permis de déterminer que l’équipement perturbateur était un émetteur RLAN (réseau local sans fil) ou Wi-Fi émettant dans la bande des 5 GHz [une des deux bandes du Wi-Fi avec le 2,4 GHz, ndlr]. Toutefois, l’équipement brouilleur peut se trouver n’importe où dans la direction de l’azimut concerné jusqu’à plus de 100 km, les radars météo étant très sensibles ».
Pas le choix, les enquêteurs de l'Agence remontent donc la piste le long de l'azimut en question. Après des passages infructueux à Saint-Quentin-En-Yvelines, la forêt de Fausses Reposes et la tour UFIMEG à Bagnolet, ils arrivent finalement à la Tour Montparnasse où ils décrochent le jackpot : « Une recherche approfondie les a menés jusqu’à un point d’accès Wi-Fi qui s’avère être utilisé pour le transfert de données d’une borne à "selfie" positionnée sur la terrasse panoramique ».
Le propriétaire de la borne fautive a mis fin au brouillage et a été notifié par l'ANFR d'une taxe de 450 euros pour frais d'intervention. L'Agence rappelle qu'il encourt « par ailleurs des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en application de l’article L39-1 du CPCE ».
Dans ce document de 2018 montrant justement un exemple de brouillage des radars de Météo France, l'ANFR rappelle à très juste titre que « la bande 5 GHz est d’usage libre, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas des règles à respecter », notamment sur la puissance d'émission pour assurer une bonne cohabitation.
Avec la 5G sur les 26 GHz, il en sera de même. Il faut maintenant attendre la CRM-19 pour savoir quelle réglementation sera mise en place et avec quels niveaux de protection pour les satellites.























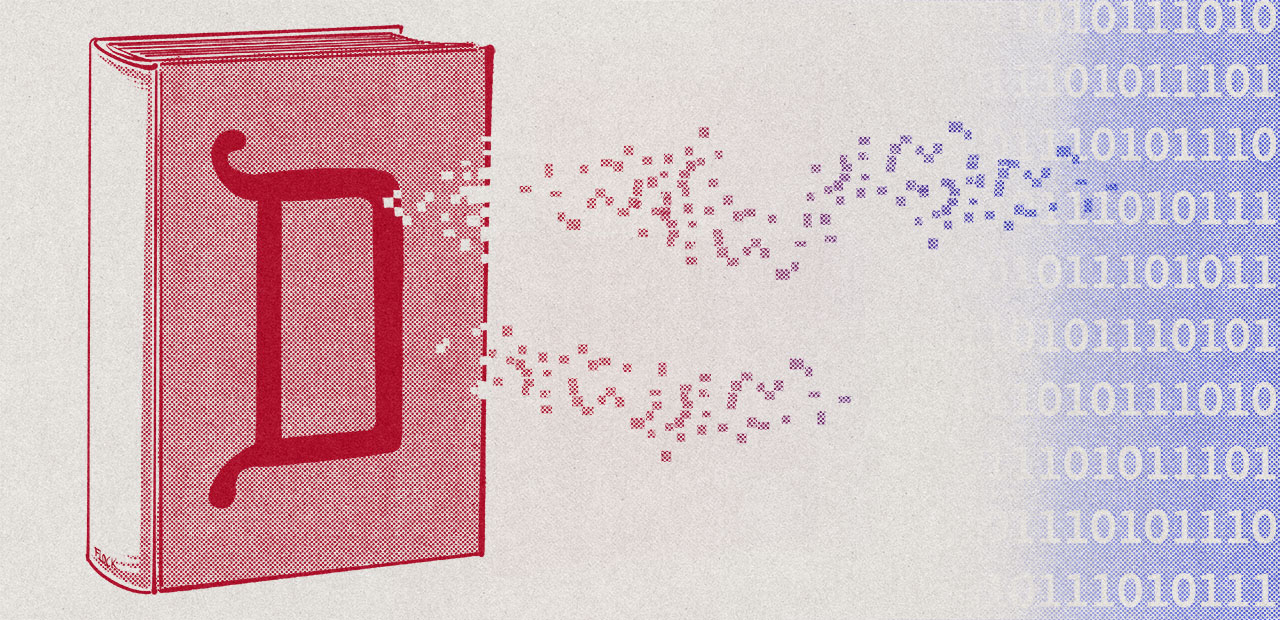
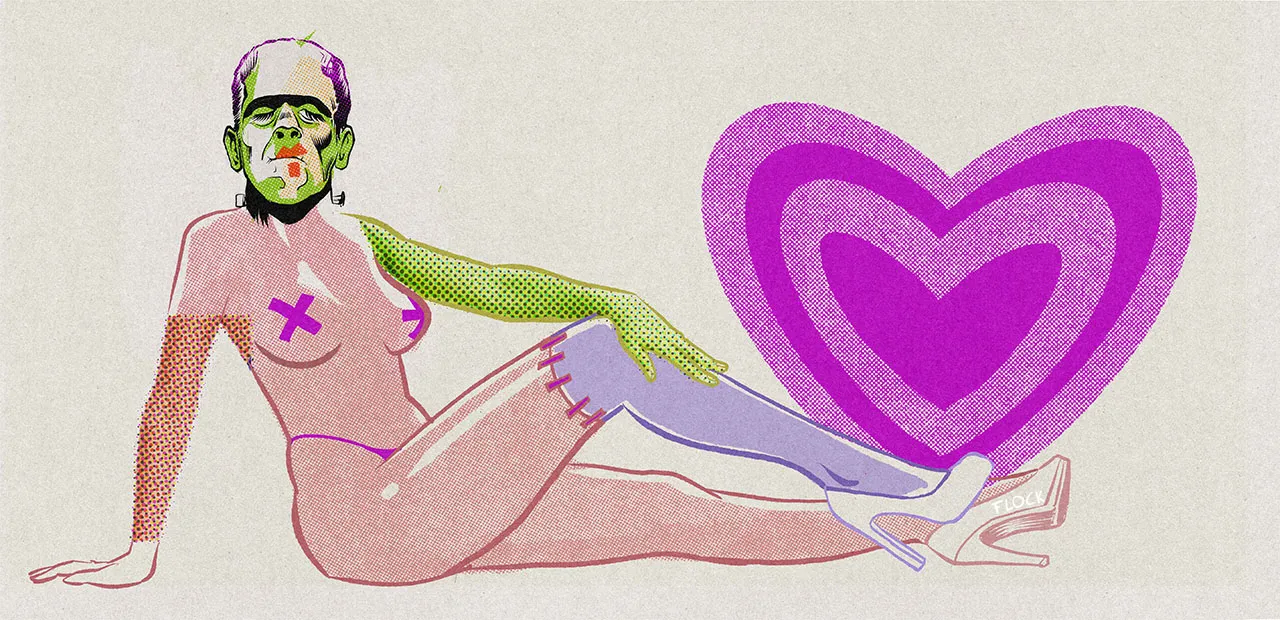
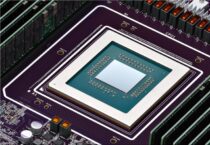






Commentaires (30)
#1
Comme d’habitude les intérêts industriels et les gros sous privés passent avant l’intérêt public, avec le pouvoir américain. Faudrait que ça change…
#2
l’anecdote sur la borne à selfie est cocasse. Mais aussi symptomatique du désintérêt total (ou la méconnaissance mais le résultat est le même) pour les normes dès qu’il est question d’argent…
450€ pour l’intervention me parait même pas très cher payé au vu des recherches menées…
#3
Je ne comprends pas pourquoi le propriétaire de la borne est incriminé si la borne est agrée et que son usage est normal.
Il parasitait donc à l’insu de son plein gré !
#4
Le coup de l’équipement RLAN non conforme n’est effectivement pas clair. Il est possible qui la borne WiFi en question était équipée d’antenne directionnelle à fort gain comme le laisse suggérer la photo, d’où la non conformité.
EDIT: d’ailleurs le document PDF de l’ANFR précise que la bande 5150-5350 Mhz est limitée à une utilisation intérieure.
#5
#6
Mouais, sauf que le public préfère capter partout y compris dans les tunnels hein. Donc l’intérêt 5G il n’est pas qu’au niveau des industriels " />
" />
#7
Si tu lis bien l’article, tu verras qu’il n’y a pas que “l’intérêt du public” en jeu - au-delà des agences météo, il y a d’autres utilisations de ces bandes de fréquences qui risqueraient un bon gros brouillage:
 " />)
" />)
En plus des satellites, l’armée et les faisceaux hertziens se partagent déjà une bonne partie des 24,25 à 27,5 GHz
Pour le retour de flamme potentiel, ça serait par ici :
alors même qu’ils exploitent de nombreux satellites observant la Terre dans cette bande
(mais bon, en cherchant bien, ils devraient pouvoir mettre les éventuels brouillage sur le dos des services secrets chinois et de Huawei
#8
Du coup grâce à la 5G on pourra consulter la météo partout et avec des jolis cartes animées en 4k, mais elle sera fausse " />
" />
#9
« des décisions de mise aux enchères de la partie basse de la bande 26 GHz (proche de la bande passive) ont été prises sans que l’administration américaine n’étudie le brouillage des satellites d’observation de la Terre »
Je ne suis pas sûr de comprendre ce passage, que veut-on dire exactement par proche de la bande passive ?
Cela signifie-t-il que les satellites météo écoutent sur du 26GHz en passif, donc sans émettre sur cette fréquence ?
#10
#11
#12
Plus que cocasse: c’est stupéfiant.
#13
On est d’accord, l’article n’est pas clair sur ce point… on en est à faire des suppositions.
#14
Hum, de ce que je comprends, le gars émettait trop fort son wifi 5GHz en extérieur.
 " />
" />
Sinon pour revenir aux US, quand on voit le gars à la tête de la FCC, je me dis qu’il y a rien d’étonnant dans leur position… En plus, ils font une pierre deux coups : plus d’observation météo, plus de réchauffement climatique… Easy
#15
C’est surtout qu’en libérant des fréquences de cette façon c’était prévisible.
 " />
" />
Permettre le chevauchement d’ondes d’équipements sensibles avec d’autres plus vulgaires se fera toujours au détriment des plus sensibles. Même en réduisant la puissance d’émission.
L’eau ça mouille, merci l’ANFR.
#16
et si y a moyen de gratter des sous partout et aux autres pays pourquoi se priver ? c’est dommage la météo devenait vraiment surprenante de précision (par chez moi)
#17
#18
#19
Merci pour ce commentaire détaillé. " />
" />
#20
#21
qu’est-ce que tu appelles un signal fin ? bande étroite ?
Comme dit dans plusieurs commentaires, le problème c’est l’antenne directionnelle qui a l’air d’être de la classe 20dB sur la photo : si elle est pointée vers le radar, c’est comme si le wifi émettait 100x plus de puissance ainsi que le fait qu’elle soit à plus de 100 mètres de hauteur qui donne une portée en ligne de visée directe très importante.
#22
#23
Ouais les USA sont trop méchants blablabla. De ce que je comprend s’est simplement que la réglementation actuelle aux USA ne dit rien sur le sujet (puisqu’une autre par dessus le fait déjà) mais que rien n’empêche les industriels de se mettre d’accord sur l’exploitation de la bande concernée, ils peuvent tout à la fois régler le problème eux mêmes comme des grands tout en étant parfaitement conforme à la réglementation. On parle plus ici de définir une ligne de conduite entre industriels exploitant des dispositifs de communication dans cette bande.
#24
La règlementation de la FCC est touffue…… en déclarations à la NTIA.
#25
Merci d’avoir cherché " />
" />
#26
merci également !
#27
#28
Merci de partager tes connaissances. " />
" />
#29
#30
Oui et heureusement d’ailleurs, sinon ils se pollueraient entre eux, et de toute façon B=50MHz donne un résolution de 3 mètres, un peu overkill pour établir des cartes de précipitations. De ce que je vois sur les prospectus du fabriquant [1] qui équipe meteofrance, c’est de 2 à 8 MHz. Il doit y avoir un système de recherche de fréquence claire qui tourne en permanence pour choisir la bande la moins polluée.
Oui il y a les 2, en tout cas sur les radars militaires (je bosse dans le domaine) : un filtre analogique assez large au pied de l’antenne qui couvre toute la bande dans laquelle le radar peut fonctionner puis un ou des filtres numériques moins larges et configurables après l’ADC. Le filtre analogique sert à éviter qu’un signal fort venant d’en dehors de la bande d’intérêt du radar ne vienne saturer les ADCs et rendent tout fonctionnent impossible.
[1]http://www.bentech-taiwan.com/pdf/selex/DB.1700C.web15.pdf