Alors que les institutions européennes n’ont pas encore finalisé l’examen de la proposition de directive sur le droit d’auteur, le groupe socialiste au Sénat, poussé par David Assouline, veut créer un droit voisin pour les éditeurs de presse. Il reconnaîtrait un droit à rémunération de … 50 ans.
L’article 11 de la future directive sur le droit d’auteur veut donner naissance à un droit voisin des éditeurs de presse en ligne. Avec lui, ces sociétés se verraient reconnaître un droit à rémunération pour toutes les exploitations en ligne, notamment des extraits issus de leurs articles.
La logique sous-jacente est que des acteurs comme Google et son service Actualités, s’enrichissent sur leur dos... quand bien même drainent-ils des visiteurs sur les sites en question.
Les eurodéputés ayant voté favorablement ce texte, s’ouvre maintenant une phase de trilogue durant laquelle des arbitrages seront pris, en toute confidentialité. Un vote au Parlement achèvera cette phase européenne au printemps prochain. La balle sera alors dans le camp des États membres qui devront chacun voter une loi de transposition.
Déjà une proposition de loi au Sénat
En France, les sénateurs socialistes n’ont pas décidé d’attendre la fin de ces aventures européennes. David Assouline, David Kramer, Marc Daunis et le groupe ont déposé une proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse.
« Les moteurs de recherche reproduisent et diffusent ainsi, comme libres de droits, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence », expliquent-ils en introduction avant de dénoncer « un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs ».
Pire, ces services en ligne sont devenus à leurs yeux « de véritables banques d'information et de données, en exploitant un contenu qu'ils n'ont ni créé, ni financé et pour lequel ils ne versent aucune rémunération ». Comme au parlement européen, la publicité suscitée par ces services en ligne n'est pas évoquée, tout comme la possibilité pour les éditeurs d'utiliser des techniques pour se couper des moteurs.
Leur véhicule législatif est ample puisque le droit voisin qu’ils appellent à faire reconnaître, « doit couvrir toutes les activités d'intermédiation dans la communication au public des contenus de ces agences et éditeurs ». Cela concerne les moteurs de recherche au sens traditionnel, mais également les services de référencement d’images (mesure déjà votée, mais jamais appliquée).
Une société de gestion collective et un droit à rémunération sur le Net
Leur texte consacre en toute logique un droit voisin sur l’ensemble de leurs productions, dont le son et l’image. Les productions sont « les éléments d'informations collectés, traités, mis en forme et fournis (…) sous leur propre responsabilité, un traitement journalistique ».
Voté, les agences et les éditeurs pourraint ainsi confier la gestion des droits afférents à ces éléments à une société de gestion collective à charge pour elle de collecter les sommes chez l’ensemble des intermédiaires qui les rendent accessibles au public. Soit, des pans entiers du Web.
S’agissant plus particulièrement des photos référencées par des moteurs tels que Google Images ou Qwant Images, le montant de la rémunération due serait déterminé selon les recettes d’exploitation ou à défaut forfaitairement.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits (…) et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images ». Cet accord prendrait donc la forme d’une convention d’une durée de cinq ans.
À défaut de convention dans les six mois, ces éléments monétaires seraient fixés par une commission comprenant des représentants de chaque partie, présidée par un représentant de l’État.
Un droit à rémunération durant 50 ans
Pour finir, alors que la proposition de directive a fixé un droit voisin de cinq ans, les sénateurs PS préfèrent opter pour une durée de... 50 ans à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle de la première diffusion.
En imaginant un texte déjà voté, un exemple concret : lorsque l’AFP publie cette dépêche le 12 septembre 2018 pour rapporter les propos de son PDG, qui plaide, en bon lobbyiste, pour la reconnaissance d’un droit voisin au profit de l’AFP, l’agence disposerait d’un droit à rémunération jusqu’en 2069.


























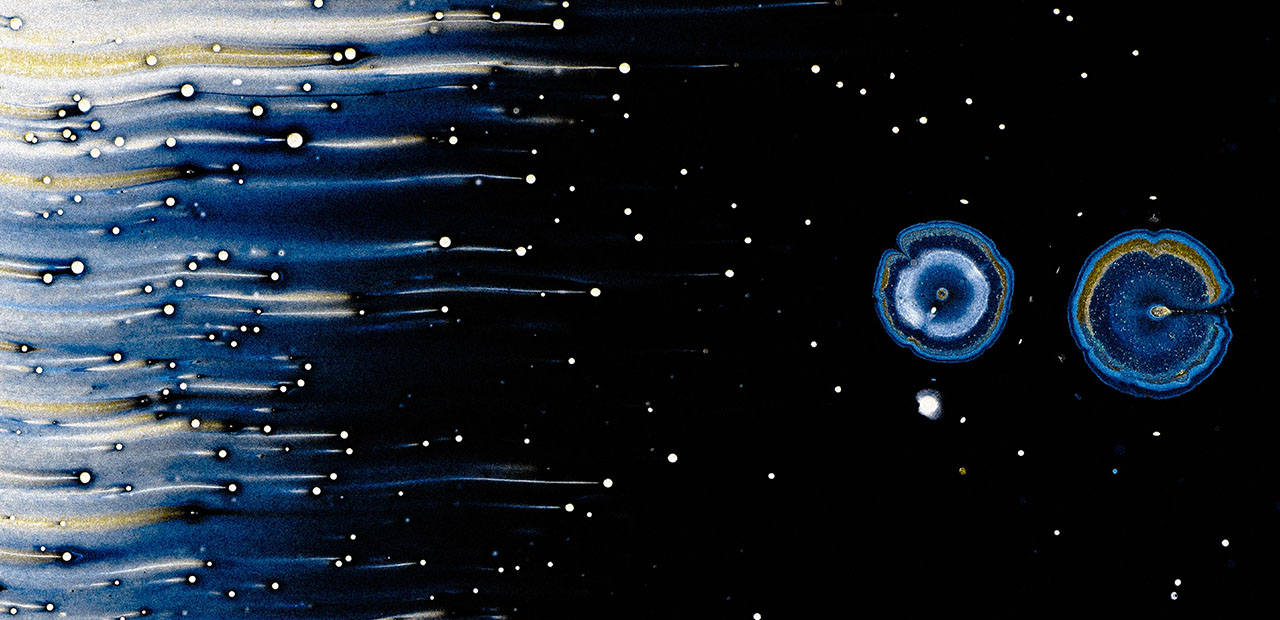


Commentaires (52)
#1
Ils joue petit, ils devrait demander une chronologie des infos comme la chronologie des médias. " />
" />
#2
Et pendant ce temps, 14 % des français se retrouvent avec 1 euro ou moins par jour pour manger.
#3
Est-il trop tard pour créer une société de gestion de droits sur les liens ? Next INpact pourrait-il consacrer un dossier sur les démarches à réaliser en ce sens ? Et devenir riche. Sans rien faire. " />
" />
#4
franchement Google devrait leur couper la chique pendant 1 semaine, juste pour voir.
#5
Sacem et cie doivent déjà avoir des projet prés à fonctionner sûrement.
#6
j’imagine que si NXI refuse d’être rémunéré contre les liens sur Google, les thunes iront aux autres?
magie de la gestion communiste collectiviste.
#7
#8
J’imagine presque tous les journalistes passé en statut d’auto-entrepreneur. " />
" />
#9
#10
Tiens, petite interrogation qui me passe par la tête:
Si l’on prend l’article et qu’on passe une moulinette pour changer certains mots par des synonymes et que l’on change certaines tournures de phrases, etc.
Est-ce que le texte qui en découle est lié au premier ou est une œuvre originale?
(ce qui me viens en tête par exemple c’est le bot tl;dr qu’on peut voir sur reddit)
#11
50 ans ce n’est pas la durée des droits patrimoniaux ?
#12
#13
source ?
#14
Sont petit joueurs, ils aurait dû faire commencer le chrono a partir de la mort de l’auteur " />
" />
#15
#16
en Europe, les droits patrimoniaux sont à 70 ans post-mortem.
50 ans après les faits, ce sont les droits voisins, on est en phase avec ce qui existe actuellement.
#17
OK donc rien de nouveau
Merci pour l’info
#18
Je propose un amendement pour le passer à 2500 ans. Tant qu’à faire n’importe quoi et créer ce genre de monstruosités, il faut aller jusqu’au bout.
#19
Petit joueur, avec l’homme augmenté on peut tabler sur la rémunération jusqu’à la fin des temps !
#20
#21
#22
#23
“« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits (…) et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images ». Cet accord prendrait donc la forme d’une convention d’une durée de cinq ans.”
Et après on va chouiner parce que trump met en l’air la neutralité du net, nous on va tronçonner les infos entre moteurs de recherche qui ont une licence et les autres…
Au fait ils font comment les agrégateurs de moteurs ?
#24
Grosso modo mon salaire de mi-temps, les fins de mois sont ric rac. " />
" />
#25
‘tain, c’est toujours aussi hilarant.
Mais si la musique ou l’image se prête à ce style de “système”, c’est parce qu’on écoute/regarde même longtemps après l’achat, voir racheter la même oeuvre sous un autre format.
Par contre, pour la presse, je me vois mal aller à la FNAC pour demander le journal “Le Parisien” de 1962 pour regarder le fameux article sur Ginette qui a la maitrise de la tartiflette dans son pays de Plouc-les-Oies.
Mettre une rémunération sur ça alors qu’à la base, le journalisme consiste à répandre sur tous les toits une information …
A quand le DLC “Journal TV” ?
#26
#27
Comment les moteurs de recherche vont faire la différence entre un site web écrit par un journaliste, donc soumis à rémunération, s’un site web normal à indexation gratuite ?
#28
#29
Si on demande l’application du droit à l’oubli sur un article on se retrouve avec une réversion compensatrice obligatoire à payer pour le manque à gagner ? " />
" />
#30
#31
Et pourquoi pas rétroactif sur 50 ans tant que nous y sommes ?
#32
#33
Le PS, ce vieux parti de rentiers bedonnants. " />
" />
#34
#35
N’importe quoi, les données de la banque mondiale donnent une population avec <1,9$ par jour à 0,0
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.DDAY?locations=FR
moins de 1€ par jour c’est déjà bien en-dessous du seuil d’extrême-pauvreté, dans les pays pas développés, alors je ne te dis même pas dans l’OCDE ce que ça serait.
#36
#37
#38
#39
Le seuil de pauvreté ne se calcule pas comme ça. Déjà les 14% c’est pour le seuil à 60% du revenu médian, donc c’est un peu plus de 1000€ (si on prend le seuil à 50%, on est autour des 900€ que tu cites, mais ça ne concerne ‘plus que’ 7-8% de la population)
Ensuite, le seuil n’est pas le même pour une personne seule ou une famille. 1000€, c’est pour une personne seule. C’est pas très large, mais ça reste gérable (comme beaucoup, je été dessous quand j’étais étudiant, c’était loin d’être la misère). Pour une famille (disons 2 parents 2 enfants de 10 ans), on applique une formule qui donne environ 2100€. Ce qui est p
Donc passer de 14% sous le seuil de pauvreté à ‘familles à moins de 900€’ c’est déjà très éxagéré.
L’enchainement à 14% des gens avec moins de 1€ par jour pour manger, c’est de la science-fiction (tu confonds peut-être avec ce qu’on appelle parfois le seuil de grande pauvreté, placé 1-2€ par jour pour vivre, mais qui est utilisé dans les pays non développés et ne concerne personne en France)
#40
#41
#42
Je sais pas où on va avec cette directive droit d’auteur, mais ça a l’air vraiment génial. On devrait même demander aux buralistes de payer une redevance car on peut lire les titres des journaux posés sur leurs étals et que ça ramène des clients qui dépensent forcément des fortunes en tickets à gratter et en barres chocolatées " />
" />
#43
Je faisais plus référence au fait d’être précaire qu’au statut d’AE. Mais tu fais bien d’apporter la précision " />
" />
#44
pour le coup, la directive (ie du parlement européen) ne sert que de paravent pour un délire bien français.
 " />
" />
Il me semble que la directive évoque des mots dans le même registre que “proportionné”. Faudra me dire à quel moment 50 ans ça parait “proportionné” pour de l’information.
#45
Oui c’est sûr que l’on sera probablement un des pays les plus touchés pas ce genre de délire.
J’imagine qu’ils pensent aux archives pour l’idée des 50 ans, choses qui ne sont consultées qu’assez peu par le grand public, et de toute façon on doit aller sur le site du journal pour lire l’article complet là aussi. Au final, y a toujours pas de perte du public au profit de Google etc…
#46
… la possibilité pour les éditeurs d’utiliser des techniques pour se couper des moteurs…
 " /> ) ne leur a pas traversée l’esprit, AV. de………” ?
" /> ) ne leur a pas traversée l’esprit, AV. de………” ?
 " />
" />
“c’est vrai ça…..pourquoi, cette idée (
(j”ai ma p’tite idée, mais bon……) !
#47
#48
#49
Cela, je n’en doute pas : ils sont en première ligne. Mais je crains qu’ils ne veuillent pas partager le gâteau avec de nouveaux entrants. Bref, je ne compte pas vraiment sur leur aide pour abaisser leur part du gâteau. " />
" />
#50
Les députés PS demandent 50 ans… Comme quoi les représentants de la “gauche caviar” n’ont pas encore totalement disparus.
#51
#52
Non, “on n’est pas en phase avec ce qui se fait actuellement”.
Proposer un droit de 50 ans sur un contenu par essence éphémère (“l’actualité”) est déjà une stupidité sans nom.
Quand on parle en plus d’un droit devant s’appliquer à la sphère numérique, où la vitesse d’évolution en technos et moeurs a un facteur 10 par rapport à la “vie réelle”, on tombe dans la crétinerie abyssale.
Le nec plus ultra, c’est quand on réserve ce doit à une population ciblée de personnes morales sous prétexte d’un status officiel qui impliquerait forcément la qualité des textes produits sous leur tutelle (haha), qui sont en plus subventionnés et rémunérés par la pub…
Alors que bon nombre de particuliers produisent des contenus plus intéressants, notamment parce que plus complets et plus réfléchis (genre mini-mémoires).
Ah, et, je passe sur le fait qu’à la base leurs contenus complets -aux journalistes- sont (comme ceux des particuliers sus-cités) d’ores et déjà protégés par le droit d’auteur classique, il faudrait juste qu’ils se bougent le cul pour faire bouger les lignes sur la cession automatique de droit “au forfait” du statut salarial.
On est dans l’escroquerie totale là : intellectuelle, morale, économique et (pour l’instant) légale.