Le projet de directive sur le droit d’auteur sera voté en commission des affaires juridiques les 20 et 21 juin. L’une des dispositions inscrite à l’article 13 suscite un déluge de critiques. Et pour cause, elle orchestre un filtrage des contenus sur les plus grandes plateformes en ligne, aux fins de protéger le tout puissant droit d’auteur.
C’est le 20 et 21 juin que la commission Juri du Parlement européen examinera le projet de directive sur le droit d’auteur. La commission saisie au fond a pour rapporteur Axel Voss, europodéputé PPE. Le texte est issu d’une proposition législative de la Commission européenne datant du 14 septembre 2016. Les ambitions initiales sont multiples : garantir un plus large accès aux contenus en ligne dans l'Union, mais aussi et surtout « favoriser un marché du droit d'auteur équitable et performant », expliquait en substance le Conseil économique et social européen.
Seulement, l’une des dispositions attise de nombreuses inquiétudes et espoirs, selon les bords. Comme exposé dans cet article ou cette émission de radio sur l’antenne de Cause Commune, l’article 13 vient poser les jalons d’un filtrage légalisé et généralisé sur les plateformes d’hébergement.
Le règne de l'autorisation, le filtrage au tournant
Avant tout, il pose qu’un acteur comme YouTube, parce qu’il réalise un « acte de communication au public », devra par défaut obtenir l’autorisation des ayants droit avant de donner accès à n’importe quel contenu.
S’il dispose d’une telle autorisation, l’accord noué avec les sociétés de gestion collective comprendra nécessairement un volet filtrage des contenus, outre une répartition de la valeur (value gap).
S’il ne dispose pas de cette autorisation, il ne pourra plus être qualifié d’hébergeur. Il aura donc une responsabilité directe sur la légalité des contenus mis en ligne par les tiers.
Toutefois, même sans autorisation, il pourra échapper à cette situation s’il supprime sans attendre les contenus notifiés tout en veillant à empêcher les réapparitions successives. Et donc initier une procédure de filtrage des contenus. De leur côté, les ayants droit seront astreints à remettre à ces acteurs le catalogue des empreintes pour que les filtres puissent jouer à plein régime. Sans cette fourniture, plus de responsabilité directe.
Une lettre ouverte signée par 70 personnalités d'Internet
Du côté du CSPLA, organe de conseil soufflant à l’oreille du ministère de la Culture, tout est déployé pour accentuer la responsabilité des intermédiaires. Outre des pressions pour revoir le statut du lien hypertexte, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique s’est vu remettre un rapport où l’article 13 est dépeint comme un « progrès réel », une proposition « équilibrée et réaliste au regard des intérêts en grande partie divergents des plateformes, des titulaires de droits et des utilisateurs ».
Pour les ayants droit, c'est la concrétisation d'un rêve, exprimé et poussé au ministère de la Culture depuis de nombreuses années. Avec cette fois, l'espoir d'une large application européenne.
Face à eux, les critiques sont bien plus aiguisées. En témoigne une lettre ouverte signée Vinton Cerf, Tim Berners-Lee, Bruce Schneier, ou encore Jimmy Wales, en tout soixante-dix personnalités de l’Internet. Ils décrivent le même article comme « un outil de surveillance et de contrôle des utilisateurs », une « étape sans précédent ». Ils dénoncent un mécanisme qui renverse la responsabilité sur les contenus hébergés, avec des coûts non neutres pour assurer ce grand nettoyage technique et une efficacité relative. « Si l’article 13 avait été mis en place lorsque les principaux protocoles et applications ont été développés, il n’est pas certain qu’ils existeraient aujourd’hui tel que nous les connaissons ».
Les critiques de Mozilla et Wikimédia France
De son côté Mozilla, signataire de la lettre, invite les citoyens de l'UE à appeler leurs députés européens pour « leur demander, qu’ils soient de simples particuliers, des scientifiques, des technologues ou des créateurs, de rejeter cette proposition ».
Selon Raegan MacDonald, Head of EU Public Policy chez Mozilla « si ces propositions étaient adoptées, l'UE ferait un pas en arrière en laissant passer une loi fragmentée et archaïque sur le droit d'auteur ». Pour Mitchell Baker, sa présidente, « en tant que créatrice, je soutiens les initiatives qui permettent aux créateurs d'être traités de façon équitable, mais je ne peux pas soutenir les filtres obligatoires pour la surveillance et la censure que l'article 13 autoriserait s'il était adopté ». Le texte n’est en effet pas réservé aux seuls contenus audio ou musicaux, mais concerne l’ensemble des œuvres sous droit d’auteur, dont les logiciels.
Pour Wikimédia France, les contenus « reconnus comme pouvant potentiellement enfreindre la loi seront automatiquement bloqués », avec le jeu de l’article 13. « Or la complexité du droit d’auteur, les différences entre pays et les exceptions au droit d’auteur ne peuvent être correctement appréhendées par des algorithmes ». L’entité anticipe un risque d’autocensure : « les plateformes opteront pour un principe de précaution en bloquant plus de contenu que nécessaire ce qui réduira la diversité de ces plateformes en empêchant les personnes peu aguerries aux nouvelles technologies d’y participer ».
Le curieux discours de la Quadrature du Net
La Quadrature du Net a une posture plus complexe. D’une main, elle dénonce des mesures « répressives et régressives », ajoutant que « la directive Copyright ne doit pas légitimer et généraliser ce solutionnisme technologique, automatisant nos relations sociales et traitant les humains comme de quelconques machines laissées aux mains de quelques entreprises privées ».
De l’autre, elle plaide néanmoins pour que les nouvelles obligations relatives au droit d’auteur « ne concernent que des hébergeurs qui hiérarchisent les contenus à des fins lucratives et qui atteignent un certain seuil fixé de manière claire ».
Disant cela, elle laisse entrevoir la possibilité de créer un troisième statut, bardé de nouvelles obligations, certes calibré pour frapper les GAFAM, mais en creux, désinciter les acteurs français à vouloir grossir. Elle plaide pour un régime d'exception, excluant les GAFAM du statut d'hébergeur.
Sur la prise en compte de la hiérarchisation, l’eurodéputé Jean-Marie Cavada, très opposé à Julia Reda, avait cosigné en 2017 un amendement à une résolution sur les plateformes en ligne qui disait peu ou prou la même chose. Il exposait que « les exemptions de responsabilité peuvent s’appliquer uniquement dans le cas de fournisseurs de services en ligne réellement neutres et passifs, et non pour des services jouant un rôle actif dans la distribution, la promotion et la monétisation des contenus aux dépens des créateurs ». Un amendement qu’on retrouve copié-collé pour les débats en commission Juri (numéro 379) autour de la directive droit d'auteur remaniée.
Détail plus piquant encore, le critère de la finalité lucrative nous replonge dans l’arrêt Tiscali du 14 janvier 2010. La haute juridiction avait décliné le statut d’hébergeur à l’entreprise au seul motif qu’elle avait placé des espaces publicitaires sur ses pages. Un arrêt certes rendu avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 sur le statut de l’hébergeur, mais qui fut utilement éclairé par sa rapporteure, une certaine Marie-Françoise Marais.




























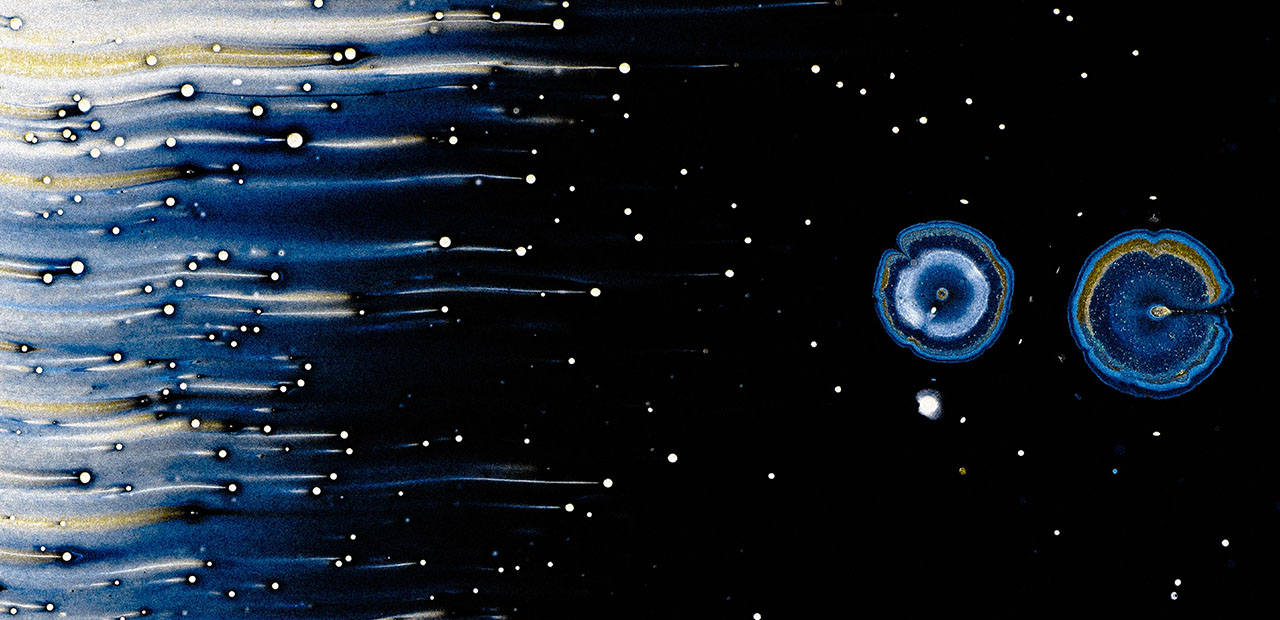


Commentaires (19)
#1
Nous commençons furieusement à ressembler aux Krells de Planète Interdite (mais de moins en moins intelligent, à trop être connectés à des futilités : “Sa va? oui et twa, quel tan il fait ché vou ? Tu ne connai pas la der n’ hier …..” " />
" />  " />
" /> " />
" /> " />
" />
#2
Je voulais dire par là, que certaines personnes ne savent plus qu’accepter sans broncher, sauf que le portefeuille ne suivra plus, à brève échéance. Mais ils restent accros comme la cigarette
#3
Ce qui acceptent sans broncher, n’ont pas de problème de portefeuille …
#4
#5
Un arrêt certes rendu avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 sur le statut de l’hébergeur, mais qui fut utilement éclairé par sa rapporteuse, une certaine Marie-Françoise Marais.
#6
Ca pourrait être rigolo… Parce que tout le monde serait logé à la même enseigne. Du coup, les politiques utilisant des trucs sans droit, ils risqueraient de prendre le deuxième effet kiss-cool dans la tronche sans comprendre et se faire censurer… Un peu comme Hadopi qui utilisait une police d’écriture sous droit d’auteur sans autorisation ou je ne sais plus quel parti qui avait utilisé une bande son de la même façon.
 " />
" />
Parce que mine de rien, à ce jeu, la citation d’auteur deviendrait un enjeu juridique et économique. Il y en aurait plus d’un qui pleureraient quand leurs discours se fassent sworder.
#7
Quelle connerie … ‘fin bref, habitué on vas dire …
Au lieu de filtrer à tout vas, il ferait mieux d’obliger les studios à mettre les moyens sur les plateformes légales.
L’autre jour, j’achète “Spectre” avec une copie digitale (cool donc, même si ça implique un DRM).
Je vais sur la plateforme pour récupérer le code => 1 seul fournisseur en France : Google …
Bref, je choisis, je vais sur Youtube et que vois-je ?
La qualité MAXIMALE est 480p. Une résolution PIRE que le DVD et dont la TNT surpasse déjà allègrement.
Quel foutage de gueule …
#8
#9
Il est clair que les petits hébergeurs n’auront pas les moyens financiers pour filtrer, et quand bien même : un hébergeur n’a pas vocation à jouer à la Stasi, en devenant complice à part entière du IVè Reich bruxellois.
Et dire qu’il suffirait d’un Frexit pour arrêter net toutes ces conneries liberticides.
#10
#11
#12
#13
Récolté au doigt, moulé à la louche… C’est pas le Saint Vergeron ?
 " />
" />
/dredi_toussa
#14
ACTA, PIPA, toussa… Retour à la case départ.
 " />
" />
#15
Tssss … j’ai une excuse : je lisais la jaquette pendant l’écriture du comm’ !
#16
@the_frogkiller
Personne n’est dupe sur les traîtres passés par la French American Foundation, qui n’ont cessé de vendre la démocratie et la souveraineté de la France à l’oncle Sam. Cela étant, ça fait 10 ans qu’Asselineau a créé son parti pro-Frexit, et cela fait 10 ans qu’il est, comme par hasard, interdit de grands médias par le système totalitaire en place et son toutou du CSA. L’an passé, 99% des français ont intrinsèquement voté pour l’UE, donc pour continuer à développer le système totalitaire bruxellois, au détriment de l’état nation France, qui est en train de se faire lacérer de tous les côtés. On trouve même encore des cons qui continuent de vocifèrer contre le Brexit de nos voisins, mais qui se tournent les talons quand on leur fait remarquer que l’économie britannique, loin de s’effrondrer, s’est déjà améliorée. Et ce n’est que le début !
#17
#18
#19