Aujourd’hui l’Assemblée nationale a débuté l’examen en séance de la proposition de loi contre « les fake news ». La séance reprendra à 21h30 ce soir. Malheureusement, plusieurs informations alternatives à la vérité ont déjà été distillées par la ministre.
Plus de 200 amendements sont sur le bureau des députés pour cette locomotive parlementaire examinée au pas de course, sous procédure accélérée.
Dans ses wagons, une transparence accrue des plateformes sur les sources de financement des campagnes de publicité, une action en référé pouvant déboucher sur le blocage des sites durant les campagnes électorales, outre de nouveaux pouvoirs pour le CSA sur les intermédiaires techniques. Et même, selon la volonté de plusieurs élus LREM, une possible labélisation des sites de presse, qui seraient surexposés sur Internet grâce à une signalétique aux petits oignons.
Aujourd'hui, lors de la présentation du texte et des premiers échanges, plusieurs vérités disons « alternatives » ont néanmoins été prononcées au micro de la séance, oscillant entre l’erreur, l’imprécision, voire un arrangement avec la vraie vérité vraie. Un comble…
Un exemple un peu subtil, mais important : Françoise Nyssen a vanté un texte protecteur de la liberté d’expression. Et pour cause, « des conditions cumulatives très précises encadrent l’intervention du juge : l’information devra être manifestement fausse et de nature à altérer la sincérité du scrutin, diffusée de manière massive ; et diffusée de manière artificielle, "ou automatisée", comme votre commission l’a ajouté ».
L’adverbe « manifestement », inspiré par le cadre de la LCEN, laisse entendre que le texte est calibré pour frapper l’information dont la fausseté sera évidente. Seul hic, on ne le retrouve pas dans le marbre de la proposition de loi. S’il passe en l’état, la fausse information sera en effet définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable ».
Un texte qui vient du parlement. Vraiment ?
Alternant la gifle et la caresse, la même ministre de la Culture a fustigé ceux qui « répandent des mensonges et des théories complotistes en imitant les codes de l’information professionnelle, en s’appuyant sur des médias entrés dans le quotidien de nos démocraties : Facebook, Twitter, Google… ». Des « tentatives de camouflage, de banalisation [qui] ne doivent pas nous tromper ». En contraste, elle a salué un texte à « la hauteur de l’enjeu », qui « vient du coeur de la démocratie : il vient du Parlement ».
Du Parlement ? Selon nos sources, le texte déposé par les députés LREM a en réalité été concocté, peaufiné, mitonné par ses services, rue de Valois, avant d’être travesti en proposition de loi. Avantage conséquent : il a pu faire l’impasse sur l’étude d’impact annexée en principe à tous les projets de loi, tout en bénéficiant de ce joli sceau démocratique.
La presse professionnelle pas concernée. Vraiment ?
La locataire de la Rue de Valois, encore elle, a voulu rassurer : « En aucun cas, les articles de presse professionnels ne seraient concernés », par cette législation en gestation.
Un amendement de la Gauche Démocrate et Républicaine avait été déposé en commission des lois pour sanctuariser justement ces professionnels de l’information, considérant que « les sites de presse en ligne pourraient être visés par cette nouvelle procédure ».
Le texte a été défendu par Elsa Faucillon mais Naïma Moutchou, rapporteure pour avis en commission des lois, s’y est victorieusement opposée : « Je ne pense pas que nous puissions faire d’exemption en dur, comme vous le prévoyez ici, madame Faucillon, car cela risquerait d’exclure certains médias – ou qui se disent médias – extrêmement peu scrupuleux, notamment des médias étrangers ». En clair, les médias sont bien concernés, dixit l’élue LREM qui ne veut pas d'un tel îlot de protection.
Twitter vend des followers. Vraiment ?
Toujours dans son discours, Françoise Nyssen a vertement dénoncé les plateformes numériques, qui « ne jouent pas pleinement le jeu de la démocratie aujourd’hui ». Selon ses connaissances, « leur modèle contribue à une gigantesque économie de la manipulation. Elles vendent des "likes" et des "followers" à tous, même aux émetteurs de fausses informations. Pour 40 euros, je peux acheter 5.000 abonnés sur Twitter ».
Là encore, le lyrisme culturel a fait des victimes pour déboucher sur une réalité exotique. Twitter ne vend pas de followers. Au contraire, les conditions du réseau social interdisent vigoureusement de telles pratiques : « Twitter interdit formellement l'achat et la vente d'interactions de compte sur sa plateforme. Lorsque vous achetez des abonnés, des Retweets ou des J'aime, il s'agit généralement de (faux) comptes robotisés ou de comptes piratés. Tout compte s'adonnant à de telles pratiques enfreint les Règles de Twitter et risque d'être suspendu ».
Des plateformes qui s'autorégulent seules. Vraiment ?
La ministre enfin, s’en est pris encore et toujours aux plateformes numériques qui, seules, « échappent aux règles aujourd’hui. Elles s’autorégulent. Elles sont les seules arbitres du vrai et du faux. Ce n’est pas acceptable ». À supposer de faire l’impasse sur l’épaisse législation qui encadre les intermédiaires, affirmer que les plateformes sont les seules à s’autoréguler n’est pas une vérité vraie.
Le ministère de la Culture le sait bien : il a lui-même ouvert ses portes pour réunir acteurs du paiement, de la publicité et sociétés de gestion collective afin de couper les vivres des sites que ces derniers considèrent comme illicites. Ces mesures sont gérées par ces seuls acteurs privés. Impossible par exemple d’obtenir le moindre espace de transparence sur le terrain des règles de la loi CADA, alors même que ce trio dispose d’un droit de vie et de mort sur les hébergeurs.
Les débats reprennent à 21H30.



















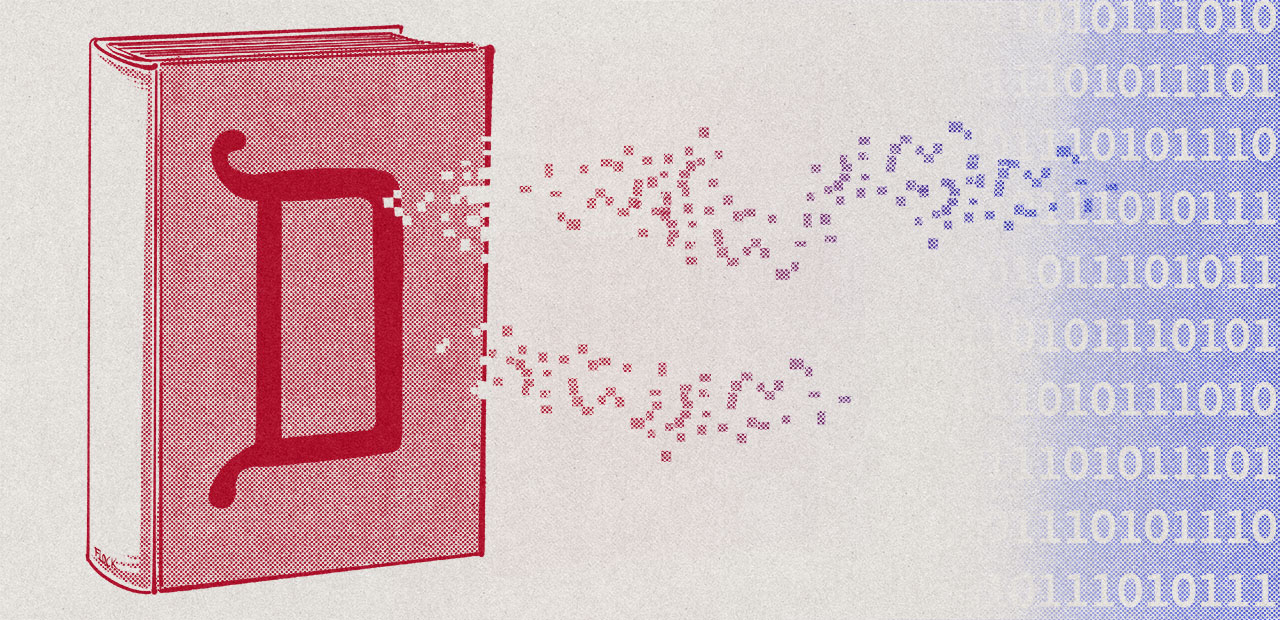
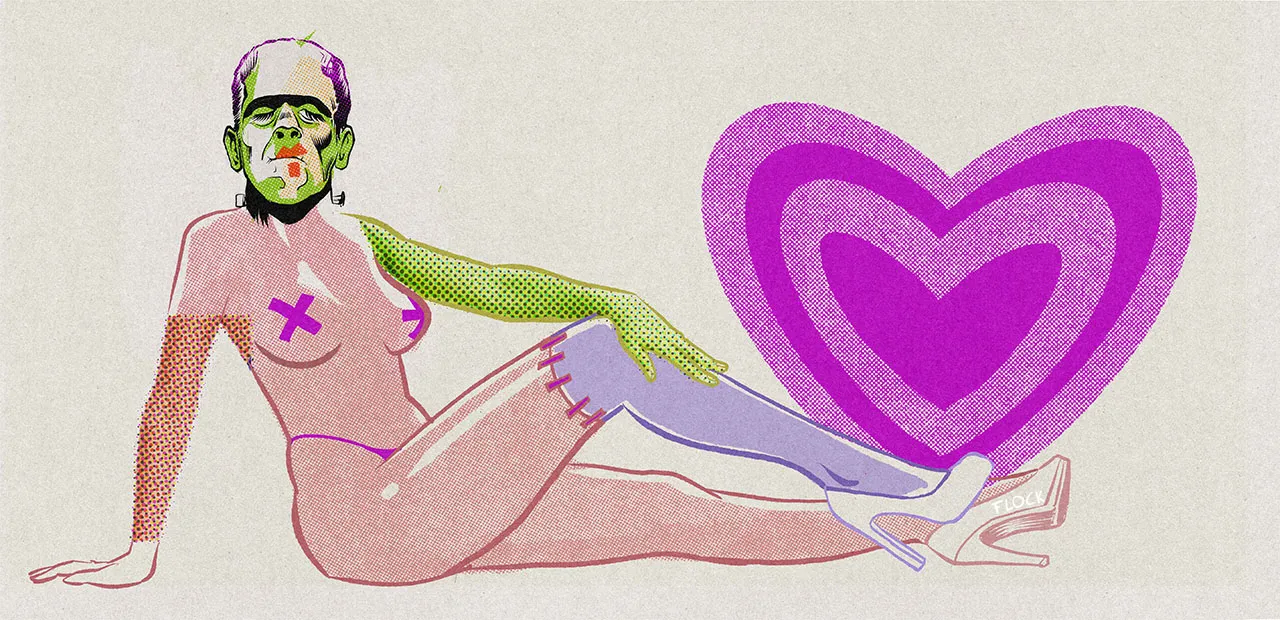
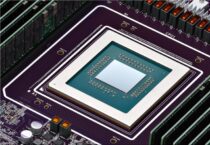






Commentaires (48)
#1
Le fait même qu’un texte aussi important avec un tel risque passe en procédure accélérée est l’expression même du déni de démocratie.
Une bonne loi ne craint pas d’être étudiée avec une procédure normale.
#2
Françoise Nyssen sait elle de quoi elle parle et cherche à noyer le poisson ou elle est là, seulement pour la tapisserie ?
#3
Du coup, si ce qu’a dit Françoise Nyssen est un fake, est-ce que ça ne devrait pas bloquer de fait sa proposition de loi ?
#4
#5
Avec cette loi l’état veut garder son monopole de la fake news " />
" />
 " />
" />
“Sadam tue des bébés dans des éprouvettes”
#6
Toujours aussi fort dans les débilités " />
" />
 " />
" />
 " />
" />
L’État français aurait prétendu la phrase entre guillemets ?
(jamais entendu parler en plus)
Les “fake news”, c’est essentiellement les extrêmes qui les propagent, ça n’a rien de nouveau.
(j’ai dit “essentiellement”, pas “uniquement”)
#7
Mais au final, c’est défini comment une fake news?
#8
Si ça peut éviter que la France insoumise nous inonde de news inventant des étudiants blessés par la police, comme elle en a l’habitude, ce sera toujours ça de pris sur cet organe de désinformation massive.
#9
On ne combat pas les fake news en les interdisant et/ou en les bloquant (j’ai l’impression de revoir la problématique du téléchargement illégal). Le résultat est connu d’avance : cela renforcera les théories complotistes et autres … et au final ces fake news … Il existe d’autres solutions plus longues à mettre en œuvre, sans doute plus cher, mais qui auraient un impact réel à long terme. Encore une fois, on nous pond une loi dont la cible n’est pas celle que l’on croit … du moins c’est mon sentiment. J’ai hâte de voir l’impact qu’elle aura sur les médias traditionnels et sur notre liberté d’expression.
#10
#11
Le humanistes est leur fantasme de vérité à travers le fantasme de vérification, on pas faire plus ridicule.
#12
A mon avis, le blougiboulga de la ministre met en lumière que c’est principalement le soft power de la Russie qui est visé (médias étrangers, réseaux sociaux), ce qui rend le recours à la loi d’autant plus maladroit. L’effet sur la cible sera faible et les dommages collatéraux seront peut-être bien plus puissants.
#13
Un vraie éducation au numérique, apprendre à analyser les sources, mais c’est plus simple de pondre une nouvelle loi. C’est facile, c’est pas cher, ça prouve que l’on existe et ça n’engage à rien.
#14
Ils auraient dû commencer par une loi qui colle des amendes automatiques (avec des petits tickets qui sortent du mur comme dans demolition man) aux membres du gouvernement ou aux élus qui mentent ou déforment la vérité…
#15
Dès qu’on touche aux sacro-saints journalistes (intouchables pour quelle raison divine ?), ouille, ouille, ouille.
 " />
" />
Next-INpact ne fais donc pas exception … Dommage
#16
#17
Y’a besoin d’une éducation spéciale au numérique?
Développer l’esprit critique serait à mon avis plus pertinent. Ya pas que sur le numérique qu’il y a de l’information (vraie ou fausse, bonne ou mauvaise)
#18
#19
Alors comme ça, le ministère de la culture revient aux fondamentaux et se réclame quasi ouvertement « de l’information ». Pourquoi pas, mais quel référent sommes-nous supposés utiliser ?
 " /> inside
" /> inside
 " /> (je suis déjà sorti)
" /> (je suis déjà sorti)
Le ministère de l’information d’André Malraux, ou bien celui de Pierre Laval ?
#20
Dès que l’on touche à la neutralité du net aussi. Et quand ca parle Ayants Droits.
Bref NXi a ses convictions et les défend.
Et cette loi ne concerne pas que les journalistes, mais aussi les plate-formes, tous les auteurs, les lecteurs.
Et vu qu’elle vise spécifiquement les periodes électorales, peut-être aussi la démocratie, donc c’est peut-être pas mal d’y faire attention.
#21
Un article se basant sur aucune étude mais seulement sur des préjugés rentrent dans les fake news ? " />
" />
#22
Pas nécessairement, il suffira d’y déclarer le texte publié comme une nouvelle. Après tout, la nouvelle est un support littéraire ma foi très classique, un court récit de fiction en prose relativement proche du conte.
Ce qui est interdit, je pense, c’est de prétendre à la Vérité (que chacun sait ne pas exister). La Vérité est du ressort exclusif (mais « délégable ») du MiniVer.
#23
Du Parlement ? Le texte déposé par les députés LREM a en réalité été concocté, peaufiné, mitonné par ses services, rue de Valois, avant d’être travesti en proposition de loi. Avantage conséquent : il a pu faire l’impasse sur l’étude d’impact annexée en principe à tous les projets de loi, tout en bénéficiant de ce joli sceau démocratique.
Sources ?
Je vais me faire l’avocat du diable, mais je ne vois aucune source pour cet article. Et si la source c’est NI, il convient d’apporter la preuve de ce que vous avancez :/
#24
#25
Je rappelle que ceux qui nous pondent ce texte sont les premiers émetteurs de fake news, et empêchent le légitime accès aux médias à l’UPR et ses 31000 adhérents depuis plus de 10 ans. Et à mes détracteurs du forum, qui oseraient prétendre le contraire, je leur rappelle également qu’Asselineau n’a plus eu droit à la moindre apparition dans les grand médias du CSA depuis la fin du 1er tour de la dernière présidentielle.
Cela s’appelle de la censure, et cela est la signature même d’un état totalitaire, qui ne supporte plus la vérité et la libre circulation des informations.
C’est également se foutre “manifestement” de la gueule des français, que de prétendre faire le tri des infos au nom d’un soit-disant manque de discernement du grand public. Réveillez-vous : ces gens là vous traitent ouvertement de cons !
Nous sommes déjà dans un état totalitaire, où l’on interdit aux opposants politiques de s’exprimer. Avec ce texte, on ferme définitivement les portes aux eurolucides, en boycottant leur seul moyen d’expression qu’est l’internet et les réseaux sociaux. Et comme par hasard, juste au moment des élections…
Non franchement : vous n’avez pas encore compris qui est visé en arrière plan, où vous ne voulez pas comprendre ?
#26
Après une recherche rapide, j’ai trouvé un article l’express. Il explique comment, au moment où la proposition de loi était publiée, la ministre s’est exprimée pour en expliquer les grandes lignes.
#27
Donc un professeur qui raconte des conneries fondées sur rien a longueur de temps, ne pourra plus publier sans dire que c’est une fiction ?
#28
#29
#30
Merci, je n’ai pas fait de recherche parce que ça ne m’intéresse pas, très honnêtement. Et puis je suis habitué à voir des articles dire des choses sans sourcer ou sans prouver. Exemple de l’article de l’Express que tu as mentionné :
Le texte a déjà été rédigé par l’Elysée d’après certains médias, par le cabinet de la ministre selon d’autres
Aucune source. “Certains médias”, même dans un commentaire YouTube, ça passe moyen comme argumentation :p
Par contre, ce qui aurait été sympa c’est de voir s’il y a eu un (ou des) journaliste qui a fouillé un peu. On aurait eu deux issues : soit on peut prouver que la proposition de loi est un paquet pré-conçu remis aux députés LREM (ou pas), soit on ne peut pas. Le deuxième cas est intéressant, ça montrerait qu’en ne sait foutrement rien de ce qui fait les lois, et comment ils les font.
#31
#32
Le secret des sources est primordiale, et ce n’est pas du tout ce que je remets en question. Ce que je te reproche, c’est la forme. Tu aurais pu (dû) mentionner la source de ton affirmation, tout en la protégeant, en disant, par exemple : « selon nos sources » (ou autre formule consacrée).
Sans ça, ton propos a beaucoup moins de force. Et c’est bien dommage, parce que, moi je crois ce que tu dis (je suis même persuadé que c’est vrai) mais c’est peut-être pas le cas de tout le monde. Sans mentionner tes sources, ton article est proche (pas identique à) de celui de l’Express mentionné plus haut, c’est à dire, en toute honnêteté, d’un torchon qui relaye des ragots.
Voilà, c’était la petite critique de l’internaute anonyme dans les commentaires. Je suis content que tu ais répondu à mon précédent message, au moins je sais d’où vient le propos : une source anonyme. Et je respecte ça :)
#33
Euh… ta réponse est puérile, là.
Faut pas prendre la mouche pour si peu… Évidemment, si j’avais voulu trouver des sources de ce que tu avances dans ton article, je les aurais trouvé. Mais c’est pas le sujet, et j’en ai de toute façon vraiment rien à secouer, de la source (puisque je te crois).
Bref. Bon courage pour la suite.
#34
#35
#36
Bah voyons …
Ne pas voir le risque d’une telle loi c’est faire preuve d’une totale naïveté,désolé.
On pense toujours que la loi ne va s’appliquer qu’aux cas qu’on a utilisé pour la justifier, sauf que non, la loi s’applique dans toutes les situations où elle est applicable.
Et à votre avis, qui dira au final si un fait est vrai ou pas ? Les politiques ? les juges ? les scientifiques ? La science ?
Si je dis que les vaccins sont sans risques en tant que scientifique alors que des juges ont déjà rendu des jugements liant accident du travail et obligation de vaccination est-ce que je tombe sous le coup de la loi ? qui aura raison ?
Actuellement la loi ne s’appliquera quand période électorale, mais qui dit que ça va rester ainsi ? De plus si je reprend mon exemple, imaginons un politique qui surfe sur la vague anti-vax pour obtenir des voix, qui aura raison dans tout ça ? Ne parlons pas du réchauffement climatique par exemple.
Bordel cette loi est la porte ouverte à tout et n’importe quoi, notamment niveau censure et auto-censure. Et ça ne changera rien à la situation. Le seul moyen de la changer c’est d’investir dans toutes les formes d’éducation et à tout niveau.
(le pire c’est que c’est les politique eux meme qui sont les plus fournisseurs d’information erronées)
#37
Encore une fois, très sincèrement, bon courage !
#38
Petit rappel. Et je suis sérieux : 5 h (ou un peu plus) n’est pas un temps de repos suffisant.
#39
#40
#41
En terme d’éléments concrets montrant la forte implication du gouverment dans la rédaction du texte, la ministre de la culture s’est exprimée à la radiosur ce texte.
Certes, c’est france inter qui parle de “projet de loi”, mais c’est étrange qu’une ministre s’exprime sur un texte qui est finalement discuté comme une proposition de loi.
#42
La politique continue de m’attrister… bah on va faire avec, comme d’hab. Mais qu’ils ne comptent plus sur moi pour cautionner tout ça en me repointant à un bureau de vote.
#43
Quand j’ai rédigé ma thèse, sur la fin je faisais 20h de rédaction/jour (sur 2 semaines) et même une journée de 26h.
La secrétaire de mon labo m’a fait une réflexion à la con, t’imagines pas comment je l’ai remise à sa place (sachant que c’est pas mon genre et qu’il en faut bcp pour m’énerver). Meme si ma réponse en elle meme était justifier (la personne n’avait pas fait son taf et me demander de le faire à sa place …) la manière ne l’était pas vraiment.
Moralité, dormir c’est bon pour les l’entourage aussi ;)
(et au passage merci pour le suivi de ce projet de loi)
#44
J’en suis à me poser sérieusement la question aussi.
 " />
" />
En plus de part mon travail, j’en suis meme à me demander si je n’en profiterai pas pour partir définitivement
#45
Contre les fake-news, rien de tel qu’un pare feu openoffice.
#46
@mizuti
Votre fake news côté chiffres ne trompera personne - à part bien entendu ceux qui soutiennent le système totalitaire que j’ai dénoncé plus haut. Selon RTL, 0,92% des votes à la présidentielle, c’est 332588 voix (sourcehttp://www.rtl.fr/actu/politique/resultats-election-presidentielle-2017-francois…
C’était bien essayé, et cela prouve à quel point la mauvaise foi évidente de certains ici dépasse très largement le cadre de la simple bêtise.
#47
Superbe article et enquete qui remet Francoise a sa place (dans la categrotie “clown”).
Ca change de la niaiserie, la moraline et le travail superficiel de la plupart des medias biberonnes aux subventions etatiques…
#48
https://www.youtube.com/watch?v=F011hLZHZrM