Ces dernières années, la montée en puissance des plateformes a poussé à scruter les problématiques de la presse, surtout dans leur dimension numérique. Pourtant, les questions de distribution et de dépendance à des tiers se posent aussi dans le monde physique.
Si l'on parle souvent de la diffusion de l'information dans le monde numérique, qui se concentre autour de plateformes gérées par des géants américains, le monde physique connait aussi ses dépendances.
Dans le secteur de la presse, il tient notamment à la distribution au numéro chez les marchands de presse. Outre les abonnements, il s'agit d'une source de revenus, de diffusion et de mise en avant, importantes pour les journaux et magazines. Et son acteur principal, Presstalis (ex-Nouvelles messageries de la presse parisienne, NMPP), est en crise.
Une crise profonde qui, sans être nouvelle, commence à toucher plusieurs éditeurs au portefeuille, notamment les indépendants. De quoi remettre en question leur viabilité économique, parfois fragile ? Pour le savoir, retour sur près de 20 ans d'évolution et de sauvetage.
Notre dossier sur la crise de Presstalis, de la loi Bichet à Canard PC :
- La diffusion de la presse n'est pas qu'un problème du numérique, malgré la loi Bichet
- Presstalis promet le retour aux bénéfices en 2019, mais cette fois « les chiffres sont fiables »
- Canard PC nous détaille sa situation difficile, renforcée par la crise de Presstalis
En France, une distribution au numéro organisée par la loi Bichet
La distribution de la presse est organisée en France à travers la fameuse loi Bichet (n° 47-585) du 2 avril 1947. Elle dispose que « la diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet ».
Celle-ci avait pour principale préoccupation d'organiser la pluralité de l'information et l'égalité entre les éditeurs après la guerre. Elle vise également à permettre une mutualisation des moyens de distribution, détenus par les éditeurs à travers des coopératives, mais au service de tous et de manière impartiale. C'est elle qui permet à n'importe quel titre d'être diffusé dans l'ensemble des marchands de presse, sans refus possible.
Ce qui a poussé certains à réfléchir un temps à une éventuelle transposition dans le domaine du numérique, pour contraindre les plateformes à assurer une plus grande transparence et une neutralité dans leurs relations avec les acteurs de la presse. Sans succès pour l'instant.
La loi Bichet a instauré le Conseil Supérieur des Messageries de Presse (CSMP) qui doit veiller au bon fonctionnement du secteur et à son impartialité. Ce dernier détaille sur son site l'organisation des différents acteurs de la distribution, des coopératives aux diffuseurs, et leurs missions.
Elle dispose dans son article 2 que « le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse » dont l'objet « est limité aux seules opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques, édités par les associés de la société coopérative » (article 4).
Elles peuvent confier « l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales » mais pour cela « elles devront s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités ».
Le capital social de ces coopératives ne peut être souscrit « que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) avec la société ». À l'inverse, elles ne peuvent refuser un titre, excepté s'il a donné lieu à certaines condamnations :
« Devra être obligatoirement admis dans la société coopérative tout journal ou périodique qui offrira de conclure avec la société un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) sur la base du barème des tarifs visé à l'article 12 ».
Un secteur avec peu d'acteurs
Ainsi, il existe en France trois coopératives de messagerie où se sont regroupés les différents éditeurs : la coopérative de distribution des quotidiens, la coopérative de distribution des magazines et les Messageries lyonnaises de presse (MLP). Les deux premières ont confié leur distribution à Presstalis et, conformément à la loi Bichet, elles en détiennent le capital à hauteur de 75 % et 25 %, respectivement.
Selon le CSMP, en 2016, Presstalis représentait « 49,1 % de la vente au numéro de la presse magazine, 100 % de la vente au numéro de la presse quotidienne nationale. Elle met en circulation plus de 2 400 titres, quotidiens, hebdomadaires, mensuels ... en France mais aussi dans une centaine de pays. Elle distribue les titres de 372 sociétés éditrices adhérentes au 31 décembre 2015 ». C'est pourquoi sa situation impacte tant le secteur.
De leur côté, les MLP « représentent 29 % de la vente au numéro de la presse. Elles mettent en circulation plus de 2 200 titres et regroupaient 514 éditeurs/sociétaires à fin 2016 » selon le CSMP.
Une situation avec précédents
Si Presstalis est sur le devant de la scène aujourd'hui, il faut savoir que la société rencontre des soucis depuis plusieurs décennies. Elle a déjà fait l'objet de nombreuses critiques, rapports et autres plans de restructurations, sans que l'on arrive à éviter la situation actuelle.
Elle est issue des Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), créées le 16 avril 1947 et qui faisaient déjà état de déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros il y a 20 ans. Dès 2000, Jean-Claude Hassan alertait sur « une réforme nécessaire, pour la pérennisation d’une solidarité profitable à tous » dans un rapport remis au ministère de la Culture.
Dès 2002, une aide à la distribution de la presse quotidienne IPG est créée par le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 afin de tenter de compenser les coûts élevés, et structurellement déficitaires de la distribution de ces journaux. Depuis, elle a été régulièrement revalorisée, comme nous le verrons un peu plus loin.
Deux ans plus tard, dans le cadre du Projet de loi de finances de 2005, le Sénat publiait un bilan de la situation des NMPP qui détaillait une situation financière « préoccupante », notamment dans la branche quotidiens. Ce, malgré des aides de l'État déjà importantes. Les accusés étaient alors l'érosion des ventes, la baisse des barèmes de rémunération ou l'insuffisante baisse des charges.
Un plan de restructuration était alors mis en place, qui devait permettre un retour à un résultat d'exploitation global positif, et une réduction des pertes pour la branche quotidiens à 26,7 millions d'euros d'ici 2007. Mais voilà, fin 2007, un certain Rémy Pflimlin, alors Directeur Général des NMPP, indiquait que la société finirait l'année dans le rouge après une perte de 3 millions d'euros en 2006.
2008 était alors présentée comme l'année du redressement, grâce à un plan de modernisation « Défi 2010 » de 130 millions d'euros lancé face à « une situation financière qui se dégradait, des points de vente en baisse, de mauvaises conditions de vente et une offre pléthorique ».
Le tout financé par Lagardère (alors actionnaire à 49 %), une augmentation des aides de l'État et les éditeurs. Le centre de traitement de Combs-la-Ville était fermé, 350 emplois supprimés. Il était alors question d'une « économie » totale de 40 millions d'euros par an.
Presstalis : bientôt 10 ans de restructuration
Fin 2009, les NMPP devenaient Presstalis. L'occasion pour Rémy Pflimlin de présenter le nouveau siège qui devait permettre une économie supplémentaire de 6,5 millions d'euros par an et d'être rassurant sur l'avenir. Chiffre d'affaires attendu pour 2009 ? 300 millions d'euros, en baisse de 25 % depuis 2004, pour 5 à 10 millions d'euros de pertes.
Mais Rue89 publiait dans le même temps un compte-rendu d’un conseil d’administration de la CPP, alors l'une des plus grosses coopératives au sein des NMPP. Il y était question d'un cap difficile à passer à l'été 2010, et d'un déficit d'au moins 17 millions d'euros. Nos confrères rapportaient que Jean-Paul Abonnenc, Président de la CPP, voyait « trois voyants au rouge » : l’exploitation, les fonds propres et la trésorerie.
Il rappelait alors « la nécessité de reconstituer les fonds propres de l’entreprise d’ici un an » sans quoi la question du dépôt de bilan, suggérée par certains, allait se poser. Outre les mauvais chiffres de vente, l'explosion des dépenses était également pointée du doigt, particulièrement un recours aux CDD et heures supplémentaires, avec un excédent de 3,9 millions d'euros par rapport au budget de l'époque.
En avril 2010, le rapport Mettling de l'Inspection Générale des Finances remis à François Fillon (alors Premier Ministre) vient souligner « une urgence » découlant d'un déficit structurel, nécessitant une réduction des coût mais également un ajustement des barèmes. Le retour à des chiffres plus positifs est alors évoqué pour 2011, avec un plan de « refondation » estimé à 125 millions d'euros, dont 90 à financer.
Le rapport précisait que « le sauvetage de Presstalis n'aura pas d'effet durable si les difficultés qui ont conduit à la situation actuelle se reproduisent ». Le mode de gouvernance était alors critiqué. Un accord est trouvé le 26 mai et comprend :
- Le versement d’une aide exceptionnelle de l’État de 20 millions d’euros ;
- La majoration de l’aide à la distribution de 11 à 18 millions d’euros ;
- Une augmentation de capital par les éditeurs à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires et revalorisation des barèmes ;
- Un refinancement à hauteur de 46 millions d’euros de Presstalis par Lagardère et la sortie du capital de l’entreprise.
De son côté, Presstalis s'est engagé sur un plan d’urgence en juin 2010, axé sur une réforme industrielle, en particulier la filliale en charge de la région parisienne (SPPS) et un plan de départ d’environ 210 personnes. C'est également à cette période que les deux coopératives actuelles (PQN et Magazine) se sont formées, Lagardère cédant pour 1 euro symbolique ses 49 % (les 51 % étant déjà détenus par les coopératives).
2011 : autorité de régulation et nouvelle direction
Après un an en tant que directrice générale, Anne-Marie Couderc prend la présidence de la société et remplace Jean de Montmort, en poste depuis 1993. Vincent Rey devient directeur général. Tous deux resteront six ans, jusqu'à l'explosion de la crise de 2017.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) est instaurée par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011. Elle vient compléter la CSMP introduite avec la loi Bichet, dont la composition est modifiée au passage. Elle intervient lorsque la procédure de conciliation devant le CSMP échoue, et rend exécutoires les décisions de ce dernier.
Le début d'une nouvelle ère ? Pas vraiment. Le tribunal de commerce de Paris désigne un mandataire judiciaire, le mandat sera prolongé jusqu'à l'année suivante. En mars 2012 Le Figaro nous apprend que des problèmes de trésorerie « menacent la mise en œuvre de sa restructuration », Presstalis peinant « à boucler ses fins de mois ». Ce malgré de nouveaux plans de réduction des coûts et de restructuration.
Tribunal de commerce, grève et accord tripartite
Solution envisagée à l'époque : « demander de conserver plus longtemps le produit des ventes qui doit remonter aux éditeurs afin de s'assurer un fonds de roulement », en plus d'une réduction du personnel. Le départ de 1 000 salariés sur 2 500 était alors évoqué, soit 40 % des effectifs. De quoi impliquer une réorganisation importante du réseau de dépositaires, avec une cession de certains dépôts à MLP, et causer le mécontentement des employés. Une grève se tient pendant l'été.
Cela n'empêche pas un nouvel accord tripartite d'être entériné, dont le volet financier était bouclé le 5 octobre 2012, devant permettre à Presstalis d'assurer sa survie. Un plan de 230 à 250 millions d'euros, financé par une hausse des barèmes, une augmentation de capital ou encore l'État.
Cette fois il était question d'une aide exceptionnelle à la distribution de 5 millions d’euros en 2012 et de 10 millions d’euros en 2013, un prêt de 20 millions d’euros du fonds de développement économique et social (FDES) et une garantie en trésorerie des gains de la réforme industrielle de Presstalis en 2014, à hauteur de 57,2 millions d’euros.
Mais la situation s'était tendue, d'autant qu'il était finalement question d'un plan de départ de 1 250 personnes, poussant le Syndicat général du livre et de la communication écrite CGT (SGLCE-CGT) à la grève et à un conflit assez dur, d'une trentaine de jours. L'emploi et les syndicats étaient d'ailleurs à l'époque le principal problème pointé par certains. En février 2013, le Figaro écrivait ainsi :
« La clé du problème est simple. En dix ans, le volume de journaux à acheminer chaque jour a diminué de 25 %. Or, dans le même temps, les effectifs de Presstalis sont restés constants. Ce qui explique que l'entreprise creuse chaque année ses pertes. Aucun gain de productivité n'a été fait. Ainsi, depuis la modernisation des imprimeries, le comptage des paquets de journaux se fait automatiquement. Mais il y a toujours des employés de Presstalis pour regarder passer ces paquets toute la nuit !
Presstalis multiplie les plans de départ depuis des décennies. Il y en a eu en 1994, 2000, 2004, 2007 et donc en 2013. Les précédents plans, financièrement extrêmement généreux, permettaient à leurs bénéficiaires de partir avant l'âge de la retraite, tout en restant payés par le groupe. Du coup, la pyramide des âges chez Presstalis montre aujourd'hui une majorité d'employés jeunes. Et, monopole d'embauche oblige, la plupart des employés actuels sont les enfants, les neveux, les cousins… des employés partis avec un chèque de 200.000 euros en moyenne lors du plan précédent ! »
Le gouvernement confiait dans la foulée à Raymond Redding, ancien directeur du courrier de la Poste, une mission de médiation pour résoudre le conflit social. Un accord est trouvé le 16 avril, avec le regroupement de deux des trois centres en région parisienne (Gonesse et Moissy, Bobigny étant le seul restant à l'époque) et deux vagues de 500 suppressions de postes en 2013 et en 2014, la première ne comportant pas de départs contraints.
Le retour à l'équilibre était alors attendu pour fin 2015, il ne viendra jamais. Il est désormais annoncé pour 2019.


























Commentaires (48)
#1
Vait être vache, dissoudre définitivement et repartir à zéro sur une base plus petite. " />
" />
#2
En même temps la presse n’est plus que l’ombre d’elle même .
Vu qu’elle n’est plus indépendante et possédait par les mêmes qui financent les politicards de m…dans leur majorité.
Et, les gens lambda ne remette quasi pas en doute la presse des médias non indépendantes …et donc vont pas souvent sur les sites, journaux etc..indépendants …
Faut pas s’étonner si l’état actuel de ces derniers soit ainsi désormais …
#3
#4
#5
+1 le principal et de pouvoir travailler.
#6
Se greffe à la conjoncture en effet le plus mauvais côté des syndicats (type syndicat du livre), qui vont rester sur leurs marques jusqu’au bout, quitte à ce que tout le monde coule. On est loin des glorieuses heures des luttes syndicales.
D’ailleurs les différents plans sociaux ont coûté très cher (enfin de moins en moins, pas d’bol pour les derniers qui seront remerciés) avec des primes de licenciement astronomiques (de quoi acheter un appart parisien à l’époque quoi). Des emplois inutiles à beaucoup d’endroits, et payés très cher par rapport à la moyenne.
C’est franchement dur à justifier, mais par contre la puissance (grève = aucun quotidien distribué) fait que jusqu’à présent personne n’est en mesure de moufter.
#7
donc une boite en situation de monopole sur la PQN, portée à bout de bras par l’Etat, incapable d’anticiper les évolutions du marché, et plombée par une gestion RH calamiteuse.
tellement facile de taper dans les caisses de l’Etat au lieu de regarder la réalité en face, ça évite de demander des comptes et de chercher des responsables.
#8
Voici un autre des problèmes de laisser tout un secteur aux mains d’un seul et unique acteur.
Outre les problèmes de concurrence/offre tarifaire, il suffit de quelques difficultés pour faire plonger tous les clients en même temps.
Encore plus quand ces problèmes existent depuis plus de 20 ans et que rien n’a vraiment été fait pour corriger la chose.
Si les journaux papiers sont intelligents, ils ont tout intérêt à aller voir ailleurs plutôt que d’attendre l’inévitable.
#9
#10
#11
le petit souci c’est que comme l’état met la main à la poche pour renflouer la barque monopolistique, pas la peine de se creuser la tête sur les tarifs.
du coup niveau concurrentiel c’est totalement impossible: qui va aller se battre contre une boite déficitaire depuis 20 ans que l’Etat renfloue?
c’est quand même magique la France, avec ses petits monopoles garantis par les pouvoirs publics.
le problème de la diffusion de la presse est donc un problème politique, comme tout un tas de trucs en France qui ne devraient pas l’être.
#12
#13
Je sais, mais ayant été sans travail pendant un bon moment, on à l’impression d’être mépriser par ceux qui en ont et par soi-même, de sentir inutile au niveau morale. " /> C’est chiant la déprime.
" /> C’est chiant la déprime.
#14
#15
#16
Article très intéressant sur l’historique du secteur de la distribution de la presse, je lirais les prochains avec intérêt (travaillant côté finance dans le secteur).
Il est vrai qu’on nage totalement dans l’absurde et l’ubuesque (cf. le changement de siège social pour faire des économies prévu pour 2 500 personnes qui se retrouve un an après avec des étages vides suite au plan social ayant abouti au départ de 50% du personnel)… le meilleur restant quand même la retenue à la source par Presstalis de 25% du CA réalisé par ses éditeurs… en toute tranquillité…
#17
Je ne comprends pas pourquoi CPC ne quitte pas Presstalis pour les MLP
#18
C’est ce qu’ils ont fait ;) (il y a un moment, avant même la crise, mais ça n’est rentré en vigueur que récemment, on en reparle d’ici peu  " />)
" />)
#19
Mais au final ils vont quand meme devoir payer 2.25% du CA pour renflouer Prestalis…
#20
Avant, La presse papier je la consommais chez moi, au bureau, en hotel/séjour, en salle de réunion/d’attente, dans le train/avion, …
Depuis que j’ai un PC fixe+internet, je ne la consomme plus au bureau/domicile.
Depuis que j’ai un PC portable+internet, je ne la consomme plus en hotel/séjour.
Depuis que j’ai un Smartphone, je ne la consomme plus nulle part.
Bref, consulter un journal papier me fait le même effet que lire une tablette d’argile…
#21
#22
#23
Ça en devient même lassant cette façon de faire “eh regardez j’ai la vraie info, ça vient pas d’un site d’un journal alors c’es vrai”. Et au final aucun source ou d’un site étranger dans le même genre qui n’a pas non plus de sources. Et la moindre critique entraine un déferlement de “eh mais t’ es un mouton, ouvre les yeux” etc.
La façon de traiter l’info est aussi un gros problème, par des biais parfois énorme (Réseauinternational sur le fait que CNN ne pouvait participer a l’investiture de Trump, alors que c’était pas du tout ca)
#24
Bel article qui dénonce les méfaits et gabegies d’un monopole quasi public, soutenu et financé avec de l’argent des autres pour satisfaire certain syndicat (et le copinage qui va avec).
C’est cela le capitalisme socialisme à la française.
#25
Pour résumer:
C’est qui la vache à lait ?
#26
#27
C’est la politique actuelle de baisse du niveau de vie des travailleurs français, c’est voulu par et pour les bourgeois qui n’ont jamais été aussi riche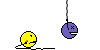 " />
" />  " />
" />
 " />
" />
Et après ils font les types qui ne comprennent pas pourquoi l’abstention, le FN ou Mélanchon gagneront toutes les prochaines élections (quand les retraités, qui ont eu la chance de bien gagner leur vie en travaillant eux, seront tous morts et arrêteront de voter le statuquo)
#28
Que veux-tu dire par “bourgeois”?
Parce que si tu définis les bourgeois par rapport aux nobles et au clergé, et bien ça fait un bail qu’on n’est plus sous l’Ancien Régime (que les bourgeois ont d’ailleurs renversé).
Ou si tu définis “bourgeois” comme habitant des villes (par opposition au paysan), et bien en France la majorité de la population est bourg-eoise !
Alors c’est quoi un bourgeois?
Quelqu’un qui profite d’une main d’oeuvre étrangère pas chère pour la fabrication de ses produits de consommation?
Quelqu’un propriétaire de son logement?
Ou un rentier capitaliste contrôlant des moyens de production (même s’il n’est au final qu’un petit patron qui passe son temps à se débattre dans la gangue de la législation)?
#29
pour une société qui est déficitaire depuis 20 ans, se séparer des employés qui coûtent le plus cher (à travail égale) est raisonnable. je dis pas que c’est une bonne chose pour les employés mais si la société veut s’en sortir, elle a pas vraiment le choix. et reprendre des CDI pour remplacer des CDI, je vais pas dire que c’est mal.
Si ce sont des fils de, des cousins de… c’est parce que le bouche à oreille fonctionne bien dans ces cas là.
on demande d’abord en interne et si on trouve on fais pas de demandes externe…
les prestataires (pour en être un, je connais la fonction) sont en CDI pour la plupart dans leur société de prestation. certain sont en interim mais je ne pense pas que ce soit la majorité. ils ont donc de l’ancienneté, de la participation, un CE etc…
Je suis pas dupe, je sais que mes collègues qui font le même boulot en interne sont payé deux fois plus (et je pense pas exagérer, net x 2) ont 90 jours de vacances, des RTT, etc… mais j’ai eu un boulot dès que j’en ai cherché et ça me gais de l’expérience pour pouvoir espérer être embaucher en interne ailleurs (parce que les boites qui embauche sont très rares, et celle où je suis n’en fait pas partie)
#30
#31
#32
#33
Hmm, ce passage de l’Histoire me répugne (probablement surtout parce qu’on m’a un peu trop forcé à l’école à lire un livre sur le sujet?), mais je devrais probablement me rafraîchir la mémoire (autant que devraient le faire tous les révolutionnaires en herbe…)
#34
#35
Outre le support (personnellement le papier reste mon support de lecture préféré, mais c’est perso), ce qui compte vraiment à un moment c’est le contenu.
Or énormément de titres de la presser papier ne sortent tout simplement en format numérique (et réciproquement bien sûr). MAis du coup quand j’ai l’occasion d’attraper certains magazines (je prends énormément le train) je me fais souvent plaisir.
#36
La Révolution, une révolte faite par le petit peuple contre les nobles et pour le compte des bourgeois et oui… (même si la portée notamment symbolique et ses répercussions en termes d’organisation sociale dépassent largement ce simple constat).
#37
Il ne faut pas généraliser. Je comprends ton sentiment d’injustice entre les internes / externes, mais bcp de boites ont des besoins ponctuels en main d’oeuvre, qu’ils ne peuvent sanctuariser, et il est normal de favoriser dans une certaine mesure ceux qui sont amenés à rester et porter les chpses sur le plus long terme.
Quant aux externes figure toi qu’ils ne sont pas tjs payés moins chers, il y a une grosse variabilité selon les secteurs. Quand tu prends des devs en presta ça te coûte souvent plus cher à la journée qu’un dev en interne, que l’externe fasse partie d’une boite ou soit en indépendant.
Tu parles d’un cas de figure, très répandu j’en conviens (malheureusement), où des boites préfèrent effectivement ne plus proposer de CDI et enchaîner les externes / prestas pour s’éviter toute lourdeur au moment de dégager les gens et bien sûr d’avoir de la main d’oeuvre corvéable à merci. C’est pas partout pareil.
#38
#39
#40
#41
Tu parles bien des plus riches -
ce n’est peut-être que moi,
mais le terme “bourgeois”, dans ce contexte,
ça me fait surtout penser à la “dictature du prolétariat”,
qui, loin d’émanciper l’homme (à ce qu’elle prétendait) de l’aliénation ,
a surtout fait encore pire que le capitalisme en massacrant les paysans (car propriétaires de leur terre),
en utilisant comme esclaves les résistants qui ont survécu (ou le premier bouc émissaire venu), (et encore, les esclaves étaient mieux traités dans l’Antiquité)
et en aliénant les autres dans un système encore pire que le capitalisme de l’époque.
Il faudrait peut-être utiliser un autre vocabulaire?
Je n’aime pas le terme “les 1%” parce qu’au vu des proportions réelles il a surtout l’air de mette sous le tapis la globalisation dont profitent surtout les 75 millions de 1% dont nous sur ce site avons forte chance de faire partie (2500€/mois en revenus ou 700 000€ en patrimoine), mais il me semble tout de même plus approprié que “bourgeois”!
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
pas aux moments de la terreur, la le bas peuple s’en ait donné à coeur joie (on avait du oublier le jeux de tarot parce que je me souvient parfaitement de ce cours d’amphi à tolbiac :p )