Devant le tribunal de grande instance de Paris, la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a obtenu le blocage durant un an d'Extratorrent, Torrent9, Isohunt, Cpasbien, ainsi que leurs sites miroirs et de redirection. Bouygues, Free, Orange, SFR et Numéricable devront prendre à leur charge les frais consécutifs.
Le 6 février 2017, la société de gestion collective des majors du disque a assigné en la forme des référés Bouygues, Free, Orange, SFR et Numéricable aux fins de blocages de ces quatre sites ainsi que leurs répliques et autres adresses de redirection.
Comme l’industrie du film, qui démultiplie les actions sur ce fondement, la SCPP s’est appuyée sur l’article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle. Un texte transposé dans le droit européen à l’occasion de la loi Hadopi et qui permet de faire ordonner toutes les mesures permettant de prévenir ou faire cesser une atteinte au droit d’auteur.
Dans le top 50, entre 70 et 78 % de titres du catalogue de la SCPP
À la date des constats, la société de perception et de répartition a relevé que sur Extratorrent – site fermé en mai, « parmi les 50 contenus musicaux les plus téléchargés, 35 correspondent à des albums ou à des titres qui appartiennent au répertoire social de la SCPP », soit 70 %. Ce taux est de 78 % chez Torrent9 et oscille entre ces deux extrêmes sur les autres sites en cause.
Pour le TGI, ces procès-verbaux « établissent suffisamment le caractère illicite des sites “extratorrent, torrent9, isohunt, cpasbien” et des sites miroirs ou proxy ». Il ajoute que :
« Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder en streaming les oeuvres à partir de liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, et ce même si les contenus sont stockés auprès de serveurs tiers ou sur des plates-formes tierces, ces opérateurs ont permis aux internautes de procéder au téléchargement des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus c’est-à-dire ont donné aux internautes les moyens de reproduire des oeuvres, dont ils ne détenaient pas les droits. »
Dans les rangs des fournisseurs d’accès, seuls à être assignés par la SCPP qui, curieusement, n’a pas jugé utile d’agir auprès de Google ou Bing, aucun n’a contesté le caractère illicite des sites épinglés.
Le principe du blocage n’a pas davantage été contesté par la majorité d’entre eux, pour autant qu’il soit proportionnel, limité dans le temps et que les opérateurs disposent d’une liberté de choix dans la technologie à emprunter. Seul Free véritablement a souligné que ces mesures étaient des murs de papier, compte tenu de la facilité de contournement.
Le TGI a toutefois balayé cette remarque :
« S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d’une part il n’est pas établi que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l’internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle et d’autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire ».
Ainsi, à ses yeux, le blocage est bien « le seul moyen réellement efficace dont disposent actuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon sur Internet ».
Entre 88 et 450 euros, la question des coûts du blocage
Mais le point dur s’est concentré sur la question des coûts. Tous les opérateurs ont demandé à ce que les frais consécutifs aux mesures de blocage soient supportés par la seule SCPP. Et celle-ci a évidemment réclamé l’exact opposé.
Les frais en question sont en façade ridicules. 25 euros chez Bouygues, Orange évoque 88,31 euros par nom de domaine. Chez SFR Numericable, le montant évolue entre 250 et 450 euros. Ce coût est enfin de 147,13 euros selon Free.
Mais si les montants sont faibles au regard du poids économique de ces mastodontes, la société chère à Xavier Niel a relevé, selon les propos résumés par le jugement, que « ce coût pouvait augmenter notamment en raison d’effet de seuils si le nombre de demandes venait à augmenter de façon considérable puisqu’il faudrait engager de nouveaux moyens ».
En clair, les FAI craignent, en étant condamnés à prendre en charge le blocage, que les vannes ne soient ouvertes avec une industrialisation des mesures de blocage. La vague récente d’assignations et de décisions ne leur donne pas tout à fait tort.
Des frais mis à la charge des FAI
Dans d’autres secteurs, la question ne se pose pas : les FAI n’ont pas à supporter les frais d’identification des IP adressées par la Hadopi, ils sont déchargés des frais consécutifs aux réquisitions judiciaires, tout comme pour le blocage des jeux en ligne (loi ARJEL).
Le jugement du tribunal a rappelé l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017, pris dans la lignée d’une autre décision de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Telekabel).
La haute juridiction française a estimé en substance qu’aucun texte ne s’opposait à la prise en charge du blocage par les FAI. Le TGI va souligner qu’à l’inverse, aucun texte ne prévoit une telle obligation sur le fondement de l’article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour le cas présent, après auscultation de la jurisprudence européenne, la présidente Marie-Christine Courboulay, vice-présidente du TGI, va finalement répondre que « les coûts des mesures de blocage seront mis à la charge » des FAI.
Ce coût n’est pas insupportable pour ces sociétés, ne compromet pas la viabilité de leur modèle économique, ni ne porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Évidemment, la faiblesse des montants exposés par les FAI leur a été fatale à la barre : « des sommes très raisonnables au regard de la surface financière des sociétés FAI (de 25 euros à 450 euros selon les sociétés) ».
D’autres éléments ont pesé : aucun fournisseur n’a dans le passé répercuté ces frais sur les titulaires de droit, qui, de leur côté, ont dû supporter des « coûts importants de constat des sites illicites ».
Pas de mise à jour des sites bloqués sans retour devant le juge
Vis-à-vis des sites miroirs, un principe de base a été rappelé par le TGI de Paris : « le nombre de sites qui doivent faire l’objet de l’interdiction d’accès est limitativement fixé par le présent jugement et toute mesure touchant un autre site doit être autorisée par une autorité judiciaire, les FAI n’ayant pas d’obligation de surveillance des contenus et la SCPP ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accès à des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire ».
En clair, en cas de réouverture de l’un quelconque des sites bloqués, les parties devront, sauf accord, retourner devant le juge pour actualiser la base. En attendant, voici ci-dessous la liste des sites, miroirs et redirection bloqués par ce jugement du 2 novembre 2017.
Sites d’origine :
- extra2.to
- torrent9.code civil
- isohunt.to
- cpabien.xyz
Sites miroirs :
- torrent9.me
- torrent9.ws
- torrent9.tv
- smartorrent.com
- torrent9.info
- torrents9.org
- isohunt.st
Sites de redirection :
- extratorrent2.cc
- torrent9.biz
- torrent9.top
- cpasbien.cm
On remarquera dans la liste « torrent9.code civil », sans doute fruit d’une erreur d’autocomplétion dans le traitement de texte utilisé par la magistrate…





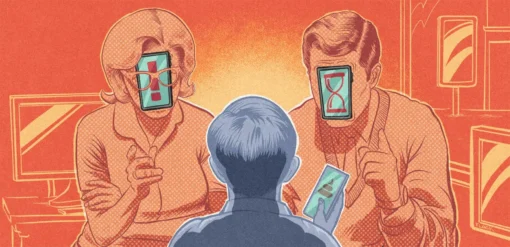

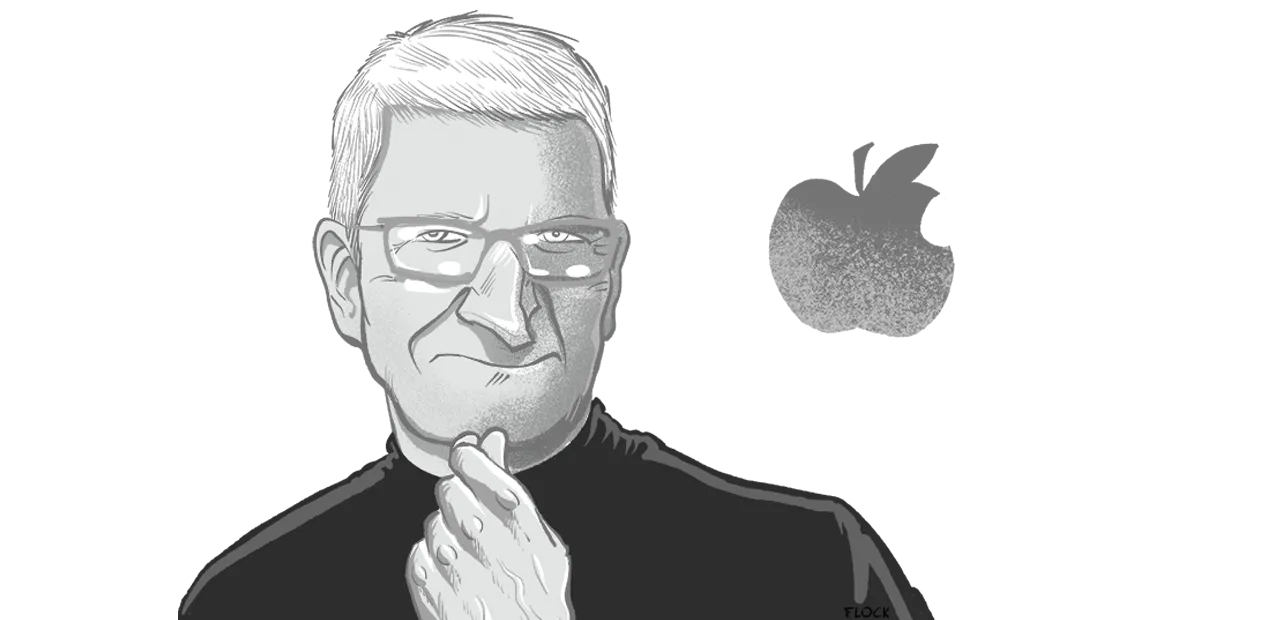
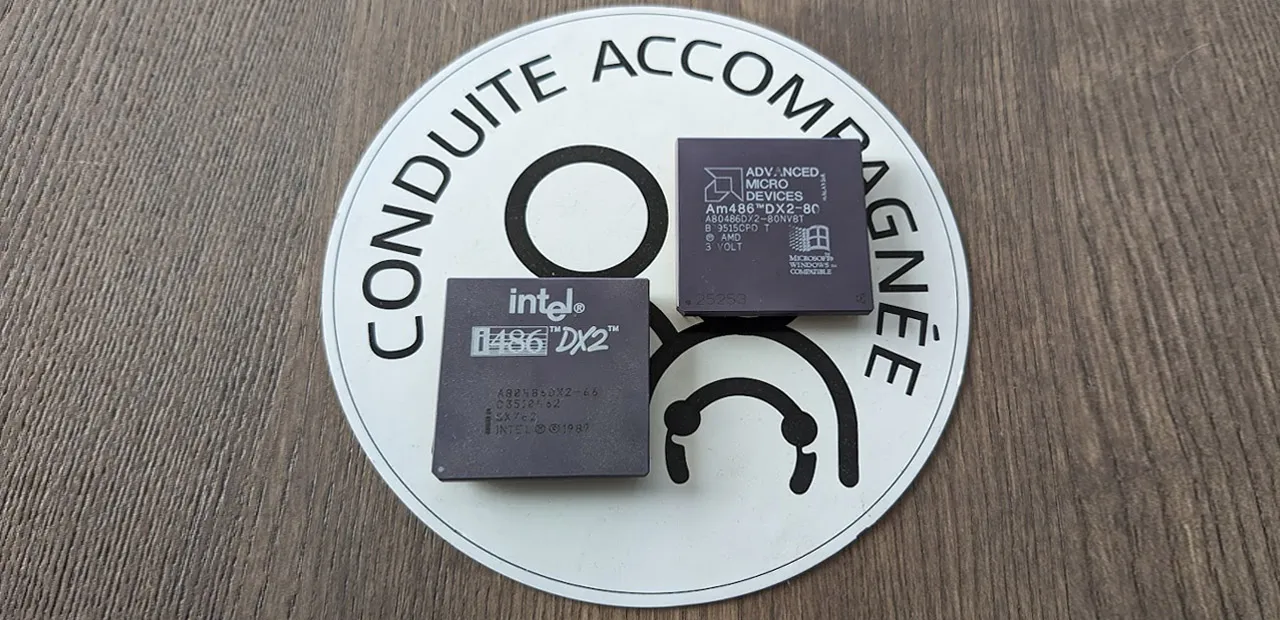
Commentaires (80)
#1
l’industrie du VPN a décidément de beaux jours devant elle.
#2
On remarquera dans la liste « torrent9.code civil », sans doute fruit d’une erreur d’autocomplétion dans le traitement de texte utilisé par la magistrate…
Incroyable
#3
Put* j’ai pas lu la dernière ligne de l’article j’ai fais signaler une erreur " />
" />
#4
Haha cette erreur de copier coller  " />
" />
“Monsieur code civil vous êtes condamnés à purger une peine de 30 ans de prison”
#5
De l’intérêt d’avoir une machine en local (Raspberry ou autre) utilisée en serveur DNS " />
" />
#6
“Des frais mis à la charge des FAI”
=> Des frais mis à la charge des consommateurs finaux, non, plutôt ? Car le prix de ces opérations sera forcément répercuté sur les forfaits.
#7
J’étais à deux doigts de signaler une erreur !
#8
Comme free le dit : mesure en carton. Même pas besoin d’un VPN pour accéder aux sites listés. Juste avoir des DNS autres que ceux fournis par le FAI.
 " />
" />
Et ils croient vraiment que ce sera efficace?
La plupart des “pirates” savent contourner ce «blocage». Ceux ne savant pas le faire sont les personnes qui se font pirater leur connexion pour accéder à ces sites.
Et puis les frais on en parle? de 25€ chez Bouygues à 450€ chez Altice? Ils sont tant dans la merde que ça pour essayer de gruger autant de pognon pour 1 ligne de code?
#9
Oh pas besoin d’aller jusque-là, hein… Tu installes Opera, tu actives le VPN, tu le règles sur autre chose qu’Europe comme localisation et voilà. " /> Un truc de “spécialiste”, j’imagine, donc…
" /> Un truc de “spécialiste”, j’imagine, donc…
#10
Cool, ils nous donnent une liste de sites à connaître !
#11
Pour ceux qui utilisent encore Opera " />
" />
#12
lol la différence de prix entre fournisseurs.
#13
présent  " />
" />
Faut pas croire, on est quand même 2% !
Enfin… depuis qu’Opera est basé sur Chromium, on est catalogué Chrome, si ca se trouve on est plus en réalité :)
#14
Même pas besoin de VPN ou de DNS perso, mon FAI n’est pas dans la liste " />
" />
#15
#16
#17
Me dites pas que ça sera contourné en changeant les DNS et/ou en utilisant un VPN ? 🤔
 " />
" />
Ah mais si.
#18
Je ne l’utilise que pour ça. 😅 Avant, on pouvait régler le VPN aux US, ce qui permettait de regarder les séries US sur les sites des chaînes de TV, mais ils ont enlevé le réglage précis de la localisation, ces empaffés, du coup je dois faire autrement maintenant. 😏
#19
#20
Tu l’as en français ?
J’ai mon Os en anglais et opera dans la même langue, le réglage précis est toujours possible. Par contre, chez mes collègues qui l’ont en français, c’est flou comme tu l’indiques.
#21
#22
#23
Rien en français chez moi, à moins d’y être forcé. " /> C’est la version 49.0.2725.64 d’Opera (donc la dernière, en tous cas, c’est ce qu’il dit), et j’ai juste le choix entre Europe, Americas et Asia…
" /> C’est la version 49.0.2725.64 d’Opera (donc la dernière, en tous cas, c’est ce qu’il dit), et j’ai juste le choix entre Europe, Americas et Asia…
#24
Tiens, marrant, ça a changé depuis hier chez moi, je suis dans le flou, tout comme toi maintenant :‘(.
#25
Oui, c’est récent chez moi aussi… Je sens un chouinage d’ayant-droit genre, “oui, mais euuuuh, avec ça on peut regarder ce qu’on veut aux US sans payer, c’pas juste!”. Et avec la politique d’auto-update pourrie d’Opera qui ne te demande rien, je me le suis chopé sans pouvoir rien y faire…
Bon, c’pas comme s’il n’y avait pas d’autres solutions, non plus… 😏
#26
Bien vu, il faut fuir les gros #grossophobie
https://www.ffdn.org/en/members-fdn-federation
#27
Utiliser un DNS autre que celui de votre FAI me parait tellement plus simple et pratique. D’ailleurs il y avait un article sur Quad9 il n’y pas longtemps et il fonctionne pas trop mal je trouve.
Le VPN d’Opera je reste dubitatif pour ma part, c’est l’utilisation de Surfeasy derrière, qui lui est payant. Donc j’ai du mal à croire que les données ne soient pas réutilisées derrière (même si elles sont anonymes). Je doute que Opera paie gracieusement un VPN à tous ceux qui le veulent juste pour gagner des PDM.
Bref… Comme d’hab, ca revient à pisser dans un violon toutes leurs décisions de justice et de blocages. Je serais curieux de voir l’impact réel sur le nombre de téléchargements…
#28
#29
#30
Et comme les FAI font ça à cout minimal, on est garanti que ce sera un filtrage dns minimal.
Donc avec une efficacité nulle pour celui qui a cherché 5 minutes sur le net.
Et sans atteinte grandiose au secrets des communications.
Et sans effet de bord désastreux.
#31
Ceux qui savent comment contourner le blocage DNS savent également comment contourner un blocage IP (proxy, relay/router, vpn…).
Ces décisions de blocage servent uniquement à empêcher l’interaute vulgaris d’accéder facilement au célèbres sites de piratage du moment. Un peu comme installer des grilles/barrières empêche la plupart des gens “ordinaires” d’entrer sur un site.
#32
+1
#33
donc en gros, c’est tout bénef pour Google qui va encore récupérer du monde sur son DNS 8.⁴ … " />
" />
#34
Ha ? ils sont encore actif cpasbien ? J’ai arrêté d’y aller depuis déjà un sacré bail, plus rien à jour dessus, les liens de navigation inter-sections foireux, recherche foireuse…
Par contre, je trouve totalement anormal que les FAI aient à en supporter le coût, ils ne sont qu’intermédiaires dans cette histoire, et si les plaignants se plaignent de leurs coûts “d’investigations”, ils les ont librement consentis donc bon…
#35
Étrange il n’y a pas le successeur historique de T411,
YGGtorrent https://yggtorrent.com
#36
Faites un clic droit > ouvrir dans nouvel onglet les liens donnés ci-dessus :)
C’est mignon !
#37
La requête initiale date du 06/02/2017 !
#38
#39
#40
Bah si, mais j’utilise Opera depuis 7 ans. Quand t’as l’habitude…
#41
#42
Pas plus qu’un truc qui appartient aux ricains en fait :)
A la limite, si les chinois récupèrent toutes mes informations de navigation, je serait peut être moins spammé de pub que si c’est des ricains ^^
édit: burned par mon VDD qui devait pas être en train de prendre l’apéro
#43
#44
#45
#46
Je peux pas utiliser Firefox sur mon pc du boulot, j’ai que 16go de ram :(
#47
Nous on trouve ça ridicule le blocage par DNS, mais une bonne partie de
la population n’y connait rien et va tout simplement abandonner.
#48
#49
jusqu’à preuve du contraire on n’est pas en Chine, donc je vois mal comment l’utilisation d’un VPN pourrait devenir illégale.
#50
#51
#52
Merci pour le lien, je viens de découvrir un FAI associatif dans ma région dont j’ignorai l’existence, j’y jetterai un œil.
 " />
" />
En attendant, idem que ActionFighter, chez moi c’est OVH, mais je ne connais pas la couleur du “tuyau” de collecte donc…
#53
#54
je vois pas le rapport avec la légalité d’une offre VPN.
et les US ont voté pour ne plus rendre obligatoire la neutralité du net chez eux.
#55
Ouais et puis en Europe, les politiques ont l’air un peu plus attachés à la neutralité du Net qu’aux States. Du moins en façade. Et puis je suis pas sûr non plus qu’ils aient bien compris ce que c’est (entre les “la neutralité du net c’est l’absence de censure” et les “la neutralité du net c’est la possibilité d’innover pour tout un chacun”).
#56
#57
#58
#59
ça n’a rien à voir.
tu peux avoir un réseau militaire neutre techniquement.
#60
Je ne serais pas si ayant-droit-à-l’optimisme que tu sembles l’être, sur ce sujet-là. " />
" />
Les habitudes de « consommation du partage » prises sur une décennie (+/-) risquent de ne pas s’éteindre aussi facilement. Le contournement est largement documenté (pour le peu qu’il y a à savoir) et nous sommes à l’ère des réseaux sociaux et de la communication instantanée, tout de même…
#61
Effectivement, disons plutôt depuis les débuts du world wide web…
#62
Si on fait une moyenne mondiale, effectivement on a des choses plutôt positive pour le moment, mais au niveau de nos pays dits “développés”, nous sommes au début d’une belle descente.
Et au passage, non, le PIB par habitant n’est pas une méthode pour savoir si les gens sont dans le besoin ou non.
#63
Mais pourquoi les gens piratent autant ? " />
" />
#64
par opportunisme?
#65
#66
#67
En autre.
Accessoirement, je pense qu’il y a une multitude de raison, mais la principale étant que les services payants n’apportent rien de plus, mais au contraire peuvent apporté des inconveniants que n’ont pas le piratage.
Ajoute à ca le prix des services payants assez monstrueux, la facilité de piratage, et d’une manière générale le fait que les gens ont compris que non, pirater ce n’est pas comme voler une voiture, et que moralement et socialement ça passe à peu près d’assumer être un pirâte.
Je joue beaucoup, je regarde beaucoup de film, beaucoup de série, et j’écoute beaucoup de musique.
Même avec un salaire au dessus de la moyenne française, tout ça ne passerais pas si je devais payer pour tout, alors je ne paye que pour une partie, principalement les jeux. Oui c’est de l’opportunisme, mais je n’hésite pas à mettre de l’argent pour un artiste ou un éditeur de jeu qui m’a fait passer un bon moment.
#68
#69
#70
concernant la musique, à moins d’avoir des besoins qui sortent de l’ordinaire en terme de qualité ou en terme de contenus (des trucs vraiment particuliers), je pense que la plupart des gens ont abandonné le téléchargement depuis l’apparition du streaming à des couts vraiment abordables.
je ne dis pas qu’il n’y a pas d’inconvénients, je dis juste que l’offre légale est devenue plus pratique et facile d’accès que l’offre illégale, pour un coût tout à fait abordable pour le commun des mortels.
concernant l’audiovisuel, je vais séparer les deux:
On voit que ce qui a marché pour la musique n’est pas appliqué pour les films/séries: au lieu de catalogues pléthoriques à prix hyper compétitifs, on a une offre rare, chère, et une multiplicité de catalogues exclusifs.
#71
Ca me parait très intéressant cette remarque du TGI :
« S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partie des internautes, d’une part il n’est pas établi que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l’internet, a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle et d’autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire ».
Car pour moi , ça revient en somme à un camouflet pour les AD.En gros, le TGI leur dit : “Bon, allez, pour 25€/site bloqué, vous pouvez aller faire chier les FAI , au moins comme ça vous viendrez plus nous les briser a nous.
De toute façon, “le plus grand nombre” des gens sont vissés devant TF1/youtube/netflix pour les plus riches, et ceux que vous cherchez a atteindre, ben en 10s de recherche sur google, ils élimineront le blocage “FAI” et trouveront une solution. Si ça peux faire que vous nous lâchez la grappe pour 3 pelés et 2 tondus…
Pour moi, très rapidement, on va avoir les ayants-droit qui vont demander une API directe aux FAI pour bloquer eux-même les sites sans passer par la justice.
Qu’ils vont évidemment abuser avec leurs algo, ptet même en bloquant leur propre sites :-)
Et Quad9 aura un joli succès français :-) (Il y a eu d’autres cas moins médiatiques - j’ai vu que les FAI déréférençais voire carrément blackhaulaient des plages IP entières liés , par exemple à des serveurs IKS ou des serveurs de CC de bot, sans rien dire a personne … )
#72
#73
#74
Quand Megaupload et assimilés a fermé, y’a pas eu de loi pour interdire le HTTP.
Tout comme il n’y a jamais eu d’interdiction du Peer to Peer, mais uniquement des logiciels utilisés pour faire de la contrefaçon.
#75
C’est sympa de compléter ma liste de site pirate ;-)
#76
#77
tant qu’il y aura des capitalistes pour bosser " />
" />
#78
#79
#80
Avec Chromium/Chrome/Vivaldi/… et peut-être même Opera " />, il existe l’extension Service proxy et VPN Hotspot Shield permettant ce genre de chose, à priori (pas testé).
" />, il existe l’extension Service proxy et VPN Hotspot Shield permettant ce genre de chose, à priori (pas testé).