La réforme du télétravail présentée la semaine dernière par le gouvernement va-t-elle permettre un recours accru à ce mode d’organisation qui séduit de plus en plus d’actifs ? Éléments de réponse avec différents partenaires sociaux et les lumières d’un avocat spécialisé en droit social.
Le Conseil constitutionnel ayant validé jeudi 7 septembre le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures relatives au Code du travail, plus rien ne fait désormais obstacle à la parution des textes présentés la semaine dernière par le Premier ministre Édouard Philippe et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, l’article 24 du projet d’ordonnance « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » (PDF) se donne pour objectif de faciliter le développement du télétravail. L’exécutif ambitionne ainsi de fixer « un cadre juridique adéquat aux nouvelles pratiques, pour sécuriser salariés comme employeurs ».
Un « droit au télétravail » plutôt bien accueilli
La mesure qui a probablement fait le plus parler d’elle ces derniers jours concerne le « droit au télétravail ». Tout salarié qui occupe « un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail » (tel que défini par un accord collectif ou, à défaut, par une charte interne à l’entreprise) pourra en effet demander à travailler à distance – que ce soit chez lui, dans un espace de coworking, etc.
L’employé devra simplement pouvoir justifier de « contraintes personnelles » (éloignement de son domicile, grossesse...). Pour refuser, l’employeur sera quant à lui tenu de « motiver sa réponse », indique le projet d’ordonnance.
« Cette réforme est une bonne chose dans la mesure où cette ordonnance consacre le droit au télétravail, se félicite Éric Peres, du syndicat Force ouvrière (FO). Chaque salarié pourra demander à pouvoir travailler ou s'organiser sous la forme du télétravail. » Pierre Beretti, qui représentait le MEDEF lors de la récente concertation relative au télétravail, concède : « Ça devient plus difficile de refuser le recours au télétravail. »
Un refus de l’employeur qui restera difficilement contestable
« Il y a un renversement de l'initiative de la demande de passage en télétravail, analyse de son côté l’avocat Grégory Saint Michel. Dorénavant, cette requête pourra émaner du salarié, et ce sera à l'employeur d'expliquer pourquoi il s'y opposerait. » Ce spécialiste du droit social estime toutefois qu’il y a un flou quant aux éventuelles suites qui pourraient être données à un refus de la part du patron : « Le projet d’ordonnance ne dit pas si cette décision est contestable. On comprend simplement que c'est à l’employeur d'évaluer l'opportunité de passer (ou non) un salarié en télétravail, s'il remplit les conditions nécessaires. »
Maître Saint Michel considère que des recours resteraient possibles, mais uniquement dans des cas extrêmement limités. « S'il est par exemple prévu que toute personne qui a une ancienneté d’au moins cinq ans peut demander de passer au télétravail, on peut imaginer qu’il soit possible de contester cette décision devant le conseil des prud’hommes. En revanche, si c'est en fonction du niveau de compétences du salarié par exemple, ça deviendrait bien plus compliqué. »
Mohammed Oussedik, de la CGT, se montre ainsi très réservé sur cette réforme : « C'est un petit droit supplémentaire pour le salarié. Ça risque d'être assez marginal dans la mesure où les accords actuels encadrent fortement le télétravail : il y a des commissions de suivi, il y a des garde-fous pour éviter le télétravail informel, etc. »
« Là au moins, c'est précisé »
S’il y a un point qui suscite l’unanimité chez les partenaires sociaux, c’est la clarification de nombreuses dispositions – par exemple en matière d’accidents du travail. Il sera en effet précisé dans le Code du travail que tout accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail est « présumé être un accident de travail » (à condition qu’il ait lieu « pendant les plages horaires du télétravail »).
« Les doutes sont levés : le salarié est protégé si d'aventure il est dans une situation d'accident du travail » applaudit ainsi Éric Peres (FO). Maître Saint Michel se veut toutefois plus nuancé dans la mesure où ce dispositif n’englobe pas certaines situations particulières : salariés en forfait-jour, télétravailleurs « informels », etc.
Dans le même registre, le fait d’inscrire dans la loi que celui qui travaille à distance dispose des « mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » est également vu comme un élément positif. « C'était déjà le cas, mais là au moins, c'est précisé, commente Éric Peres. On est en télétravail, c'est une organisation différente, mais on a les mêmes droits que n'importe quel salarié – y compris en termes de formation ». Pour le représentant de Force ouvrière, « il ne s’agit pas d’un simple toilettage : on reprécise et on sécurise le fait que le télétravailleur est un travailleur à part entière ».
Suppression des dispositions sur la prise en charge des frais de télétravail
Si certaines choses sont effectivement précisées, d’autres, en revanche, disparaissent... L’employeur ne sera par exemple plus tenu « de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ». Une précision qui figurait jusqu'ici à l’article L1222-10 du Code du travail.
« Peut-être que demain, on aura des entreprises où l'on vous dira que si vous voulez bénéficier du télétravail, il y a un certain nombre de frais qui seront à votre charge » s’inquiète Mohammed Oussedik pour la CGT.
Pierre Beretti estime toutefois qu’il ne faut pas surestimer ces craintes : « La question de l'indemnisation pouvait se poser il y a cinq ou dix ans, quand les gens n'avaient pas d'équipements très développés à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet majeur » considère le représentant du MEDEF, au motif que la plupart des salariés disposent selon lui d'un accès à Internet à la maison. « Les gens gagnent à télétravailler : ça fait moins de déplacements, moins de contraintes... » souligne-t-il au passage.
Pour Maître Saint Michel, il n’y a effectivement « plus rien dans le texte qui oblige les employeurs à prendre en charge les frais professionnels ». Ce vide pourrait toutefois se combler devant les tribunaux : « D'un point de vue juridique, c'est contraire à la convention européenne des droits de l’homme et au droit du travail international. Il me semble difficile d’imposer à un salarié des dépenses professionnelles sans qu'elles ne lui soient remboursées. Ce n'est pas au salarié de débourser pour exécuter. Je pense qu’il y aura donc toujours possibilité que la jurisprudence revienne sur le texte. »

Craintes d’abus suite au renvoi à des chartes
Autre changement prévu par le gouvernement : le fait que le télétravail dépende uniquement d’accords collectifs ou, à défaut, de chartes – alors que le contrat de travail était jusqu’ici le document de référence pour préciser les modalités d’organisation du télétravail.
« Le texte va affaiblir ce socle qu’était le Code du travail pour dire aux entreprises que finalement, elles vont pouvoir y déroger – soit via des accords d'entreprise, soit en ayant recours à des chartes » craint Mohammed Oussedik. Si les entreprises devraient y gagner en souplesse, « l'impact risque d'être très négatif pour les salariés » prédit le cégétiste. « Peut-être que demain, on aura un accord d'entreprise qui reviendra sur le fractionnement des heures de repos. Auquel cas il y aurait un risque pour la santé des télétravailleurs, tout simplement parce qu'il y a des employeurs qui vont être tentés de surcharger leurs salariés qui sont en télétravail. »
Le recours à des chartes imposées unilatéralement par l’employeur, notamment dans les petites entreprises, suscite davantage encore d’inquiétude de la part des syndicats. « Si on se limite à une simple charte, il y a un risque d'abus, voire la possibilité de ne pas encadrer suffisamment et de manière contractuelle les engagements de part et d'autre, soupire Éric Peres. Mieux vaut passer un accord, de branche ou d'entreprise. »
De rares situations de télétravail imposé en cas de « circonstances exceptionnelles »
Quant au fait que l’employeur puisse dorénavant imposer à ses salariés de télétravailler momentanément lors de « circonstances exceptionnelles » ou « en cas de force majeure » (l’article L1222-11 du Code du travail cite en exemple les menaces d’épidémie), tous s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une mesure à la portée très limitée.
« Les circonstances exceptionnelles ou les cas de force majeure, c'est l'extériorité, l'imprévisibilité, etc. Ce sont des conditions extrêmement restrictives, de type inondation ou incendie dans l'entreprise, explique Maître Saint Michel. Ce sera donc nécessairement très provisoire. »
« Il y a beaucoup de garde-fous » abonde Mohammed Oussedik (CGT). « D'abord, il faut que la situation exceptionnelle soit avérée et qu'elle soit exceptionnelle. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une grève... De deux, chaque fois, on vérifie que l'ensemble des salariés dispose bien des moyens d'effectuer du télétravail. Donc finalement, ça reste cantonné à une proportion limitée du salariat. »
Entre « coup d’épée dans l’eau » et « vraie accélération »
En fin de compte, les avis sont plutôt partagés sur l’impact de la réforme à venir. « C'est marginal ce qu'il se passe, réagit Mohammed Oussedik. Pour nous, la meilleure façon de favoriser le télétravail, c'est d'obliger la tenue de négociations au niveau des branches. Là, on aurait pu s'adapter ensuite en fonction des secteurs d'activité. » Et le représentant de la CGT d’insister : « C'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a des bonnes intentions qui sont affichées. Elles ne sont malheureusement pas concrétisées par de vraies décisions pour favoriser le télétravail. »
Chez Force ouvrière, on considère aussi qu’il « n’y pas forcément de grand changement », même si certains points sont clairement positifs. « Je suis plutôt confiant. Chacun y trouvera sa part » prédit ainsi Éric Peres.
Du côté du MEDEF, on affiche davantage encore de satisfaction. « Ce qui est prévu à ce stade va dans la bonne direction. Ça lève plusieurs points de réticences ou d’ambiguïtés des textes précédents » estime ainsi Pierre Beretti. « C'est loin d'être une réforme accessoire. C'est une simplification, c'est une facilitation du télétravail qui concerne 5 millions de salariés, poursuit l’intéressé. On consacre finalement des usages et on les facilite. C'est une vraie accélération qui va dans le bon sens. Et dans le sens de l'évolution des pratiques du travail. »
« Ce n'est pas forcément le Code du travail qui va changer grand-chose »
Seul l’avenir nous dira si le recours au télétravail s’accélère véritablement au fil des prochaines années. Éric Peres observe néanmoins que « ce n'est pas forcément le Code du travail qui va changer grand-chose : c'est la volonté à la fois des employeurs et des salariés de s'emparer du sujet. Certains se cachent derrière les contraintes administratives, mais jusqu'à présent, ce sont souvent les pratiques managériales qui ont fait obstacle au développement du télétravail – plus que des problèmes de droit. »
« Si, en effet, personne ne joue le jeu, ce ne sont pas ces quelques lignes qui vont révolutionner la planète. Ceci étant, elles sont de nature à lever quelques freins, notamment de la part de certaines entreprises et de syndicats de salariés. » Le représentant FO, par ailleurs membre de la CNIL, raconte que « certains salariés s'interdisent de parler du télétravail, par peur d'être vus par leur employeur comme des gens qui voudraient moins travailler... Comme si ça allait susciter des doutes sur l'efficacité de leur investissement au sein de l'entreprise. Or on voit aujourd'hui que tout le monde y gagne, à condition que ce soit bien organisé et négocié. Si les employeurs en prennent conscience, je ne pense pas que ce soit très long à se mettre en place. »
Dans un premier temps, restera à voir si ces dispositions évoluent d’ici à leur présentation officielle en Conseil des ministres, prévue pour le 22 septembre prochain. Le gouvernement doit en effet encore consulter différents organismes (tels que le Conseil national d’évaluation des normes), ce qui pourrait conduire l’exécutif à revoir sa copie – très probablement à la marge.






















Commentaires (71)
#1
l’employeur ne sera ainsi plus tenu « de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Vivement qu’on paye notre patron pour travailler…
#2
ça va dans la bonne direction, bonne nouvelle  " />
" />
Pour les frais de connexion, c’est vrai qu’on se poserait la question. J’imagine que s’il y a un télétravail régulier, ça ferait comme certains titres de transport, où ta société rembourse 50% de tes frais de FAI (à 30 ou 40 euros, ça va, quand même).
#3
On peut se poser la question de ce qu’il se passe pour les salariés de SSII qui sont en régie…
#4
#5
#6
Quand je fais du télétravail, je rapporte mon PC pro à la maison et je travaille avec.
Acheter un deuxième PC avec toutes les licences, c’est effectivement autre chose.
#7
Pour les frais de connexion, j’ai par ma boite 20 euros mensuels, ça m’a permis de prendre le plus gros forfait cher l’agrume et avoir une qualité de connexion équivalente à celle que j’ai sur site (en upload essentiellement).
Je trouve qu’il y a un intérêt, après tout dépends des besoins en terme de débit par rapport à son activité.
#8
#9
#10
#11
Je sens plutôt le truc dans le sens:” ouiiiii, on permets le télétravail mais sous des conditions intenables pour le salarié donc au final ca changera pas grand chose”
A croire que ce n’est pas ni bien vue, ni souhaitable de faire du télétravail… :C
#12
#13
On peut très bien payer la ligne ADSL ou fibre du salarié et la mettre au nom de la boite , lui filer un PC portable avec son VPN , une imprimante et un téléphone mobile
C’est ce que j’ai fait quand j’ai implémenté ça ( avec nos propres modems pour que nos gars réseau puissent aider en cas de dysfonctionnements).
Ce n’est pas parce que l’état pond des décrets qu’on n’a pas le droit d’être inventifs et logiques.
#14
Personnellement ce point ne me choque pas vraiment celon le cas.
 " /> ).
" /> ).
 " />
" />
EN dehors des entreprises sans locaux et ou le télétravail serait obligatoire, à partir du moment ou on ne t’impose pas le télétravail, je ne comprends pas pourquoi ça serait à l’entreprise de payer ce coût là.
En gros quand le télétravail est un choix, une volonté du salarié, je ne vois pas pourquoi ça serait à l’entreprise d’assumer les coût de ce choix, alors qu’en venant dans les locaux tout serait fourni.
A ce compte là c’est à l’entreprise de me payer tous les frais pour me rendre au travail hein…. (oui elle prend déjà en charge la moitier des transports en commun plafonné à je ne sais plus combien, mais c’est juste les transports en commun…)
Que l’entreprise doive payer le matériel nécessaire et spécifique au cadre de l’entreprise (genre admettons que la norme de secu impose un tunnel vpn + un pc particulier), là je comprends, mais tout ce qui était “standard” genre un accès internet lambda que l’utilisateur a déjà, je ne trouve pas ça logique que ça soit à l’entreprise de le payer (et je suis salarié hein pas patron
Pour le pc en général l’entreprise à le choix entre un pc fixe ou un pc portable, donc fournir un pc portable n’est pas vraiment un problème en soit.
Sinon en dehors de ça, le téléravail reste malheureusement trop peu diffusé en france, ce n’est pas généralisable à tous les métiers, mais beaucoup de métiers dans les nouvelles technologies pourraient le faire…. Les patrons restent frileux sur ce domaine et veulent voir les employés en actions, faut surveiller etc. Le télétravail ça leur convient pour faire des heures sups gratuites par contre….
#15
Le refus sera difficilement contestable. Le patron peut te dire d’acheter toi-même ton matos et tes licences logicielles. La possibilité de définir les modalités par des chartes.
Bref, beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
#16
#17
Si le patron est sensibilisé à la sécurité informatique il préférera fournir le matériel que de se baser sur du BYOD (et tout le support technique qui en découle si tout un chacun a du matériel exotique).
 " />
" />
S’il a compris que cela risque de faciliter le piratage de la maquette du prochain produit en cours de développement. M’enfin avec des si.
#18
#19
ça c’est de l’esbroufe, le télétravailleur ne sera ni plus ni moins équipé du matos standard du commercial :
-> la bagnole en moins
faut pas non plus prendre les employeurs pour des abrutis, tu télétravailles certes, mais c’est pas pour autant que tu dois pas être rentable!
#20
Dans ma boite, pas besoin d’avoir tous les logiciels installés sur son PC perso, un simple VPN suffit.
Pour les employés ayant des PC portables ils ont leur environnement de travail installé
pour ceux qui ont encore (plus pour longtemps) des PC au format tour, une connexion bureau a distance fonctionne parfaitement.
#21
Je fais du télétravail quotidiennement jusqu’à 4 jours par semaine et c’est inscrit très clairement dans mon contrat de travail. Je ne suis par contre remboursé d’aucun frais comme l’électricité, le chauffage supplémentaire ou la connexion internet. Ceci dit, j’épargne le coût d’un abonnement de transport. Et ça permet pas mal de flexibilité.
#22
#23
Quand je vois les kilomètres que je bouffe quand je vais au bureau, tout ça pour faire de l’administratif 80% du temps, et que la boite refuse le télétravaille, ça me fou les boules. D’autant plus que je suis déjà équipé de tout le matos, mon travail étant déjà nomade. Ce qu’il va surtout falloir faire évoluer, ce sont les mentalités “pas présent = glandeur”.
Quand t’as un coup de froid, t’as le choix entre te mettre en arrêt (avec une visite à 25 balles chez le médecin) et rester chez toi, ou bien braver les éléments et aller au bureau comater. Alors que tu pourrai bosser depuis chez toi et récupérer plus vite.
#24
Le salarié de SSII a signé pour se faire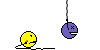 " />
" />
 " />
" />
#25
+1 (snif)
Dans les deux dernières boites que j’ai faites le télétravail est mal vu parce que… parce que. Dans ma boite du moment ils ont laissé partir le meilleur dev qui avait demandé au moins 2 jours de télétravail par semaine parce qu’il a un trajet monstre chaque jour genre 3h A/R (et dont on avait pourtant la garantie que le mec n’en profitait pas pour se tourner les pouces). Mais ils ne voulaient pas que ca donne des idées à d’autres employés parce que … parce que.
#26
#27
#28
#29
C’est une moyenne : il a normalement un peu moins mais il se tapait les lignes les plus foireuses d’IdF… Il bougeait pas parce que sa femme enseignante était pas loin de son école et que c’était mieux pour les gosses + avoir un petit pavillon plutôt que s’entasser dans un 50m2..
 " />
" />
MAis oui moi je pourrais pas
#30
Oui je sais que tout le monde n’est pas aussi obtus, encore heureux et tant mieux…
Mais bcp de boites craignent le télétravail c’est certain, comme tout un tas d’autres changements tenant à l’organisation du travail.
Par exemple toutes les études montrent que la sieste est ultra bénéfique en termes de productivité… Mais ds combien de boites est-ce possible sans passer pour une grosse feignasse?
#31
malheureusement très courant dans les plus grosses agglos
#32
de la pme de 50 personnes c’est suffisant
#33
Ca prend du temps, mais faut aussi voir qu’un trajet en RER c’est pas un trajet en métro.
Je suis à 1h15 porte à porte (10minutes de voiture, 1h de RER avec un changement, 5 minutes à pied), ben je trouve que ca se fait. Et j’échangerais pas contre même 30minutes de métro.
Dans le RER on est assis. Quand on sort de Paris, le RER est en extérieur
Le métro c’est généralement debout dans des tunnels. Selon les lignes, tu es balloté à droite et à gauche.
C’est un rythme à prendre mais ya des avantages :)
#34
#35
#36
Ici société moins de 30 personnes, pas question qu’un matériel informatique non administré par la boîte entre sur le réseau interne (VPN compris, bien sûr).
Donc télétravail => PC portable fourni. Pour les linuxiens, en général ce portable sert à se connecter à la station de travail qui est restée sur le bureau, et de là on bosse comme d’habitude.
#37
Pour faire les 2 je suis bien d’accord avec toi. Mais quand t’as une famille, un taff, et peut-être même (soyons fous) d’autres activités non praticables dans le rer (il y en a), -3h dans une journée c’est lourd quand même.
#38
Me suis fait insulter quand j’ai voulu m’entrainer pour ma compet de tir-à-l’arc la dernière fois.
 " />
" />
Saleté de banlieusard aigris
#39
#40
Hmmm…. Ca dépend de la mentalité de la PME. Tu en as qui préfèreront faire venir des cow-boys (ou un pote “qui s’y connait”) une fois de temps en temps, parce que 50 personnes, c’est justement le point où tu commences à vraiment en avoir besoin, mais où c’est pas encore “rentable” d’employer un mec à plein temps pour s’occuper de ça.
#41
#42
Je parlais de longs trajets.
Cest sur que si tu prends le RER juste avant Paris, t’as difficilement de la place, mais t’as pas 1h à faire non plus..
#43
Je plussoie. Je complémente même ton post en disant que si l’endroit où tu vas ne se trouve pas entre là où tu es et Paris, ben c’est la misère.
#44
Utilisé son propre matos pour bosser, ce ne sera plus d’actualité chez nous en tout cas.
 " />
" />
La sécurité des postes et applis (paramétrages, licences, durcissement, niveau de patch, etc) ne peut être suivit et assuré sur le matériel personnel.
Par conséquent, le télétravail ne peut se faire qu’avec un PC pro et là ce sera de toute façon à l’employeur de le fournir, fort heureusement c’est 95% de portable.
#45
Il existe d’autres solutions que fournir le matériel pro.
Un portail web qui après avoir vérifié que sur ta machine perso tu as certains prérequis (antivirus dans une certaine liste et à jour, updates windows à jour) te monte un applet Citrix pour bosser depuis chez toi, c’est comme si tu étais au boulot et c’est sécurisé.
Le VDI risque d’être le vrai avenir du télétravail, à condition de rester assez étanche entre hôte perso et machine à distance.
#46
#47
« Il y a un renversement de l’initiative de la demande de passage en télétravail, analyse de son côté l’avocat Grégory Saint Michel. Dorénavant, cette requête pourra émaner du salarié, et ce sera à l’employeur d’expliquer pourquoi il s’y opposerait. »
Le fait d’être loin de l’équipe, ce n’est pas quantifiable, donc ça fonctionera toujours. Histoire de toujours cacher qu’on n’a pas confiance.
#48
Il y a d’autres aspects que la connexion web qui doivent être pris en charge, comme par exemple le coût des locaux (implicitement il faut un bureau pour travailler, ce qu’on n’a pas toujours de base) et l’électricité. Ces coûts sont à la charge de l’employeur.
Par exemple, dans mon entreprise, c’est 15€ pour l’employé par jour de télétravail. Et l’entreprise est contente parce que ça limite les frais liés au locaux de l’entreprise. Lorsque la place est chère, pouvoir placer 22 ou 23 personnes dans un openspace de 20 sans jamais le remplir, grâce au télétravail et au temps partiels, ça fait économiser plus de 15€ par jour à l’entreprise.
Par contre pour le matériel comme le PC, je considère que c’est aussi à l’entreprise de le fournir, ou alors l’inclure dans les frais de télétravail
#49
si il y a une suite de logiciels complexes, la solution est de passer par des sessions terminal server.
et c’est encore plus adapté au télétravail !
j’ai installé beaucoup de serveurs terminal server dans ds entreprises ayant une suite d’applications métier complexe. ça évite de maintenir x postes de travail. là il y en a juste un (le serveur).
les terminaux peuvent etre n’importe quel PC ou client léger ou même tablette.
La plupart du temps, la direction prend cette décision pour rationaliser les couts et simplifier les maintenances, mais après un certain temps l’entreprise comprend que ça facilite grandement aussi le télétravail.
Les employeurs trouvent largement leur compte dans le télétravail quand l’architecture le permet.
#50
tu laisses ta station de travail au bureau, et tu fais une session bureau à distance depuis chez toi.
nécessite ip fixe au taf + redirection d’un port externe vers l’IP de ta station, port 3389. ou mieux un VPN
#51
#52
Sur ma machine perso, il n’y a pas d’updates windows à jour.
Par contre, les apt-get upgrade sont faits régulièrement.
Pas de télétravail comme ça pour moi alors :-(
Heureusement que le portable de la boite est OK.
#53
#54
Ça marche aussi avec des Linux et même MacOS. A voir avec ton admin chéri.
Ça fait longtemps que plus personne ne se déplace pour les migrations/maintenances du weekend où les astreintes du milieu de la nuit et Windows n’est pas vraiment la tendance à domicile. Les admins sont les premiers concernés aussi par le télétravail en général.
#55
#56
Arf enfoiré!!  " />
" />
#57
mmmmmh sûr que selon les métiers et le type des boites les conditions pour mettre ça en place ne sont pas les mêmes. Dans la mienne on est typiquement dans le cas où c’est possible facilement pour pas mal d’employés (pas moi par exemple…). Pour les devs notamment, même le daily scrum se fait à l’aise en visio
#58
Les raisons pour refuser ne sont pas compliqué à trouver :
Risques de fuites de données accrues
Coût supplémentaires pour l’entreprise pour colmater certaines failles humaines qui mèneraient aux fuites de données, sachant que la faille “regarder par dessus l’épaule” sera compliqué à résoudre.
#59
Rien n’empêche de faire en sorte que son ordinateur mente au service si on est administrateur de la machine.
Ton portail requiert forcément un petit quelque chose en plus que ton navigateur, le navigateur va pas distribuer laliste des logiciels et mises à jours installés comme ça gratos.
Même si tu essaies de tricher avec la liste des polices installées, ça ne permet pas de savoir si les logiciels de sécurité sont à jours.
#60
Ça dépends vraiment dans quoi tu bosses
#61
On doit pas prendre le même RER :
Je suis debout, les places assises sont déjà toutes occupées, on cogne sans cesse mon dos, mon sac contenant mon matériel.
Même constat dans le métro.
Et encore, avant on me marchait sur les pieds quand je portais des converses, mais ça bizarrement ça n’arrive plus avec les new rock.
#62
Bien trop de flou.
A une époque ou la sécurité informatique est un enjeu stratégique, jusqu’où une entreprise peut “écouter, vérifier, modifier, contrôler” les données qui transitent, même temporairement stockées sur un matériel non approuvé par l’entreprise qui n’en a pas fait l’installation logicielle?
La seule solution est que l’entreprise fournisse le matériel sur lequel elle aura loisir de préserver le niveau de sécurité qu’elle décide d’appliquer (le tout en respectant la loi en vigueur).
C’est valable pour tous les périphériques de communication et de stockage (smartphone, tablettes, clé usb..) que peut fournir l’entreprise si elle veut exercer un contrôle lié à l’utilisation et à la sécurité des données de l’entreprise.
Reste l’usage des imprimantes, les box ou modem/routeurs et la fiabilité du réseau de l’employé qui peut ne pas garantir un minimum de sécurisation des données.
Du coup, l’employeur pourra-til exiger une mise en conformité avec ses exigences en matière de sécurité informatique des installations informatiques d’un employé?
l’employé devra-til se soumettre à des contrôles ou des audits de sécurité?
Jusqu’où aller en définitif si on considère que le logement du salarié est alors une extension du bureau de l’employeur?
#63
aux USA…200⁄300 km. c’est “Cats’jump” (saut d’puce), ils n’ont pas les-mêmes
 " />
" />
valeurs des distances qu’en Europe !
#64
Ouai je sais bien, enfin moi si je passe plus de 30 minute sur le trajet, qu’il fasse 5km ou 1000km, ça me fait bien chier " />
" />
#65
#66
La principale contrainte en France ce sera le management à la française où on t’évalue à la “loyauté” (comme à l’école ou en politique) plutôt qu’en fonction de ce que tu produis, où les compétences sont généralement personnalisées parce que 1/ se rendre indispensable c’est le moyen de rester pour le salarié 2/ ça nécessite de passer du temps à documenter et d’avoir un management structuré d’organiser la polyvalence (et le manager français moyen… voilà quoi).
 " />
" />
 " />
" />
Pour la même raison que plein de boites ferment en aout pour que tout le monde soit absent au même moment, pour la même raison que plein de boites pressurisent à mort les gens pour le présentéisme (des fois qu’il arrive quelque chose sur ton domaine de compétence que toi seul connais quand tu n’est pas là) le télétravail généralisé ce n’est pas pour demain.
Et vu comme les ordonnances macron cassent le reste des protections du salarié le fait que ce soit un “droit” ne va rien changer du tout : Puisque l’employeur pourra licencier et harceler à volonté sans qu’il ne risque plus de deux mois de salaire à payer dans plusieurs années aucun droit ne sera plus revendiqué dans les petites structures…
Et il y a un triste paquet d’imbéciles qui se réjouissent des ordonnances macron juste sur ce point du télétravail sans voir tout le reste…
En même temps il a bien fallu des idiots pour l’élire donc
#67
Je me suis mal fait comprendre:
Je répondais à un commentaire (sais plus lequel, ni de qui) qui parlait de télé-travail depuis la machine personnelle du salarié, sous condition de présence de certains logiciels dessus.
Mais ces logiciels sont des logiciels spécifiques à Windows, donc il y avait une condition supplémentaire sur l’OS du PC concerné, et c’est ce que je voulais mettre en évidence (et c’est raté, donc)
#68
Désolé pour toi, dans ce cas oui, vaut mieux écourter le trajet.
Perso cest RER C depuis la branche Sud ( Brétigny) et c’est largement vivable
#69
Après pour ta défence, c’est super compliqué de faire approuver une conf. linux si tu n’es pas membre de la DSI, voire même de l’équipe infra. Ca prend du temps donc à part pour les collègues qu’on connait bien, c’est jamais fait en pratique.
#70
Ben, Cergy, c’est le bout de la ligne A…
 " />, mais presque pas en fait
" />, mais presque pas en fait  " />)
" />)
Ah ben voilà, le RER C, c’est pas un vrai RER, c’est un tortillard ! (
#71
À lui seul non (ya qu’une boucle) mais si tu y ajoutes les autres lignes (TER et marchandises) qui emprunte les mêmes rails, tu peux te retrouver avec un paquet de noeud :)
Et bon télétravail demain à tous les RER-iens \o/