En une seule séance nocturne, les députés ont adopté le projet de loi sur le terrorisme défendu par le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. Mais les députés ont rejeté l’extension du blocage ou l’incrimination de la consultation habituelle de sites terroristes. Le texte revient au Sénat par le jeu de la navette parlementaire.
Tous les amendements visant à étendre le blocage des sites pédopornographiques au blocage des sites faisant l’apologie du terrorisme ont été rejetés. On sait que la mesure avait été appréciée avec des pincettes par Manuel Valls, lequel toutefois laissait la porte ouverte en Commission des lois. « Si d’ici le débat en séance (...) on peut trouver une solution qui permette au moins, alors sous forme provisoire ou d’évaluation, au moins en signalant le sujet, le ministre de l’Intérieur (...) n’y serait pas défavorable. Parce que je sens bien qu’il faut commencer à travailler et que nous aurons besoin de faire évoluer ce texte ». Valls laissait ici entendre qu’il ne serait pas contre un test.
L’opposition avait pris le ministre au mot et proposé dans un amendement de tester ce blocage des sites faisant l’apologie du terrorisme pour une durée de deux années, avant une entrée en vigueur pleine et entière.
Captation de données
La rapporteur Marie-François Bechtel s’opposera d’abord à cette extension : avant d’étendre le blocage des sites pédopornographiques à d’autres domaines, estime la députée, il faudrait d’abord évaluer son efficacité, « afin d’abord d'évaluer les choses de manière posée et efficace ». En outre, la modification n’est demandée ni par les magistrats spécialisés ni par les services du renseignement. Enfin, cela créerait surtout des obstacles pour la découverte de certains éléments. « En revanche, l’imagination voudrait (…) à ce que l’apologie du terrorisme sur internet puisse conduire à la captation de données, qui serait beaucoup plus utile que le blocage des sites. Mais là-dessus, il n’y a pas de propositions. Le gouvernement, je crois, est prêt à travailler, mais cela pose encore des problèmes constitutionnels un petit peu délicats sur lesquels le texte n’a pas encore pu prendre ».
Pour Manuel Valls, la lutte contre les sites à caractère terroriste pose un problème complexe « car elle touche à la liberté d’expression » et impose donc de trouver un équilibre au regard de nos normes constitutionnelles et celles européennes. Le ministre fait état en outre d'« une infrastructure très lourde pour un résultat aléatoire au détriment d’autres axes d’investigations et de surveillance de la mouvance terrorisme ». Valls l’assure, par ailleurs : « le recours au juge doit être la règle et les procédures administratives, l’exception. » Enfin, l’article 6-I-8 de la LCEN permet déjà un retrait judiciaire rapide des contenus litigieux par fois de référé (l'article avait été mobilisé dans l'affaire Copwatch, par exemple).
« Par un souci d’efficacité ou de cohérence, le gouvernement est davantage enclin à sanctionner celui qui met en ligne ou permet la mise en ligne de tels contenus. ». Comment ? Par l’incrimination de l’apologie de terrorisme ou le délit d’association de malfaiteur en vue d’une entreprise terroriste.
Visiblement, des arbitrages gouvernementaux ont remis les pendules à l’heure, mais Valls n’a pu s’empêcher de clore tout débat : il ajoute à la fin de son discours que le gouvernement pourra évoluer sur ces questions, « dans les années qui viennent ». Plutôt qu’une expérimentation, il promet un rapprochement entre le ministère de l’Intérieur et le parlement « pour approfondir » le sujet. « On doit prendre le temps »
Loi sur la presse ou Code pénal
Même sort funeste pour les amendements visant à sanctionner non plus dans la loi sur la presse de 1881, mais dans le Code pénal ceux qui provoquent directement à des actes de terrorisme ou font l’apologie de ces actes. Les peines, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, auraient été portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits auraient été commis en ligne. L’insertion de ces délits dans le Code pénal aurait permis d’appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun (saisie, contrôle judiciaire, détention provisoire, comparution immédiate, etc.).
Des grands sabres noirs, de la musique obsessionnelle
Sur le délit de consultation des sites terroristes, on se souvient des propos de Nathalie Kosciusko-Morizet qui citait cet exemple en commission des lois : « L’une de mes employées de mairie a été mariée pendant vingt ans à un homme qui s’est engagé dans un processus de radicalisation ; elle en est aujourd’hui séparée, mais elle a quatre fils, parmi lesquels les deux aînés, engagés dans le même processus, sont manifestement surveillés ; quant au troisième, il a quinze ans et subit l’influence de ses frères, qui vivent avec le père et lui donnent des adresses de sites Internet montrant des scènes de décapitation, par des hommes munis de grands sabres noirs, sur fond de musique obsessionnelle. »
Une pluie d’amendements était tombée dans le cadre du projet de loi Valls pour punir la consultation habituelle de sites terroristes à l’instar du projet de loi souhaité par Nicolas Sarkozy. Là encore, l’opposition s’était engouffrée dans la brèche ouverte par Valls en proposant d’expérimenter la mesure pendant deux ans.
La commission des lois refusera la mesure, avec la bénédiction du ministre de l’Intérieur. Au plan pratique, elle estime que l’utilité n’est pas évidente. Sur le plan des principes, la rapporteur dénonce une « absence de précision préoccupante » dans la définition des dispositions ce qui pose problème au regard du principe de légalité des délits et des peines. Elle note aussi que par le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et surtout de l’application de la loi pénale la plus douce, si l’expérimentation est abandonnée à terme, toutes les poursuites engagées tomberont sur le champ. « On va tout de même pas créer la première incrimination pénale à caractère expérimental ! » commentera dans le même sens le député Jean-Yves le Bouillonnec, « ce dispositif est ajuridique au vrai sens du terme. »
Le texte a donc été voté par les députés tard dans la soirée sans ces dispositions prônant le blocage ou l’incrimination de la consultation habituelle de site.
Quand l'expérimental s'incruste dans la durée
Notons cependant que le projet de loi proroge jusqu’en 2015 les mesures exceptionnelles de la loi de 2006 contre le terrorisme. Le Gouvernement promet que c’est la dernière fois que les dispositions de l’article 6 de la loi de 2006 sont étendues dans le temps. Initialement, ce texte n’était applicable que jusqu'au 31 décembre 2008. La loi du 1er décembre 2008 a cependant prorogé de quatre ans cette application soit jusqu’au 31 décembre 2012. L’article 1 de la loi Valls ajoute trois années de plus au compteur.
La loi de 2006 « donne la possibilité aux services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme d'accéder dans le cadre de la police administrative, à différents traitements automatisés. ». C’est ce dispositif qui permet les réquisitions administratives des données de connexion, celles détenues par les FAI durant un an (« données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date de la communication »).
![[MàJ] Le projet Valls voté, sans blocage ou consultation illicite de site terroriste [MàJ] Le projet Valls voté, sans blocage ou consultation illicite de site terroriste](https://cdn.next.ink/inpactv7/data-next/images/bd/wide-linked-media/0.jpg)


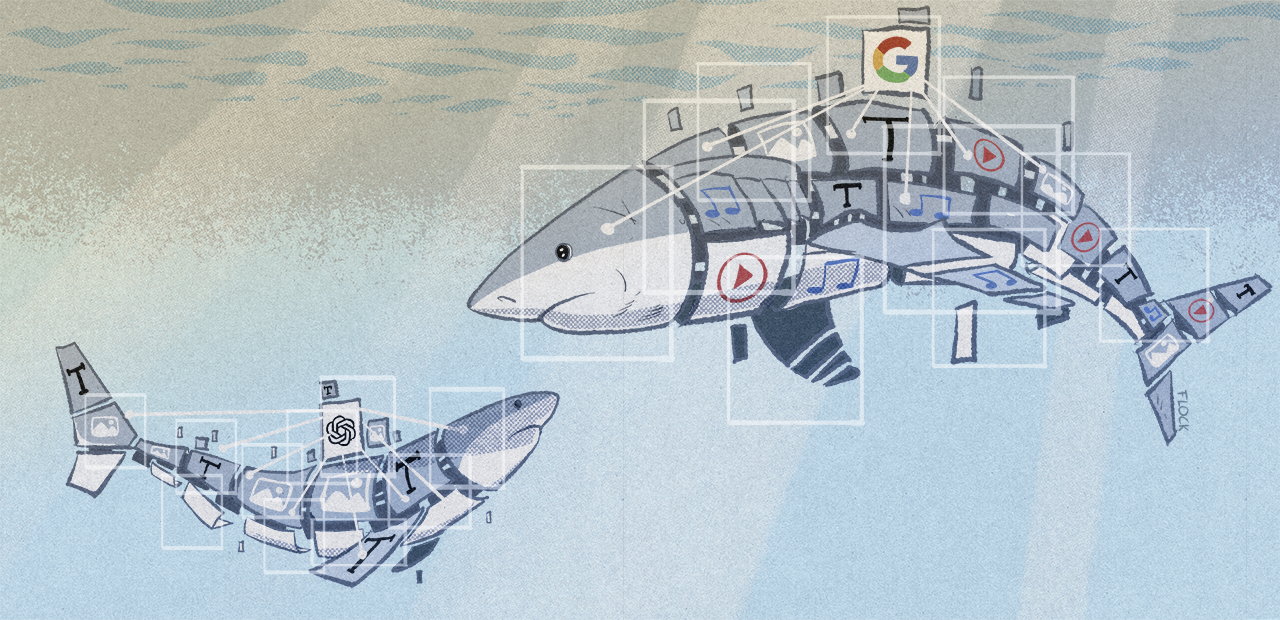

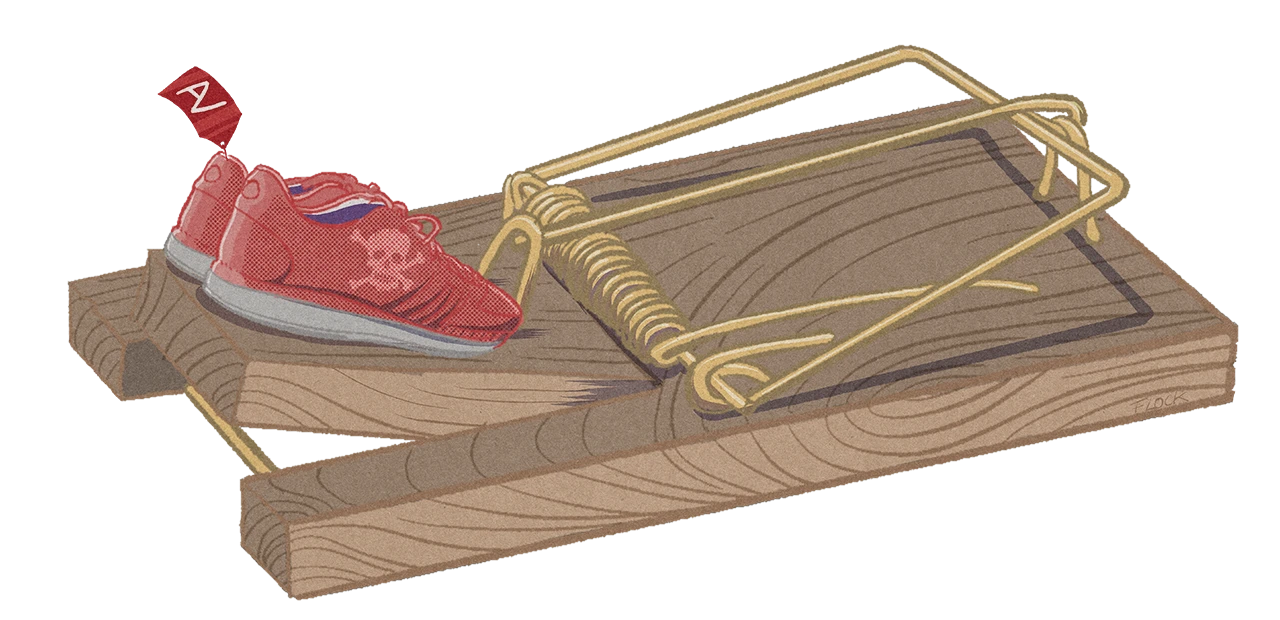
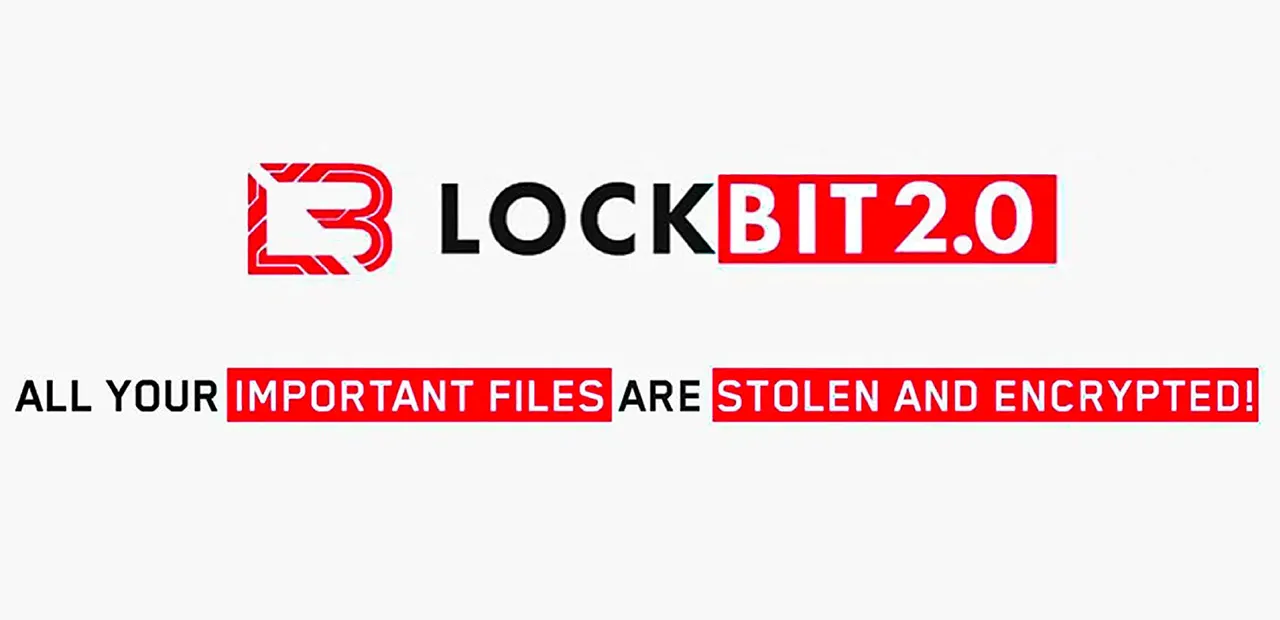
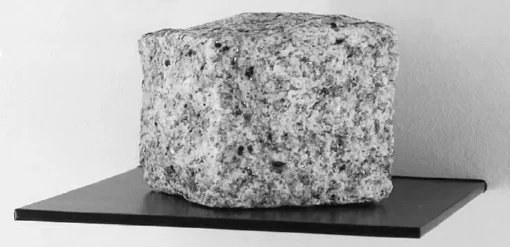


Commentaires (34)
#1
Le texte part revient au Sénat par le jeu de la navette parlementaire.
Manuel Valls
Premier paragraphe.
#2
Le changement, c’est maintenant
 " />
" />
#3
C’est marrant quand même : beaucoup ont loué la gauche et au final, elle va réussir à faire passer tout ce que l’UMP n’a pas osé faire " />
" />
#4
#5
Ils gardent sûrement pour plus tard " />
" />
#6
Mode PMU
#7
Le Gouvernement promet que c’est la dernière fois
Et la prochaine fois, ils promettront que c’est vraiment la dernière…
Et la fois d’après, suite à des événements (poussés en douce par eux), ils diront que cette loi est vraiment nécessaire…
#8
Kosciusko-Morizet emploie vraiment n’importe qui " />
" />
#9
….
#10
http://www.francetvinfo.fr/un-depute-ump-fait-le-lien-entre-terrorisme-et-enfants-d-homos_177725.html#xtor=AL-54
 " />
" />
On voie le niveau d’intelligence des députés sur le sujet du terrorisme.
Désespérant.
#11
#12
#13
Pour l ‘ argument de la décapitation, autant interdire tous les films d ’ horreur car là, pour le coup, on voit bien pire.
#14
Ils en profitent tant que la presse parle que de l’UMP, comme ça les lois bonne ou mauvaises passent sans faire crier ici ou là.
#15
L’a pas encore valsé, Valls… " />
" /> " />
" /> " />
" />
 " />
" />
#16
un retrait judiciaire rapide des contenus litigieux par fois de référé
Ach so!!
#17
#18
#19
#20
montrant des scènes de décapitation, par des hommes munis de grands sabres noirs, sur fond de musique obsessionnelle.
Hum… attend, et le sang n’avait t’il pas comme une consistance d’une gelée? Et que les mecs perdent environs 150L de sang avant de se sentir un peu fatiguer? Sisi, je crois connaitre, et il y a un rouquin dans le tas qui se trimbale avec une grosse fucking épée compensatrice? En effet, la BO est pas mal.
#21
C’est marrant toute ces lois “secondaires” et parfaitement inutiles pour qui connaît un peu le net.
Et pendant ce temps là, la planète France se rapproche de la Grèce…
#22
#23
Celui-ci considère que « la multiplication des sites internet et la propagande djihadiste qu’ils diffusent permettent d’attirer de nouvelles recrues. Certains jeunes sont endoctrinés, des réseaux renforcent leur puissance dévastatrice en diffusant leur propagande ou en organisant des camps d’entraînement en Afghanistan et au Pakistan. Nous ne sommes plus à l’abri, comme nous l’a démontré l’affaire Merah (…). »
oui enfin la théorie comme quoi Merah était un loup solitaire qui s’était auto-formé sur internet a fait long feu. tout comme son auteur, un certain Bernard Squarcini…
non mais lol quoi.
#24
Le socialisme en 2012 si je comprend c’est : laisser faire les terroristes ce qu’ils veulent ou dire ce qu’ils pensent et faire fuir les riches ainsi que les entreprises, y’a comme un truc qui cloche ou alors notre cher président n’est pas du tout ce qu’il prétend être….
#25
Le problème sur ce qu’ils demandent c’est que au début tu les autorises à fermer un site pour terrorisme, punir la consultation et que les ayants droits sont capables de te rajouter le “terrorisme culturel” à la place du piratage …
Mais dans le fond je trouve cela logique d’interdire les sites faisant l’apologie du terrorisme, le problème c’est que les terroristes des uns sont les résistants des autres. Du coup ce type de loi peut se retourner contre nous à un moment ou un autre.
#26
#27
#28
#29
Flamby démission avant que ça soit trop tard …
#30
Flanby avait dit, “le changement c’est maintenant”, par contre il a pas précisé quoi, peut-être qu’il a juste changé de string. " />
" /> " />
" /> " />
" />
#31
#32
#33
le recours au juge doit être la règle et les procédures administratives, l’exception.
&
Par un souci d’efficacité ou de cohérence, le gouvernement est davantage enclin à sanctionner celui qui met en ligne ou permet la mise en ligne de tels contenu
-> Question débile : pourquoi est-ce que personne n’a pas eu ces idées de bon sens avant ?
Utiliser les juges pour cadrer légalement les intervention et mettre la priorité sur l’arrestation de ceux qui mettent le contenu illégal sur Internet (et donc attaquer la source du problème) me parait logique.
#34
[MODE LETTRE COURTE ET OUVERTE=“on”]
Nous regrettons notamment que les amendements visant à pénaliser la consultation, voire à bloquer des sites internet faisant l’apologie du terrorisme n’aient pas été adoptés, car il s’agit là d’outils redoutables et malheureusement très efficaces de recrutement et de prosélytisme » a soutenu ce mercredi le député (UMP) Jacques Alain Bénisti.
Cher M. Bénisti,
quand vous regrettez la non adaptation des amendements visant la pénalisation, la consultation, voire le blocage de site, j’espère que vous vous rendez compte que le terrorisme sur internet est du même accabit que les publicitaires produisent comme travail, qui est en grande partie une apologie de la consommation/abrutissement de masse.
Si vous vous en rendez compte, alors pourquoi ne pas amender contre la diffusion de doctrine consommatrice, consumériste et débilitante ?
Je ne peux que me permettre de vous conseiller que lorsque vous pensez à une idée, de pouvoir l’appliquer dans tous les domaines svp, et non que sur les points qui vous arrangent. De grâce, soyez cohérent.
[MODE LETTRE COURTE ET OUVERTE=“off”]