De la montée en débit aux réseaux en fibre, la Commission européenne a analysé en profondeur le financement du plan très haut débit français. S'il est validé, les points de vigilance ont été nombreux pour l'institution, dont le travail a été une véritable épreuve pour les équipes de Bercy.
En novembre, la Commission européenne déposait son blanc-seing sur le plan France THD, après deux ans d'une instruction douloureuse pour l'État français. Il y a quelques semaines, l'analyse de la Commission était enfin publiée, avec le détail de ses considérations. Si la conclusion du document de 75 pages est positive, il offre une plongée dans les réseaux publics et le financement de la montée en débit.
Ces deux ans de travail ont été vécus comme un traumatisme par certains responsables de Bercy, qui nous ont affirmé avoir fait face à des agents peu au fait des télécoms à la Commission européenne. Si le besoin de pédagogie sur le projet français, décrit comme particulier, était bien mentionné par nos ministres, il semblait s'agir d'une bataille permanente pour la Direction générale des entreprises (DGE), en charge du dossier côté hexagonal.
Les nombreuses garanties politiques, apportées notamment par la commissaire Margrethe Vestager, n'ont pas suffi à une validation rapide. Les doutes européens ont été nombreux pendant l'instruction, notamment autour de la montée en débit, reconnue comme un point bloquant par des personnes proches de Bercy. À l'été 2015, Bruxelles considérait des subventions antérieures au plan France THD comme illégales, une analyse bien éloignée de l'actuelle.
Il reste que les subventions des opérations menées par Orange, spécifiquement la montée en débit, occupent une part importante de l'analyse de la Commission. L'espace est partagé avec les réseaux publics, notamment la collecte (qui les relie à Internet), un point d'interrogation pour l'institution.
13,3 milliards d'euros dans les réseaux publics, en majorité pour la fibre
Pour mémoire, le plan France Très Haut Débit consiste à coordonner et financer les futurs réseaux Internet du pays (voir notre analyse). D'un côté, les opérateurs privés déploient sur fonds propres la fibre pour 57 % de la population en zones urbaines (zones très denses et moins denses), pour environ 7 milliards d'euros.
De l'autre, des réseaux publics sont montés par les départements et régions dans les zones peu denses, voire rurales, pour un total de 13,3 milliards d'euros, dont 3 milliards sont subventionnés par l'État.

L'ensemble est piloté au sein de l'Agence du numérique, à Bercy, qui doit à la fois s'assurer d'amener assez vite de meilleurs débits (par exemple via la montée en débit sur cuivre) et qu'en 2022, tous les Français disposent bien tous du très haut débit, dont au moins 80 % en fibre. Elle analyse chaque dossier de collectivité, pendant de longs mois, avant de donner son accord pour financement.
Comme le récapitule la Commission, les 13,3 milliards d'euros sur la partie « publique » sont répartis comme suit :
- 11 milliards d'euros pour des réseaux NGA (comprendre en fibre jusqu'à l'abonné)
- 1,1 milliard d'euros pour les réseaux de collecte
- 700 millions d'euros pour la montée en débit
- 500 millions d'euros pour le haut débit dans les zones rurales isolées
Rappelons que tout cet argent n'est pas public, des fonds privés et les opérateurs construisant les réseaux pour les collectivités pouvant contribuer à ces coûts. La répartition semble être équilibrée entre public et privé, ce dernier étant bien plus actif depuis 2015, comme le constate Bercy et les industriels des réseaux publics.
Pas de distorsion de concurrence sur les réseaux publics
Ces réseaux peuvent être gérés de différentes manières. La collectivité terroritoriale (un département ou une région) peut soit construire son réseau et déléguer à un tiers son exploitation (marché de service ou délégation de service public en affermage), déléguer toutes les tâches à un tiers (délégation concessive), confier la responsabilité du réseau à un opérateur tiers le temps de l'amortir (contrat de partenariat) ou bien se retrousser les manches pour construire et exploiter elle-même son réseau (régie).
Au fond, la Commission semble avoir bien peu de critiques à émettre sur ces modèles. Elle estime qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence, car aucune construction de réseau privé n'est officiellement prévue sur ces zones. En 2011, les opérateurs nationaux ont délimité celles qu'ils comptaient fibrer à leurs frais, laissant le reste aux collectivités. Un choix critiqué, qui a pourtant le mérite de la clarté pour l'institution européenne.
Même si des opérateurs privés peuvent y investir en propre plus tard, la nature ouverte des réseaux publics (obligés d'accueillir tout opérateur sans discrimination) et le fort contrôle public sont des garanties suffisantes pour la Commission. Dans le cas où un opérateur tiers construit, gère ou commercialise un réseau public, le passage par un appel d'offres public serait aussi satisfaisant.
Des subventions utiles dans les « zones blanches NGA »
Concernant les subventions de l'État pour ces réseaux en fibre, pour près d'un quart de leur budget, « l'aide est le moyen d'action approprié » avec « un effet d'incitation », pense Bruxelles. « La réglementation ex ante [existante], qui sert l'efficacité du système, serait également en elle-même insuffisante pour déclencher un déploiement d'un réseau haut débit à grande échelle » note la direction de la concurrence.
Les financements décidés par le gouvernement doivent tout de même bien concerner uniquement les « zones blanches NGA », c'est-à-dire celles où le déploiement d'un réseau très haut débit par un opérateur privé n'est pas prévu dans les trois ans. Le découpage de 2011 fournit bien une garantie importante pour l'institution, qui note que 90 % des subventions sont prévues dans des zones sans initiative privée.
La neutralité technologique serait aussi respectée. « Le régime en examen ne favorise aucune technologie ni plateforme de réseau particulières, les opérateurs commerciaux étant autorisés à [utiliser]les solutions technologiques qu'ils jugent les plus appropriées » affirme la Commission. La fédération des industriels des réseaux publics (Firip) a pourtant obtenu des avancées sur les réseaux radio de la part de Bercy, en se plaignant à Bruxelles d'une inégalité de traitement, causant la colère du ministère français (voir notre analyse).

L'épine des réseaux de collecte
Les réseaux de collecte, qui servent à relier les réseaux publics aux cœurs de réseau des opérateurs, sont aussi un point d'importance. Orange dispose du plus important réseau de collecte du pays, fourni depuis une décennie via une offre (LFO) régulée par l'Arcep. Il est devenu indispensable à bien des réseaux publics, qui se connectent à Internet par ce biais.
Les limites de ce modèle sont bien notées par « les autorités françaises » (comprendre l'Arcep et Bercy), qui ont dû longuement se justifier sur ce point. « Les autorités françaises considèrent la diversification de la collecte comme une condition sine qua non à la poursuite du déploiement du très haut débit » écrit la Commission.
Le problème se pose comme suit : les capacités d'Orange seront insuffisantes pour tous les réseaux publics et Bercy exclut clairement que l'investissement privé suffise à combler ce manque. Conclusion à demi-mot du rapport : les collectivités devront pour partie monter leur propre réseau de collecte, qu'il s'agira de subventionner seulement quand nécessaire.
Selon les autorités françaises, citées par la Commission, il n'est pas question de toucher au cadre actuel, écrit et éprouvé de longue date, et dont la modification demanderait un travail et un temps trop importants. En attendant, reconnaît le ministère de l'Économie, Orange n'a aucune pression pour aller au-delà de ses obligations légales.
Dans ces conditions, une collectivité pourra monter son propre réseau de collecte s'il ne duplique pas un réseau existant auquel elle peut avoir accès. Il faut donc prouver que l'actuel lui est inaccessible ou qu'aucun n'existe. Charge aux « autorités françaises » de le vérifier à chaque fois.
Une montée en débit jugée efficace
Vient ensuite le moment de parler de la montée en débit, qui consiste à tirer la fibre jusqu'à des sous-répartiteurs du réseau téléphonique pour en améliorer les débits, en finissant toujours le réseau en cuivre. Il s'agit d'une solution d'attente pour les zones où aucun nouveau réseau n'est prévu dans les trois ans, note la Commission. Cette dernière a donc cherché, dans ce cadre, à savoir si le financement public correspond bien aux coûts de l'opérateur historique.
Rappelons qu'en 2015, nous avions révélé qu'Orange poussait fortement cette solution auprès des petites collectivités, parfois au détriment du plan posé par le département ou la région. Des élus nous évoquaient un double discours, au moment où l'opérateur s'affichait en grand soutien du plan France THD. Depuis, collectivités et régulateur l'ont épinglé pour une publicité indue sur les armoires qu'il posait dans ce cadre.
Après de très nombreux calculs, sur la base de données fournies par Bercy, la Commission affirme qu'Orange ne surfacture en rien les armoires qu'elle vend aux collectivités, dans le cadre de son offre PRM. Cette dépense ne constitue d'ailleurs pas une aide d'État, assure l'analyse européenne.
Orange respecterait ses coûts, une marge n'est pas exclue
Un répartiteur « montée en débit » (NRA-MED) engendrerait un coût de 41 877 euros pour Orange, un montant bien inférieur aux 44 064 euros que pourrait afficher un opérateur « efficace ». Deux notes, tout de même. La première est que le coût de 44 064 est le montant le plus bas trouvé par la Commission, dans la fourchette qu'elle a calculé. La seconde est qu'un opérateur « efficace », au sens de Bruxelles, peut engranger une marge (indéterminée). Sur la maintenance, le coût de 900 à 1 200 euros correspond au montant « efficace ».

La Commission indique donc bien qu'Orange agit selon ses coûts, mais pas qu'il n'en tire absolument aucune marge. « Les paramètres ont été fixés de telle manière qu'Orange ne fasse aucun profit [...], en tenant compte des recettes y afférentes ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligation » écrit précisément l'institution.
Elle rappelle tout de même que la montée en débit ne doit pas concerner plus de 1,5 million de lignes cuivre, « ce qui reste en tout état de cause limité ». La prévision actuelle tournerait plutôt aux alentours de 800 000 lignes, face à environ 7 millions de lignes fibre au final.
« Les autorités françaises ont apporté des preuves solides et spécifiques démontrant que, pour chaque prestation comprise dans le SIEG [Service d'intérêt économique général] confié à Orange, les coûts du prestataire Orange sont conformes aux prix de marché » conclut-elle.
Un bilan positif, sur le papier
Sans surprise, la Commission estime donc, au terme de son analyse et de deux ans de dialogue avec la France, que les effets négatifs du système mis en place sont bien moindres que les positifs. Il est donc validé sans grande réserve par la direction de la concurrence, qui rappelle tout de même que le plan sera régulièrement contrôlé.
« Le régime notifié, qui est d'envergure nationale, fera l'objet d'une évaluation par un expert indépendant », France Stratégie côté gaulois. Un rapport de suivi annuel est aussi prévu, avec la liste des aides, les technologies concernées et les résultats en termes d'aménagement de débits. En outre, « les autorités françaises s’engagent à fournir tous les deux ans à la Commission européenne les informations essentielles sur les projets de réseaux subventionnés dans le cadre du plan THD ». Cela en plus d'un rapport à mi-parcours et d'un final, au 31 décembre 2022.
Il reste que l'analyse européenne semble rester assez théorique, fondée sur les évaluations de l'Arcep, de Bercy et de la documentation officielle (dont le cahier des charges de 2015). Elle ne revient pas sur certains freins concrets, par exemple sur l'accès au génie civil, parfois considéré difficile pour les concurrents d'Orange, ou la bataille entre Orange et SFR sur les déploiements en zone moins dense.
Elle s'intéresse aussi surtout au volet délimité par le plan, c'est-à-dire le déploiement du très haut débit jusqu'en 2022, alors que la Cour des comptes rappelait que bien des projets de réseaux publics se clôturent plutôt en 2030 (voir notre analyse). Autant de points qui seront (sûrement) abordés dans de futures analyses.




























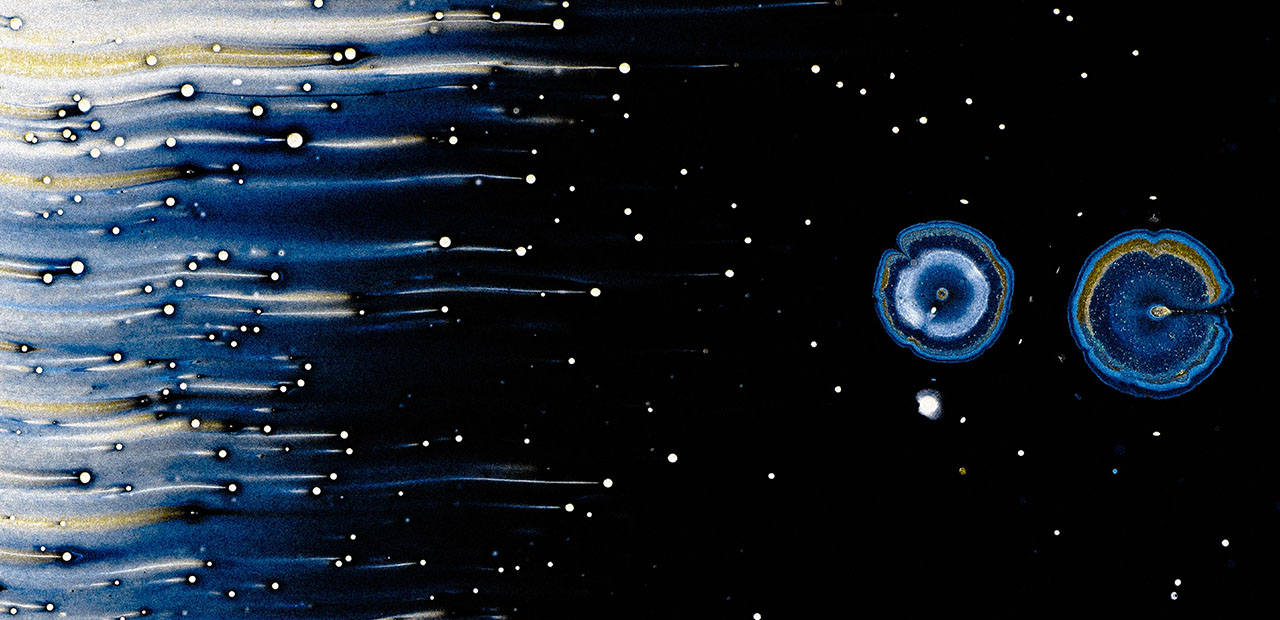


Commentaires (21)
#1
..avoir fait face à des agents peu au fait des télécoms à la Commission européenne.
 " />
" />
après ça, faudra pas s’étonner que les Dossiers soient “mal-ficelés” !
#2
Mouais, c’est parce que c’était des fonctionnaires non “spécialistes/geek/techniciens”, ou bien qu’ils étaient carrément aux fraises ? Ou bien que Bercy était énervé qu’on vienne fouiller leurs dossiers ?
#3
C’est sympa de lire un article qui parle des réseaux de collecte (on parle généralement du réseau de distribution FttH ou cuivre sans mentionner le réseau en transport).
#4
L’analyse de la Commission européenne reste à l’opposé de l’analyse que porte de nombreux Français. Les zones blanches sont toujours une réalité. Dans certains endroits, il n’y a que par le satellite que l’on peut avoir Internet. Je rappelle que les abonnements pour l’Internet par satellite restent relativement chers et un seul des prestataires de services offre de l’illimité (mais pour quel prix aussi…). Dans d’autres endroits où l’Internet classique passe, l’ADSL reste encore un doux rêve. Le bas débit est toujours d’actualité et la concurrence inexistante.
Nous en reviendrons toujours au même souci. Le pognon est le principal vecteur du déploiement de la fibre. Les zones peu rentables seront desservies en dernier, si elles le sont un jour. Le très haut débit reste encore et toujours l’apanage des grandes agglomérations et encore, même dans celle-ci la fibre n’y est toujours pas entièrement déployé.
Je continue à rester dubitatif sur l’échéance de ce plan Très Haut Débit. Soit disant que le 31 décembre 2022 tous les Français auront accès au très haut débit, dont 80% via la fibre optique. Mais il y reste encore tellement à faire… De vastes zones restent encore à couvrir et je doute qu’en seulement 5 ans, cela sera fait. Je trouve la Commission européenne trop confiante envers ce qui n’est désormais plus une ambition pour la France mais un réel but qu’elle doit atteindre. La France a réaffirmé cette date d 31 décembre 2022 à la Commission européenne. Un faux pas et la Commission européenne verra rouge. Elle n’a déjà pas apprécié l’histoire des subventions publiques accordé à l’opérateur historique pour le déploiement de la fibre. Je doute qu’elle apprécie que l’échéance soit reportée.
#5
#6
#7
Moi ce qui me gêne énormément c’est cette histoire de MED:
Ok, que Orange se fasse pas de blé sur le montage des armoires MED (encore que 40k€… c’est foireux, j’ai jamais vu un devis en dessous de 60k€… bref) encore heureux :
La plupart du temps ces armoires sont PAS dégroupées (donc en pratique soit les gens passent chez Orange en FAI, soit ils restent chez leur opérateur d’origine à 1mbps) , et si elles le sont, Orange touche encore 9€/mois de location de la part de l’opérateur dégroupeur…
Et le plus souvent ces armoires sont payées par les coll. terr. , donc 0 invest pour orange.
Sympa…
Ah oui dernier point : l’installation d’une armoire MED “bloque” tout projet de FTTH pour les 5 prochaines années, dixit l’ARCEP. C’est pour ça qu’il y a quelques années Orange voulait en coller partout dans les campagnes et les banlieues…
Pour le reste ça m’étonne pas : la commission valide (et embrasse) le principe même le plus controversé du plan France THD : L’abandon de la péréquation territoriale (norme depuis Napoléon), qui implique une égalité de traitement entre les zones dense et peu dense (pas forcément une égalité de prix final, notez bien).
Le problème des zones rurales n’est PAS que ça coûte plus cher de faire: C’est que comme il faut que ce soit 30€/mois pour tout le monde , ben dans les zones rurale il vaux mieux ne rien faire. Comme avec tous ces plans, ces “compétences numérique” les moyens d’actions juridique sont retirés des citoyens et des communes, ben…. il ne reste rien sauf le déménagement à 15km de Caen.
#8
Tu parles de l’étalement urbain ou de la ruralité ? Il y a tout de même une différence entre une zone pavillonnaire et un hameau perdu dans la ruralité.
#9
+1 pour les NRA-MED
J’ai aussi lu que ces NRA-MED ne béneéicient qu’à Orange et sans dégroupage.
L’autre point qui me gène est que la fibre tirée ne serait suffisante pour faire par la sjite du Ftth. Il faudra donc en tirée une nouvelle .
#10
#11
TOUT ..dépend ce qu’on entend par “THD” ?
 " />…pardon, je n”ai pas pu me retenir)
" />…pardon, je n”ai pas pu me retenir)
c’est sûr SI pour ça compte à partir de 30Mbts., ils y arriveront
à ce que tout-le-monde sera en “THD” (
(perso.) je suis à 28-29 Mbts. (VDSL)
heu …
#12
“..pour EUX …”
https://www.youtube.com/watch?v=WBsQ5gGLx7I
#13
Le problème du déploiement de la fibre c’est que parfois, les locataires doivent parfois très pro-actifs pour que ça avance, sinon ça stagne entre copro / syndic / orange.
#14
L’analyse de la Commission porte sur l’absence de distorsion de concurrence engendrée par l’action de l’État, le reste n’est absolument pas son problème.
#15
Merci pour ces précisions
#16
Hm… je ne vais pas répondre à tout parce qu’il est tard, mais quelques remarques en passant :
#17
#18
On est d’accord, il y a beaucoup d’autres coûts à prendre en compte et tous ces coûts sont à la charge des collectivités territoriales. L’offre PRM n’est effectivement qu’une partie d’un projet de montée en débit sur cuivre et le lien de fibre entre le NRA d’origine et le NRA-MED représente probablement le poste de coût le plus important de la majorité des projets.
Cependant, toutes les prestations hors PRM sont réalisées suite à des appels d’offres des collectivités. Même si l’empreinte d’Orange est bien marquée sur l’ensemble du territoire, concrètement, rien n’oblige les collectivités à choisir Orange pour réaliser toutes les prestations hors PRM.
Des disparités sur la couverture en dégroupage des NRA-MED, il y en a peut-être, oui. Mais dans quelles proportions ? Ça serait un résultat intuitif en tout cas, mais je n’ai jamais vu de données le montrant.
Concernant la descente en dégroupage des opérateurs, à ma connaissance, Free le fait quasi-systématiquement. De mémoire, environ 90 % des NRA-MED rattachés à des NRA d’origine dégroupés, sont eux-mêmes dégroupés par au moins un opérateur (stats Arcep).
Concernant les fibres surnuméraires, j’ai pour ma part déjà vu des modules pour les “accueillir”, mais je ne saurais dire si c’était des cas isolés ou non. Je n’ai malheureusement aucun élément sur le nombre de projets que cela pourrait concerner (à ma connaissance, il n’y a pas de statistiques sur ce sujet).
Orange n’est gestionnaire que des 12 FO utlisées pour la montée en débit sur cuivre. Les fibres surnuméraires (si elles ont été déployées) sont gérées par la collectivité.
#19
#20
Petit feedback sur une travail “perso/bénévole” en marge de mes activités de conseil, travail fondé sur l’opendata du TdB HD/THD de l’ARCEP enrichi des données du fichier PODI des NRA publié chaque trimestre par Orange… Il me reste à développer une moulinette à partir des données dégroupage d’ARIASE ou DEGROUPTEST…
Aujourd’hui je détecte une tendance assez marquée à l’amplification relative des opérations de MeD en Zone dite “Non dégroupée” (cf. terminologie ARCEP pour leur analyse trimestrielle) sur des parcs importants de petites SR (<150 lignes, voire très inférieures style 30, 40 lignes) dans des départements hyper-ruraux où, à la base la proportion de NRA dégroupés est resté très faible (15 à 30% du nombre total de NRA)…
En résumé, hors recours aux offres bitstream imposées à Orange, la mise en concurrence sur ces territoires reste hypothétique…
#21
(suite) je poursuis “en mode texte” n’arrivant pas à valider mes commentaires accompagnés de graphiques…
Donc:
1- sur l’année 2016 le parc de NRA-MED en zone NON dégroupée est passé de 360 à 700 (avec une proportion significative sur le 2ème semestre (S1: 93, S2: 247)
2- simultanément le parc de NRA-MED en zone dégroupée est passé de 866 à 1497, avec une progression LINÉAIRE de trimestre en trimestre
3- globalement le rapport zone NON dégroupé vs NON dégroupé repasse la barre des 30%, à la hausse!
4- le parc de NRA-MED sur des SR de - de 150 lignes représente désormais 41% du parc total (vs 75% respectivement pour le parc <300 lignes)
5- le % de SR dégroupées de moins de 100 lignes n’était que de 42% fin 2015 (en attente de récupération des données ARIASE ou DEGROUPTEST du dégroupage… pour 2016)
CQFD !?