Plusieurs députés ont questionné Bercy pour connaitre son avis sur un élargissement de l’assiette de la « redevance TV » (ou CAP, contribution à l’audiovisuelle publique). Celui-ci vient de répondre en décrivant l’ensemble des scénarios possibles, avantages et défauts inclus.
Alors que les usages évoluent, migrant de la télévision à Internet, l’audiovisuel public est confronté au risque d’une lente érosion de l’assiette d’assujettissement. Dans une réponse parlementaire, le ministère de l’Économie indique cependant que ce sens de l’Histoire ne s'est pas encore manifesté : « le nombre de foyers redevables continue de progresser (+0,68 % en 2015), bien qu'à un rythme ralenti par rapport aux années précédentes (+1,1 % en 2012, +0,96 % en 2013 et +0,75 % en 2014) ».
Cependant, aux parlementaires qui suggèrent fortement d’étendre la redevance aux foyers consommant du flux audiovisuel public sur d’autres écrans que la télévision, le même ministère est quelque peu gêné : cet élargissement « ne serait pas compatible avec l'engagement du gouvernement à maîtriser la fiscalité directe pesant sur les ménages ». Concrètement, trois scénarios sont envisageables pour réformer cette assiette, « chacun présentant des avantages et des inconvénients ».
L'extension aux nouveaux écrans
D’abord, l’extension aux nouveaux écrans comme les tablettes, les ordinateurs ou les smartphones. « Le nombre de nouveaux assujettis serait au maximum de 1,26 million, soit le nombre de foyers déclarant ne pas avoir de téléviseur actuellement » calcule Bercy.
Un avantage : « la neutralité technologique de la CAP ». Mais deux inconvénients : d’une part, « elle pourrait pénaliser les jeunes ». D’autre part, il y aurait « un risque de contentieux et de fraude accru ». Pourquoi ? il tiendrait à la « difficulté technique qu'il peut y avoir à définir les appareils entrant dans l'assiette et à assurer les contrôles ».
Transformer la redevance en une surtaxe de la taxe d'habitation
Ensuite, on pourrait transformer la redevance TV « en surtaxe de la taxe d'habitation, payée par tous les foyers qu'ils possèdent ou non un appareil récepteur de télévision ». Une idée juteuse, puisque le rendement serait supérieur à celui de la première option, « notamment si les résidences secondaires étaient concernées ».
Plus brutal, ce chantier entrainerait au surplus « une diminution de la fraude et des contentieux ainsi que des frais de gestion supportés par l'administration fiscale ». Pour faire passer la pilule, il suffirait alors de baisser les taux, « ce qui pourrait faciliter son acceptation ». Le fameux consentement à l'impôt...
Mais là encore, un inconvénient : la crainte est que la CAP puisse être requalifiée en prélèvement obligatoire par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), noircissant davantage encore la façade française.
Augmenter la TST-D
Enfin, dernière idée : « remplacer progressivement la CAP par une augmentation de la fiscalité sur la consommation (TVA ou taxe sur les services de télévision due par les distributeurs de services de télévision (TST-D), c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet) ».
Inconvénients de cette taxe affectée au CNC : « d'importants effets redistributifs » outre « des conséquences sur le financement du soutien au cinéma ». Et pour cause, « les montants concernés étant en outre déséquilibrés (la TST-D représente un rendement de 230 M€ contre 3,5 milliards d'euros pour la CAP ».
Bref, aucune des pistes ne présente d’avantages non accompagnés d’inconvénients. À l’heure du bilan à quelques encablures du grand rendez-vous électoral, le gouvernement a préféré justifier ses choix mis en œuvre notamment lors des deux dernières lois de finances.
Le choix gouvernemental
Si depuis 2016, le robinet des dotations publiques a été fermé dans le budget général, laissant au bord de la baignoire seul celui des ressources affectées, la stratégie a été d’augmenter très légèrement la contribution à l'audiovisuel public (CAP). Voire à limiter cette hausse à la seule inflation.
Finalement, la seule vraie bouée de secours fut de mettre un coup d’accélérateur sur la taxe Copé ou taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE). La part de cette ponction affectée à France Télévision a ainsi « été augmentée à due concurrence » : de 140,5 millions d’euros en 2016 à 166 millions d'euros en 2017.
Au total, l’audiovisuel a grimpé de 63 millions d'euros, inflation comprise. L’exécutif n’y voit que du bon : une telle hausse « permet en particulier, un soutien renforcé à la création, au rayonnement culturel de la France à l'international, ainsi qu'un accompagnement des acteurs à la révolution numérique et aux nouveaux modes d'accès aux services audiovisuels, notamment en matière d'information ».
Seul détail. Frappé d’amnésie, Bercy a oublié de rappeler (derrière ce tour de passe-passe) les critiques des contributeurs, les Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free qui, fin 2016, en plein débat sur le projet de loi de finances, avait une nouvelle fois dénoncé cette stratégie. « Alors que cette taxe avait déjà été augmentée de 44% il y a moins d’un an les opérateurs seraient à nouveau mis à contribution pour financer France Télévisions au détriment des priorités fixées par le gouvernement en matière d’aménagement numérique des territoires. »
Calculette en main, ils avaient déterminé que depuis l’instauration de la TOCE en 2009, le total « représente l’équivalent de 3,8 millions de prises en fibre optique ou d’environ 18 000 installations d’antennes 4G ».

























Commentaires (122)
#1
Wow, le sous titre !
Marrant, mais tellement vrai ! Un truc de dinosaures !
Comment on fait pour ne plus payer cette taxe sur des TV & radio que je ne regarde plus ni n’écoute ?…
[Hé ! Prem ?!?!]
#2
A terme faut pas se leurrer, ça sera systématique. (comme en Allemagne par exemple).
#3
Il n’y a plus beaucoup d’intérêt à regarder ces chaînes plutôt que d’autres, pourquoi ne pas les vendre? Ca se passe comment à l’étranger dans les pays libéraux?
#4
Mais …. et si on supprimait quelques chaines publiques ? On pourrait revoir cette taxe à la baisse :)
#5
Mais là encore, un inconvénient : la crainte est que la CAP puisse être requalifiée en prélèvement obligatoire par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), noircissant davantage encore la façade française.
Mais qu’ils assument, franchement…
#6
Et si France TV avait un budget contrôlé et respecté au lieu de monter la redevance tout les ans.
Ce qui me pose problème c’est que le seul critère pour être éligible c’est de posséder un tuner TNT. Hors toutes les télévisions (par définition) en ont un. Et que si tu possède un écran pour autre chose (Netflix/console…) et bien tu dois la payer…
Sinon ils n’ont qu’à passer France TV en crypté mais pas sur qu’il y ai un gros succès.
#7
permet en particulier, un soutien renforcé à la création, au rayonnement culturel de la France à l’international, ainsi qu’un accompagnement des acteurs à la révolution numérique et aux nouveaux modes d’accès aux services audiovisuels, notamment en matière d’information
Ho ! Une “très légère augmentation” de taxe permet de faire tout ça ?
Mais qu’attendons nous pour appliquer très forte, massive, gargantuesque hausse de la taxe, pour un puissant rayonnement radioactif culturel-mais-pas-que de la France avec un grand F partout dans le monde et le système solaire, et une assistance totale au multiples révolutions numériques et quantiques des millénaires à venir et aux nouveaux modes d’accès à tous les services, notamment l’ensemble de ce qui existe et qui existeront à l’avenir ?
#8
#9
Il est possible de faire retirer le tuner d’une TV. Mais c’est pas forcément donné…
Après, le principe d’un service public, c’est quand même la mutualisation, tout le monde y contribue, éventuellement en fonction de ses moyens, et tout le monde y a accès quelque soit ses moyens. Donc passer le service public audiovisuel en chiffré, ça irait totalement à l’encontre de l’idée même de service public.
Accessoirement, la redevance ça ne sert pas qu’à financer France TV, c’est aussi Radio France, les archives de l’INA et, au moins indirectement, les moyens techniques d’émission (antennes, réseaux…), qui sont des infrastructures indispensables en cas de crise majeur (gros accident industriel, catastrophe naturelle, etc…).
#10
#11
Le problème est la piètre qualité des émissions en générale.
#12
#13
Et lesquelles en particulier ?
#14
Et faire payer par abonnement?
C’est pas comme s’il fallait déjà un compte Facebook pour pouvoir utiliser Pluzz.
Ensuite si vraiment France Télévision est en déclin, pourquoi vouloir maintenir une perfusion?
#15
Si je fout mon canapé dans la rue gracieusement est ce que dans 1 ans ou 2 je peu réclamer une taxe applicable a toute la France ? Bein ouai , toute personne capable de se déplacer dans la rue sera susceptible de s’asseoir dedans…
 " />
" />
En plus il a un peu vieilli mon canapé ça permettrait de le rentabiliser!
#16
Comme tu dis c’est pas forcément donné et ce n’est même pas forcément valide. En plus ça risque de tuer ta garantie. Bref je ne le ferai pas.
Sinon je sais à quoi sers à redevance et ce qu’est un service publique. Dans ce cas on généralise vraiment au lieu de faire une règle pour que 99.9% de la population y soit éligible. Ce qui m’énerve c’est qu’on te dis que tu as le choix de ne pas avoir de télévision mais qu’une télévision en 2017 ça ne sers pas qu’à recevoir la TNT…
#17
Cela dépend des goût de chacun.
#18
Tous les pays développés, même les USA (PBS/NPR), ont un réseau de chaîne publiques payées par le contribuable.
Le principe de la redevance est appliqué dans un grand nombre de ces pays, surtout en Europe, et la France est l’un de ceux où elle est la plus faible (ce qui peut expliquer la qualité très variable des productions de France Télévisions, par rapport par exemple à la BBC). Mais qu’il y ait redevance ou pas, les réseaux publics sont financés par le contribuable de toute façon (aux USA, c’est pris principalement sur le budget général fédéral et sur les budgets généraux des États, et complété par des donations).
#19
Les chaînes TV & radios ne m’intéresse pas, j’ai personnellement fait l’achat d’un écran “dynamique” (ou “commercial”) : un écran sans tuner.
A qualité équivalente, l’achat d’un écran dynamique coûte plus chère (il faut bien vérifier si les pieds de l’écran sont fournis, si des enceintes sont intégrés), mais en 2 ans, le non paiement de la redevance comble cette différence (j’ai d’ailleurs un peu tiqué quand il y a plusieurs mois ils parlaient d’étendre la redevance aux box TV…)
Couplé à un Roku, j’utilise principalement Netflix, Deezer, Twitch & Plex.
Et puis : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F88
Matériels concernés : “Par contre, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.”
#20
Les chaînes TV & radios ne m’intéresse pas, j’ai personnellement fait l’achat d’un écran “dynamique” (ou “commercial”) : un écran sans tuner.
A qualité équivalente, l’achat d’un écran dynamique coûte plus chère (il faut bien vérifier si les pieds de l’écran sont fournis, si des enceintes sont intégrés), mais en 2 ans, le non paiement de la redevance comble cette différence (j’ai d’ailleurs un peu tiqué quand il y a plusieurs mois ils parlaient d’étendre la redevance aux box TV…)
Couplé à un Roku, j’utilise principalement Netflix, Deezer, Twitch & Plex.
Et puis : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F88
Matériels concernés : “Par contre, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.”
#21
#22
#23
Payer les salaires de ce système de désinformation dont le pouvoir est devenu supérieur à celui de nos élus, non merci !
#24
Après avoir créé de nouvelles chaînes, France TV Ô 1 2 3 4 5… ce n’est plus du service public, c’est de l’aide à la personne!
Allez hop, si on supprimait une chaîne? Les français auraient toujours accès aux informations du soir et 2-3 émissions de “variétés”.
Sinon je serai ravi que ma bande de potes et moi soyons recrutés. On vous assure au moins 10 téléspectateurs et on promeut la redevance TV!
#25
Ensuite, on pourrait transformer la redevance TV « en surtaxe de la taxe d’habitation, payée par tous les foyers qu’ils possèdent ou non un appareil récepteur de télévision ». Une idée juteuse, puisque le rendement serait supérieur à celui de la première option, « notamment si les résidences secondaires étaient concernées ».
C’est fondamentalement injuste : les “gens du voyage” seraient exonérés de cette taxe alors qu’on voit bien les caravanes de roms partout avec des antennes de télé et des paraboles.
#26
#27
#28
C’est juste pas possible de répondre ça…
“Le problème est la piètre qualité des émissions en générale.” ne peut pas être suivi d’un “Cela dépend des goût de chacun”
C’est la problématique du service public que de s’adresser à chacun (du moins essayer) avec évidemment toujours la même épée de Damoclès au dessus qu’est l’audience et la part de marché.
“La grande librairie”sur France 5 le jeudi soir est une émission de grande qualité, suivi en moyenne par 400 à 500 000 téléspectateurs quand durant une soirée il y a environ 25 000 000 de téléspectateurs. Faut-il donc la supprimer ? Ou faut-il s’attendre à ce qu’une chaine privée la diffuse ?
#29
#30
#31
#32
#33
C’est plutôt tout les émissions ou jeux pour ressembler aux autres chaines. Personnellement, me passerai bien des émissions de musique, de télé-réalité, de pseudo-reportage, et certaine série française ( du genre de pblv, les supporte pas ).
#34
La redevance à été créée quand les téléviseurs étaient loin d’être un incontournable de tous les foyer, justement pour éviter de mutualiser les coût d’un service dont peu de monde disposait, je pense que cette distinction accès télé/pas accès télé n’a plus lieu d’être on peut désormais la faire passer comme une taxe, ainsi cela reviendrai à demander une contribution par personne et non pas par foyer et par conséquent l’état pourrai dans un premier temps la faire diminuer pour faire mieux passer la pilule ce qui ravira les célibataire qui paye près de 150€/an.
#35
#36
#37
#38
#39
Perso j’ai aussi fait le même choix, sauf que j’aimerais renouveler mon materiel et que le changement d’assiette pourrait être un mauvais choix si tu payes ton matos plus cher avant de te faire taxer avant d’avoir fait le moindre retour sur investissement…
<HS>Tu as pris quoi comme écran dynamique? J’aimerais remplacer mon 27” pour quelque chose dont la taille est supérieure à 42” mais c’est chaud de trouver qq chose à moins de 600€. Pas besoin de son dans mon cas puisque j’utilise une barre de son :)
#40
Arte, il m’arrive de la regardé de temps en temps. Des émissions sympa.
#41
Bien joué, faut que je fasse comme toi :)
#42
Le problème de fond, ce n’est pas les programmes qui s’y trouvent de toute façon… Ni comment éviter de la payer actuellement. A force, on sait tous ce qu’il faut faire, ou ne pas faire.
Ca semble compliqué à adapter au mode de consommation actuel. Mais il faut bien essayer de le faire. Pourquoi Mr X paierait la redevance parce qu’il a un TV (qui regarde peut être très peu, voir jamais, et encore moins les chaines publiques), et Mr Y qui regarde depuis le NET sans passer par un tuner devrait payer ? C’est un vrai problématique en fait… car non mesurable et non contrôlable.
#43
#44
#45
”….
 " />
" />
 " />
" />
Au total, l’audiovisuel a grimpé de 63 millions d’euros, inflation comprise.
L’exécutif n’y voit que du bon “…
..tu m’étonnes ?
pas nous !
Alors que cette taxe avait déjà été augmentée de 44% il y a moins d’un an*”….
* seulement !!!
#46
#47
#48
#49
#50
#51
ah pour ça, là-bas ils sont TRES fort :
j’espère qu’en France on n’adoptera PAS le même système ?
#52
#53
Tu mets les chaînes en crypté.
 " />
" />
Tu payes=tu regardes
tu ne payes pas=tu ne regardes pas.
c’est pourtant simple !
TROP ……..peut-être ?
#54
#55
Si les habitudes ont tant changé que ca, pourquoi on ne croise pas les déclarations de la TAV avec les données client des FAI : ils savent très bien qui dispose d’une box avec TUNER, ou qui redistribue la TV avec la fibre/ADSL.
Mais dans ce cas, il faut aussi que les internautes puissent avoir Internet SANS la partie “box TV”, mais juste le routeur.
#56
Dingue de voir qu’en 2017, tant de gens ne savent toujours pas que la redevance ne finance que les chaines publiques. " />
" />
#57
#58
J’entends de plus en plus l’argument de l’accès à la TV de rattrapage pour justifier le paiement et l’étendre aux autres écrans.
#59
TPMP, argent public ? " />
" />
#60
Je vois pas pourquoi on se complique autant la vie avec la redevance.
Suffit de la faire payer à tous les gens imposables et d’en faire cadeau aux autres.
#61
Je suis bien content de payer une taxe qui finance des émissions de service public comme “Les Z’amours”.
(ou pas)
#62
Comme à chaque fois qu’on parle de la CAP, c’est la foire au n’importe quoi dans les commentaires.
Non, les chaînes privées ne sont pas concernées.
Oui, le principe de l’imposition défini par la possession d’un téléviseur est archaïque au possible. Il faut changer ce système.
Mais SI, il faut maintenir un service audiovisuel public.
Pour des télés, des radios, des sites ouaibe d’information de qualité, indépendants des contraintes commerciales. Il y a déjà de belles choses qu’il faut maintenir.
Et tout le monde doit payer, comme tous les services publics (police, école, pompiers, personne ne penserait payer que ce qu’il “consomme”).
C’est là qu’on doit commencer à être exigeants : il y a d’excellents programmes, et d’autres qui n’ont rien à faire sur des chaînes publiques. Notre exigence ne doit pas être d’arrêter de payer, mais d’avoir une meilleure qualité de service public audiovisuel.
#63
#64
Tout à fait " />
" />
#65
Bien sur AUCUNE PROPOSITION d’economies d’echelle (regroupement d’antennes du Réseau régional de France 3, des myriades de services de radio) ou limitation des salaires de producteurs TV …
#66
C’est à cause des vieux ça. Et il en faut pour tous les goûts, sans aller dans des émissions comme les ch’tis ou the voice qu’on peut laisser aux éboueurs de la télé.
Tu mets quoi sur le créneau semaine 10-17 ? Je préfère que les trucs intéressants soient le soir quand je peux les voir
#67
#68
#69
#70
alors, faut signaler l”erreur à la rédaction !
Seul détail. Frappé d’amnésie, Bercy a oublié de rappeler (derrière ce tour de passe-passe) les critiques des contributeurs, les Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free qui, fin 2016, en plein débat sur le projet de loi de finances, avait une nouvelle fois dénoncé cette stratégie.
« Alors que cette taxe avait déjà été augmentée de 44% il y a moins d’un an les
opérateurs seraient à nouveau mis à contribution pour financer France
Télévisions au détriment des priorités fixées par le gouvernement en
matière d’aménagement numérique des territoires. »
#71
#72
Ouais mais là on parle de la redevance TV pas des taxes imposées aux FAI, tu comprendras donc que tu n ‘es pas facile à suivre si tu mélanges tout sans préciser de quoi tu parles… " />
" />
#73
#74
#75
#76
Le financement de la culture pour la création des millionnaires du show-biz ?
http://www.lepoint.fr/culture/johnny-hallyday-charles-aznavour-zazie-le-scandale…
http://www.20minutes.fr/culture/musique/1896923-20160722-johnny-halliday-encore-…
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/johnny-hallyday-et-c…
#77
#78
Sauf ceux qui vivent sur la pelouse du chateau de M. Bouygues " />
" />
#79
C’est leur choix. Il existe un service public de l’instruction, l’école publique, ils font le choix d’aller voir ailleurs, ok, mais ils contribuent quand même au financement de l’école publique par l’impôt.
#80
perso, je veux bien continuer à payer cette fameuse taxe, mais faudrait qu’ils revoit leur grilles des programmes en mettant des trucs regardable autrement que comme dérivatif aux somnifères.
perso, payer pour des chaines aussi rébarbatif, et que je ne regarde jamais, me fait personnellement mal au derrière. Enlevé cette taxe pour moi inutile, me permettrais d’aller plus souvent au cinéma (je dois pas être le seul à ne pas avoir les moyens d’y aller 7 à 10 euros la séance), au moins là je serait sur de l’utilité de ma dépenses.
mais ne rêvons pas, les français sont considéré par des pompes à fric par l’état (qui lui, refuse de ce serrer la ceinture) et cela ne changera pas, quelque soit le gagnant aux prochaine élection, et même risque d’empirer avec certain.
#81
#82
#83
Frais de scolarité déductibles ? Gné ?
#84
ouai mais j’y verrai ce que j’ai envie, et non ce que des dépressif chronique veulent me montrer
#85
ok !
#86
Méeuh , j’arrêt de déprimer et de rager quand je dors  " />
" />
#87
C’est plus compliqué que ça.
 " />
" />
Tu crées une fondation des amis de l’école, loi 1901 toussa toussa, qui sert à filer des sous à l’établissement, même indirectement.
Du coup c’est un moyen déguisé pour certains de passer sous des barres d’imposition, ou d’aider discrètement l’école.
Pour le fun, j’ai entendu le cas de la dame qui demande à la comptable de l’école privée si elle accepte les virements du compte bancaire de son mari, officiellement aux îles anglo-normandes, dans la Manche
#88
#89
+1 J’ai sauté le pas moi aussi.
#90
#91
#92
#93
#94
Ben justement, c’est pas le privé qui fera ce que font Arte, France Inter, France Culture, l’INA etc.
La merde et les vautours sont des anomalies sur le service public. Il faut les renvoyer à leur place : dans le privé, là où se trouve “l’oligarchie”, celle du pognon, celle des Bolloré, Bouygues, Drahi, etc. qui censure tout ce qui critique le pouvoir de l’argent mais ouvre grand ses portes aux fachos, comme BFM-TV aka Télé-FN.
#95
”… les FAI donnent la liste des abonnés triple play quand Bercy le leur demande
 " />
" />
(en gros, quand tu leur dis ne pas avoir de TV) …. tiens, tiens !!!
#96
En fait, les FAI tiennent à jours un fichier des clients qui possèdent une offre triple Play (obligation légal suite à une loi en 2013 de mémoire), d’ailleurs les chaines criptées (Canal +) et du satellite sont soumis aux même règles que les FAI.
Et l’état (enfin, les contrôleurs de la CAP) consulte ce fichier pour les gens qui indiquent ne pas posséder de TV (pour vérifier s’il y a des regroupements possible).
#97
….en plus leurs sourires bien faux…
 " /> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" /> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rien que ça, ça suffit pour
#98
#99
la dernière fois, je regarder une interview d’un Politique :
(il n”a pas fini)
“messieurs les journalistes, choisissez-vos questions*, mais laissez-les développer leurs idées” !
* posez-en moins
#100
La 8ème maison de Drucker plutôt que la fibre pour les Français, on voit bien la vision économique de nos gouvernements " />
" />
#101
Les gens au RSA vont être ravis d’être racketté d’une part importante de leur revenu pour le “rayonnement culturel de la France à l’international”: politique, tour d’ivoire, tout ça tout ça " />
" />
#102
Déja , ils n’ont qu’a mettre plus de pubs sur france tv ;-)
#103
Je rebondis sur un argument donné en commentaire, la redevance sert à financer les infrastructures ?? Ça finance TDF ??
Quelqu’un peut me confirmer ou infirmer cela ?
#104
#105
#106
#107
#108
Ou simplement la possibilité de désactiver le tuner tnt et l’iptv comme chez Free en décochant une case sur son compte. " />
" />
#109
#110
#111
#112
#113
Payé pour des séries débiles (plus belles la vie) et des mecs comme Ruquiers ou grassement payé pour vomir la propagande étatique cela me gêne énormément et les 136€ qui partent pour ça m’énerve au plus haut point.
Ma tv me sert uniquement pour regardé du contenue provenant de divers sources sauf de la tnt.
Qu’ils fassent comme canal un décodeur
#114
Ah les chaînes tv DVB-T et DVB-S ne sont plus transmises par ondes radio (fréquence mesurée en hertz) ?
#115
Ai-je vraiment dit ça ? " />
" />
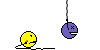 " />
" />
edit: Ah, je vois que tu fais allusion à “chaines hertzienne” au lieu de “chaines analogiques”.
#116
Oui je suis un chipoteur.
De toute façon même une information lumineuse (fibre) est une onde hertzienne.
#117
Si tu avais lu tout mon message tu aurais relevé qu’après avoir énoncé ce principe, je réclamais des changements dans la gestion des chaînes.
#118
ce n’est pas un impôt … c’est une taxe…
Ha ! bon, ce n’est pas pareil alors.
#119
#120
moi, ce que je vois : “c’est que ça sort de mon porte-feuille, pour aller dans les caisses de l’Etat”
après les noms qu’il leurs donne ….
etc …
bof !
#121
#122
merci pour cet éclairage " />
" />