En 2015, étaient signées Rue de Valois une charte avec les acteurs de la publicité en ligne, une autre avec les acteurs de paiement. L’idée ? « Follow the money ! », couper les vivres des sites massivement contrefaisants. Une procédure CADA a été lancée pour obtenir la liste noire des mis à l’index. Peine perdue.
Ces chartes avaient été habillées comme de merveilleux outils pour lutter contre la contrefaçon en ligne. À cette fin, selon la charte sur la publicité en ligne, la première signée, chaque partie a depuis la possibilité d’établir « une liste d’adresses URL de sites internet en se référant aux informations fournies par les autorités compétentes, en utilisant éventuellement des outils technologiques, et en collaboration avec les ayants droit qui sont les seuls à avoir la connaissance des droits qui s’appliquent ». Toujours selon ce document signé sous les dorures du ministère de la Culture, cette fameuse liste noire est depuis régulièrement mise à jour.
Cet accord signé en mars 2015 par l’univers de la publicité en ligne, différentes sociétés de gestion collectives et autres organismes de défenses, mettait en musique les préconisations des rapports de Mireille Imbert-Quaretta. Depuis la Hadopi, l’ex-présidente de la Commission de protection des droits avait en effet préconisé de telles mesures indirectes contre les sites « pirates », histoire de leur couper les vivres pour assécher leur vitalité.
Une liste d'URL dans la charte sur le paiement en ligne
Cette charte s’est doublée en septembre 2015 d’un épisode identique avec l’univers du paiement en ligne. À cette fin, un comité associe « les représentants des moyens de paiement et les représentants des ayants droit » toujours sous l’impulsion du ministère de la Culture. Autour de la table, du beau monde : l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile), la FBF (Fédération Bancaire Française), le GIE cartes bancaires, Mastercard, PayPal, Visa Europe, outre le Geste (Groupement des Editeurs de Services en Ligne), et une armée d’acteurs de la culture, dont l’Alpa, l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, le SNE (syndicat de l’édition), la SACEM, la SCPP (majors du disque), la SPPF (producteurs indépendants), le SNJV (syndicat du jeu vidéo)...
On retrouve la même logique : « les participants tiennent compte des observations du comité dans le retrait des sites considérés comme contrevenants et s’engagent à prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour sensibiliser leur profession et en assurer l’effectivité, notamment, dans le respect de la réglementation, via l’établissement de listes d’adresses URL ou en utilisant éventuellement des outils technologiques » (voir le PDF).
Quand l'avocat de 1fichier.com demande communication de la liste noire
C’est à partir de ces informations, qu’un avocat a réclamé du ministère de la Culture la communication de cette fameuse liste. Pour la petite histoire, Me Ronan Hardoin assure la défense de 1fichier.com, un hébergeur qui rencontre de lourdes difficultés pour trouver un prestataire de paiement acceptant d’accompagner le développement de son activité. Systématiquement refoulé par les banques, il craint d’être placé sur cette fameuse liste d’URL, alors même qu’il a encadré au cordeau sa procédure de notification et de retrait.
Seulement, la procédure CADA qui s’en est suivie s’est effondrée. Dans son avis, la Commission d’accès aux documents administratifs lui a répondu que sa demande de communication était « sans objet ». En clair : la liste noire n’existe pas.
Plus exactement, la Commission avait été saisie le 3 juin 2016 « à la suite du refus opposé par la ministre de la Culture et de la Communication à sa demande de communication de la « liste noire » d’adresses URL et des "outils technologiques" élaborés dans le cadre du comité de suivi des bonnes pratiques des moyens de paiement en ligne dans le respect du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que le détail des actions de valorisation engagées par le ministère à ce sujet ».
En retour, la CADA s’est d’abord déclarée « incompétente » pour se prononcer sur la communication des « outils technologiques » et des « actions de valorisation », s'agissant de simples renseignements, non de documents administratifs. « Au demeurant, la ministre de la Culture et de la Communication a informé la commission qu'aucune action de valorisation n'a, à ce jour, été engagée par le ministère sur la recommandation du comité de suivi » ajoute l’autorité.
Le plus intéressant arrive : concernant « la liste des sites de paiement en ligne à bannir, ou « liste noire », la ministre a informé la commission qu'aucune autorité administrative, à sa connaissance, n'a élaboré ni ne détient une telle liste ». Faute de mieux, la Commission a donc déclaré sans objet cette demande particulière.
Contacté sur les modalités exactes de ce comité de pilotage, Frédéric Delacroix, délégué général de l’Alpa, nous indique sur ce point qu’il n’y a « pas concrètement de fichier Excel dressant la liste de ces sites ».
« Forcément des noms de site et d’autres informations qui sont transmis »
Cependant, « il y a forcément des noms de sites et d’autres informations qui sont transmis », par exemple la mise à l’index de pubs pour des services en ligne diffusés sur les sites peu au goût des titulaires de droits, et qui en bout de course vont solliciter un passage par une case paiement.
Les sociétés de défense des intérêts du secteur passent aussi par les services « abuse » des solutions de paiement, afin de dénoncer les hébergeurs qui ne retirent pas promptement les contenus qui leur ont été notifiés. Ensuite, le jeu des relations contractuelles des grands acteurs du paiement en ligne avec les banques fait son office.
Une liste noire gérée uniquement par des acteurs privés
En clair, la charte prévoit bien l’établissement d’une liste d’URL, il y a des noms de sites qui circulent, mais aucune autorité administrative ne gère une telle liste.
Ce paradoxe apparent se résout facilement : la charte est signée par et pour le bénéfice des acteurs privés. Le ministère n’est intervenu que pour offrir sa coquille, pas plus. Ces arrangements n’ont donc pas le caractère de documents administratifs mais relèvent d’une discussion sans un nuage de parfum public.
Résultat, un acteur possiblement placé dans ce flux est donc démuni sur le terrain du droit administratif. Il ne peut obtenir gain de cause ou à tout le moins simplement savoir s’il est effectivement parmi les bannis. Et sur le terrain du droit privé ? Réponse sous peu puisque plusieurs actions ont été lancées devant les juridictions.






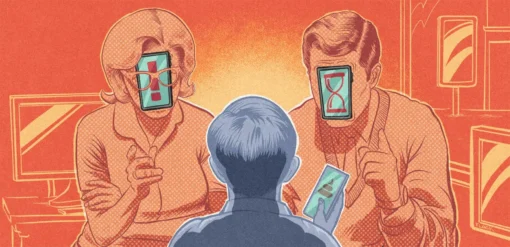

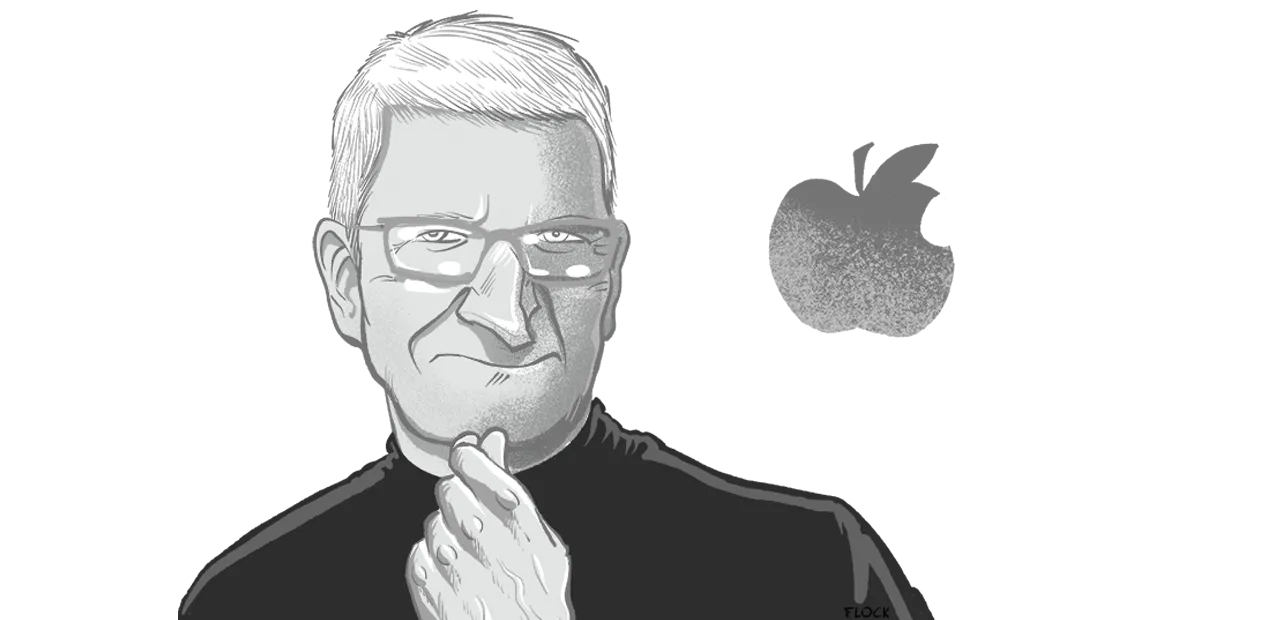
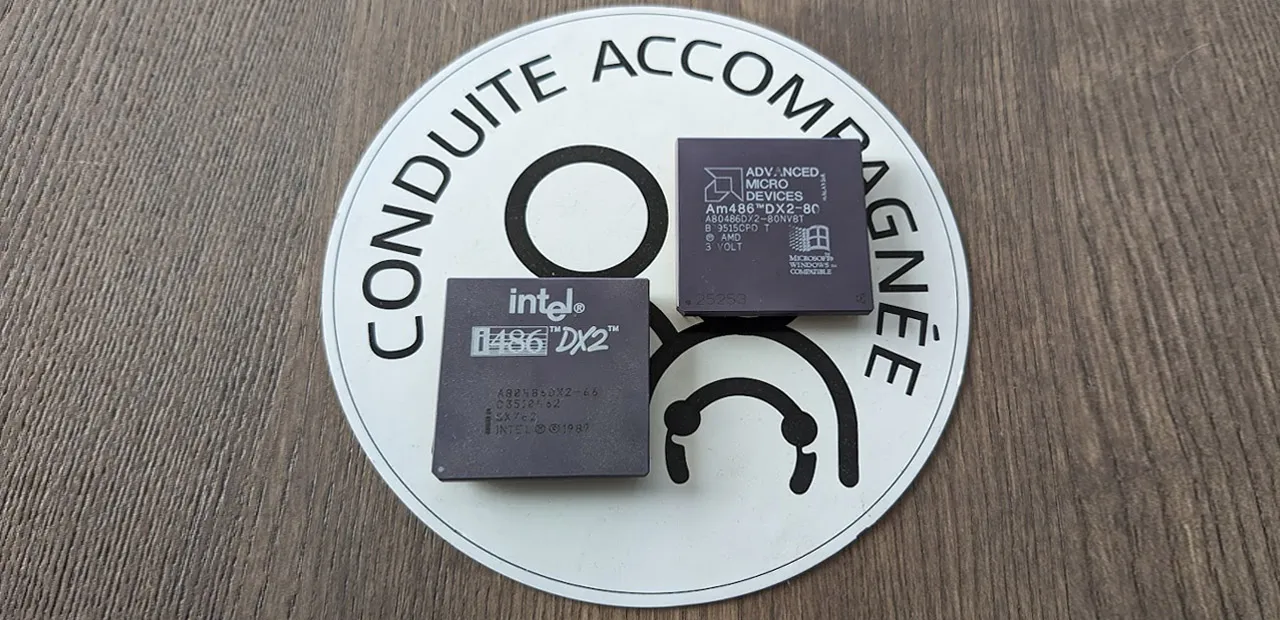
Commentaires (44)
#1
C’est classe, une liste par, pour et géré par des intérêts privés, appliqué au titre de l’intérêt public.
Et puis, quitte à limiter les moyens de paiements de 1fichier.com, pourquoi ne pas s’attaquer à Free aussi (qui dispose d’un moyen pour envoyer et mettre à dispositions des données) ?
Et au final, si on veut savoir si on est sur cette liste, on doit porter plainte ?
Bref, ça devient flippant comment internet est “géré” par “ceux qui savent”.
#2
C’est mafieux.
#3
Entre ça et les retouches photos, tout cet encadrement va bientôt rendre la publicité plus chère que la conception des produits..
#4
Est-ce que ça pourrait expliquer que j’ai un nombre important de paiements internet que je ne peux désormais plus effectuer car rejetés par ma banque …. hmm
Je parle ici de trucs tout ce qu’il y a de plus officiel, paiement sur des sites internet de JV pour des éditions collector de jeux notamment
#5
Ça c’est parce que t’es à découvert " />
" />
#6
Quelles bandes de pourris …
#7
En même temps l’oligarchie française est pour libérer toutes les transactions en Europe, et elle veut bloquer des transactions avec les seules banques françaises? " /> Où est la cohérence dans tout ça?
" /> Où est la cohérence dans tout ça?  " />
" />
 " />
" />
Ça revient juste à faire perdre des clients aux banques françaises, clients qui iront légalement ouvrir un compte ailleurs dans l’UE
#8
#9
C’est magnifique. " />
" />
#10
Ah ! voilà ce qu’on appelle de la politique de faveurs au service des lobbies ! On n’en attendait pas de moins du sinistère de la Kulture du Kampdubien !
Ne reste plus qu’à autoriser les ayants-droits à rapprocher leur liste noire avec la liste TES, et la (parodie de) justice pourra faire son office : un bel instant fasciste en perspective.
#11
Bah d’un côté, pour un service comme 1fichier.com, je suis surpris qu’il soit “encore” domicilié en France et qu’il utilisait une banque française. Mais bon le service est légal, son utilisation aussi (tant que le copyright n’est pas enfreint).
Si ils voulaient réellement bloqué ce site, il n’aurait qu’à le faire “par erreur” chez les FAI, ou mettre en place un DMCA.
D’ailleurs c’est étonnant qu’on a pas encore un DMCA à la française …
#12
Il suffit d’installer le plugin Fakeblock+ sur le navigateur
 " />
" />
#13
On comprend mieux qui fait la loi à l’Élysée: une chanteuse sans voix, puis une actrice sans charisme " />
" />
#14
#15
Comprend pas bien la tournure de l’article.
L’Etat a mis autour d’une table des acteurs privés pour qu’ils puissent trouver une solution à leurs problèmes.
Il a rédigé une charte dans laquelle il a été clairement spécifié que le travail allait être effectué entre acteurs privés.
Pourquoi lancer une procédure CADA (qui avaient toutes les chances de ne pas aboutir, tant est qu’on ait lu la charte) et pas une attaque en justice de cette charte ?
#16
#17
#18
Je vois pas le problème, c’est du libéralisme, les sociétés privées font appel à des sociétés privées, c’est génial, et ce sera toujours plus efficace que le côté procédurier d’un organisme d’état. Et en plus, ça ne coûte rien en impôts.
 " />
" />
 " />
" />
‘dredi
#19
#20
#21
#22
#23
#24
Après ça le gouvernement ne peut plus dire qu’il n’est pas là pour défendre les lobbies (les forts) contre le peuple (le faible)
#25
#26
Le souci n’est pas avec le privé mais avec quelques dirigeants d’entreprises déjà milliardaires qui ne pensent qu’à s’enrichir au détriment du vulgus pecum, en faisant adopter pour cela des lois liberticides et autres (exemple : amendement Vivendi Universal pour la DADVSI, quand ce ne sont pas des lois sur commande des majors).
C’est ce genre d’entreprise, organisé en lobbies, qui pose problème. Pas le monde du privé en général.
#27
#28
la confiance du marché?
#29
Une paix royale des AD?
#30
#31
Ya bien des vieilles qui ne sont pas des “anciennes”…
#32
Il ne s’en cache même plus depuis un moment
#33
C’est toujours utile d’être copain avec les politiques.
 " />
" />
Après tu peux aller les voir et leur demander des services…. enfin j veux dire leur donner des conseils
#34
Tu as lu l’article? Justement le ministère la culture est “innocent” pour une fois…
#35
Donc Valois met à disposition la puissance et la violence d’un état (ce n’est pas une coquille vide) au profit d’interet privés maquillés en interet général. Vivement une loi de séparation des entreprises et de l’état.
#36
#37
#38
#39
Le fait qu’on se fait entuber bien profond par ces mafiosi.
#40
#41
#42
#43
Comme ce blog économique qui est bloqué (même à mon taf d’hôtellerie, il a était bloqué un temps pour religion lol)
http://www.jovanovic.com/blog.htm
#44
Et bah les gens, vous êtes parfois une bonne bande de trolls …