Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu son ordonnance dans l’action lancée par plusieurs associations issues du milieu du libre contre l’accord Microsoft/Éducation nationale. Les plaignants sont tous déboutés.
Peine perdue pour le Conseil national du logiciel libre, les associations Ploss Rhône-Alpes, La Mouette et l’Aldil. Estimant l’accord de partenariat passé entre l’Éducation nationale et Microsoft illicite, elles avaient réclamé devant les juges des référés sa suspension provisoire (notre compte rendu d'audience).
Sur quel fondement ? D’abord l’article 808 du Code de procédure civile, qui permet de réclamer en urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Souci : l’accord a été formalisé à partir du 18 novembre 2015. Le président du tribunal a du coup eu un peu de mal à flairer une quelconque urgence.
Pour expliquer ce retard, Me Soufron, avocat des associations, a rappelé qu’il avait d’abord tenté un recours gracieux auprès du ministère de l’Éducation nationale. Grimace du magistrat : « La convention litigieuse ne relevant pas, selon les parties, de la compétence du juge administratif, le recours gracieux exercé par les associations demanderesses n’était donc pas un préalable indispensable à la saisine du juge judiciaire ».
Défaut de condition d'urgence
En clair, dans une telle procédure, si urgence il y avait, les associations auraient dû agir immédiatement à sa porte, et surtout ne pas perdre un temps précieux auprès du ministère avec une procédure administrative inutile. Du coup, alors que ce recours gracieux a eu lieu le 29 janvier 2016, le juge des référés ne comprend pas pourquoi les mêmes associations « ont choisi d’attendre la fin du mois de juillet 2016 pour se décider à porter leur affaire devant la juridiction des référés ».
Les associations ont aussi prétexté n’avoir eu connaissance que tardivement de cet accord, entré en application depuis de longs mois. Mais l’argument a fait pshit : « les associations demanderesses ont eu connaissance de ladite convention dès sa formalisation puisqu’elle a été mise en ligne sur Internet ».
Certes, l’exécution d'un tel partenariat n’est pas exclusive d’une situation d’urgence, si du moins est démontré que les effets de cette convention ont depuis gonflé avec le temps. Me Soufron a bien fait état d’une charte de confiance sur les données personnelles qui « ne respecterait pas les dispositions de la loi Informatique et Libertés ». Une « accusation, spéculative à tout le moins, [qui] ne caractérise pas une urgence » lui a répondu l'ordonnance.
De même, il a évoqué la fermeture de la société Ryxeo, éditrice d'une suite de logiciels libres dédiés à l’éducation. Re-pshit : « le lien de causalité entre la convention litigieuse et la liquidation de ladite société n’est nullement démontré », d’autant que la société a publié un communiqué pour se plaindre de la crise économique et de l’amalgame « libre = gratuit ». Bref, la condition d’urgence n’est pas remplie au titre de l’article 808 du Code de procédure civile.
Défaut du caractère illicite de ce partenariat
Une autre disposition, le 809 alinéa 1 du même code, lui permet néanmoins de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires à la prévention d’un dommage imminent, ce qui suppose une illicéité. Seulement, à bien regarder, le compte n'y est pas.
Microsoft et l’Éducation nationale évoquent un contrat de partenariat. Les associations, un contrat de vente et de louage, illicite car sans prix et passé en violation du Code des marchés publics. L’ordonnance se refuse néanmoins à requalifier cet accord, sauf à malmener la volonté des parties.
Le juge constate surtout que le document ne mentionne pas de prix, n’est pas exclusif, n’impose pas d'obligations à la charge du ministère sauf à instituer des mesures dans le cadre du plan numérique à l’école et à organiser une coordination en matière de communication. Enfin, souvent évoquée, la somme de 13 millions qui pèserait sur les épaules de Microsoft n’y apparaît pas. Bref, le juge de l'évidence a du mal à constater une quelconque illicéité et donc l’existence d’un dommage illégitime qui aurait pu justifier une suspension.
Au final, les associations sont donc déboutées. Elles sont toutes condamnées aux dépens ainsi qu’à verser 2 500 euros à l’État et autant à Microsoft au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Contacté, Jean-Baptiste Soufron n’exclut pas la possibilité d’agir au fond. Une réunion sera prochainement organisée avec les associations pour connaître les suites du feuilleton. Seul petit détail : si jugement il y a, il sera rendu après la fin de ce partenariat.




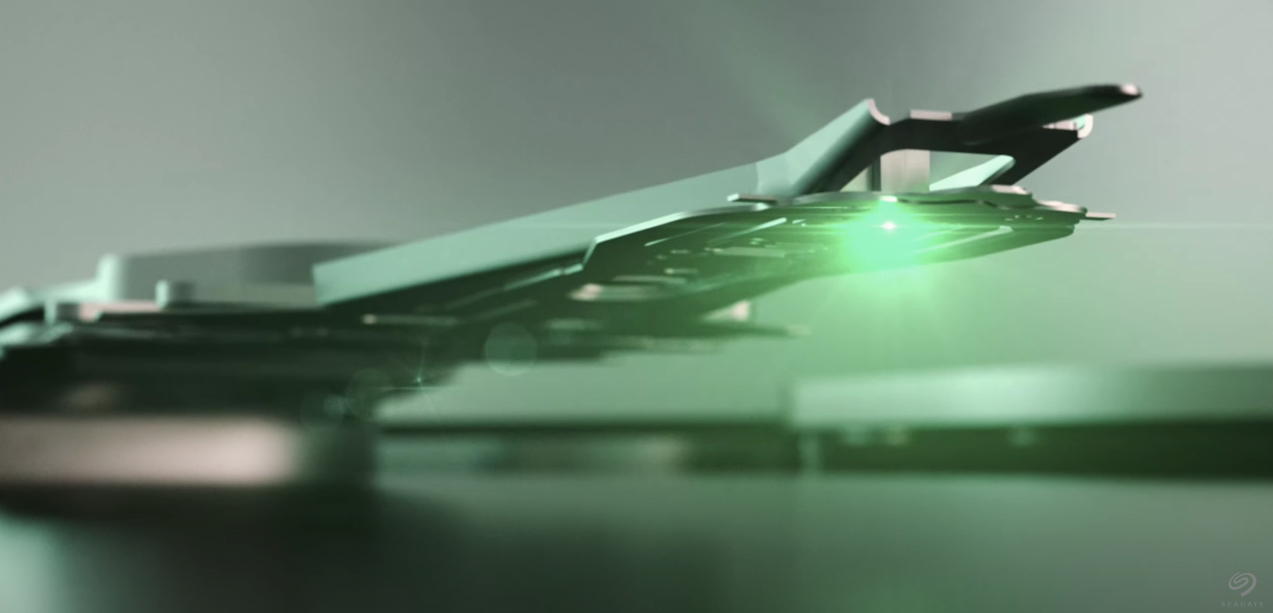




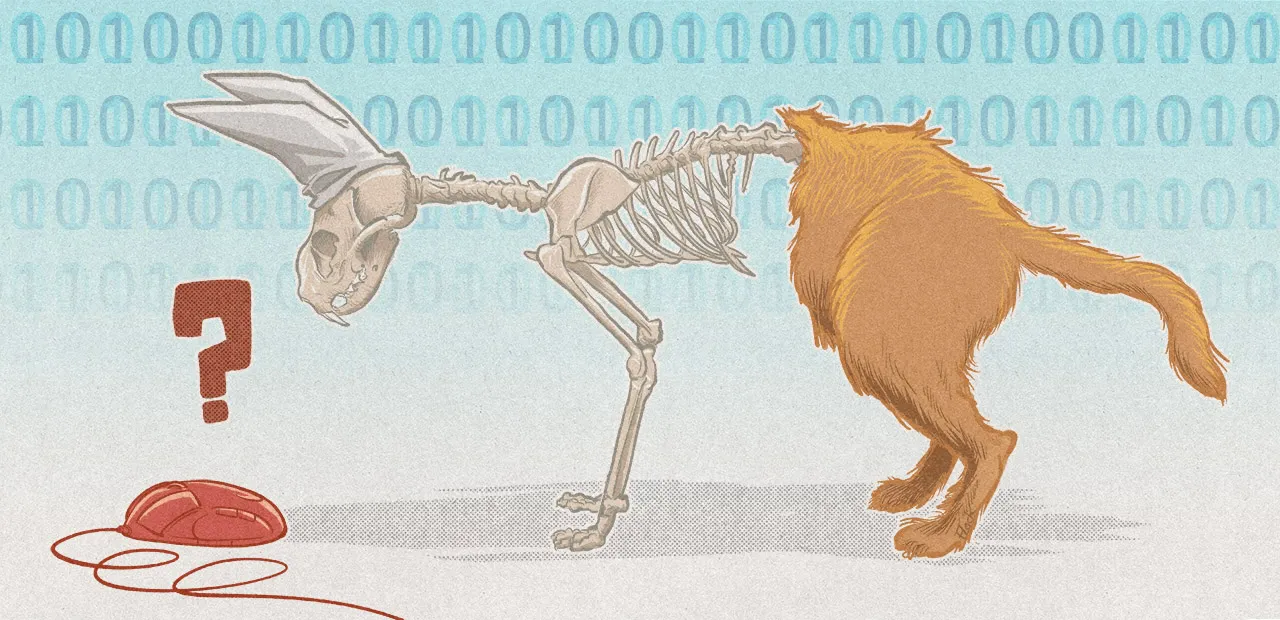














Commentaires (108)
#1
C’est quand même dommage que l’EN livre les élèves à Microsoft comme ça.
#2
Anéfé.
#3
Pourquoi ce n’est pas étonnant ? Tiens, je vais ouvrir un site de prédiction juridique. Celui qui à le plus d’argent gagne, bientôt le concept de justice sera assimilé a celui d’un porte monnaie bien rempli.
#4
#5
Ça permet à la mafia des puissants de continuer à s’enrichir gentiment dans son coin au détriment du quidam moyen. Et au final c’est ce dernier qui se fait entuber mais dont on détourne l’attention vers ces salauds de pauvres qui sont tous des profiteurs. Mais surtout pas les Bettencourt & Cie…
#6
Les associations se sont fait tordre le cou, les bras etc….
Leurs présidents, secrétaires, juristes sont trop éloignés des subtilités administratives et surement trop de débat en interne : on y vas? on y vas pas? et que font les autres? ben pendant ce temps les mois passent.
et comme dans le poème : passe le temps, passent les heures et je me meurs.
#7
#8
Les associations ont perdus en référé car elles n’avaient pas à demander là. Le juge constate qu’il n’y pas d’urgence et que les associations ont 6 mois de retard. Le jugement actuel n’est pas un jugement au fond qui peut intervenir si les associations décident d’aller plus en avant.
Donc en gros, concernant ledit accord, on est pas plus avancé pour sa légalité.
#9
Elles sont toutes condamnées aux dépens ainsi qu’à verser 2 500 euros à l’État et autant à Microsoft
argent versé en Irlande ?
#10
Ha ben au mois les élèves pourront apprendre l’informatique dans un environnement stable, performant et apprendre a coder en .NET, pas encore leader en part de marché, mais de loin le plus performant ! Aucune utilité à sortir de l’environnement Microsoft, tout est tellement bien pensé !
Allez hop circulez !
#11
Ce qui est drôle avec cet article, c’est que l’on a déjà, et que l’on aura encore des commentaires du style “Justice de m* qui va toujours du côté du puissant” alors que dans le cas présent, aucune décision sur le fond n’a été prise.
#12
Donc ils auraient porté le dossier au tribunal en février, là le résultat aurait été différent ? Mais ça ne change rien sur le fond de l’accord, qu’on le fasse en février ou en juillet ! " />
" />
 " />
" />
Et je note de ne jamais mettre de montant dans mes prochains contrats, histoire d’éviter les embrouilles
#13
Si l’accord entre l’EN et Micro$oft ne précise pas la façon d’utiliser ces logiciels.
“ON” peut imaginer que les logiciels en question (Suite Office et Visual Studio par ex) ne seront distribués uniquement aux enseignants afin de faire des démo comparatives avec les équivalents en Logiciel Libre qui eux seront mis dans les mains des élèves qui pourront aussi les exploiter sur leur PC.
“ON” peut rêver….
Si ce n’est pas le cas c’est une planification (socialiste???) pour l’agrandissement de la fracture (du gouffre) numérique pour les familles peu aisées…
#14
Merci de le rappeler " />
" />
#15
#16
On a déjà un point “j’aime pas les riches” en #5 " />
" />
#17
#18
La Justice en référé ne juge pas sur le fond :
« En cas d’urgence, la procédure
de référé judiciaire vous permet de demander à la Justice d’ordonner des
mesures provisoires tendant à préserver vos droits, à prévenir un
dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »
source : justice.gouv.fr
#19
Franchement, quand on voit le bordel dans le libre, les trentes mille versions de linux (y en a pas un capable d’offrir la même ergonomie et facilité qu’un windows (j’entends par là, pas de ligne de code, et une capacité à installer tous ou presque en graphique, tout le monde n’a pas que ça à foutre d’apprendre un langage qui sera inopérant sur une autre distri) , le décalage d’ergonomie de libreoffice, etc… Je suis désolé mais c’est pas plus mal. Après, l’exile fiscal, c’est autre chose.
#20
Les associations ont porté l’affaire devant le juge des référés (Justice d’urgence visant à annuler rapidement quelque chose) et la réponse de la justice a été : “Vous pouvez pas dire qu’il y a urgence si vous mettez 6 mois à porter la chose devant nous”.
Exemple d’appel en référé : Les contestations des arrêtés municipaux contre les burkinis. L’appel en référé a eu lieu 3⁄4 jours max après.
Dans le fond de l’affaire, aucune décision n’a été prise puisque c’est juste un juge des référés qui a donné son jugement. Si l’affaire n’est pas portée devant la justice “régulière”, sa décision aura force. Mais si les assos vont plus loin, ce qu’elles doivent faire, et qu’elles gagent, ce jugement en référé n’aura plus de valeur.
Le problème là n’est pas sur l’accord en lui-même mais sur le fait que ces associations s’y sont prise comme des glands.
#21
Faut-il donc comprendre derrière que les recours gracieux et autre procédures administratives sont strictement inutiles, et qu’il vaut mieux taper directement sur ma justice plutôt que d’y aller à l’amiable ?
 " />
" />
De puis Racine et «Les Plaideurs » ça a pas vraiment changé, m’enfin bon
#22
Non, le juge n’a pas jugé la légalité de l’accord.
Il a jugé que la discussion sur sa légalité :
Donc il a dit aux assos, vous m’avez sonné pour rien. Voyez avec mon collègue pour un jugement au fond. Ah et puisque vous m’avez sonné pour rien, ça fera 2500€.
#23
Un juge qui déboute les associations de leur plainte ce n’est pas une décisions judiciaire???
Ah bon…
#24
+1
Les associations ont été “trop” gentilles, trop lente à réagir voir même mal conseillées… Le fond de l’affaire n’a pas été jugé.
#25
C’est une décision judiciaire oui, par une décision sur le fond vu que c’est un juge des référés.
#26
Ça je suis bien d’accord qu’il n’y a pas eu débat sur le fond.
Mais la décision du juge de les débouter reste une décision judiciaire, ce qui permets éventuellement aux associations de monter d’une échelon dans la procédure judiciaire, justement pour obtenir un jugement sur le fond.
#27
#28
#29
Version H2G2 " />
" />
There’s no point in acting all surprised about it. The plans and demolition orders have been on display at your local planning office in Alpha Centauri for fifty of your Earth years, so you’ve had plenty of time to lodge formal complaints.
[…]
What do you mean you’ve never been to Alpha Centauri? Oh, for heaven’s sake mankind, it’s only four light years away you know. I’m sorry, but if you can’t be bothered to take an interest in local affairs that’s your own lookout.
http://www.imsdb.com/scripts/Hitchhiker’s-Guide-to-the-Galaxy,-The.html
#30
#31
#32
Tiens c’est marrant j’ai le même genre de remarque quand je doit utilisé un logiciel propriétaire.
C’est gonflant à la longue ces commentaires (troll ?) qui parlent de “mon expérience personnel des logiciel s libres” dans des article qui parle du problème de non respect du principe d’appel d’offre.
Expliquer que le choix technique du gouvernement est le bon via un jugement personnel à l’emporte-pièce relève plutôt du hors-sujet.
Ou peut être que certain ici, trouve que les appels d’offres sont un mauvais système et que la concurrence, pfff … ?
#33
#34
C’est ça.
#35
la petite faute de frappe qui va bien  " />
" />
#36
Encore beaucoup de fantasmes sur ce sujet. J’avais déjà commenté la dernière fois mais je le fais de nouveau.
Déjà les assos étaient au courant depuis le début, y avait eu tout un tas d’articles sur les grands médias, le monde etc. Y compris sur NXI je crois, bref, pour pas être au courant fallait le vouloir.
MAis c’est pas ça qui compte. L’Education Nationale n’équipe pas les collèges en matériel, c’est le Conseil Départemental qui le fait, et ce sont les communes pour les écoles.
Sur le plan logiciel, c’est chaque Académie (le Rectorat donc) qui décide, et ils font clairement pas les mêmes choix les uns et les autres.
Donc ce partenariat ne signifie absolument pas que Microsoft va être déployé dans les écoles. Je suis dans une boite française qui propose des tablettes Android faites maison pour les écoles et les collèges, et je tourne de villes en villes dans des bahuts. Et ben sachez que Microsoft j’en vois quasi pas la couleur, et que les appels d’offre (passés encore une fois par les collectivités et PAS l’Education Nationale) ne sont clairement pas remportés par Microsoft dans la grande majorité des cas, mais plutôt pas de l’Apple et diverses solutions Android.
Ce qu’entraine ce partenariat (qui a pas tellement fait plaisir dans ma boite puisque nous sommes des concurrents de MS) c’est que certains services, dans le cas du choix de MS, seront gratos. Mais dans le fond, c’est le cas de bien des services à commencer par ceux de Google. En fait ce partenariat, pour MS qui avait depuis longtemps la politique de brider ses prix dès qu’il s’agissait d’éducation (pour former de futurs consommateurs), c’est surtout un coup de pub et rien d’autre.
@NXI : je sais que c’est un sujet un peu particulier et sectoriel, mais ce serait sympa qu’un article un peu de fond vienne expliquer tout ça. Là il se raconte un peu tout et n’importe quoi.
#37
Niveau psychologie de comptoir on fait très fort sur cette news quand même !
#38
“bug dans la mise à jour”
Pourtant elle dit qu’elle ne voit rien
#39
Bien fait pour les assos qui ont mal fait leur boulot. Le juge a parfaitement eu raison de les débouter sans argument recevable, avec 5k€ pour leur apprendre que le respect du droit s’applique aussi à eux.
 " />
" />
Si vous me cherchez il est déjà vendredi là où je suis.
#40
#41
Attention je n’ai pas dis qu’il s’agit du cheminement normal ou usuel ^^!
Il est “normal” au regard de la procédure initiée par les assos, manifestement peu ou mal informées (volontairement?!) sur les recours possibles/viables.
Le but du référé est d’interrompre en urgence un fait.
Or si la procédure est déclenchée tardivement, le juge des référés peut en effet mettre en doute l’urgence et statuer, vis-à-vis de la procédure qui lui est soumise, un non lieu.
Le caractère “Urgent” est donc écarté.
La licéité de l’affaire quant à elle reste à juger, ce qui n’est pas le rôle de la procédure de référé, quel que soit le cas étudié.
Les associations eussent-elles été gagnantes dans cette procédure, un autre procès aurait eu lieu de toute façon pour juger l’affaire sur le fond.
#42
Sache que dans les établissements, voir la suite Office de MS est rarissime, ils sont tous sous Open ou Libre Office, et c’est pas forcément près de changer. Par contre y a du Windows (7 au mieux mais y a encore du XP).
Et pour les quelques étabs en Linux, la réalité est que ça ralentit gravement les usages parce que y a plein de merdes à cause d’un manque de compétences. Je passais y a pas longtemps dans un collège où un prof de techno avait fait imposer Linux, et le gars faisait vraiment un bon boulot pour que tout marche aux petits oignons. Mais ca lui prenait un temps fou et il était pas payé pour ça.
Il est parti à la retraite et depuis c’est un bordel sans nom, personne arrive à prendre la suite. Résultat : migration sous Windows l’année prochaine.
#43
les lobys (heu… Microsoft) on encore bien travaillé
Changez rien surtout!
#44
“si urgence il y avait, les associations auraient dû agir immédiatement à
sa porte, et surtout ne pas perdre un temps précieux auprès du
ministère avec une procédure administrative inutile.”
Donc l’institution la plus lente, la justice, reproche la lenteur de la réaction… Et avoue clairement que les recours administratifs auprès de l’EN sont “inutiles”. Pas mal !
Plus ça va plus on se croirait dans Brazil !
#45
Et ça a continué après ton commentaire
#46
#47
#48
#49
justement, quand tu vois les arguments ça fait vraiment penser aux lobBys
(pis les mots en Franglais…. :o )
#50
Le fait que 6 mois de délai, ce soit plus une urgence c’est un argument de lobby ?
#51
Je sais bien, d’où mon “aussi”. Tu prêches un convaincu.
#52
#53
#54
Je crois que c’est ce qu’on récolte quand on veut prendre les juges pour des cons.
Cela ne plait pas à certains mais c’est exactement ce qui est arrivé et il est difficile de trouver une faille dans le raisonnement du juge.
#55
Alors, je crois qu’il y en a qui n’ont pas compris ce qu’implique un jugement en référé.
On est d’accord, il s’agit d’un jugement qui se fait dans l’urgence pour suspendre une décision, un contrat, etc.
Mais le jugement est bien toujours fait sur le fond !
Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une urgence qu’on va suspendre toutes les décisions qui font l’objet d’un référé, sinon, on bloque tout.
Donc ce jugement est clairement en 2 parties :
1) Les demandeurs s’y sont pris trop tard pour qu’on puisse parler d’urgence, ce qui entraine un déboutement automatique et une condamnation aux dépens. C’est pour la forme
2) La demande n’est pas justifiée au vu de la léicité de l’accord, ce qui entraine un déboutement non automatique. C’est pour le fond.
Si on lit le jugement, on peut lire clairement que le jugement ne porte pas que sur la forme. Encore faut-il savoir lire.
Alors, ok, c’est un référé, donc il faut que le problème soit évident (ce qu’il n’est clairement pas selon le tribunal) et les associations peuvent toujours aller plus loin, mais ce jugement pourra peser (lourd) dans les débats ultérieurs.
#56
#57
#58
Franchement celui qu’il faut plaindre c’est l’avocat qui n’a pas bien conseillé les associations dans leur action. Il aurait pu anticiper ces points là.
#59
#60
#61
Moi ce que je voudrai c’est qu’un jeune en formation d’initiation à la programmation étudie à l’école (… lycée, fac, etc) avec Visual studio et ne puisse pas mettre en œuvre ou corriger ses TP pour cause de “pas les moyens de me procurer” le logiciel en question.
Quant à utiliser Linux, Windows ou Mac ce n’est que le système d’exploitation (je suis utilisateur Linux, Windows n’est disponible sur mes bécanes qu’invité sous VirtualBox), toutes les machines du commerce courantes sont vendues avec Windows donc… inutile de refaire le procès de la vente forcée, c’est déjà perdu la commission de l’UE l’a validé dernièrement.
Le problème Linux c’est justement parce que le promoteur essai de faire un truc aux petits oignons au lieu de rechercher une distribution répondant à un max de besoins et de l’utiliser tel-quel mais de faire de la documentation pour expliquer les différences et d’expliquer les palliatifs que les utilisateurs prennent ou pas (ou en trouvent d’autres).
La documentation étant souvent la dernière roue du carrosse, pas mal de projet foirent pour maintenance impossible après le départ du bidouilleur de 1ère classe, ou pendant le développement initial parce-que le logiciel n’est qu’un ensemble de verrues.
#62
#63
#64
#65
Tout le monde n’a pas l’air d’accord avec toi. (cf 2 posts plus bas que ta réponse)
En disant c’est “plus sur la forme que sur le fond”, il me semble que je suis sans doute pas trop loin, même si effectivement ma connaissance du système judiciaire est quelque peu lacunaire !
#66
Courage courage Konrad à lutter contre des moulins !
P.S.: RMS dirait d’ailleurs que c’est beaucoup grâce à GNU que tout cela est interopérable… c’est pas faux, le fameux “langage” utilisant en général pas mal d’utilitaires GNU genre grep, sed, etc… au milieu des instructions de contrôle de flot (boucles, tests,…) !.
P.S.2: ma mère [74 ans] n’a pas appris la moindre instruction du fameux langage et se sert à merveille de son PC Linux, ce depuis 8 ans.
#67
#68
C’est vraiment un problème de (transfert de) compétence, et de directives claires et soutenues (ou pas) par la hiérarchie/direction.
Même dans les DSI de grandes écoles ou universités, on voit ce genre de cheminement !
Il suffit qu’un gus, un peu balaize en linux, leader d’une équipe, se casse ailleurs, pour que les départements qu’il avait sous sa responsabilité migrent peu de temps après sous Windows…
C’est tellement plus facile et intuitif d’installer des softs sous Windows que n’importe quel gus, pour peu qu’on lui ai donné les droits d’admin, peut le faire…
#69
#70
#71
#72
#73
Je te rassure le problème du transfert de compétence ce n’est pas réservé à l’informatique. Je connais un poste d’un responsable en santé qui a aussi la responsabilité de l’assurance qualité/traçabilité.
Les prédécesseurs n’ont laissé aucun documents si ce n’est les procédures obligatoires pas à jour (la boîte est passé à l’informatique)…
+1 pour l’obligation de transfert de compétence
#74
#75
J’y comprends plus rien dans ces histoires.
 " />
" />
#76
#77
#78
#79
Je soutient la Mouette.
Mais je savais que cela allez finir ainsi … quand on inverse les valeurs ce sont toujours le “méchants” qui gagnent … toujours.
Le côté obscure de la force !
#80
Merci pour cet éclairage du terrain qui apporte beaucoup plus que l’article en lui même. Il permet de comprendre pourquoi
Comme tu le dis bien : cette bataille n’est pas juridique mais elle se gagne sur le terrain, en faisant valoir que les produits libres sont plus appropriés que les produits propriétaires.
#81
Dès le premier article j’avais annoncé que c’était mal branlé leur truc.
#82
#83
J’essaye de remettre les 2 posts en 1 " />
" />
#84
#85
#86
#87
Non.
#88
#89
Les histoires de pognon entre les boites ne me concernent pas je ne suis pas actionnaire… Et il y a aussi de ces mêmes histoires entre les boites pro-Microsoft/Apple.
Je viens de faire un recherche infructueuse pour télécharger Microsoft Office gratuit, PAS TROUVÉ normal je ne suis pas un gosse mais peu importe j’ai LibreOffice.
C’est bizarre il y a quelque temps j’ai développé un programme devant tourner sous KDE il fonctionne correctement, merci. Ce qui est bizarre c’est qu’il fonctionne aussi sous Gnome (en trichant un peu) avec quelques bibliothèques de KDE et très très étonnant il peu faire un apparition opérationnelle sous Windaube.
Les programmes shell, pour être portable il suffit de les programmer en sh de base sans utiliser les petites fioritures du bash où l’on peu trouver des différences entre les distributions c’est vrai mais aucune incompatibilité majeure. Mais tout cela est hors sujet.
Je pense que ce qui est bon c’est que nos enfants (petits enfants dans mon cas) ne soient pas formatés uniquement aux produits Microsoft.
#90
#91
#92
+100
 " />
" />
C’est politiquement inexcusable
#93
#94
on appelle ca un tribunal prive et ca existe deja grace aux accords de libre echange, type ALENA, TAFTA, CETA.
Des clubs prives de decisions de justice ou les citoyens se dont enfler a chaque fois
#95
#96
Et TAFTA a du plomb dans l’aile avec la position actuelle de la France.
#97
Je sais qu’ on ne peut pas reproduire une marque sans autorisation.
Toutefois une reproduction de la marque Pschitt pour ceux qui ne la connaissent pas serait utile tant vous l’ employez à volonté.
Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pschitt_(boisson)
#98
#99
#100
Je ne suis pas d’accord avec toi. Je passe de collèges en collèges (et pas mal en écoles aussi), et le matos n’est jamais le même.
Certains ont des TBI, d’autres des classes mobiles, d’autres misent tout sur la salle info… Et pour un même matériel (TBI, ordis), on a des tonnes de marques différentes. Pour l’administratif (Amon, Scribe…) on retrouve à peu près les mêmes briques mais jamais foutues pareil, c’est impressionnant.
Si tu prends le dernier PNE, qui consiste pour l’Etat à subventionner l’achat de matériel mobile par les collectivités jusqu’à hauteur de 50%, cela laisse toute la latitude pour la collectivité entre choisir des ordis portables ou des tablettes, et pour chacun à choisir la marque… puis encore de choisir le matériel qui accompagnera tout ça (casques, stylets, clavier pour les tablettes, etc.).
Pour MS, ils ont vraiment gagné en termes d’OS pour les ordis, comme dans le grand public quoi. Mais sinon, c’est Open ou Libre Office à gogo.
#101
Ce qu’il y a de complexe n’est pas tant Linux en soit, mais les infras logicielles dans les établissements, avec un réseau pédagogique, l’identification des matériels dans l’établissement, etc. Linux offre les mêmes possibilités que Windows, mais il y a bcp plus de gens compétents sur Windows que sur Linux.
Donc quand quelqu’un se retrouve face à une galère (c’est à dire pas loin de tout le temps), ben c’est plus facile d’avoir du support quand on est sur Windows.
#102
Pour les collèges c’est un peu différent c’est le conseil général qui s’occupe de les équiper en partie. Et les fournisseurs (les marchés donc) ne sont pas les mêmes selon les départements. C’est uniquement lorsque c’est L’EN via le crid que le matos (et surtout le soft) est plus ou moins unifié.
En lycée par exemple pour les TBI, ça été du Promethean, et que cette marque pendant très longtemps. D’ailleurs le phénomène est bien plus marqué dans les lycées et les universités.
Mais encore une fois, c’est aussi lié au marchés qui sont passés, toujours avec les même boites, qui généralement utilisent du MS parce qu’ils ont de gros contrat de volume. Gros contrats qui ne sont signés que parce que ces boites bossent avec l’EN.
L’EN n’est pas directement responsable du gros parc d’OS Windows dans les établissement, mais les contrats qu’elle passe avec ces boites fait en sorte de privilégier MS plutôt qu’un autre OS. Parce que, tout simplement, on se fait plus de fric en passant ce genre d’accord qu’en installant du libre qui ne rapporte rien.
#103
Ah oui en fait tout à fait d’accord avec toi. Faut dire que je passe surtout dans des collèges aussi, et que les lycées ne sont pas dans mon giron.
Et je te rejoins tout à fait pour dire qu’il y a de gros biais dans les fournisseurs “agréés” ou ce que l’on trouve à l’UGAP par exemple.
Petite nuance quand même, je suis pas sûr que les fournisseurs & distributeurs de solutions se fassent foncièrement plus d’argent en envoyant des ordis (ou autres) équipés de Windows que si c’était du libre, sachant qu’une bonne partie des bénéfices se fait via les contrats de maintenance etc ompagnie.
Et dans le cas de ce partenariat MS - Educ Nat, pour le oment, je ne vois pas de retombées conséquentes sur le marché.
#104
En fait le libre est censé être “gratuit” et dans un marché ca se vois tout de suite. et on va te dire : “hey oh, vous êtes aussi cher que votre concurrent mais vous ne proposer pas de Windows ?”
Alors que celui qui propose du Windows arrive a peu de chose près au même prix que celui qui propose du libre, mais avec la “sécurité” Microsoft en plus. Et c’est généralement ce qui fait penché la balance en faveur des soft de MS, le libre ayant un mauvaise réputation auprès des profanes.
Pourtant ayant installé des Ubuntu, les élèves ne font pas la différence entre un Win et un *nix et ils savent très bien où aller et où cliquer pour obtenir ce qu’ils veulent. Reste les profs qui sont un peut réfractaire (et les soft proprio qui ne fonctionnent que sous Windows), mais ça c’est juste une question d’éducation (sans mauvais jeu de mots).
#105
C’est vrai que les profs veulent du Windows. Faut les comprendre c’est ce qu’ils ont à la maison, les softs qu’ils utilisent sont sur Windows… Mais d’accord avec toi qu’un Ubuntu fait parfaitement l’affaire, surtout quand on regarde le type de softs déployés sur les ordis d’un bahut.
En ce qui concerne la suite Office je les trouve plutôt assez sensibilisés au libre en revanche, ils sont pour la plupart sous Open/Libre Office, même sur leur ordi perso.