Devenue l'arme facile des sites vivant de la publicité, les « anti-adblocks » ont pour objet de contrecarrer les mesures de contournement activées par les lecteurs. Seulement, une contrariété pourrait surgir. Elle est liée à la législation sur les données personnelles.
Le mois dernier, par une action concertée, des mastodontes de la presse en ligne ont placardé des messages de sensibilisation, en bloquant parfois ceux qui tentaient d’évincer leurs flux publicitaires. Cette récente campagne « anti-adblock » du GESTE et ses membres, dont le Figaro, Voici, L’Équipe, Le Monde, etc., a ouvert un débat de fond, mais aussi ravivé les critiques d'un consultant « vie privée », Alexander Hanff.
Selon l’intéressé, ces contre-mesures, lorsqu'elles sont techniquement enregistrées et exécutées en douce sur la machine de l’utilisateur, présenteraient un vice. Elles oublient en effet de glaner préalablement le consentement de l’utilisateur avant toute mise en mouvement.
L'analyse est forgée sur l’article 5(3) de la directive ePrivacy 2002/58. Dès lors qu’un acteur en ligne envisage « de stocker des informations ou d’accéder à des informations stockées dans [son] équipement terminal », l’utilisateur doit pouvoir s’y opposer tout en bénéficiant préalablement d’une information « claire et complète ». Et ceux qui implanteraient des « anti-adblock » en douce seraient donc en vilaine contrariété avec cette législation.
Le débat divise toutefois la communauté des juristes. Le blog SedLex ne partage pas ces conclusions. Selon ce site, sous l’article 5(3) « se cache le consentement de l’utilisateur lors de l’utilisation de cookies ». Et l’auteur d’ajouter « qu’un détecteur d’Adblocker et un cookie fonctionnent de manière très différente ». Il aurait en principe un fonctionnement purement local, « dès lors, aucune transmission n’est effectuée ». Et donc, « l’analogie du cookie ne peut pas s’appliquer selon moi ».
La première analyse de la Commission européenne
Seulement, un autre acteur est entré dans la danse. Et pas des moindres : la Commission européenne. Dans une réponse faite à Alexander Hanff, celle-ci juge le champ lexical du fameux 5(3) suffisamment large pour embrasser aussi les « anti-adblock ». Pour s’en convaincre, l’institution bruxelloise rappelle les dispositions du considérant 24 de la directive, où est évoquée la nécessité d’un recueil de consentement pour « les logiciels espions, (...) les identificateurs cachés et les autres dispositifs analogues ». Bref, tout ce qui peut pénétrer dans le terminal de l’utilisateur « à son insu afin de pouvoir accéder à des informations, stocker des informations cachées ou suivre les activités de l’utilisateur ».
Since so many people are bugging me for them here are photos of the relevant pages of letter. pic.twitter.com/vcTG0qdhIC
— Alexander Hanff (@alexanderhanff) 20 avril 2016
Elle cite également le point 65 de la directive 2009/136 sur la vie privée et les communications électroniques, lequel dégomme « les logiciels qui enregistrent les actions de l’utilisateur de manière clandestine ou corrompent le fonctionnement de son équipement terminal au profit d’un tiers ».
Selon le considérant 66, qui n'est pas mentionné, lorsqu'un tiers souhaite stocker des informations sur l’équipement d’un utilisateur, à des fins diverses, qu’elles soient légitimes ou non, il est primordial que « les utilisateurs disposent d’informations claires et complètes lorsqu’ils entreprennent une démarche susceptible de déboucher sur un stockage ou un accès de ce type. Les méthodes retenues pour fournir des informations et offrir le droit de refus devraient être les plus conviviales possibles. »
Un principe, deux exceptions
La Commission européenne considère au final que l’article 5(3) s’appliquerait bien « au stockage par les sites Internet de scripts sur le terminal utilisateur, pour détecter s’il a installé ou utilisé un ad-blockers ». L’analyse n'est cependant pas définitive. Et pour cause, deux exceptions prévues par l’article l’article 5(3) autorisent le stockage ou l’accès techniques « visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques », ou encore ces mêmes actes lorsqu’ils sont « strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur ». Deux portes de sorties qui pourraient être exploitées par ceux qui décident de bloquer les utilisateurs de bloqueurs de pubs.
Alexander Hanff, qui a rencontré la CNIL l’été dernier, assure que l’autorité française le soutiendrait dans sa plainte contre ceux qui ignorent ces règles, retranscrites en France à l'article 32-2 de la loi Informatique et Libertés (voir notre article). Et selon nos informations, le front est prêt à se durcir puisque d’autres personnes ont ou vont déposer d'autres réclamations en ciblant spécialement des éditeurs de presse français...
Des « finasseries technico-juridiques »
Contacté, Emmanuel Parody s’agace. Le secrétaire général du GESTE ne voit là que des « finasseries technico-juridiques » sur un débat « secondaire ». Un sujet qu'il préfère aborder sous un autre angle, plus impérieux : « Un éditeur qui se voit interdire d’afficher un message à ses lecteurs ? Cela pose tout de même une sacrée question. Je crois qu’on n’a pas pris la pleine mesure de ce que cela implique d’un point de vue éthique ! »
Sur le terrain du modèle économique, la charge redouble : « Tous ceux qui pensent jouer au plus malin en contrant les procédures techniques pour accéder à des contenus sans monétisation sont des mouches qui tournent autour d’un plat. Le cœur du message est de se demander si on peut encore avoir des contenus en accès libre qui ne peut se faire qu’avec contrepartie publicitaire. » L’intéressé invite évidemment les uns et les autres à scruter avant tout les pratiques des grandes plateformes.
Ces questions jugées secondaires sont néanmoins auscultées par une équipe de juristes nourrie d’échanges avec la CNIL. Outre l'opt-in, « si la Commission veut que l’on mette 40 pages pour expliquer ces dispositifs, on les mettra, conclut Emmanuel Parody. Nous n’avons jamais eu de problème à donner le maximum d’informations. Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies, cela va devenir complexe ! »





























Commentaires (154)
#1
/Stan
 " />
" />
Fight! Fight! Fight!
/Stan
#2
“Un éditeur qui se voit interdire d’afficher un message à ses lecteurs ? Cela pose tout de même une sacrée question.”
Ca pose seulement la question de savoir si les lecteurs ont le droit de choisir ce qui’ls veulent voir.
Ni plus, ni moins. Et c’est déjà une question compliquée…
Est-ce qu’on doit présupposer un consentement tacite au contrat “pub contre gratuité” ? mystère.
#3
j’adore la photo d’illustration : “vous utilisez un logiciel qui bloque les publicités. Sans ces ressources voici.fr n’existerait pas”
ça ne donne pas du tout envie de débloquer les publicités : au contraire, qu’il crèvent !
Soit on vend du contenu aux lecteurs (les clients).
Soit on vend les lecteurs aux annonceurs (les clients).
#4
« Un éditeur qui se voit interdire d’afficher un message à ses
lecteurs ? Cela pose tout de même une sacrée question. Je crois qu’on
n’a pas pris la pleine mesure de ce que cela implique d’un point de vue
éthique ! »
Un éditeur qui pourrit 90% de la bande passante de ses lecteurs avec des contenus intrusifs et dangereux pour la vie privée, ça ne les dérange pas. D’ailleurs Numerama a relayé une observation intéressante, le poids moyen d’une page web est égal à celui du jeu Doom, en grande partie à cause de la pub (je ne mets pas de lien, je vous laisse chercher).
#5
#6
Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies, cela va devenir complexe !
D’un autre côté, si vous ne balanciez pas 70 cookies…
#7
Tu as le choix de quitter le site qui vit de la pub.
#8
Même pas, le problème de fond c’est que le message apparais suite a collecte d’informations a l’insu du lecteur.
Un site marchand qui affiche que ca sert a rien d’aller plus loin, car ton compte est dans le rouge, il a le droit de le marquer. Par contre il peu pas/n’a pas le droit de vérifier l’état des comptes. (donc techniquement il peut pas afficher ce type de message)
#9
« Un éditeur qui se voit interdire d’afficher un message à ses
lecteurs ? Cela pose tout de même une sacrée question. Je crois qu’on
n’a pas pris la pleine mesure de ce que cela implique d’un point de vue
éthique ! »
On en veut pas de ton “message”.
Après, je comprends que certains sites vivent de la pub.
Il y a une différence entre, au hasard, Cdiscount qui est un vrai sapin de noel et NextInpact qui sait “mettre en valeur” les pubs.
Et les pubs en vidéo qui se jouent toutes seules avec en plus du son non merci.
Les mecs ont trop abusé, voilà le résultat.
Dès que l’on me demande de désactiver adblock, je change de site. Pas de chance.
#10
Le secrétaire général du GESTE ne voit là que des « finasseries technico-juridiques » sur un débat « secondaire ».
Il aurait bien sûr le même avis si la CE penchait en sa faveur
si la Commission veut que l’on mette 40 pages pour expliquer ces dispositifs, on les mettra,
Un éditeur qui se voit interdire d’afficher un message à ses lecteurs ? Cela pose tout de même une sacrée question.
Son “message” ? C’est une plaisanterie ? (</leasalame>)
Sa pub compte plus que le contenu ? C’est l’internaute qui demande de message ?
ah, j’oubliais que sa vision du web c’est tous ces sites clickbait où il n’y a pas de contenu
Et ensuite il viendra pleurer que les internaute passent leur chemin… Ils ont fait les cons et on les a obligé à metter un bandeau “cookies” qui fait ch… tout le monde, visiblement cela ne lui a pas suffit.
Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies, cela va devenir complexe !
Pas grave si c’est complexe. Je voudrais bien qu’il m’explique pourquoi il faut que je me trimballe 70 cookies pour un seul site !
Le poids moyen d’une page web est désormais celui du jeu Doom
(bien que les cookies et autres scripts publicitaires ne soient pas les seuls responsables)
#11
#12
J’ai aussi le choix de rester sur le site et de ne pas regarder/visionner l’image/vidéo publicitaire.
A moins qu’on m’interdise ce choix… et dans ce cas, comme dirait le secrétaire général du GESTE, “Cela pose tout de même une sacrée question. Je crois qu’on n’a pas pris la pleine mesure de ce que cela implique d’un point de vue éthique ! “
#13
#14
Tout cela amène à se questionner sur un modèle économique un peu obsolète et surtout utilisé de manière délirante par certains sites, pour se monétiser facilement. La surcharge de pub n’est pas un modèle viable (La presse papier s’en rend compte tous les jours) et son absence n’est pas viable non plus. Je dois reconnaitre que le combo addblock/ghostery m’est devenu indispensable dans la mesure ou de nombreux site usent de duplicité pour m’amener vers des contenus non sollicités au travers de liens à double ou triples redirection où chacun d’entre elle peut contenir une infection… Il est plus que temps que cela cesse !
Par ailleurs bravo Nextinpact, vous semblez avoir trouvé un modèle propre et j’espère efficace et rentable pour vous
#15
Il faudrait carrément un code de la pub relatif au Web. Parce que sans ça, celui qui a raison sera celui qui bugle le plus, et nous on restera là comme des con a se battre contre ces pub invasives.
#16
Donc tous ceux qui travaillent pour ce site ne doivent pas être rémunérés.
#17
Et quid des extensions du genre “I don’t care about cookies” qui, pour le coup, ne permettent pas de recueillir le consentement de l’utilisateur !
Edit: grilled !
Zyami a écrit :https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/i-dont-care-about-cookies/ ;)
#18
Culpabiliser les internautes, c’est tout ce qu’ils ont trouvé ?!
Misère du web d’aujourd’hui qui devient aussi pathétique que la télé.
#19
Concrètement, y’a-t-il un moyen de “bloquer les ad-blockers” ?
#20
Donc tous les visiteurs doivent être utilisés comme valeur marchande ?
Comme je le disais, c’est une question compliquée. On parle d’un contrat “moral” entre les visiteurs et les éditeurs. Les uns reprochent aux autres d’avoir brisé ce contrat (“trop de pub” vs “trop d’adblock”). Les litiges moraux (éthiques ?) sont les plus compliqués a trancher.
#21
Dès lors qu’un acteur en ligne envisage « de stocker des informations ou d’accéder à des informations stockées dans [son] équipement terminal », l’utilisateur doit pouvoir s’y opposer tout en bénéficiant préalablement d’une information « claire et complète ».
reste “plus” qu’à l’appliquer !!!
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058
#22
Surtout qu’ils incitent eux-même à un installer un adblocker, à leur sauce sans doute… 1ère fois que je vois ça (évidemment, je ne vais jamais sur ce site ^^)
#23
Il y a pub, pub envahissante, pub genante, et trackers
La pub ne me gene pas au contraire ca permet de financer le site, mais le reste ca devient du viol
#24
s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies
70 cookies : il ne doute de rien sur les conneries qu’il fait ce garçon ?
C’est le bel exemple de ce qu’il faut faire pour tuer la presse en ligne ça.
#25
Une question qui peut paraître stupide mais les éditeur de sites peuvent ils afficher un contrat d’utilisation à la première connexion?
Et donc rediriger ceux qui refuse la pub ou utilise un ad blocker si il les refuse.
#26
A partir du moment où tu tapes l’adresse d’un site ou alors si tu cliques sur un lien qui mène vers celui-ci, tu ne sais pas s’il y aura de la pub ou pas.
Si on part du constat que la pub peut t’influencer (ce qui est tout son but), ça devrait être un droit de ne pas voir de pub, et donc, les sites devraient afficher un message pour te demander la permission de t’afficher des pubs (et éventuellement, te faire quitter le site si tu refuses), exactement comme on te pose la question pour les cookies.
Mais quel site accepterait de mettre ce système en place ?
#27
#28
#29
Oui, il suffit de vérifier la présence d’un adblocker et de ne pas charger le contenu tant que le logiciel est détecté.
#30
Il y a toujours un moyen de bloquer des ads avec des adblocks
Il y a toujours un moyen de bloquer des adblocks avec des anti-adblocks.
Il y a toujours un moyen de bloquer des anti-adblocks avec des anti-anti-adblocks.
…
Il y a toujours un moyen de bloquer des (anti)^n adblocks avec (anti)^n+1 adblocks
#31
#32
#33
Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies, cela va devenir complexe !
sans déconner?
alors non seulement on colle à nos lecteurs 70 cookies avec sans aucun doute une bonne partie de cookies tiers ce qui leur permet d’être tracés par toute une galaxie de pubars et autres boites offshores qui feront ce qu’elles veulent des données récupérées, mais en plus vous comprenez, C’EST TROP COMPLIQUE d’expliquer à nos chers lecteurs pourquoi on le fait et pourquoi.
tu m’étonnes. s’ils devaient expliquer d’où viennent les 70 cookies, ça pousserait peut-être certains à se demander ce qu’ils viennent foutre sur le site en question.
c’est surtout ça qui est compliqué.
#34
Si un tel système est jugé légal il élimine un risque judiciaire , que ce soit une condamnation de l’UE ou de la CNIL avec ces histoires de cookies. Et de toutes façons pas de visites ou visites avec ad block c’est pareil financièrement.
#35
Tout à fait d’accord, tout comme cela devrait être fait pour les trackers.
#36
à la place d’un gros message, j’aurais lancé un filtre au débilitron http://www.debilitron.com/)
 " />”
" />”
avec un petit message en bandeau en haut ou en bas : “salut, tu veux lire le vrai article, soit gentil, enlève ton bloqueur de pub
#37
C’est assez tentant de faire des analogies avec du vol d’objets réel, mais ça ne colle pas. Le modèle de la pub est trop différent. Tu pourrais par exemple visiter le site et mettre des morceaux de carton au niveau de la pub affichée, est-ce que ça ferait de toi un voleur ? Non. Pourtant, tu ne verrais pas la pub non plus.
Le problème de la pub c’est que ça t’influence sans forcément que tu ne t’en rendes compte. Quand tu vas payer ton pamplemousse, tu sais ce que tu payes et combien tu le payes. Quand une pub s’affiche, tu ne sais pas combien ça te coûte, tu ne sais pas où vont les informations récoltées lors de la visite de ton site, tu ne sais rien de tout ça. Donc non, ce n’est pas comparable.
#38
#39
Clair que la pub c’est une des plus belles saloperies du XX et du XXI siècle.
#40
Ma morale c’est de ne pas profiter gratuitement du travail des autres.
#41
Je propose une nouvelle extension histoire de foutre encore plus le bordel " />
" />
 " />
" />
 " />
" />
2 modes de fonctionnement:
1/ Le mode adblocker qui… adblock
2/ Le mode afk : tu mets tes sites préférés financés par la publicités dans une liste et l’add-on ouvre/rafraichit tous les sites sans bloquer les pubs dans des sessions privées/anonymes
Hum attendez j’ai les annonceurs qui frappent à la porte
#42
Ma morale c’est de ne pas profiter gratuitement du travail des autres.
Les éditeurs profitent gratuitement de l’activité de visualisation des utilisateurs.
Les utilisateurs profitent gratuitement de l’activité de publication des éditeurs.
Le contrat de base était un bénéfice mutuel. Mais ce contrat a du plomb dans l’aile.
#43
Nous n’avons jamais eu de problème à donner le maximum
d’informations.
C’est beau cet art magique…
Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe
autour de 70 cookies, cela va devenir complexe !
…de dire quelque chose et le contraire à la fois.
Mais blague à part, si il y a une explication tangible pour 70 cookies, je suis preneur.
#44
« stockage par les sites Internet de scripts sur le terminal utilisateur, pour détecter s’il a installé ou utilisé un ad-blockers ».Ça relève de la méconnaissance totale du fonctionnement des sites web: les scripts présents sur le site font partie du site et ne sont pas spécifiquement stockés sur le terminal de l’utilisateur (hors cache) contrairement aux cookies qui servent à mémoriser des informations sur le terminal pour les retrouver ensuite et éventuellement partager avec d’autres sites.
Demander la permission dès qu’un script est présent sur un site, ça revient à demander à l’utilisateur la permission d’afficher le site demandé.
#45
Ca ne change rien au fait que le travail n’est plus rémunéré. Les termes du nouveau contrat ne te convienne plus tu vas vas voir ailleurs.
#46
Je vous aurais dit ce que je pense, mais vous avez un ad-blocker alors vous ne le saurez pas.
#47
#48
Certes, mais tu vois l’idée derrière ce que je dis. Un visiteur aveugle qui visite un site avec des outils d’accessibilité ne verra pas non plus les pubs, pourtant il ne vole rien du tout.
#49
Visiblement tu as catégorisé ça dans la bêtise " />
" />
#50
#51
Nan ils se sont couvert avec :
ces mêmes actes lorsqu’ils sont « strictement
nécessaires à la fourniture d’un service de la société de l’information
expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur ».
Donc en gros t’as juste droit de faire ce qu’attend le lecteur
#52
#53
Je parle du principe…
#54
« les logiciels qui enregistrent les actions de l’utilisateur de manière clandestine ou corrompent le fonctionnement de son équipement terminal au profit d’un tiers ».
Cela me fait penser à ces sites qui, sur mobile, te font switcher de la page sur laquelle tu es pour te demander si tu ne souhaites pas avoir leur super application… Exemple :
ouvrir depuis GNews un article du point dans un nouvel onglet va bloquer la navigation puis te faire switcher sur sa page.
#55
Si les termes du nouveau contrat ne conviennent pas aux éditeurs, ils n’ont qu’a trouver de nouveaux visiteurs.
Quel que soit ton argument en faveur de l’un, je pourrais TOUJOURS le retourner en faveur de l’autre… pour la bonne raison qu’il s’agit d’un contrat réciproque.
#56
#57
Si le site ne vous convient pas, libre à vous de ne pas le visiter.
C’est un peu le même argument que ceux qui prennent des jeux en torrent.
Si la politique d’un éditeur ne me plaît pas( et il n’y en a pas qu’un malheureusement), je n’achète pas ses jeux mais je ne les prends pas non plus par d’autres moyens.
#58
Bizarre mon ordinateur je l’ai payé ma connexion je la paye si les auteurs d’algo ne sont pas rémunérés a chaque usage ils bénéficient d’un modèle économique efficace qui les rémunèrent et pour wikipédia il s’agit d’une fondation il me semble qui vit de don et de l’activité de bénévole.
Les journaux ne sont pas des fondations mais des entreprises a but lucratif.
#59
#60
Toute la démonstration de Sedlex tombait déjà à l’eau quand on prenait l’exemple de lemonde.fr qui utilisait un cookie dans sa solution anti-adblock.
#61
Je n’aurai pas du parlé de travail gratuit t’as raison la dessus c’était raccourci simpliste mais plutôt de modèle économique. Les éditeurs de presse ne sont pas des fondations. Ils ne font d’équivalent d’une license libre pour le logiciel, tu vas surement m’en parler.
#62
pour info: la page charge un fichier (css la plupart du temps) genre “ads.css” qui “display:none” la page du message d’info.
adblock bloque ce fichier et le message s’affiche
#63
J’avoue n’avoir jamais codé d’anti-adblock ou regardé le code d’un, mais le fonctionnement c’est pas plutot de voir si une ressource a été chargée ou non ? C’est comme ça que je ferais perso, avec des variables privées pour pas qu’elles soient accessibles.
Du coup y’a aucun espionnage du matériel de l’utilisateur, ça rentre dans le bon fonctionnement du site (comme le lazy loading des images en gros.)
#64
“Selon le considérant 66, qui n’est pas mentionné, lorsqu’un tiers
 " />
" />
souhaite stocker des informations sur l’équipement d’un utilisateur, à
des fins diverses, qu’elles soient légitimes ou non, il est primordial que « les utilisateurs disposent d’informations claires et complètes lorsqu’ils entreprennent une démarche susceptible de déboucher
sur un stockage ou un accès de ce type.”
“j’l’avais pas vu” sera la réponse ?
#65
Oui.
https://github.com/reek/anti-adblock-killer#anti-adblock-killer–reek
#66
des mouches qui tournent autour d’un plat
Sous entendu c’est de la merde qui nous est servie par les affiliés du GESTE?
#67
Bin, maintenant que tu le dis, je suis même étonné d’avoir jamais entendu parler de ça.
Y’a plein de sites qui ont un auto-refresh pour augmenter le nombre de vue, donc c’est que techniquement les vues comptes.
#68
#69
Des mouches autour d’un plat ? Décidément, ce Parody porte bien son nom.
#70
Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies, cela va devenir complexe !
C’est surtout qu’il serait bien incapable d’expliquer ce que font concrètement ces 70 espions, tout ce qu’il peut dire c’est combien ça lui rapporte, de vendre la vie privée de ses lecteurs
#71
#72
#73
(suite) Il est vrai que c’est un peu fort de payer 1 € si on ne regarde qu’un article
#74
Sur la version papier, tu es obligé de lire la pub, sinon ils ne peuvent pas payer les salariés.
#75
Il y a tout de même un problème caché derrière ces “édictateurs de pub en herbe”, en effet à aucun moment il n’est question d’évaluer le contenu transmis en échange de la réclame ciblée ni de son volume.
D’une part la fréquentation est un critère imparfait puisque biaisé par le(s) moteur(s) de recherche qui ne sont pas impartiaux et fortement suspectés de financement qui les rendent déterministes.
D’autre part la bande passante dans laquelle il faudrait mesurer le taux réel d’information au milieu des balises et autres protocoles de transmission et enfin non des moindres la place de la publicité car au final c’est le débit qui est vendu aux clients-nautes.
On serait assez idiot pour payer un service vantant le très haut débit qui nous arroserait de pub par celui-ci ?
#76
#77
Quand est qu’il y aura une notice sur les effets de la publicité sur l’être humain avant la diffusion de cette dernière.
Quand est-ce qu’il y aura indiqué sur les étiquettes des produits en vente la part du coût de la publicité?
#78
Chevalier ou Laspalès sort de ce corps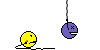 " />
" />
#79
En l’occurrence voici, le monde, le figaro, ce sont des journaux papier aussi. " />
" />
 " />
" />
Donc non, s’ils la joue bien, une visite avec adblock ou pas de visite c’est pas la même chose. Il suffit de garder des articles pour la version papier et d’en faire la pub sur la version web (je ne parle pas d’encart pub, mais d’un bandeau indiquant le sommaire des articles inédits de la version papier).
Et même sans ça quelqu’un qui est intéressé par les articles sur le web pourra finir par acheter la version papier (même si je n’ai aucune idée du taux de conversion).
Et enfin il y a le paywall si nécessaire. Mais un utilisateur n’achètera pas un article ou un abonnement si il n’accède à aucun article parce que on le bloque parce qu’il a un adblocker.
Nextinpact et d’autres rares sites montrent qu’une autre démarche de gestion des pubs et un autre système économique est possible.
#80
En attendant, un petit uMatrix pour défourailler tout ça…
#81
J’irai même plus loin : pas sans analyse du comportement du navigateur.
Tu peu parfaitement faire une redirection des cookies venant de certaines URL vers /dev/null a leurs interception via reverse proxy+regex, le cookie ne touchera jamais ta machine locale et sera directement redirigée vers le néant absolu : a condition de ne pas utiliser de couche secure, ou de permettre au reverse d’accéder a la signature de ta machine.
Voir pour pallier au fait de vouloir du secure et avoir ce genre de comportement, d’installer directement une passerelle vers ta propose machine et de faire une règle firewall sur la machine locale pour éjecté certains contenus de la source : fonctionne dans le cadre d’anti pub mais pas d’économie de bande passante (mais ça fait le job), et ils pourront toujours installer tout les scripts du monde sur ta machine, ils trouveront jamais comment tu rejette les publicités sans installer carrément un système lourd du style contenu encapsulé dans un conteneur pouvant avoir une fonction média (mais dans ce cas pour eux, plus de tracking possible). CQFD : si ils font ça, ils perdent des revenus, des affichages possibles et une commercialisation possible.
#82
Leur vrai modèle économique c’est la subvention d’état, donc le lecteur (ou non) a déjà payé qu’il utilise adblock ou pas, c’est juste leur cupidité qui les poussent à insulter leurs lecteurs (façon majors du showbiz), et puis sur figaro.fr la pub elle est souvent DANS les articles qui vantent tel produit ou telle société " />
" />
#83
#84
#85
Tu n’as pas adblock intégré à ton nerf optique, tu en lis forcément,
peu importe les grimaces que tu peux faire.
#86
#87
#88
Ces questions jugées secondaires sont néanmoins auscultées par une équipe de juristes nourrie d’échanges avec la CNIL. Outre l’opt-in, « si la Commission veut que l’on mette 40 pages pour expliquer ces dispositifs, on les mettra, conclut Emmanuel Parody. Nous n’avons jamais eu de problème à donner le maximum d’informations. Simplement, s’il nous faut exposer tout ce qui se passe autour de 70 cookies, cela va devenir complexe ! »
Y a des site qui a besoin de 70 cookies?!
#89
#90
Moi si. Tu me montres une pub, si je ne fais pas un effort conscient, je suis incapable de te citer ni le produit ni la marque même 2 secondes. Je me serais juste rappelé qu’un contenu nuisible m’a cassé les noix pendant x secondes.
#91
Depuis qu’il y a eu des abus de pub lors du début du net et que Adblock est sortie, bah putain que j’ai respiré, voir des bloques clignoter dans tous les sens, des musiques / son qui se lançaient, et j’en passe des meilleurs non merci..
Sur mobile, on t’ouvre une popup de merde alors que t’as pas encore lu un mot du contenu que tu souhaites visionner, tout ça pour t’inciter à cliquer sur un connerie (80% des cas).
Jamais je débloquerai mon outil tant que les pratiques ne seront pas revu, perso je hais la pub à la télé, sur le net, sur les app, partout, ça me gonfle.. On te bombarde de ces merdes toutes la journée en t’épuisant psycologiquement à acheter, Génial n’est-ce pas?
Si je veux acheter quelque chose, je n’ai pas besoin d’être bousculé.
#92
#93
Je ne suis pas contre la pub lorsqu’elle est respectueuse (j’ai bien marqué la pub…)
mais l’intrusive qui s’affiche quand tu parcours un texte ou qui te plante 20s de visu bon gré mal gré …NON !
une pub latérale ou en en-tête de site ne me gène pas, il m’arrive même souvent d’aller y jeter un oeil
(je le récupère après…)
L’abus crée la défense !
Et si les ad-blocks existent c’est assurément parce-que les publicistes poussent le bouchon trop loin.
Quand leurs publicités sont comme la poussière sur un pare-brise de voiture…
Hop, un coup de balais d’essuie-glace !
#94
Ils s’en foutent un peu de ce que tu veux; eux ils veulent te forcer à acheter tout et futiles ; je parle pas pour toute les formes de publicités , mais en partie celle pour des produits
#95
Vive l’internet cent pubs
#96
Intéressant mais en toute honnêteté la pub est déjà assez omniprésente…
#97
ça, on le devine (presque tous), et qu’ils “leurs bonnes raisons” (arg), mais n’empêche
 " />
" />
elle reste gonflante, on est obligé de la subir pour pouvoir accéder au contenu de la vidéo .
le Publiciste qui trouvé ça…mérite le Prix Nobel !!!
#98
/popcorn
#99
#100
Parce que la pub a un rôle qui va au delà d’orienter vers un produit visé. La pub en tant que telle, dans sa globalité, a une fonction propre : faire accepter le principe d’une société de consommation.
Lorsque tu es agressé de pubs de toutes parts et que tu décides de ne pas cliquer, regarder ou meme que tu rejettes la marque, tu as l’impression de faire un acte de résistance. Si tu résistes c’est que tu ne rentres pas dans la norme (si on est dans la norme, on n’est pas un résistant). Donc tu acceptes inconsciemment que la norme est de consommer.
D’ou l’utilité “sociale” du matraquage publicitaire dans une “société de consommation”.
#101
Pour ma part j’utilise un bloqueur de publicité pour plusieurs raisons :
- j’en ai marre des sites dans lesquels 60% de la page sont remplis de publicité
- assez souvent ce sont des vidéos qui se lancent sans mon accord et avec le son en plus
- les sites prennent 10 fois plus de temps à se charger, quand on a pas la fibre ça fait mal
Depuis j’ai vraiment améliorer mon expérience de surf. J’ai tellement soufflé que je n’ai pas cherché à regarder quel site mérite de se faire bloquer la publicité ou pas.
Je ne suis pas contre l’utilisation de publicité du moment où l’expérience utilisateur est respecté. Un petit bandeau en haut de page, une petite case dans le coin cela suffit. Un gif pour l’animation aussi pas de flash s’il vous plait.
Du coup je pense qu’il faudrait surtout contrôler l’utilisation des publicités dans les pages. Et les sites qui pleurent parce que leurs clients demandent à ce que les utilisateurs désactivent leur bloqueur devrait plutôt inviter les utilisateurs à constaté que leur publicité n’est pas envahissante.
Voilà
#102
#103
Je ne connaissais pas. Merci bien l’ami !
#104
101 ? ..tant que ça !!! " />
" />
#105
#106
le modèle économique au clic ou à la vue est bête à souhait. Il induit les sites internet à adopter des pratiques franchement abjectes.
C’est ensuite la réputation du site en question qui tombe en flammes et donc ses revenus potentiels. Par contre pour le publicitaire, aucun problème moins il y a de vue moins il paye, il ne prend aucun risque (surtout que les vues risquent d’être redistribuées sur d’autres sites qui lui rapportent eux aussi des vues et permettent de montrer “l’efficacité” de la campagne publicitaire).
Quand est-ce que les fournisseurs de contenus des sites se rendront compte que leur relation avec les publicitaires n’est pas seulement nocive pour les utilisateurs mais également pour eux? Pour ceux qui diraient que c’est pas possible de se battre contre ces publicitaires, et qu’ils ne peuvent pas négocier alors il s’agitd’un problème de concurrence et ça n’est toujours pas au lecteur d’en faire les frais.
J’ajoute encore que la publicité la meilleure et la plus efficace est quand l’utilisateur est intéressé et réceptif.quand on me force à consommer de la pub j’ai plus tendance à détester celui qui me force et le produit dont il est question. Est-ce qu’améliorer la qualité de la pub et non sa quantité ne serait pas mieux
économiquement?
Enfin tout ça n’englobe pas les pratique plus que douteuses en terme d’intrusion dans la vie privée et de tracking, le tout sans que personne ne sache ce qu’il donne, a quel prix et à qui profitera ces données.
C’est se comporter en truand et prendre les gens en otage les sites et les utilisateurs que de “criminaliser” l’utilisation des bloqueurs de pub. Pour moi si le site veux contrôler l’accès à ses contenus alors il en restreint l’accès (comptes, etc). La consultation d’un site ne crée pas a mon sens un contrat obligeant d’en imprimer chaque ligne de la première à la dernière y compris la pub.
Bref, il y a une belle place pour de l’innovation en terme de business model publicitaire. Pub éthique ou meilleure valorisation des espaces publicitaires des sites? on peut même envisager autre chose que du premium même si cette solution a l’avantage de permettre aux sites de s’émanciper des publicitaires.
#107
#108
mais
le jour où “Mrs. les Publicistes” AURONT, ENFIN, compris ça, on aura bien avancé !
mais, on n’en prend pas le chemin, au contraire c’est “..comment je peux ent
#109
Et pi faut avoir un sacré four pour tous ces cookies….
#110
Cette directive ridicule produit donc un nouvel effet ridicule.
A quand une réglementation utile pour la vie privée ? Exemple : signalétique obligatoire pour tout service ou produit pouvant entraîner une collecte de données personnelles (hormis infos nécessaires à la maintenance, à la sécurité, à la qualité du service ou à l’amélioration du service dans la mesure du raisonnable).
#111
C’est vraiment un gros débat que celui de la pub sur Internet, surtout que les torts sont grandement partagés.
Il y a d’une part une immensité d’internautes qui pensent réellement que ce qu’ils consomment sur le net doit absolument être gratuit. Et qui n’en démordent pas. Lire un article écrit par un journaliste, même s’il a enquêté pendant des jours, ça doit être gratuit. Voir des films qui ont coûté des millions, ça doit être gratuit. Tout doit absolument être gratuit, comme ça ils peuvent se payer un iphone à 650$ (oui, c’est un objet, c’est pas pareil).
Je ne suis pas d’accord. Un contenu, ça se paye, parce que ça a demandé à son auteur du temps et du travail. On le paye via des abonnements, ou via des publicités. Vous ne voulez pas lâcher quelques euros sur un site, alors faites avec la pub.
D’un autre côté, le tout gratuit (avec pub) a été bien trop largement exploité par les “créateurs” de contenu. Les sites “clickbait” n’auraient tout simplement pas existé sans ce modèle. Publicités intrusives, redirections fantômes pour simuler du clic (mention spéciale aux sites de morandini pour ce système) et popups en tous genre ont fleuri un peu partout, avec une baisse générale de la qualité du contenu. Le but étant la rentabilité maximum. Produire du contenu vite, produire du contenu vide, produire beaucoup de clics.
Le modèle vertueux est doucement en train d’émerger, mais sur une technologie encore récente et se métamorphosant souvent, il n’est pas facile de trouver un équilibre.
C’est une question d’éducation.
Il faudra que les internautes comprennent que les gens qui créent de la valeur sur internet méritent d’être rémunérés.
Il faudra que les sites qui abusent de la publicité et pestent contre ad-block comprennent qu’ils sont voués à disparaître s’ils persistent. Ad-block n’est qu’une réponse apportée à leurs abus.
#112
#113
Perso tout les sites qui me bloquent à cause de mon ad-bloker se retrouvent black lister et je n’irais plus jamais même s’ils venaient à faire marche arrière.
#114
#115
#116
#117
je suis un peu partagé…certains sites (comme gamergen pour ne citer qu’eux) abusent carrément, j’ai tenté une fois de désactiver ublock origin sur ce site…mal m’en a pris, articles tronqués par la pub des banderoles en veux tu en voila…n’est ce pas possible pour les sites de trouver un juste milieux (comme pour next inpact ou, abonné ou non je désactive mon bloqueur)
Je peux comprendre que les sites aient besoin de sponsor pour vivre, mais bon de la a imposer un mode de fonctionnement à l’utilisateur, je trouve ça tout bonnement scandaleux.
Certains sites désactivent d’eux même adblock (je n’ai plus leur nom en tête), d’où mon choix d’ublock origin.
Lol Voici ne détecte pas mon bloqueur de pop up.
#118
Les verts devraient profiter de ce débat pour dénoncer un système peu écologique : le poids de la pub sur les pages WEB entraine gaspillage de ressource et de bande passante, et donc gaspillage énergétique (aussi bien pour les serveurs que terminaux).
Sur certains sites où 90% des données ne sont pas liées au contenu, c’est 90% de gaspillage énergétique ! Pourquoi ne pas le taxer ??? Ca calmerait certaines ardeurs, et pousserait à respecter la nature et le lecteur final
#119
#120
lorsqu’un site me demande de désactiver addblock je me casse illico.
plus clair que ça, c’est pas possible.
s’ils ne peuvent vivre sans pub(s), moi je peux, et très bien même 😊
#121
#122
Comme taxer est la seule chose que savent faire les politiques, spécialement en France, cela pourrait en effet etre une solution pour faire bouger les choses.
D ailleurs, taxer la bande passante est tres legitime, puisque l augmentation de celle ci nous “force” à renouveler les infrastructures, payer par le contribuable (fibre optique en zone non hyper urbaine notamment).
Donc oui pour une taxe, mais avec un revenu destiné à l élaboration du réseau!
#123
#124
Sans compter le vol de temps processeur/batterie.
#125
Il n’y a pas besoin de regarder la pub de façon active pour qu’elle agisse.
#126
#127
#128
#129
Même réponse que précédemment : si les règles du web ne conviennent pas aux éditeurs il aurait peut être mieux valu y réfléchir AVANT…. " />
" />
#130
Une question à tous les abrutis défenseurs des anti adblocks : quand adblock sera interdit, mais qu’il circulera une belle liste de domaines de régies publicitaires associés à 127.0.0.1 à copier coller dans le etc/hosts ils vont faire quoi ? interdire de modifier le hosts ?
Et en admettant, quand il existera des DNS qui font la même chose en réaction, ils vont interdire de changer de serveur DNS ?
Il faudrait qu’ils comprennent un jour qu’il faudrait modifier la structure même du web pour les satisfaire…. et que ça c’est pas pour demain….
Pas de bol, la techno a été pensé JUSTEMENT pour éviter ce genre d’abus, donc à moins de changer de techno c’est un combat perdu d’avance….
#131
Pour ceux qui ont un périphérique Android avec un accès root je conseille cette superbe application open source :
http://free-software-for-android.github.io/AdAway/
Ça permet de modifier le fichier hosts, créer des whitelists et blacklists, etc.
Bien pratique :)
#132
Pas les sites qui manquent … si tel ou tel site renonce a ne grosse partie des utilisateurs (car beaucoup de monde utilisent ad block) ils se privent eux memes de la raison de leur existance … Pour ma part si un site me dit desactive ad block ou tu me voit pas je ferme et je vais voir ailleurs y’a de quoi faire sur le net, et je me tape suffisament de pub au quotidien, fallais pas en abuser a se point et peut etre que les adblock n’aurai jamais exister ou n’aurai jamais eu autant de succes … Sans oublier que nombreuses failles de securité sont lié aux publicités de site et que ses dernier ne verifie pas a qui il prennent l’argent des pubs ca justifie mon choix de toujours avoir adblock activé sur tout le sites que je visite. Je serai meme pret a payer pour de tels logiciels :)
#133
Certaines régies proposent désormais des parades … par exemple, en laissant la possibilité aux sites d’héberger eux-même le script publicitaire. Petit exemple avec AdCash : http://support.adca.sh/?st_kb=custom-url-publishers
 " />)
" />)
(Et c’est chiant, car un peu plus compliqué à bloquer
#134
En très gros oui, mais tu peux rendre le système “browser agnostic” avec les infos que j’ai donné.
#135
J’imagine le jour et les TV empêcheront le téléspectateur de zapper au moment de la pub parce que sans la pub “TF1 n’existerait pas”..
Bin là le adblock c comme une zapette quoi, et on essai d’en interdire le contenu si on le zappe ..
#136
#137
#138
il est bien loin le temps de la cinquième chaine, qui coupait ses pubs par des extraits de films.
#139
#140
Le pire c’est que quand tu actives Adblock et qu’ils t’empêche d’accéder au site si c’est juste un mot d’avertissement ça va.
#141
#142
#143
#144
#145
#146
#147