Une pluie d’actions devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Voilà ce qui s’est abattu sur la France avec pour cible principale, la loi sur le renseignement de juillet 2015.
On connaissait déjà la plainte de l’Association confraternelle de la presse judiciaire, celle de l’Ordre des avocats au barreau de Paris et d'Olivier Sur, son président, celle encore du Conseil national des barreaux, et plus récemment du Syndicat national des journalistes et de la Fédération internationale des journalistes.
En substance, les atteintes au texte de la CEDH seraient multiples : atteinte au secret des sources des journalistes, atteinte au secret professionnel de l’avocat, etc. Si ces professions dites à risque bénéficient, dans la loi, d’un régime plus protecteur, ce formalisme se fragilise en pratique puisqu’il est impossible, lors d’un ample recueil de données de connexion, d’isoler celles qui relèvent ou non de ces acteurs. De même, seules les informations relatives à leur profession ou mandat profitent de ce surplus de garanties. Or, il est consubstantiellement impossible d’anticiper dans un échange à venir, celles des données relevant de leur vie privée ou de leur activité.
13 actions dirigées contre la France
Mais d'autres reproches ont pu être émis, compte tenu de la ribambelle de procédures initiées contre la France. Selon l’inventaire dressé par Policyreview.info, ce ne sont en effet pas moins de 13 actions qui visent ce texte censé avoir trouvé l’équilibre idéal entre atteintes à la vie privée et nécessités de maintien de l’ordre et de la sécurité publics :
- Association Confraternelle de la Presse Judiciaire et autres v. France
- Martin v. France
- Lecomte v. France
- Babonneau v. France
- Souchard v. France
- Triomphe v. France
- Egre v. France
- Deniau v. France
- Ordre des Avocats au Barreau de Paris v. France
- Sur v. France
- Eydoux v. France
- Conseil National des Barreaux v. France
- Syndicat National Des Journalistes et la Fédération Internationale des Journalistes v. France
Dans ce lot, sept des recours nominaux concernent sept membres du bureau de l'association de la presse judiciaire. On devrait donc retrouver mécaniquement les arguments portés par les associations et syndicats du secteur.
Des garanties sur le papier, des fragilités en pratique
Rappelons que la loi sur le renseignement a accru les moyens des services du renseignement, eux-mêmes également démultipliés. Sur le papier, les possibilités d’intrusions légales ont été encadrées et donc autorisées pour toute une série de finalités rédigées en des termes très vastes, dont la prévention du terrorisme mais également en matière d’intelligence économique.
Sa grande sœur, la loi sur la surveillance des communications internationales a rendu plus musclé encore ces outils, avec un accompagnement formaliste en net retrait. Pour les communications reçues ou émises depuis l’étranger, il n’y pas de passage a priori devant la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, laquelle n’intervient qu’après l’atteinte à la vie privée.
Ajoutons enfin que la CNCTR elle-même a critiqué le déficit de centralisation des renseignements collectés. Ce problème risque en effet de reléguer au rôle de simple cache-sexe l’utilité normalement attendue de cette instance administrative.





























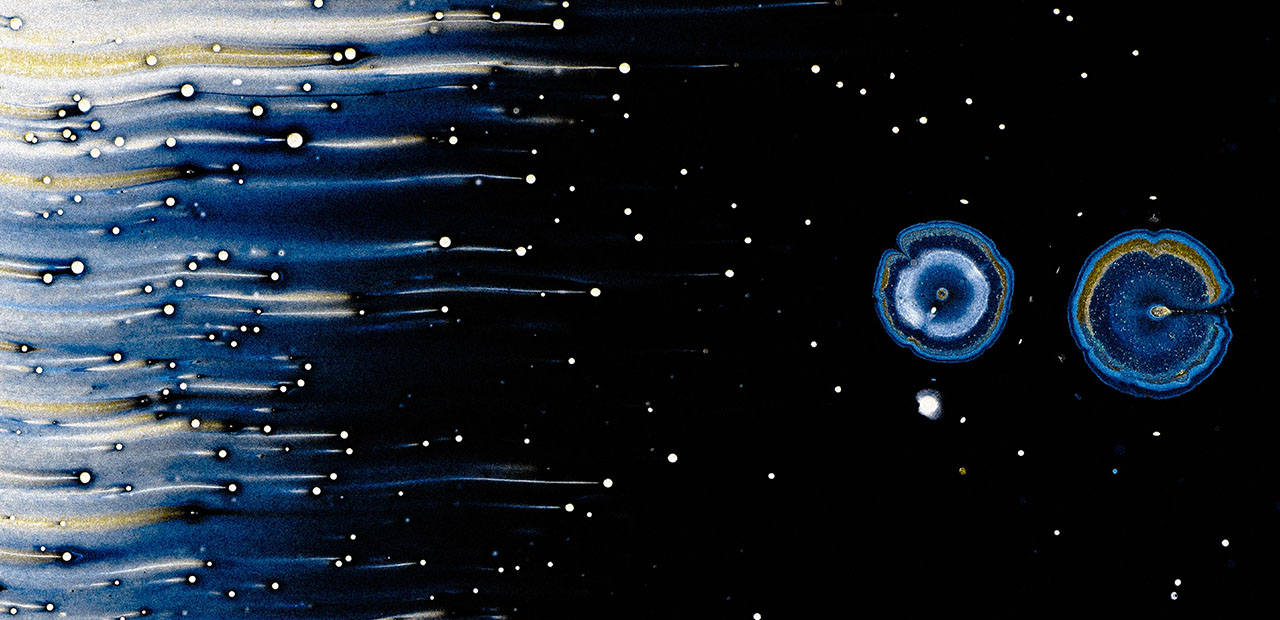


Commentaires (16)
#1
Et bah quand même …
#2
La france & les autorités administratives.
Une grande histoire d’amour.
Le prochain PC que je me monte, sera crypté & avec un abo VPN qui va bien.
J’aurai plus qu’a laisser un verre de lait et un bol de cookie près de l’entrée en attendant le GIGN…
#3
#4
Policiers -éleveurs de cochons, même combat: l’Union Européenne ?
#5
Bah c’est pas valls qui a fait remarqué que les droits de l’Homme ça va bien deux minutes ?
Y a aussi un conseillé en communication qui disait que ce genre de préoccupation faisait parties des “éléments de langage” (lors de la légion d’honeur remise au ministre des affaires étrangères saoudien).
T’as une devise sur le fronton des mairies qui ressemblent de plus en plus à 3 morceaux de PQ.
#6
Nos politiques ont enfin réussi à faire de la croissance d’autre chose que du surendettement… le recul des droits de l’Homme " />
" />
#7
Abjection votre honneur
#8
“Algorisme vs droit de l’hommisme”
 " />
" />
Mais que vient faire Al Gore dans ce truc
#9
Ce serait plutôt allégorie VS droit de l’hommisme " />
" />
#10
J’aime quand on me parle comme ça
#11
#12
Personne pour gueuler contre ces salauds de journalistes et d’avocats qui réclament un statut particulier ?
Je suis déçu #cétémieuavan
#13
#14
#15
Généralement le GIGN ne débarque pas avec un seul gars, donc prépare une colonne de verre de lait ;)
#16
Sans parler du double goulot d’étranglement chiffrage + VPN qui va te castrer les performances de la machine et de la connexion  " />
" />