Hier, en fin de journée, Fleur Pellerin a procédé à l’installation d’un comité de suivi visant à assécher les ressources financières des sites de streaming et direct download illicites. Autour de la table ? Des ayants droit et des représentants des moyens de paiement. En son centre, des listes noires.
Après avoir lancé une charte antipiratage avec les régies publicitaires, le ministère de la Culture a finalement procédé à la deuxième étape : tenter de couper directement les ressources financières des sites peu regardants avec le droit d’auteur.
La voie avait été initialement tracée par Mireille Imbert-Quaretta dans ses travaux contre la contrefaçon en ligne, poursuivie par Pierre Lescure dans son rapport sur l’acte 2 de l’exception culturelle. L’idée est simple : inciter les prestataires des moyens de paiement à couper les liens avec les sites de streaming et de direct download de films, musiques ou encore de jeux vidéo. Mais cette approche, dite « follow the money » (frapper au portefeuille) est loin d’être une innovation française.
Des précédents aux États-Unis et en Angleterre
Ainsi, en 2011, un accord conclu sous l’impulsion de l’administration Obama avait ouvert une voie similaire avec American Express, Discover, MasterCard, PayPal et Visa. Le mécanisme reposait sur « un dispositif de signalement par les ayants droit, suivi d’une démarche de vérification entreprise par l’intermédiaire financier ou la banque du site illicite « mandatée » par l’intermédiaire » expliquait la présidente de la commission de protection des droits, au sein de la Hadopi, dans son rapport de 2013.
« À l’issue de l’échange engagé avec le site, poursuivait Mireille Imbert-Quaretta (MIQ), l’intermédiaire financier, le cas échéant au travers de la banque du site, pourra exiger du site qu’il soit mis un terme à l’activité illicite. À défaut, les services de l’intermédiaire financier impliqué pourront cesser de lui être fournis ».
La même année, une démarche identique était lancée outre-Manche entre l’IFPI, les intermédiaires financiers, Visa, MasterCard et PayPal, avec une nuance : les preuves du caractère illicite des sites pointés du doigt étaient vérifiées par la « direction du crime économique ». D’autres chartes furent aussi signées contre la contrefaçon de marque notamment, en France.
Des listes noires établies avec les ayants droit
On retrouve dans le comité de suivi, installé hier depuis la Rue de Valois, la logique américaine. Le comité associe « les représentants des moyens de paiement et les représentants des ayants droit, sous notre impulsion » annonce Fleur Pellerin..
L’idée est toujours d’aller plus loin que l’application pure et simple des conditions générales de ventes qui permettent déjà de rompre des liens contractuels avec les sites illicites comme le montre l'actuel dossier 1Fichier.com. Il s'agit de faciliter « l’échange des informations et des bonnes pratiques », précise la ministre, avant de décrire d’ailleurs le scénario idéal : « les ayant-droits pourront ainsi signaler aux professionnels des moyens de paiement les sites qui contreviennent massivement aux droits d’auteurs et aux droits voisins, et réciproquement, chacun selon ses compétences et ses instruments. Autrement dit, des listes seront faites, les professionnels du secteur sensibilisés, et le retrait effectif sera suivi de près. »
Le système reposera donc sur l’ébauche par ces acteurs privés, de listes noires de sites jugés par les ayants droit comme « massivement contrefaisants ». Selon le document officiel, « les participants tiennent compte des observations du comité dans le retrait des sites considérés comme contrevenants et s’engagent à prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour sensibiliser leur profession et en assurer l’effectivité, notamment, dans le respect de la réglementation, via l’établissement de listes d’adresses URL ou en utilisant éventuellement des outils technologiques. »
Des listes noires ébauchées sans l’intervention de la Hadopi
En 2014, MIQ rappelait toutefois dans son deuxième rapport sur les outils opérationnels contre la contrefaçon, la sensibilité du sujet. Lors de ses auditions, les acteurs du paiement lui avaient ainsi exprimé le besoin « de disposer d’éléments suffisamment probants pour garantir leur sécurité juridique » rapportait-elle. Aussi, histoire de garantir une « appréciation objective » de la situation illicite de tel ou tel site, la présidente de la CPD proposait de faire intervenir une autorité publique, chargée de valider ces listes noires, voire de les publier publiquement.
L’auteure y voyait en effet plusieurs avantages. D’abord, « la contrefaçon du droit d’auteur et des droits voisins peut être plus délicate à vérifier que d’autres infractions et notamment la contrefaçon de droits de propriété industrielle, en particulier les contrefaçons de marques ». Or, « les intermédiaires de paiement ou de publicité en ligne n’ont pas les moyens de s’assurer de la véracité de l’ensemble des réclamations qui leur sont adressées. Il s’agirait donc de faciliter les tâches de vérification pour les intermédiaires auxquels sont signalés des contenus illicites ». De plus, l’intervention publique aurait sécurisé les mesures d’autorégulation, puisque les acteurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de leur client. Enfin, la mesure de publicité assurée par l’autorité, aurait (peut-être) permis d’engager la responsabilité des intermédiaires techniques, sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’économie numérique.
Visa, Mastercard, PayPal, la musique, le jeu vidéo, le cinéma
Cela n’a pas été suivi par le ministère de la Culture : le mécanisme est essentiellement privé, mettant en scène plusieurs acteurs du paiement en ligne comme l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile), la FBF (Fédération Bancaire Française), le GIE cartes bancaires, Mastercard, PayPal, Visa Europe, outre le Geste (Groupement des Editeurs de Services en Ligne), et une armée d’ayants droit (ou d’acteurs liés à eux). S'y ajoutent ceux issus du cinéma, de la musique et du jeu vidéo : l’Alpa, l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, le SNE (syndicat de l’édition), la SACEL, la SCPP (majors du disque), la SPPF (producteurs indépendants), le SNJV (syndicat du jeu vidéo).
« Cet engagement conjoint est la garantie d’une plus grande efficience de la lutte contre le piratage commercial. Le mode de gouvernance du comité de suivi allie souplesse et durée, et donc adaptabilité de notre riposte » poursuit Fleur Pellerin, avant d'esquisser son prochain plan de bataille : « Il s’agit désormais de progresser sur le chemin du signalement et du retrait des œuvres exploitées illégalement, par l’intermédiaire d’outils technologiques efficaces et performants. Il en existe et je travaille aujourd’hui avec le CNC pour que les producteurs s’en saisissent plus massivement. »





























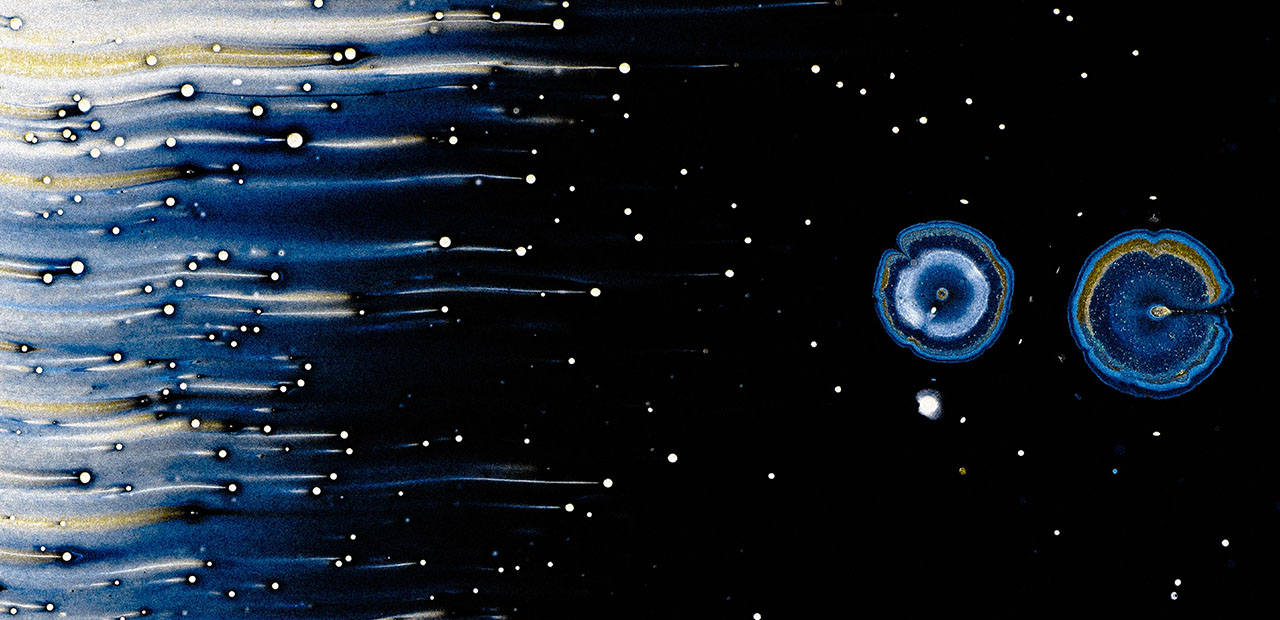


Commentaires (70)
#1
Pendant ce temps là, à Rome, la SACEM vient rendre visite à la SIAE (équivalent italien) pour un projet commun. Je les ai croisés ce matin dans le hall, ça faisait bizarre d’entendre du français.
#2
#3
Black et mortifère
mouais
#4
Une idée du projet en question ?
(merci)
#5
Et pour le p2p non marchand, il comptent faire comment ?
 " />
" />
Obliger tout le monde à installer W10 pour que les mouchards intégrés détectent les tipiakeurs ?
#6
Malheureusement non, je n’ai pas de contact avec ceux qui s’occupent de ça, je suis cantonné au service informatique. Après peut etre qu’ils veulent juste apprendre à rembourser la redevance copie privé comme on le fait de ce coté des Alpes (on peut toujours rever)
Mais oui, il y a un projet de prévu entre nos deux pays, pour avoir entendu des bruits de couloirs ces dernières semaines
#7
Pratique, pour assécher le financement de Wikileaks par exemple ou pour dégommer en plein vol un nouvel acteur (légal) qui commencerait à faire trop d’ombre ; et bien sûr accusation, juge et bourreau confondus, c’est tellement plus efficace et pratique.
#8
Que disaient ces bruits ?
(merci encore:))
#9
ça tombe bien les consommateurs ont aussi leur liste noire entre les achetants-le-droit et leur portefeuille " />
" />
#10
En fait, ça va accélérer l’adoption des monnaies virtuelles ces pratiques.
Et à force, peut-être verra-t-on une baisse du CA des banques .
#11
Ce qui m’énerve ,c’est que nous avons ici un comportement digne des mafias d’antan …
Mais cela ne choque plus personne et surtout pas les médias actuels …
#12
je crois bien que ce sont les ayant droit qui décident de ce qu’ils leur reversent, forcement …
#13
Je ne pirate plus … mais du moment qu’ils ne sortent pas une loi nous obligeant a leur acheter leur m*s, ca ne me gène pas trop !
 " />
" />
Par contre pour le sous titre vous êtes pas un peu fatigué ? Ca se voit que l’on est dredi !
#14
Une volonté d’harmoniser certains droits. Après dans quel sens ça je ne sais pas…
#15
Evidement aucune mesure pour couper les finances des ayants droits qui abuserait des listes noires. Finalement il n’y a plus que l’arrêt de consommation de “bien culturel” qui les fera disparaitre
#16
Taper sur ces sites, c’est comme taper sur les sociétés de transport privé (UPS, GLS, DPD,…) à cause de l’utilisation qui serait faite de leur service.
#17
Petits arrangements entre acteurs privé , classique, c’est déja le cas avec paypal
#18
Et bon, du coup, vu que youtube est sûrement la plus grosse plateforme de piratage, est ce qu’ils vont couper les finances de google ? " />
" />
#19
#20
Même pas, ils se sont fait des petites rentes…
#21
(Et ce n’est pas la peine de me remercier, j’en sais pas assez pour que ce soit vraiment intéressant…)
#22
c’est donc suite à ces réunion que MasterCard ou Visa décident unilatéralement de suspendre leur services pour un site comme mediapart par exemple?
c’est beau la démocratie, la transparence, les données publiques…
#23
Passeront par des paiements par paysafe card et autres….
Puis bon pour le DDL autant prendre un bon debrideur
#24
Donc si je comprends bien ils veulent que les principaux acteurs de paiement ne travaillent plus avec certains organismes / personnes qui sont un peu trop proches du milieu du piratage. C’est légal ça ? C’est pas une espèce de justice parallèle à la vraie justice ? Et c’est soutenu par la ministre de la culture ? Bravo. C’est l’aveu de l’échec du gouvernement, une justice déléguée à des prestataires qui sont eux-même les concernés.
Moi qui pensait qu’Hadopi les occupait assez sans vraiment être dangereuse, en fait non ils ont tout compris au système. Leur avenir passe par le contournement de la justice et des gouvernements, trop lents et un peu trop respectueux des droits des citoyens.
#25
La fleur se bouge drolement le popotin quand il s’agit de tacler au portefeuille mais pour ce qui est du portemonnaie des clients, personne n’a jamais rien fait contre ces majors de l’escroquerie.
Beau gouvernement !
Si c’est pas un magnifique signe de conflit d’interet ou favoritisme ca !???
“ elus par le peuple, remercié par les entreprises ” Non mais VIREZ MOI CA !
#26
il faut voir, j’ai entendu dire qu’il y aurait aussi des magouilles dans ce secteur (pas vraiment étonnant)
perso, les bitcoins et autre, je ne fait pas confiance…
#27
Tu n’en sais peut-être pas assez mais c’est déjà pour lui un point de départ pour contacter d’autres personnes et ensuite de mener son enquête… Je pense que c’est pour ça qu’il te remercie.
(après, je ne suis pas journaliste)
#28
#29
#30
C’est ça, mais ça peut être indirect aussi : un « ami » politique pourrait demander à un AD de servir de porte-flingue, une petite erreur dans une black list est si vite arrivée (le risible signalement de l’url 127.0.0.1 par exemple).
#31
Non mais le pire, c’est que nous on suit la loi, et on rembourse ceux qui doivent etre remboursé!
#32
Dans quel sens ? XD tjrs le même, le sens qui leur convient.
#33
Oui ils remboursent… avec toute la mauvaise volonté du monde et en rasant la moitié de la forêt d’Amazonie en paperasse
#34
Nope, en quelques instants et avec une simple demande, fut elle par téléphone. Faut pas voir le mal partout hein. En France ils abusent, ailleurs ils sont un minimum honnete
#35
Ben vu qu’on est très loin d’avoir les memes abus qu’en France ici, je dis pas, faut voir comment ça évoluera. Je laisserai trainer mes oreilles à la machine à café en attendant.
#36
Sans vouloir être médisant, la directive européenne (2001/29/CE) ne parle pas de remboursement pour le professionnel mais de non assujettissement, c’est un peu différent.
#37
Autant pour moi, tu parlais de la SIAE
#38
J’ai dit un minimum. Pas complétement. Disons que c’est comme pour la TVA, techniquement un pro n’est pas assujetti, pourtant il va la payer à ses fournisseurs et se faire rembourser après parce que y à pas le temps de faire au cas par cas.
#39
#40
c’est sur que la pause café est une vraie mine d’infos, je confirme " />
" />
#41
Bah surtout quand tu bosses dans un autre service XD
#42
de l’espionnage involontaire " />
" />
#43
De toutes manières, au risque de passer pour Capt’ain Obvious, il faut bien voir que tous les efforts des gouvernements (y compris ceux qui se disent “socialistes”) et institutions européens, aujourd’hui, tendent vers une harmonie des législations. Droit du travail, retrait des monopoles d’Etat, droit bancaire, tout est modifié pour aller vers une plus grande unicité au sein de l’espace Schengen.
Seul problème, la volonté européenne ne va absolument pas dans le sens de la défense des intérêts individuels, contrairement à notre vieux système Français, fondé sur les idéaux de la Résistance. Il suffit de lire le projet ACTA pour voir ce qui va nous servir de point de référence pour le futur. L’occident est en train de se réunir petit à petit autour d’un projet transatlantique commun, avec moins d’Etat et plus de libéralisme corporatisme d’entreprise, au nom de la main soit disant invisible mais que l’on devrait voir partout.
Donc que ce soit en termes de droits d’auteur ou autres, il n’y a pas à tergiverser pendant quinze pages de commentaires : les grosses structures vont poser leur couilles sur notre nez et nous aurons tous l’air de (devinez)… Ceux qui vont s’y opposer seront marginalisés (Quadrature du Net, Next Inpact) et associés, au mieux, aux complotistes qui dénoncent le nouvel ordre mondial, au pire, à des personnes faisant le jeu des terroristes et des radicaux. Et tout çà est irrésistiblement en train de nous écraser la tronche, sans que nous puissions y faire quoi que ce soit, à part voter pour des illuminés ou des nazis, arrêter de consommer, retirer notre argent du système et payer les commerçants en capsules de bouteilles de Coca.
Mais ce n’est que mon humble estimation des évènements à venir.
#44
Avec tous les commentaires qui traîne ici, me demande si nxi sera dans la liste noire, même si elle doit l’être déjà dans celle de certains ministres et des amis de l’Hadopi. " />
" />
#45
Et bien évidement, ce sera la faute du stagiaire s’il y’a une “malencontreuse” erreur dans la liste noire.
Ni coupable, ni responsable, ni compensation en cas d’erreur. Bref comme l’usage du content-id par les AD, c’est tout benef.
Le jour où dans les réglementations, ils penseront à mettre des garde-fous (principalement et malheureusement financiers) pour les abus et erreurs (in)volontaires, peut-être que les lois et autres seront mieux respectées/utilisées/pensées.
#46
Police privée? Vous avez dit police privée? naaaan, ils n’oseraient pas.
#47
Possible que ce soit lié au projet Armonia, qui est déjà un partenariat franco-hispanico-italien pour racketter au niveau européen.
Sinon à part de la propagande je n’ai pas vu grand chose sur leur site.
#48
Il y a de la place dans ta boite? C’est bien? ^^
#49
Donc projet Armonia:http://www.anem.it/progetto-armonia/
#50
#51
Bah en tout cas y a du boulot, pour le moment le service est complet et vu la moyenne d’age les départ à la retraite c’est pas pour tout de suite ^^ Mais ma boite sinon c’est directement la SIAE
#52
C’est une possibilité, mais ça semble tourner au ralentie ce projet, donc soit ils viennent de décider de le relancer, soit c’est vraiment un truc juste transalpin, sinon je pense que y aurai eu au moins une ou deux autres société présente
#53
Perso je penche bien pour la relance du projet, en vue d’une extension européenne à terme.
 " />
" />
Merci pour le retour d’info quoi qu’il en soit ;)
Ca me tenterait bien de retourner sur Rome
#54
Pour le coup, vu que le rapport Reda a été adopté au parlement européen en juillet avec volonté de faire quelque chose et d’harmoniser, on peut aussi se dire qu’ils veulent préparer leur truc dans leur coin avant que l’Europe fasse une loi qui ira à contre (leur) sens.
Mais ce serait jouer au complotiste
#55
Autrement dit, l’état français abandonnerait aux entreprises privées ses prérogatives judiciaires.
Si j’ai bien compris le projet, les “ayant droits” seront habilitées à constater eux même les infractions et appeler leur petits copains du monde financier pour rendre la justice.
Ils décideront de la vie ou de la mort d’un acteur du web en passant complètement au dessus du pouvoir judiciaire.
Rappelons quand même que le principe de la séparation du pouvoir judiciaire est la base d’un système démocratique.
#56
La loi, c’est à la Justice de dire si un suspect la viole ou non, pas à un comité quelconque intronisé par le ministère de la culture de décider si un site Web viole la loi sur la contrefaçon.
Les ayants droit n’ont qu’à porter plainte s’il sont sûr d’eux plutôt que de demander aux intermédiaires financiers de couper les vivres à ces sites.
De plus, comme le souligne l’article de Marc, la responsabilité juridique des intermédiaires financiers peut être engagée. Ce n’est pas vraiment confortable pour eux en fait.
Qu’un membre du gouvernement pousse à une”justice privée” est un vrai problème de démocratie.
#57
Par contre pas besoin de bloquer les virements des achetants droit vers les paradis fiscaux qu’ils aiment tant, ça n’a rien à voir " />
" />
#58
Ca fait déjà un bout de temps que la privatisation de la justice est en marche, il suffit de voir ce qui se trame dans l’ACTA.
#59
#60
peut etre mais à ma connaissance, l’esprit de la dite loi ne prevoyait pas d’assimiler des biens de seconde main* à de la contrefaçon, au départ, si ? ca te convient ?
*(acquis initialement en toute legalité)
#61
#62
#63
#64
”
Cela n’a pas été suivi par le ministère de la Culture : le mécanisme
est essentiellement privé, mettant en scène plusieurs acteurs du
paiement en ligne comme l’AFMM (Association Française du Multimédia
Mobile), la FBF (Fédération Bancaire Française), le GIE cartes
bancaires, Mastercard, PayPal, Visa Europe, outre le Geste (Groupement
des Editeurs de Services en Ligne), et une armée d’ayants droit (ou
d’acteurs liés à eux). S’y ajoutent ceux issus du cinéma,
de la musique et du jeu vidéo : l’Alpa, l’association de lutte contre
la piraterie audiovisuelle, le SNE (syndicat de l’édition), la SACEL, la
SCPP (majors du disque), la SPPF (producteurs indépendants), le SNJV
(syndicat du jeu vidéo).
« Cet engagement conjoint est la garantie d’une plus grande
efficience de la lutte contre le piratage commercial. Le mode de
gouvernance du comité de suivi allie souplesse et durée, et donc
adaptabilité de notre riposte » poursuit Fleur Pellerin, avant d’esquisser son prochain plan de bataille : « Il
s’agit désormais de progresser sur le chemin du signalement et du
retrait des œuvres exploitées illégalement, par l’intermédiaire d’outils
technologiques efficaces et performants. Il en existe et je travaille
aujourd’hui avec le CNC pour que les producteurs s’en saisissent plus
massivement. »
Cela s’appelle du fascisme: obliger des personnes privées à rompre leurs relations contractuelles sans intervention d’une autorité administrative ou judiciaire est exorbitant du droit commun. C’est dans la continuité de la loi sur le renseignement: atteinte inadmissible contre les droits des personnes sans passer par les procédures adéquates. Fascisme.
#65
Mais y a pas de sanction financière ou pénal, juste un arrêt de contrat sans perte pour la banque. Tant qu’il n’y aura pas de loi interdisant cette close, ils font ce qu’ils veulent.
#66
Je ne pense pas que le code civil soit de cet avis (article 1315 en particulier) :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
#67
Le p2p et la bonne vieille mule ont encore de l’avenir !
#68
Oh la belle milice que voilà.
#69
Il va être urgent d’organiser la séparation de l’Entreprise et de l’Ëtat.
#70