Rien ne va plus aux États-Unis : cette nuit, à minuit, plusieurs mesures du Patriot Act sont devenues inopérantes du fait de l’absence d’un consensus chez les sénateurs américains. Les forces de l’ordre et les agences de renseignement ne peuvent plus se servir en particulier de la collecte massive des métadonnées téléphoniques. Pourtant, la situation n’est sans doute que temporaire.
Des sénateurs dans l'impasse
Comme nous le rappelions la semaine dernière, plusieurs points de certaines lois votées après les attentats du 11 septembre soutiennent à eux seuls une grande partie de la collecte massive de données, qu’il s’agisse des métadonnées téléphoniques sur le sol américain (Section 215 du Patriot Act) ou des informations dans le reste du monde, surtout quand elles sont hébergées sur des serveurs américains (Section 702 du FISA).
Mais au cœur du Sénat, le projet de loi Freedom Act crée de nombreux remous. Porté par la Maison Blanche, il revoit le fonctionnement du renseignement sur deux points particuliers : la collecte des métadonnées téléphoniques et la possibilité pour les entreprises concernées de communiquer de manière plus riche avec les clients sur les requêtes d’informations. La NSA par exemple ne récupèrerait plus directement les métadonnées et elle en devrait en demander l’accès aux opérateurs, via des demandes précises et motivées, attribuées au cas par cas.
Le vide entre le Freedom Act et les autorisations manquantes
Le problème est que le Freedom Act divise très largement. Le Sénat est en majorité entre les mains des républicains, qui font nettement obstacle au texte proposé par Barack Obama. Mais même au sein de cette majorité, le projet divise car il remet directement en cause le fonctionnement de la collecte de masse de certaines données. Or, certains sénateurs rejettent cette collecte et le Freedom Act, d’autres veulent la poursuivre tout en acceptant le projet de loi, d’autres encore rejettent tout en bloc, sans parler de ceux qui aimeraient maintenir le statu quo : laisser en place les mécanismes actuels.
Sauf que ces derniers ne sont justement plus actifs. Depuis minuit, la collecte de masse ne peut plus fonctionner car les sénateurs, coincés entre les autorisations à renouveler notamment pour la Section 2015 du Patriot Act et le Freedom Act, n’ont pas trouvé de consensus. Conséquences, ni le projet de loi de Barack Obama ni les autorisations n’ont été signés. Les États-Unis se trouvent donc dans une zone vide où le renseignement, sur certains points, doit à nouveau travailler avec les outils dont il disposait avant les attentats du 11 septembre.
Cela signifie-t-il que la collecte de masse est définitivement terminée aux États-Unis ? Non. Le Sénat est actuellement dans une impasse, mais il y aura nécessairement une décision prise. Si le Freedom Act est une nouvelle fois rejeté (il a été adopté par la Chambre des représentants, mais déjà repoussé deux fois par les sénateurs), il devra y avoir décision sur les processus de collecte.
« Nos océans ne nous protègent plus comme ils pouvaient le faire il y a un siècle »
Le sénateur républicain Rand Paul est particulièrement actif pour que les autorisations données jusqu’à présent ne soient pas renouvelées. Candidat aux élections présidentielles de l’année prochaine, il ne veut ni de l’ancien système, ni du nouveau. Et le flou qui règne entre les deux est copieusement critiqué, tant par la Maison Blanche que par le monde du renseignement et les forces de l’ordre.
Joshua Earnest, responsable de la presse à la Maison Blanche, pointe ainsi un comportement « irresponsable » du Sénat. Il remarque que le Freedom Act s’avance doucement vers une acceptation, mais demande aux sénateurs de « mettre de côté leurs motivations partisanes » et « d’agir rapidement ». Mike Lee, un sénateur républicain qui milite pour le Freedom Act estime qu’il « est très, très fâcheux » que le Sénat n’ait pas pu décider : « Nous savions que cette date arrivait depuis quatre ans. Quatre ans. Et je pense qu’il est inexcusable que nous ayons ajourné ».
Mais les critiques les plus acerbes viennent de ceux-là mêmes dont le travail est désormais rendu plus complexe par le vide juridique. John Brennan, directeur de la CIA, est clair à ce sujet : « Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre maintenant. Parce que si vous regardez les attaques terroristes terrifiantes et la violence perpétrée sur l’ensemble de la planète, nous avons besoin de garder notre pays en sécurité, et nos océans ne nous protègent plus comme ils pouvaient le faire il y a un siècle ». Puisqu’il est question de peur, le directeur ajoute que des groupes tels que Daech suivent ces développements « avec beaucoup d’attention » et qu’ils cherchent à tirer profit de cette situation. Il accuse également certains d’avoir trop politisé le débat et de ne pas vouloir face à ces questions essentiellement pratiques.
Un Freedom Act qui devrait finir par passer
Le plus probable désormais est que le Freedom Act finisse par être voté. Les sénateurs sont parfaitement conscients que l’opinion publique est désormais bien plus au fait des problématiques de sécurité et de vie privée, après bientôt deux années entières de révélations issues des documents dérobés à la NSA par Edward Snowden. Renouveler les autorisations pour quatre ans, surtout pour la Section 215 du Patriot Act, fait sans doute craindre une punition par les urnes.
Le problème est que le Freedom Act, dont on peut juger d’ailleurs le nom curieux, ne fait pas consensus, loin de là. Une partie des sénateurs estime que le travail de collecte peut rester entre les mains de la NSA, qui travaillera ainsi plus efficacement. D’autres pensent au contraire que les bases de données doivent être gérées par les opérateurs de téléphonie et que les forces de l’ordre, dans leur globalité, doivent n’obtenir que ce dont elles ont réellement besoin dans le cadre d’une enquête. Mais même ce point fait débat, car la durée prévue pour la sauvegarde des métadonnées, à savoir cinq ans, est jugée insuffisante par certains.





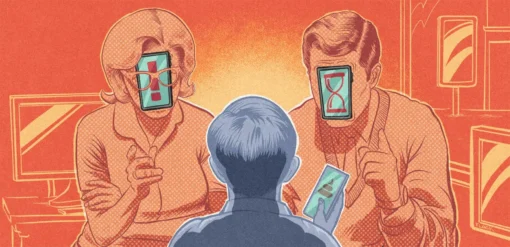

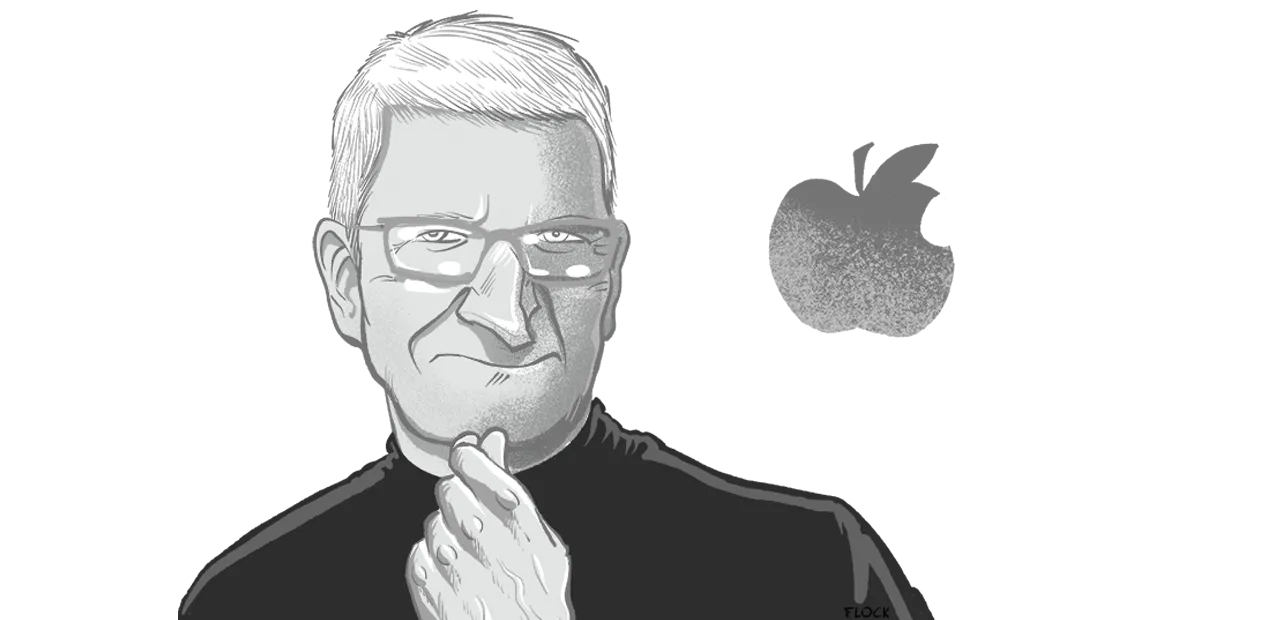
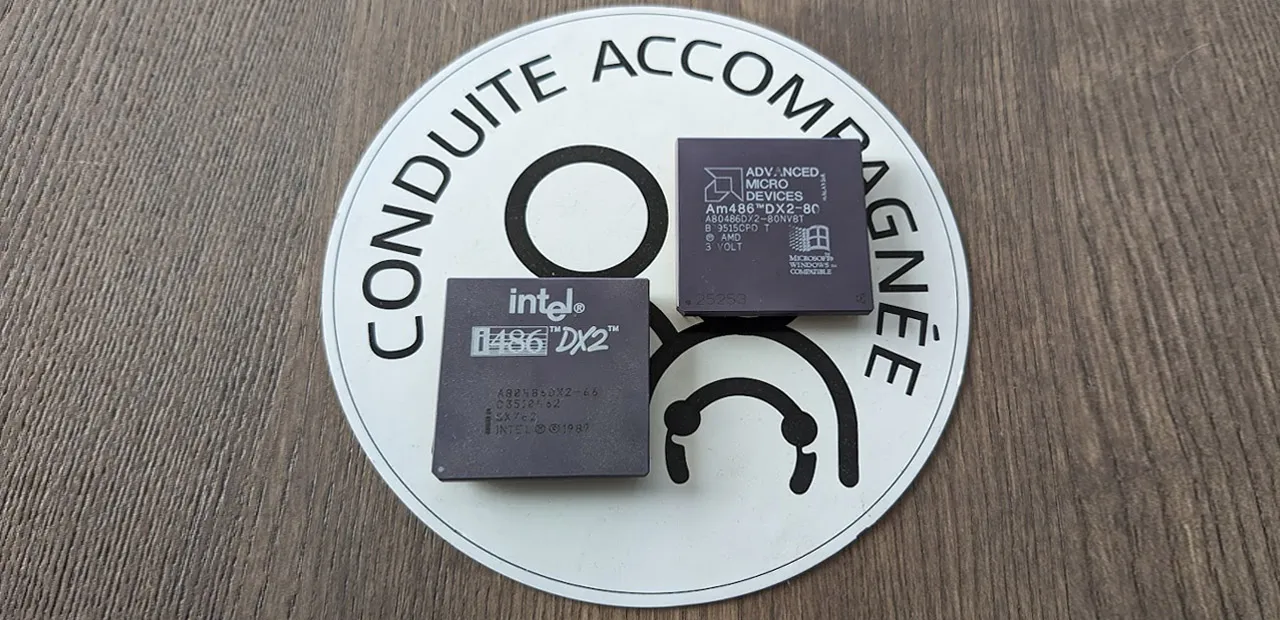
Commentaires (27)
#1
Pas mal le directeur de la CIA… “laissez nous vous espionner h24 sinon daech va organiser des attaques terroristes terrifiantes”…..
 " />
" />
Bref, ayez confiance, nous ne voulons que votre bien……..
Edit : vu comme ça, on pourrait presque se demander si daech n’est pas une sous structure de la CIA pour justifier la surveillance ^^
#2
terroristes
#3
Cet énorme brassage de vent… Les métadonnée téléphonique ne représente qu’un millionième de ce qu’ils capturent. Ils pourraient reconstituer ce qui leur manque par ce biais à l’aide de leurs milliers de programmes actif connus et inconnus, donc total bullshit.
Ils cherchent seulement à bloquer toute initiative de contrôle de leurs services ou de leur marge de manœuvre avec toujours la même technique : la peur. Mais concrètement je pense qu’ils s’en foutent, ils veulent juste faire rentrer dans le crâne de tous le monde que c’est un mal nécessaire et que c’est normal.
#4
Le patriot act, tout comme notre fameuse “loi renseignement” a été un loi faite “à chaud” et sous le coup de l’émotion. Et comme toujours, ce type de décisions revient à prendre un bazooka pour tuer une fourmi, et tant pis pour les dommages collatéraux (à savoir les citoyens et leurs libertés).
Si je comprends bien le Freedom Act, il s’agit d’une loi ayant eu le bénéfice de la réflexion “à froid” et qui redonne la juste mesure de la nécessité d’espionner tout un chacun.
Evidemment, la NSA qui avait les pleins pouvoirs pour espionner tout le monde, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, n’est pas contente de voir ses pouvoirs diminuer. Quelle horreur, devoir motiver ses demandes !!!
Bref, Wait and see, et d’ici 15 ans en France, on arrivera peut être à abroger la loi pourrie de Valls (et j’espère bien qu’il sera tenu comme responsable, tout comme Flamby)
#5
#6
#7
#8
Avec une claymore " />
" />
#9
Le plus probable désormais est que le Freedom Act finisse par être voté. Les sénateurs sont parfaitement conscients que l’opinion publique est désormais bien plus au fait des problématiques de sécurité et de vie privée
On pourrait même croire que les sénateurs font exprès de retarder l’adoption du texte, pour laisser croire aux électeurs qu’ils ont un cas de conscience: “Bah, vous voyez, c’est pas si simple. On a pesé le pour et le contre, et puis finalement on a choisi la sécurité”…
Mais les critiques les plus acerbes viennent de ceux-là mêmes dont le travail est désormais rendu plus complexe par le vide juridique. John Brennan, directeur de la CIA, est clair à ce sujet.
“Bon, ca suffit maintenant !! Rendez-nous nos jouets !!”
#10
“Freedom act”…
Pour un truc qui justement enlève toute liberté…
On voit l’importance de la com’ de nos jours.
#11
#12
Avec cela la nsa sera comptant :
 " />
" /> " />
" /> " />
" />
http://pro.clubic.com/entreprises/google/actualite-768566-levis-google.html
#13
Les États-Unis se trouvent donc dans une zone vide où le renseignement, sur certains points, doit à nouveau travailler avec les outils dont il disposait avant les attentats du 11 septembre.
Ca, c’est la théorie. On a bien vu que, même avant les autorisation, ils utilisaient ces outils. Alors le fait que maintenant il n’ont plus cette autorisation… Ahem. Ils ont toujours les accès…
#14
Avec tout ce qu’il y aurait à graver, ils ressembleraient tous au mec dans Book of Blood the Clive Barker…
#15
De la novlangue dans le texte, USA = Océania? " />
" />
#16
“le Freedom Act, dont on peut juger d’ailleurs le nom curieux”
C’est toute la beauté de la Novlangue américaine.
#17
#18
#19
#20
#21
Et d’ici quelques jours, aura-t-on droit à “On a r’trouvé les tuyaux !” ? " />
" />
#22
#23
Tout dépend de la police en fait, la deuxième a tendance à écrire en gras police 72, ce qui n’est pas très simple à déchiffrer sur un front " />
" />
#24
#25
Je ne sais plus qui (Cazeneuve) avait dit en interview que le projet était en réflexion depuis un moment déjà et ne tombait pas du ciel suite à l’attentat sur Charlie Hebdo.
De mon point de vue, ça a juste servi d’accélérateur et de buff pour le consensus…
#26
Je suis prêt à parier que la NSA continue sa collecte comme elle le faisait hier. Et dans quelques mois, quand tout aura été renouvelé et qu’on apprendra qu’ils n’ont pas arrêté, elle nous dira « ben oui mais on protège le pays des méchants terroristes, et puis on n’arrête pas tout ça d’un claquement de doigt, et puis on n’était pas au courant qu’il fallait arrêter, et puis de toute façon on vous emmerde et on fait ce qu’on veut ».
#27