Dans un récent arrêt, la cour administrative d’appel de Paris a raboté quelque peu le droit à indemnisation des opérateurs. Lorsque ceux-ci se retrouvent confrontés aux demandes de communication de Bercy, ils doivent se faire une raison : ces demandes peuvent devenir une charge normale pesant sur les acteurs des télécoms.
Dans un arrêt de mai 2012, la cour administrative d’appel de Paris avait accordé 1,35 million d’euros à France Télécom-Orange. Le litige concernait le droit de communication de l’administration fiscale sur les données détenues par les opérateurs. Un gisement qui permet à Bercy de nourrir ses enquêtes afin d’optimiser la récolte fiscale. Le fisc avait cependant rechigné à indemniser Orange pour ses demandes émises entre 2004 et 2007, au motif qu’aucun texte n’avait prévu la moindre indemnisation pour ce concours sur cette période, pas même le contrat initialement passé avec l’opérateur visant à fluidifier ces échanges.
La justice répondra au contraire qu’« en l'absence de dispositions législatives autorisant le pouvoir réglementaire à définir de manière unilatérale un mécanisme de compensation financière, il appartenait à l'administration fiscale de prendre toutes dispositions, notamment par la voie de conventions, afin d'assurer aux opérateurs de communications électroniques une juste rémunération de leurs prestations accomplies pour le compte de l'administration fiscale ». Les magistrats s’étaient alors appuyés sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2000 (paragraphe 41) qui pose le principe « d'une juste rémunération » des opérateurs pour les aides apportées aux activités menées par l'État, tendant à la sauvegarde de l'ordre public.
Le droit de communication peut devenir une charge normale chez les opérateurs
Trois ans plus tard, la même cour administrative d’appel de Paris a subtilement changé de fusil d’épaule, il faut dire qu'un arrêt du Conseil d'Etat est depuis passé par là. Les faits sont un peu différents (période de 2008 à 2011), mais les acteurs restent les mêmes, tout comme la scène, à savoir le droit de communication. En novembre 2013, donc, face aux désormais légendaires réticences du ministère, le tribunal administratif de Paris condamnait en toute logique l’État à verser cette fois à Orange plus de 700 000 euros, sans compter les intérêts moratoires.
Saisie par Bercy, la cour administrative d’appel a, dans son arrêt du 20 avril 2015, rappelé que le silence d'une loi « ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices ». Cependant, gros pépin pour Orange : nécessairement inspirée par le Conseil d'Etat, elle a illico réservé ce droit à indemnisation au seul préjudice « excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation [et qui] revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent ». Et là, c’est le drame : les juges embrayent, hache à la main : ils considèrent que le préjudice résultant de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale « ne présente pas un caractère spécial », et n’a donc pas être indemnisé pour le cas présent.
Orange opposera vainement que ces demandes vont lui asséner une série de coûts notamment en personnel, « il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre du droit de communication se traduirait, pour la société intimée par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de lui être imposée dans l'intérêt général », lui répond la cour. Bref, circulez, l’obligation de répondre au droit de communication devient ici une charge normale. Orange aura beau presser, elle n’obtiendra pas la moindre goutte d’indemnisation. Une note salée joliment sucrée.
Quels effets sur le projet de loi sur le renseignement ?
Cette décision, pointée par le juriste Alexandre Archambault, pourrait fermer solidement les porte-monnaies lors du déploiement de la future loi sur le renseignement. Actuellement examinée au Sénat, le texte industrialise en effet ces impératifs administratifs sur les épaules des opérateurs.
Or, si l’article D 98-7 IV du CPCE prévoit un principe d’indemnisation via une convention pour certains frais d’investissement et de maintenance, et à l'acte pour les demandes individuelles, le flou risque donc d'être artistique sur ces derniers frais de fonctionnement. D’ailleurs, l’ARCEP elle-même avait tiqué sur ce versant financier : « Si les textes prévoient que les opérateurs doivent être indemnisés des surcoûts spécifiques exposés pour répondre à ces différentes demandes, les opérateurs rencontrent parfois avec certaines autorités administratives des difficultés dans le paiement des sommes correspondantes ». Dans son avis sur le fameux projet de loi, l’autorité de régulation invitait alors le gouvernement « à veiller à l’indemnisation rapide et homogène des surcoûts exposés par les opérateurs ». Un espoir à l'avenir incertain.






















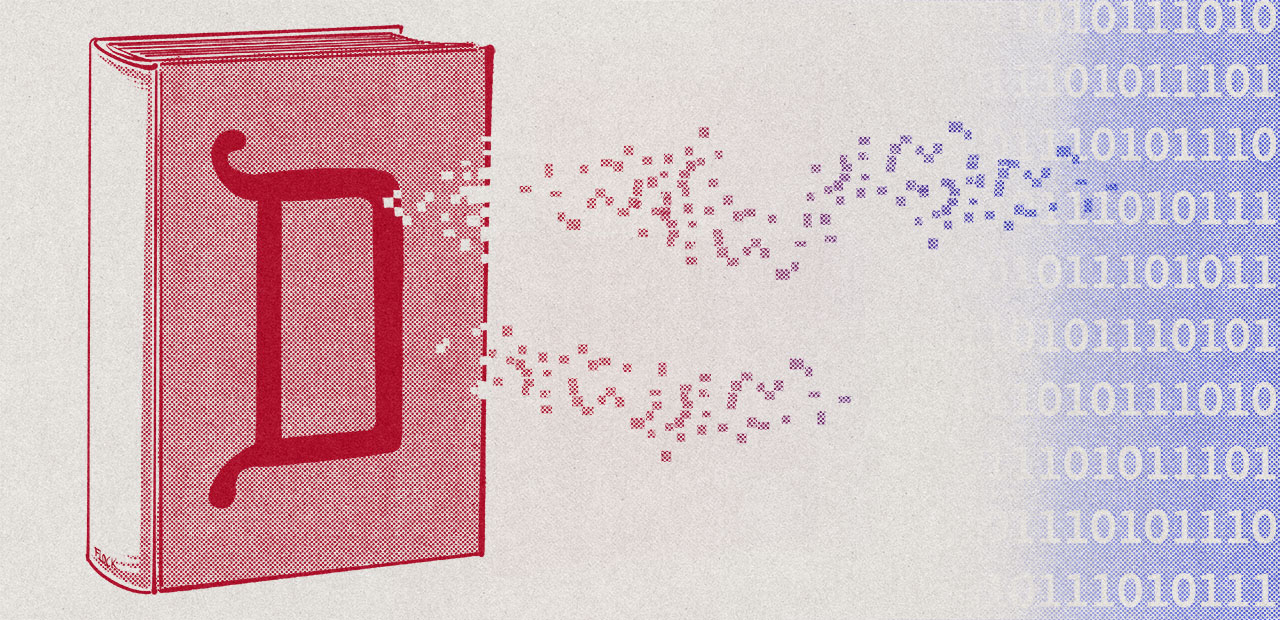
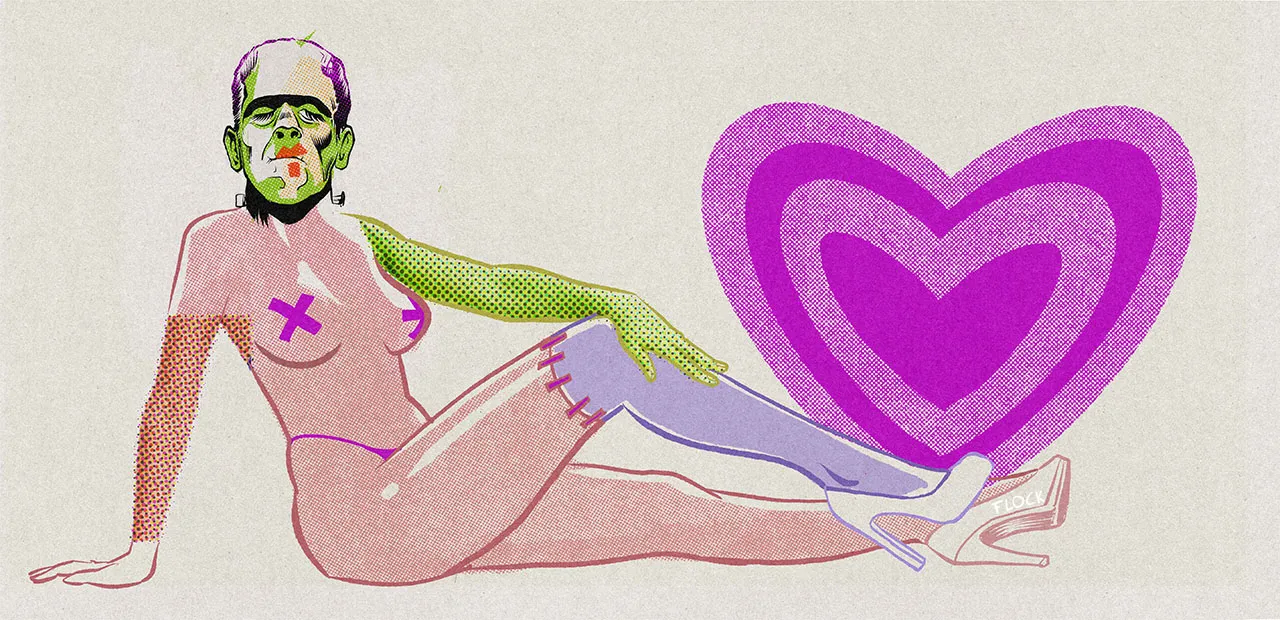
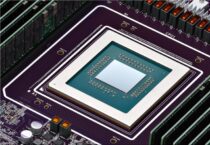






Commentaires (22)
#1
Orange opposera vainement que ces demandes vont lui asséner une série de coûts notamment en personnel
Ils n’ont qu’à minimiser ces coûts en personnel en n’affectant qu’un personne à mi-temps.
Après, ils font comme avec Google : si vous voulez un tuyau plus gros pour traiter vos demandes, vous payez.
#2
Comme pour Hadopi, ils dégainerons une loi.
#3
T’inquiètes, ils sont déjà blindés de ce côté là avec des amendes assez salées par jour de retard et par demande.
#4
Hein ?
#5
Quelqu’un peut m’expliquer ou me donner 1 ou 2 exemples ou le fisc aurait besoin des services d’Orange ou de Free ou de SFR ?
la justice je peux comprendre , la police , Hadopi , aussi mais le fisc ?
Merci d’avance
#6
Ils ont un service d’enquêtes sur les fraudes.
http://www.lefigaro.fr/impots/2013/12/06/05003-20131206ARTFIG00440-comment-le-fi…
#7
Ok merci
en fait en lisant un peu plus lentement , c’est peut-être pas que le fisc mais les administrations en général
Merci
#8
C’est pas grave, on paiera, comme d’habitude, soupirs.
#9
Doit être le seul service de police ou l’objectif de faire du chiffre est clairement annoncé.
#10
“En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts.”
De Benjamin Franklin.
Bonus : “Les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs.”
#11
Héhé dans le cul la balayette.
Ce qui est surtout fou c’est le retournement de veste de la cour administrative d’appel entre les deux.
Qui a versé du pognon à qui ? Non parce que pour statuer aussi diamétralement sur un même sujet il y a forcément eu des caranbouilles en arrière-cuisine…
#12
#13
Ça juste pris plus longtemps que je le croyais, mais ils ont bien sorti cela de leur carton.
Il fallait être vraiment naïf (ou sot) pour croire que seuls les intéressés par ces “outils” auraient mis la main au porte-feuille.
#14
C’est Hadopi qui doit être content : l’ardoise s’alourdissait, pouff un coup de baguette magique, maintenant ils vont pouvoir dire que leurs demandes deviennent “normales” et donc plus besoin d’indemnité aux FAI.
 " />
" />
Le FAI, le meilleur service de renseignement de l’Etat (et comme c’est un service rendu à l’Etat, donc au peule, c’est normal que ce soit le peuple qui paie : CQFD).
Merci pour votre compréhension, vous pouvez retourner travailler pour gagner laborieusement votre salaire afin de con-sommer. Merci pour nous
#15
Easy,
Je suggère aux opérateurs de rajouter une ligne sur leur facture comme il l’on déjà fait avec les “1 euros ” de coût pour les service télévisuels.
Ils créent une ligne : “ frais pour que l’administration puisse accéder à vos données individuelles/personnelles” avec un montant forfaitaire, et voila!
Une publicité magnifique sur le sujet, ce qui en résulterait peut être, serait une prise de conscience des consommateurs à plus ou moyen cours terme. En deux mots, ce serait d’afficher un impôt “déguisé” car noyé dans les coûts opérateurs à la vue de tout le monde.
#16
#17
Si les opérateurs ne mettent qu’une personne à mi-temps, les demandes ne seront pas traitées dans les temps.
Du coup l’opérateur se prendra une amende.
Ils ne peuvent donc pas faire pression là-dessus.
#18
À ma connaissance, cela s’applique uniquement pour HADOPI et dans ce cas, c’est hautement automatisé, donc ne nécessite pas de traitement humain.
Dans les autres cas, rien n’est prévu en terme d’amende.
#19
Hum, c’est vrai que je trouve rien dans le texte de loi ainsi que dans ceux relatifs.
Je croyais que l’amende existait pour tous ces cas.
#20
#21
Au moins La Mort et toujours à l’heure, jamais de retard. " />
" />
#22