Le projet de loi sur le terrorisme continue de susciter des vagues. Après le Conseil national du numérique, le syndicat de la magistrature dénonce dans une longue note cette future législation d’exception.
Que ce soit le Conseil national du numérique ou la Commission des libertés numériques à l’Assemblée nationale, beaucoup se sont pour l’instant concentrés sur un seul article du projet de loi de Bernard Cazeneuve : l’article 9 qui instaure en effet un blocage administratif contre les sites faisant l’apologie du terrorisme.
Cette focalisation est une erreur puisque dans ses grandes lignes, ce texte va nettement plus loin. Il compte déployer tout un arsenal pour lutter contre le terrorisme.
Il n’y a pas que le blocage administratif des sites
Par exemple sera qualifié pénalement de « terrorisme » le fait de détenir, transporter ou diffuser en ligne le plan de fabrication d’une bombe. De même, le projet institue un nouveau délit, celui de la préparation individuelle d’actes de terrorisme qui permettra de punir « les loups solitaires », du moins « le fait de rechercher [sur un moteur, par exemple, NDLR], de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ».
Une simple recherche sur Google ne suffira pas puisqu’il faudra démontrer en plus l’intention de troubler gravement l'ordre public « par l'intimidation ou la terreur ». Le projet veut tout autant faciliter les perquisitions dans les nuages ou la mise au clair des données, tout en musclant la répression contre le piratage informatique et permettre la captation à distance du son et des images…
Le temps politique de l’urgence et de l’exception permanente
Dans une longue note, le Syndicat de la Magistrature (SM) s’est ému de ce nouveau wagon accroché au train des législations d’exception : « c’est le propre de la politique antiterroriste, en France et ailleurs, que de s’inscrire dans un temps politique de l’urgence et de l’exception permanente. Derrière l’apparence d’un respect de la légalité et l’adoption d’un arsenal souvent validé par le Conseil constitutionnel, s’effectue en réalité une érosion des garanties de la procédure pénale instaurant dans notre droit comme dans les pratiques policières et judiciaires des poches « d’exceptionnalisme », sans cesse étoffées depuis 25 ans ».
Une position également défendue par la Cour européenne des droits de l’Homme qui répète qu’au nom de la lutte contre le terrorisme, les États ne peuvent voter tout et n’importe quoi, quand bien même ils jugeraient ces mesures « appropriées. »
Pour le Syndicat de la Magistrature, le piège de ces législations d’exception – déjà une quinzaine en France – est d’être aiguillonné dans un débat politique qui « force le consensus ». Cependant, il n’est jamais bon que de tels textes puissent être sécrétés dans « l’urgence, l’émotion et la peur », d’autant que sont en jeu d’autres droits et libertés fondamentales.

Assimiler des revendications sociales au terrorisme
Il pointe tout autant du doigt l’article 4 du projet de loi qui va basculer du droit de la presse au Code pénal, les délits de provocation aux actes de terrorisme et leur apologie. Un choix qui n’est pas neutre, répond le SM : chapeautées par le droit de la presse, ces dispositions bénéficient « d’un régime protecteur destiné à protéger les citoyens contre une ingérence abusive de l’État ou de tiers dans la liberté d’expression, cette liberté fondamentale dont l’abus est d’appréciation complexe. »
Par ce transfert dans le code pénal, les personnes soupçonnées pourront dire adieu aux garanties procédurales particulières dont elles pouvaient jusqu’alors bénéficier : les autorités pourront en effet mener à bien des saisies, profiter de la comparution immédiate ou encore de prescription allongée. Il existe pourtant un risque : celui de « l’assimilation à des actes de terrorisme de certains écrits revendicatifs de contestation sociale de l’ordre établi. »
Une législation d’anticipation, un droit de la dangerosité
Autre chose : plusieurs articles du projet de loi du gouvernement veulent punir une série d’actes au plus tôt. Pour le SM, « vouloir sanctionner ces faits en eux-mêmes procède de cette logique d’intervention précoce - sinon hâtive - alors même que la réalité de l’intention terroriste et de la menace sont très complexes à établir. À vouloir intervenir trop tôt, le droit pénal se meut en un droit de la dangerosité, incompatible avec notre État de droit ». Dans cette logique, l’article 5 disions-nous permettra de punir « le fait de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. »
Une législation d’anticipation puisque « derrière le vocable « rechercher » pourront se nicher de simples recherches sur internet ou consultation de sites. Encore une fois, on veut saisir des faits avant même le commencement d’exécution juridiquement requis pour établir la tentative d’une infraction. Au risque de pénaliser ce qui n’est encore que des intentions - d’ailleurs bien difficiles à caractériser - et d’incarcérer « préventivement » des personnes que rien ne permettra juridiquement de condamner, tant les éléments seront faibles ».
Un cheval de Troie pour des pouvoirs accrus de l’administration
Sur le blocage administratif, le SM estime que « l’antiterrorisme [est le] cheval de Troie de l’accroissement dangereux des pouvoirs « préventifs » de l’administration ». Le ministère de l’Intérieur « se voit ainsi confier le rôle de dire ce qu’il est licite de penser et de dire ». Certes un magistrat sera là pour épauler son travail dans l’établissement et la mise à jour des sites à bloquer, mais cette intervention n’est « qu’un leurre » puisque « ce magistrat n’est pas décisionnaire » (on pourra à ce titre relire les positions du ministère de l'Intérieur).
De même, « l’étude d’impact justifie ce choix d’une compétence par le délai d’intervention d’un juge judiciaire. Alors même qu’il est libre de fixer un délai court s’imposant au juge, le législateur est mal fondé à invoquer cet argument pour privilégier une procédure insuffisamment respectueuse des droits. »
Le Syndicat de la magistrature rappelle au contraire que le blocage possède à la fois des effets de bord - des contenus licites vont se retrouver touchés – et des trous puisque les stratégies de contournement sont simples.
Autre chose, cette législation d’exception est appelée à « contaminer » le droit commun. En témoigne notamment l’article 12 du projet de loi qui va plus sévèrement punir les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD). En effet, contre eux pourra être appliqué le régime spécifique de la criminalité organisée.
« Cette disposition ne cible en réalité pas les actes à visées terroristes mais conduira sans nul doute à la surpénalisation des nouvelles formes de contestation de l’ordre social. Il est ainsi bon de rappeler qu’en France, l’une des rares « attaques » informatiques en 2012 a consisté dans le blocage par quelques personnes des sites internet d’EDF dans le cadre d’une campagne de protestation contre l’énergie nucléaire, sous l’égide du mouvement Anonymous. »






















Commentaires (74)
#1
On découvre un pouvoir dont l’arsenal répressif se renforce au fur et à mesure qu’il perd en légitimité. Ce n’est pas sans rappeler la période prè révolutionnaire. Le pire c’est que ce sont le lois mêmes censées protéger le système qui le tire vers la tombe.
#2
#3
Et ça se dit gouvernement de gauche…
#4
#5
Il devient dangereux d’exprimer son opinion. Nul ne sait qui pourra vous reprocher quelque chose et avoir un levier pour vous condamner.
#6
Si ca à fonctionné pour les Americains, pourquoi pas en France… " />
" />
#7
Tout est dit.
 " /> recevront ce qu’ils méritent sans que le peuple n’en fasse les frais.
" /> recevront ce qu’ils méritent sans que le peuple n’en fasse les frais.
Les dirigeants ne sont pas idiots, ils savent parfaitement ce qu’ils font.
J’espère de tout cœur que ces
#8
Cette proposition de loi est vraiment une horreur.
 " />
" />
 " />)
" />)
Rien que le fait de punir « le fait de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » permet de faire condamner n’importe qui.
Acheter de la javel, des couverts, une voiture ou encore n’importe quel objet du quotidien revient à “se procurer des objets de nature à créer un danger pour autrui”.
Même une baguette de pain peut être un danger pour autrui
(Il est vrai qu’on ne compte plus les meurtres à coup de mie de pain. Une véritable épidémie…
Bref, on a là une loi fourre-tout qui permettra surtout de faire condamner des personnes gênantes (opposants politiques, syndicats ou encore patrons faisant jouer la concurrence (je pense à un certain X.N qui, si la loi avait existé en 2010, aurait subi les foudres d’un certain président fortement ami avec un de ses concurrents).
La pire loi pour favoriser l’arbitraire et la corruption
#9
#10
Déjà qu’avec les lois ‘anti-terroriste’ actuelles il y a des abus, la ça va être un vrai massacre. Les étapes précédentes du projet de démocratie policière étant passé très facilement, je doute qu’il y ait de vrai problème à faire passer ceux la.
#11
#12
Qu’ils aillent se faire enculer. " />
" />
Edit : le jours où la France sera totalement pourrie par toutes ses lois, on ira chez nos voisins Suisses, qui eux, ne pondent pas des lois sans l’avis du peuple.
#13
#14
#15
#16
#17
De toute façon soit on veut de la sécurité soit de la liberté, c’est un mélange des deux reste à voir ce que la population est capable d’accepter en terme de privation de liberté pour avoir un niveau de sécurité.
#18
#19
L’oligarchie sent bien qu’elle perd la soumission du peuple à sa fable de la “liberté, égalité, fraternité”, et met en place une police qui tuera dans l’œuf toute rébellion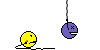 " />
" />
#20
#21
#22
#23
De mon point de vue, il me semble que ces personnes font état de troubles mentaux et devraient être démises de leurs fonctions.
#24
C’est beau de critiquer.
 " />
" />
Mais quand vos enfants deviendrons terroristes après s’être fait violés par des nazis, on en reparlera
#25
Un peuple près à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finira par perdre les deux.
Benjamin Franklin
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
Le jour ou wikipedia et google seront en panne, je serais ou trouver des miroirs.
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
Donc tous les lycées et étudiants en chimies seront considérés comme des terroristes des qu’ils vont chercher certains cours ?
 " />
" />
Allez dredi petites recettes :
NaCl + Fe + Al
ou sucre + NaClO3
#53
#54
#55
#56
My 2 cents:
L’existence d’un réseau de communication informatique mondial n’est pas, à elle seule, une excuse suffisante pour ignorer ou forger des lois.
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
Bin ils ont oublié les pédonazis!
 " />
" />
#68
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9⁄10500472_313685812134633_5589392168741282432_n.jpg
#69
Par exemple sera qualifié pénalement de « terrorisme » le fait de détenir, transporter ou diffuser en ligne le plan de fabrication d’une bombe.
tu pètes dans la rue, en moins de deux t’es plaqué au sol et menotté
#70
pouvoirs préventifs de l’administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_d’%C3%8…
#71
Par exemple sera qualifié pénalement de « terrorisme » le fait de détenir, transporter ou diffuser en ligne le plan de fabrication d’une bombe. De même, le projet institue un nouveau délit, celui de la préparation individuelle d’actes de terrorisme qui permettra de punir « les loups solitaires », du moins « le fait de rechercher [sur un moteur, par exemple, NDLR], de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ».
Donc, seul les états auront le droit de faire du terrorisme à coups de bombes et de drones au doux nom de la démocratie (entendez par là mettre la main sur les richesses d’un pays qui ne peut se défendre) ?
Un loup solitaire c’est quoi ? Un type qui a mis la main sur une magouille politique grave ? Son stylo sera une “bombe terroriste” ?
Donc, si je recherche sur la Toile le moyen de comprendre comment on fabrique une bombe A, ce sera assimilé à du terrorisme ? Et le fait d’avoir bombardé la Libye pour les compte des copains de la haute finance et des banques, c’est quoi ? Ah, c’est de la “démocratie”…
On voit que les socialos ne peuvent s’empêcher de faire comme le fit le régime stalinien : “si vous êtes libre, ce n’est pas parce que vous êtes innocent mais parce que nous avons mal fait notre travail”.
Quant à la droite, elle ne vaut pas mieux sur ses désirs dictatoriaux.
Alors, tous ces salauds peuvent montrer du doigt le FN, en ce moment, sans l’avoir mis dans leurs programme, ils font PIRE !
#72
Le projet de loi
Déclaration des droits de l’homme 1789
extrait :
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.
c’est le ou” qui change toute la donne, “et” serait plus démocratique
#73
#74