Votée en décembre 2013, la loi anti-pourriel (C-28) vient d'entrer officiellement en vigueur aujourd'hui mardi 1er juillet. Cette loi n'est pas anodine puisqu'elle force toutes les entreprises opérant au Canada à obtenir un « consentement exprès » de la part des internautes pour leur envoyer des courriels ou encore des SMS. Il faut de plus fournir un mécanisme de désabonnement. Les médias locaux indiquent toutefois que de nombreuses entreprises ne se sont pas encore conformées à la loi.

Message envoyé par le mouvement de coopératives d'épargne et de crédit Desjardins à ses clients
« Dissuader l'envoi au Canada de pourriels sous leurs formes les plus dangereuses »
Depuis plusieurs jours, de nombreux résidents au Canada reçoivent des courriels habituels. Il ne s'agit pas de spams mais de messages expliquant rapidement la nouvelle loi tout en proposant de se désabonner pour les personnes intéressées. Il faut dire que la loi est enfin entrée en vigueur ce 1er juillet, et elle est particulièrement contraignante, ce qui n'est pas sans créer quelques remous au pays de James Cameron et Céline Dion.
Déposée en 2009 suite à de nombreuses plaintes lors des années précédentes, la loi canadienne sur la protection en ligne (C-28) a été adoptée en décembre 2010 et définitivement votée en décembre dernier. Ses objectifs sont simples : « dissuader l'envoi au Canada de pourriels sous leurs formes les plus dangereuses et trompeuses, comme l'usurpation d'identité, l'hameçonnage et les logiciels espions, et de contribuer à décourager les polluposteurs de sévir au Canada ».
Pour atteindre lesdits objectifs, le gouvernement demande aux entreprises d'obtenir le consentement de leurs clients, d'indiquer clairement leur identité (adresse postale, numéro de téléphone, etc.), un moyen simple de se désabonner et d'envoyer des messages qui ne soient « ni faux ni trompeurs ». Ces requêtes ne visent toutefois que les sociétés excerçant des activités au Canada et utilisant les emails, les SMS ou encore les médias sociaux pour communiquer avec leurs clients. Les entreprises évoluant en dehors du pays et n'ayant pas d'activités au Canada ne sont donc pas concernées, ce qui réduit déjà l'impact de la loi. Les organismes sans but lucratif et n'effectuant pas d'activités commerciales sont aussi exemptés.
Concernant le premier point, à savoir celui du consentement, il est explicitement demandé qu'il soit « exprès » et non « tacite ». La différence est de taille. Un consentement exprès implique en effet que le destinataire a donné une « indication positive ou explicite de son consentement à recevoir des messages électroniques commerciaux », tandis que le tacite n'est lié qu'à un achat, un contrat ou toute autre interaction entre l'internaute et la société. Le consentement exprès n'est d'ailleurs pas limité dans le temps, contrairement au consentement tacite qui doit normalement l'être, tout du moins si la loi est appliquée.
« Seuls 8 % des chefs de PME disent être au fait de cette loi »
La loi n'interdit donc en rien de pouvoir envoyer des messages aux internautes, mais elle appuie son doigt sur l'accord de ces derniers. Selon Les Affaires, la plupart des PME n'ont toujours pas agit pour s'adapter à la nouvelle loi. Pire encore, la plupart des entrepreneurs ne sont de toute façon même pas au courant. Au Québec, « seuls 8 % des chefs de PME disent être au fait de cette loi et des obligations qui en découlent et 68 % affirment ne pas avoir encore entrepris d’actions pour s’y conformer » explique ainsi la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).
Les conséquences peuvent pourtant être lourdes. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) précise ainsi que si la violation de la loi n'implique pas automatiquement de sanctions et peut consister en de simples avertissements, il peut néanmoins infliger une amende jusqu'à 1 million de dollars pour les particuliers, et même jusqu'à 10 millions de dollars pour les entreprises.
Bonne nouvelle toutefois pour les personnes et entreprises encore non conformes à la loi, elles disposent encore de trois ans (trente-six mois) pour s'adapter. « Les tribunaux civils ne pourront être saisis » des violations de la loi avant juillet 2017 indique ainsi le site gouvernemental Combattre Le Pourriel. Ce site peut aussi servir afin de signaler les spams via le Centre de Notification des Pourriels (CNP).
Une loi qui entraine... plus de spams
Notez enfin que d'après La Presse Canadienne, cette loi a eu de drôles d'effets secondaires. De nombreux internautes canadiens reçoivent depuis plusieurs jours plus d'emails qu'auparavant, justement afin de demander leur confirmation. « La quantité de pourriels que je reçois parce que les polluposteurs réagissent à la nouvelle loi anti-pourriel pour réduire les pourriels est pire qu'avant » a par exemple indiqué Emmett Macfarlane, professeur de sciences politiques à l'Université de Waterloo (Ontario). Sur Twitter, les réactions sont d'ailleurs importantes.
@simon_forgues C'est drôle, je reçois encore plus de pourriels ces derniers jours et j'ai hâte de voir après... Je suis amusée un brin 😉
— Cindy Cinnamon (@Cindy_Cinnamon) 1 Juillet 2014
Je reçois des courriels de compagies demandant la permission de continuer á m'envoyer leurs #pourriels Haha! #merciloiantipourriels
— michel jean (@micheljean5) 30 Juin 2014

























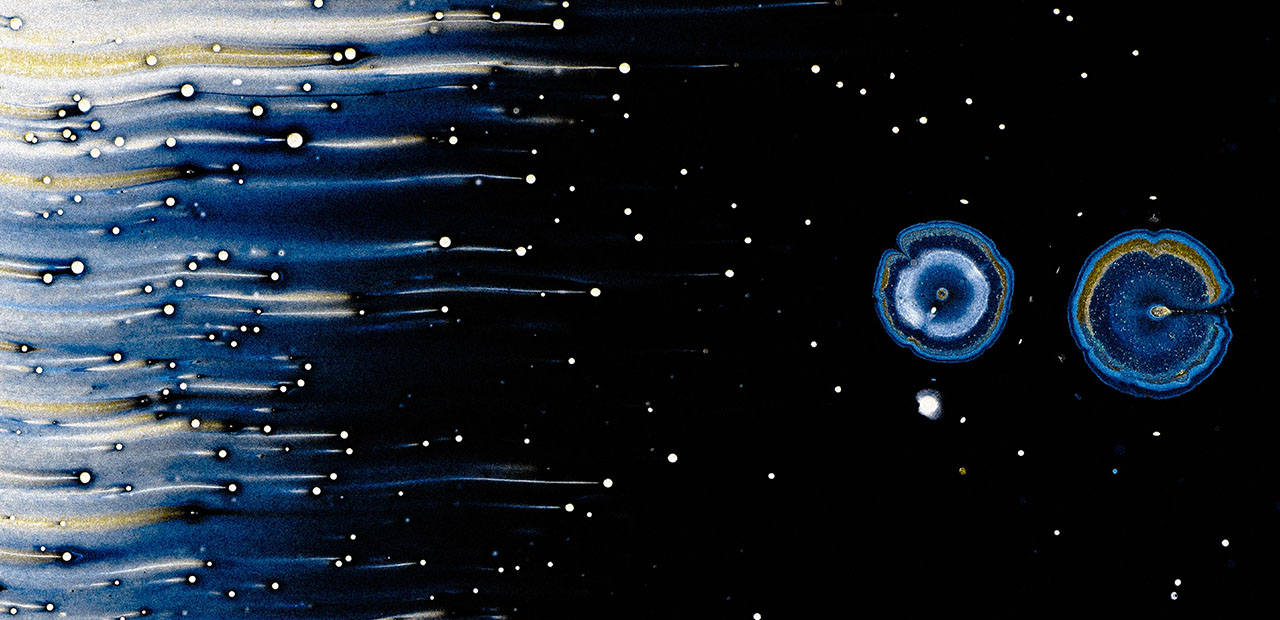


Commentaires (15)
#1
Vivement la même chose en France " />
" />
 " />
" />
Par contre, la première photo n’illustre-t-elle pas une utilisation contraire à cette loi ? L’utilisateur se voit proposer un désabonnement explicite plutôt qu’un abonnement explicite
#2
Et pour le papier, on a quelque chose ?
 " /> Elle n’a pas encore de filtre anti spam.. Vais acheter un pitbull tiens…
" /> Elle n’a pas encore de filtre anti spam.. Vais acheter un pitbull tiens…
Ma boite aux lettres est gavée, malgré mon petit écriteau “pas de pub”
#3
#4
Cool c’est un super moyen pour les spammeurs d’obtenir des emails ‘valides’
#5
Le plus fort, c’est qu’avant tu ne donnais que ton email. Maintenant pour dire que tu acceptes de recevoir leurs courriels, c’est nom, prénom, téléphone, adresse complète des fois. Ridicule.
Jusqu’à présent pour moi, c’est 100% refus.
#6
Y a pas un arrière goût de confusion entre spam et newsletter la dedans !?
#7
La prospection commerciale par Courrier électronique
source : cnil.fr
#8
Article 13
Communications non sollicitées
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
#9
#10
#11
on imprime cet article sous forme d’un poster qu’on affiche en face de l’appart de Benoit Hamon.
Avec evidemment possibilite de signer pour lui faire pression.
#12
Depuis deux mois sur mon adresse “poubelle” je clique systématiquement comme quoi je me désinscrit. C’est vraiment efficace. Certes je dois valider mon adresse mais au moins c’est valable… (de 15 à 20 par jour, je n’en reçois qu’un de temps en temps)
 " /> , vendent ton adresse. LA POSTE par exemple si tu fais suivre ton courrier en cas de changement d’adresse, te fait payer et en plus vend ton adresse
" /> , vendent ton adresse. LA POSTE par exemple si tu fais suivre ton courrier en cas de changement d’adresse, te fait payer et en plus vend ton adresse  " /> c’est pas bien
" /> c’est pas bien
Les filtres anti spam c’est le calvaire…….. et en plus quelques fois ça bloque des vrais courriels.
Il ne faut pas s’y fier, des sites bien sur tout rapport
#13
#14
Cette loi a une chance dA’voir un impact positif, car on est au Canada. Ici en effet un petit panneau “pas de publisac”, fonctionne très bien.
Le respect des lois est un pré requis, en France c’est mort depuis bien trop longtemps.
#15
Je ne suis pas certain que cela aura beaucoup d’effet sur un spammer domicilié aux Iles Toulabatoutobou ou même aux USA puisque la majorité du spam vient de là et kissenfoot royalement … source : very old pcinpact http://www.nextinpact.com/archive/Les_Douze_Salopards_facon_spam.htm