Ceux qui téléchargent de la musique en peer-to-peer sont aussi ceux qui en achètent le plus. Voilà la conclusion de chercheurs, qui ont démontré que cette différence était d'environ 30 % en ce qui concerne par exemple les États-Unis. Autre résultat intéressant : le téléchargement n’est pas la première source de copie, mais bien les échanges dit « de proximité ».
Depuis plus d’un an, cinq chercheurs conduisent différentes études pour l’American Assembly (proche de l’université américaine de Columbia), sur le thème de « La culture de la copie aux États-Unis et en Allemagne ». Hier, ces auteurs ont publié quelques éléments relatifs à leurs travaux, s’intéressant tout particulièrement à la provenance des fichiers copiés, comme le pointe TorrentFreak.
Crédits : American Assembly
En comparant les personnes adeptes du peer-to-peer et celles qui ne le sont pas, ces chercheurs ont démontré deux choses. Un, ce sont les utilisateurs des réseaux P2P qui disposent des collections les plus importantes de musique, « de l’ordre de 37 % environ » par exemple en ce qui concerne les États-Unis. Deux, cette même catégorie d’individus est également celle qui achète le plus de musique. Comme l’indique le graphique ci-dessus, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, les internautes partageant des fichiers musicaux en P2P possèdent une plus grande collection d’œuvres achetées que les autres. Les chercheurs relèvent ainsi qu’il y a une différence « significative » de 30 % environ en ce qui concerne les américains, tandis qu’en Allemagne, ce ratio s’envole : « Les utilisateurs allemands de réseaux P2P acquièrent près de trois fois plus de musique numérique que ceux qui ne fréquentent pas les réseaux P2P », écrivent les chercheurs, tout en relativisant la portée de cette donnée à la faiblesse de leur échantillon.
Les auteurs concluent : « les plus gros pirates de fichiers musicaux sont aussi ceux qui achètent le plus de musique enregistrée ».
Une étude qui souligne à nouveau l’importance du « piratage de proximité »
Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs se sont aussi intéressés à une question : d’où proviennent les titres musicaux ? D’une manière générale, il apparaît que les acquisitions légales sont le premier moyen de constitution d’une collection musicale, quel que soit le pays et la tranche d’âge. Toutefois, contrairement à une idée reçue, les téléchargements gratuits sont loin d’être en tête. Ils sont même moins importants que les copies de fichiers réalisées depuis des titres musicaux que l’on possède déjà ou bien que des amis ou de la famille peuvent fournir.
Ce faisant, les chercheurs rejoignent plusieurs études publiées récemment, qui relativisaient justement la portée des échanges sur les réseaux P2P. Une étude interne à la RIAA, le bras armé de l’industrie musical américaine, révélée en juillet dernier, montrait ainsi que 47 % des titres musicaux avaient été acquis l'année dernière par du piratage « de proximité », c’est-à-dire par la copie d’un disque ou depuis un autre support de stockage tel qu’une clé USB ou un disque dur externe. Le P2P ne comptait quant à lui que pour 15 %, et 4 % pour les hébergeurs de fichiers.
Toujours en juillet 2012, des chercheurs du M@rsouin observaient quant à eux une montée du piratage dit « de proximité » en France (étude complète disponible ici en PDF). Les résultats de leurs enquêtes indiquaient alors que « 43 % des internautes [français] utilisent ce moyen pour acquérir de la musique ». Que ce soit grâce à des disques durs, des clés USB ou même par téléphone portable, les auteurs de cette étude décrivaient cette pratique comme étant le « moyen le plus sur, le plus efficace, mais également le plus répandu pour acquérir des contenus illégaux ».
*M@rsouin : Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages d’Internet.





















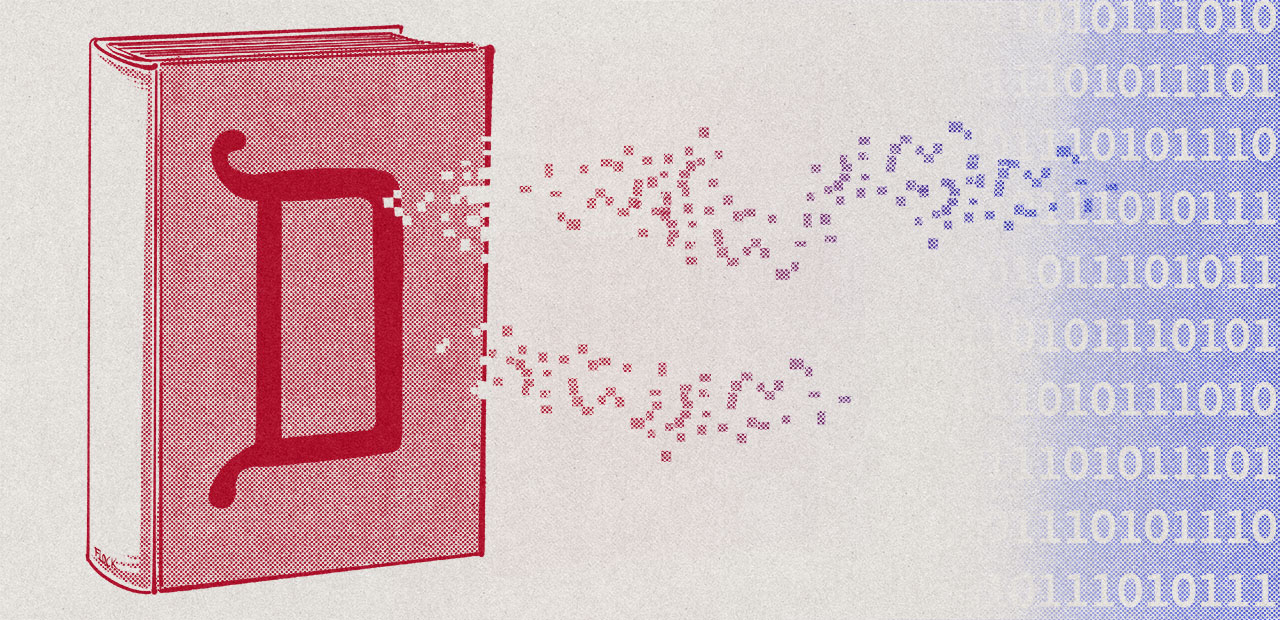
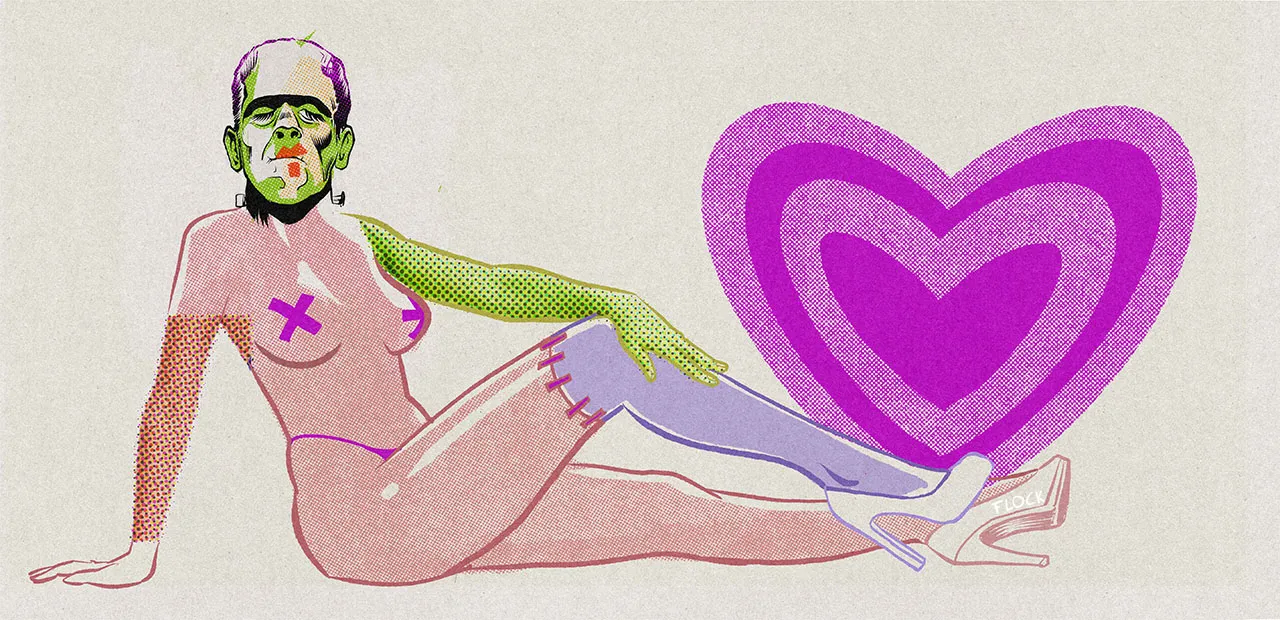
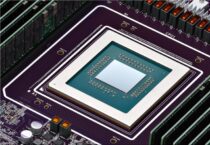






Commentaires (72)
#1
Ben ça alors, quelle surprise !
Ce qui amène au fait que l’industrie du disque à beaucoup à perdre avec cette répression à outrance.
#2
En gros, ceux qui sont les plus intéressés par la musique en achètent plus… c’est pas mal comme résultat d’étude!
#3
Petit cadeau aux INpactiens, ainsi qu’aux modos…
 " />
" /> " />
" /> " />
" /> " />
" /> " />
" />
Sinon, ben, on a un autre son de cloche avec des arguments sensés. Et la confirmation que les Hadopi-likes ne servent à rien…
#4
Quand ils auront compris que rien ne pourra arrêter le piratage. C’est à eux de s’adapter à la nouvelle donne.
D’autant plus que toutes les taxes qu’ils imposent (même quand on ne pirate pas), rendent pour les gens légitime le fait de pirater (après tout, j’ai payé).
Mais bon, ils défendent leur trésor, ça peut se comprendre. Dommage qu’ils n’évoluent pas dans leur façon de penser.
#5
Oui, cela tend à montrer qu’Hadopi ne sert presque à rien, mais cela donne aussi du grain à moudre aux partisans de la taxe pour copie privée. Un raisonnement du genre: “les gens utilisent beaucoup leurs DD, clés usb & co pour échanger de la musique gratos, et cela doit être taxé”…
Dans tous les cas, ils (lobbys musicaux, hadopistes) ont une corde à leur arc…
#6
#7
c’est quoi cette étude a la mord-moi-le-noeud " />
" />
#8
“Blablablabalba! j’ai rien entendu ! c’est une étude de spice de docteurs fous pirates pédo-nazi , leur arguments sont faussés par le malin pour nous conduire vers l’anarchie et les enfers! “
#9
#10
#11
Il aurait été INtéressant de savoir si les utilisateurs P2P vont plus souvent aux concerts que les autres, histoire d’enfoncer un peu plus le clou " />
" />
 " />
" />
Par contre, ils indiquent eux mêmes que leur échantillon est limité, les ayants droit risquent d’être les premiers à dire que les résultat sont bidons
#12
Une petite pensée pour Rascal Pègre. " />
" />
#13
#14
#15
#16
Beer-to-beer
Je comprends enfin l’augmentation des taxes sur la bière : c’est pour lutter contre le piratage de proximité !
Le lobby des ayants droit est partout !
#17
#18
La seule question à se poser afin de savoir si l’étude est scientifiquement valable :
 " />
" />
Est-ce que le panel de “pirates” a été nourri au maïs OGM ?
#19
Ce n’est pas la première étude qui arrive à cette conclusion & ça n’a rien de surprenant.
Le noyau dur du p2p, les 10% d’utilisateurs qui à eux seuls générent 90% des téléchargements, ce sont des passionés de musiques/films/jeux & forcément ils sont aussi parmi ceux qui sont prêt à mettre le plus d’argent dans cette passion..
Le problème ce n’est pas “oh mon dieu des gens osent télécharger les oeuvres de mes artistes sans payer”, c’est comment rendre l’achat de musique en ligne aussi pratique que le p2p, en particulier pour toute une partie du catalogue qui n’est pas disponible dans le commerce.
#20
Faudrait savoir …
Procès de wwww.mania.fr :
Me Moriceau a contesté « les demandes indemnitaires des majors qui reposent sur l’idée que chaque film téléchargé correspond au prix d’une place de cinéma ou à l’achat d’un DVD ». Or, selon lui, « les gens qui téléchargent ne vont pas au cinéma ni n’achètent de DVD ». Il estime ainsi que le montant des dommages et intérêts « ne correspond pas à la réalité »
Donc quand ça arrange, les pirates achètent, et quand ça dérange, les pirates quoi qu’il arrive, n’achètent pas ^^
#21
#22
C ‘est dit et répété mais tout le monde se torche le cul avec ces études.
Qu’il l ‘ envoie à Lescure et Hadopi !
#23
#24
oliv5 a écrit :
Oui, cela tend à montrer qu’Hadopi ne sert presque à rien, mais cela donne aussi du grain à moudre aux partisans de la taxe pour copie privée. Un raisonnement du genre: “les gens utilisent beaucoup leurs DD, clés usb & co pour échanger de la musique gratos, et cela doit être taxé”…
Dans tous les cas, ils (lobbys musicaux, hadopistes) ont une corde à leur arc…
Oui et non, car s’ils se servent de cela pour justifier une hausse de la taxe copie privée c’est aussi confirmer que cette taxe sert aussi de dédommagement au piratage. Sauf que là c’est la porte ouverte à une licence globale.
et non, puisque les sages ont dit, qu’ils ne fallaient pas tenir compte du piratage dans le calcul de la taxe copie privée.
#25
#26
et hop une etude pour ca… y a vraiment des mecs qui font des supers etudes !
perso je pirate pas la musique, je l’achete pas non plus ! vu ce qu’on nous sert, c’est meme pas la peine !
#27
#28
S’ils veulent stopper le piratage, qu’ils arrêtent de donner des raisons valables de le faire.
quand un label bloque un artiste à toute diffusion hors de son pays d’origine, ça n’incite pas à la légalité.
Et après on ne se tape que des conneries de musique folklorique en rayon musique du monde…
#29
Les auteurs concluent : « les plus gros pirates de fichiers musicaux sont aussi ceux qui achètent le plus de musique enregistrée ».
Je ne vois pas ce que vous avez du mal à comprendre dans cette phrase ?
#30
#31
#32
#33
#34
Question d’interprétation.
Si les P2Pistes achètent plus que les autres, c’est parce qu’ils sont plus passionés de musique.
Par contre, quelle seraient leurs achats sans P2P ?
#35
#36
#37
On en revient au problème du droit d’auteur et de ses extensions… alors que le client doit être propriétaire de son produit acheté légalement (taxes comprises), doit pouvoir le revendre unitairement ou le donner gratuitement.
 " />
" />
#38
Je pensais pas qu’il y en avait tant que ça qui rippaient eux-même leurs CDs :)
C’est quand-même abusé le prix des MP3s/FLACs/etc… qui ne baisse jamais alors que celui des CDs baisse régulièrement et tombe vers les 10 euros (voire moins) au bout d’un an après sa sortie.
#39
bah une étude qui ne sortira jamais du cercles des “initiés”
c’est comme le cannabis : on prend que les études qui nous arranges et on coupe volontairement pour faire peur :
cannabis provoque une perte du Q.I
vraie phrase : cannabis fumée pendant la jeunesse engendre une perte du Q.I
sinon pas mal l’étude mais il me semble que c’est pas la première qui montre cela.
#40
#41
depuis le temps qu’on le répète..
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
Je l’imite bien hein ? " />
" />
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
“Ici, être adepte de P2P implique d’acheter plus de musique en moyenne que les autres. ”
Sauf que personne ne sait si c’est pas “acheter plus de musique” qui implique “être adepte du P2P”
#58
#59
#60
#61
#62
#63
ne pas confondre correlation et causalité
#64
Et il faudrait peut-être aussi leur expliquer que le type qui pirate des albums de musique ou des films ne les auraient pas obligatoirement achetés, et ne devraient donc pas être considérés comme des pertes monétaires par l’industrie.
#65
#66
#67
#68
#69
Moi j’écoute mon QI IQ, acheté légalement et physiquement " />
" />
 " />, et j’ai plus d’un QI IQ légal
" />, et j’ai plus d’un QI IQ légal  " />
" />  " />
" /> " />
" />
#70
#71
#72
[quote:4307382:CanalGuada]
 " />
" />
Ou de regarder la télévision, écouter la radio en ligne ou pas. Et alors ?
Ce sont les acquisitions de titres musicaux et leur provenance qui sont étudiées ici pour déterminer l’impact du “piratage”, pas les modes de consommation.
===
tu ne peux pas comparer la télévision la radio et le streaming.
le streaming est un service d’écoute a la demande comme l’est le p2p
sauf que c’ets parfaitement légale. tu peux écouter de la musique avec deezer ou sur youtube . apartir de la si tu es passionné de zic tu n’as pas besoin de trainer sur p2p
si par la suite tu traines sur p2p . alors de deux choses l’une c’est pour telecharger de la musique illégalement
c’est pour graver des albums illégalement, pas pour acheter
sinon comme tu dis si on a pas internet il existe la radio et la télévision et bien entendu les cd qu’on a acheté.
==
Tu contredis l’étude, soit. Des arguments, c’est mieux.
============
non je ne ne la contredis pas.
les gens ne téléchargent certainement pas pour acheter .
======
Pour savoir qui est “passionné” ou pas, faut déjà commencer par comparer la taille de la collection de musique. Il n’y a pas d’autre solution. À part ton doigt levé ?
=======
pas vraiment non, je suis un passionné de musique ,j’ai seulement deux cd chez moi
(que je nécoute jamais)
=======
Oui et donc ? Parmi l’ensemble des “pirates” qui téléchargent via P2P, il y a en aussi certainement beaucoup qui n’achètent pas beaucoup de titres.
====
et donc?
et bien forcément celui qui ne s’intéressent pas du tout a la musique, n’achetera pas de cd et il ne risque pas non plus de pirater de la musique. faut déja etre un consommateur de musique a la base.
a partir de la c’est pas comparable. c’est comme si je creais une etude en disant que 99% piratesde mp3 ne portent pas de patins a glaces .
par rapport aux amateurs de patinage
=======
Ça tombe bien, c’était précisément de voir l’impact de ces “terroristes du piratage” sur le nombre de titres achetés, finalement quand même plus important en moyenne que chez les autres, qui était intéressant.
========
que les amateurs de musique consomment plus de cd que ceux qui ne sont pas amateurs .non c’est pas intéressant. on a juste deux profils de consommateurs différents. le mieux cest de comparer avec un fan de musique qui ne telecharge pas.on verra de suite l’impact du p2p sur la vente d’album. on verra si ce la change les habitudes et les consommations.
et on se rendrait vite compte qu’il existe aussi ceux qui écoutent de la musique sur le net sans téléchargersans graver et que ceux la onttrois possibilités: payer/ acheter ou pirater. ou ne pas consommer.
et puis apres il suffit de controler les achats de ceux qui écoutent de la musique sans pirater et ceux qui écoutent de la musique en piratant
=========
Et si tu te plains que ceux qui n’écoutent pas de musique sont aussi pris en compte, le résumé de l’étude sur son site précise que la comparaison P2P vs non-P2P est faite parmi ceux qui s’intéresse à la musique puisque disposant d’une collection significative.
=========
pas vraiment en regardant le tableau, onmontre seulement que ceux qui téléchargent ont plus de cd. par rapport a ceux qui ne téléchargent pas.mais ca ne veut pas dire que les non p2p sont de fans de musique.
========
======
Certes dans l’absolu, mais dans ce cas très précis, il faut au moins démontrer :
========
c’et aux chercheurs de démontrer les conclusion de leurs etudes a partir des observations. j’ai déja dit comment. on fait des experiences, on prend les memes profils dans des conditins différents et on etudie les modes de consommations. et les comportements de chacun.
========
======
premiere version: plus on telecharge plus on achete.
seconde version, plus on achete plus on telecharge
c’est ni l’un ni l’autre
par contre il est vrai que plus les gens telechargent moins ils achetent.
pourquoi? parce qu’entre payer et graver, les gens preferent ne pas payer.
l’inverse n’est pas vrai: plus le sgens achetent moins ils téléchargent.
par ce que ceux qui achetent ne téléchargnet pas de toute facon. (pas de causalité)
et moins le gens telechargent plus ils achetent n’est pas vrai non plus
car il n’ya pas de causalité, juste correlation et encore
========
=====
tout dépend des conditions, une major raisonen en part de marché. elle s’en fout des comportements individuels.
========
========
pas de coincidences, juste des constatations et les motivations qu isont propres a chacun, apres les majors ne rperochent pas aux telechargeurs de ne pas acheter mais de mal consommer
et les majors ne s’(attaquent pas spécialement aux pirates mais aux consommateurs lambda qui voudraient pirater au lieu d’acheter la musique.
========
soit qu’à la fois acheter entraine l’utilisation du P2P et qu’utiliser le P2P provoque l’achat. Ce qui paraît à l’hypothèse la plus plausible, discréditant encore une fois le discours des majors.
========
pas de causalité directe.donc inutile de faire des généralités.tous ceux qui téléchargent n’achetent pas (au contraire) et tout ceux qui achetent ne téléchargent pas.